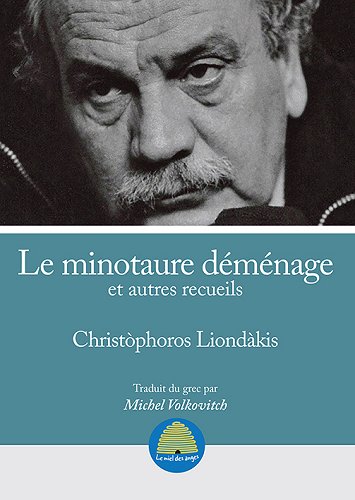
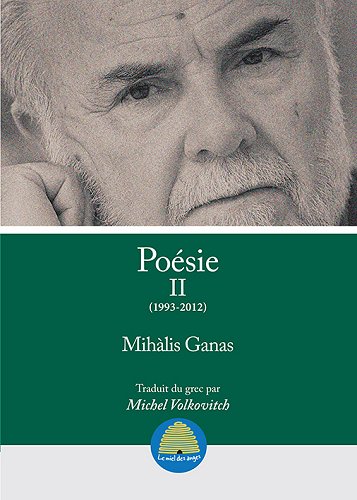
Les événements de notre passé s'éloignent peu à peu, en douceur semble-t-il, jusqu'au moment où l'on découvre qu'on ne sait comment, comme un iceberg se détachant de la banquise, ils ont basculé dans le passé.
Mes débuts en traduction par exemple, vieux de quarante ans, ont beau garder en moi des couleurs très vives, ils m'apparaissent lointains soudain, comme sortis d'un livre d'histoire. Je ne me rendais pas compte, à l'époque, de la chance que j'ai eue : être dès le départ amené à m'occuper de poésie. J'ai commencé par les poètes de mon âge, quasi quadragénaires, et ce fut là aussi une chance de connaître alors, et d'être admis à traduire, moi le novice, deux fameux bonshommes : Christòphoros Liondàkis et Mihàlis Ganas. Ils étaient déjà, pour les Grecs, parmi les plus grands poètes vivants du pays.
Je suis devenu leur ami tout de suite, et le suis resté jusqu'au bout. Je les ai rencontrés à chacun de mes voyages en Grèce et de leurs passages en France ou en Belgique, chacun d'eux étant invité en francophonie plusieurs fois. J'ai traduit leurs poèmes intégralement ou presque et les ai publiés au Miel des anges.
Leurs parcours sont parallèles : une enfance loin d'Athènes, puis, à l'âge d'homme, l'installation dans la capitale. La poésie de chacun, marquée par un profond amour de la nature, fait dialoguer un passé campagnard et un présent urbain.
Ils ne s'aimaient pas. Pourquoi, je ne l'ai jamais su. Les villages de Liondàkis le Crétois et de Ganas l'Épirote étaient aux antipodes l'un de l'autre, mais la géographie n'explique pas tout. Je ne les ai jamais vus ensemble. Ils évitaient soigneusement de mentionner le nom du confrère en ma présence et je n'ai jamais cherché à éclaircir le mystère.
Ils sont morts à cinq ans d'intervalle. Liondàkis avant le confinement, d'une maladie rare, et Ganas il y a quelques semaines, d'un cancer. J'aime leur poésie, leurs poèmes sont mes amis, mais autant que Liondàkis et Ganas j'ai aimé Christòphoros et Mihàlis. L'un plus expansif, comme sont souvent les Grecs — il s'échauffait facilement, je l'ai entendu pleurer au téléphone —, l'autre plus réservé, plus secret. Leur disparition ne m'a pas causé que du chagrin. Bien qu'ils ne soient pas partis dans leur prime jeunesse, leur départ m'a pris au dépourvu. Je ne les croyais pas immortels, bien sûr, et pourtant si, un peu. Ils faisaient depuis si longtemps partie du paysage. Chez Christòphoros, le balcon, un vrai jardin, semblait fleuri pour l'éternité, et le petit brin de basilic ou de romarin qu'il vous offrait semblait une promesse de fertilité perpétuelle. Mihàlis m'inspirait le même sentiment de paix que certains arbres. Sans leur présence tutélaire, désormais, je me sens seul comme un arbrisseau privé de ses appuis.
Avec Liondàkis, toutefois, j'ai le sentiment consolant d'une amitié pleinement vécue, et d'une fin réussie. Lors de l'ultime rencontre, peu avant la maladie finale, nous avons dîné avec d'autres dans une taverne, et en partant il m'a tendu une grande enveloppe : son dernier poème, encore inédit, qu'il me confiait pour que je le traduise. Un cadeau d'adieu, sans qu'on le sache. Et parmi tous mes souvenirs de lui, l'un d'eux s'impose étrangement. Nous sommes sur je ne sais plus quelle plage en Grèce, et pendant un court instant nous nageons ensemble. Je déteste l'eau, je me baigne tous les dix ans, et cette scène anodine a bientôt pris pour moi la dimension d'un précieux symbole : le poète et son serviteur brassant la mer immense des mots.
Si la mort de Ganas, elle, me laisse un sentiment d'inachevé, c'est que nous avons raté nos adieux. J'ai cessé de venir en Grèce à partir du confinement, lequel a plongé, dit-on, le poète dans la déprime. Je ne l'ai pas su tout de suite ; lui téléphonant, je l'ai senti bizarre, absent, et du coup je n'ai plus osé rappeler. J'avais de ses nouvelles indirectement : il allait mieux, mais pas assez mieux, puis ç'a été le cancer, l'hôpital et la fin.
Je n'ai jamais nagé avec lui, mais il m'a pris dans sa voiture un jour dans Athènes ; il avait, dans mon souvenir, une 2CV verte, et c'était un beau symbole aussi, le poète conduisant son traducteur. J'ai longtemps rêvé que nous allions tous les deux, pourquoi pas dans sa 2CV, jusqu'à son village natal, perdu dans les montagnes juste avant la frontière albanaise. C'était tout à fait improbable, mais j'ai toujours le rêve d'y aller un jour sans lui.
Là aussi, parmi tant de souvenirs, il en est un qui se détache. Après avoir correspondu, nous nous voyons pour la première fois, je crois, dans la librairie du centre d'Athènes où il travaille alors. Il discute assis au fond de la boutique avec deux autres poètes. Ses tout premiers mots : «Micel, qu'est-ce que tu nous mijotes ?»
Cela n'a l'air de rien, et pourtant ces quelques mots m'ont ravi et me ravissent encore. Il m'offrait une belle métaphore comme cadeau de bienvenue, et sans me connaître il me tutoyait d'entrée, comme si nous étions déjà compagnons de travail.
Aujourd'hui tout a changé, j'ai traduit trop de poètes, je ne rencontre plus la plupart d'entre eux ; presque toujours, désormais, ils ont l'âge que nous avions à l'époque — l'âge d'être mes enfants. Mais sache-le bien, Mihàlis : le marmiton que tu as intronisé jadis, devenu vieux, n'a toujours pas l'intention de quitter les fourneaux, et si j'ai là devant moi plusieurs casseroles où ça n'en finit pas de mijoter, c'est en grande partie grâce à toi et quelques autres, à votre confiance jadis.
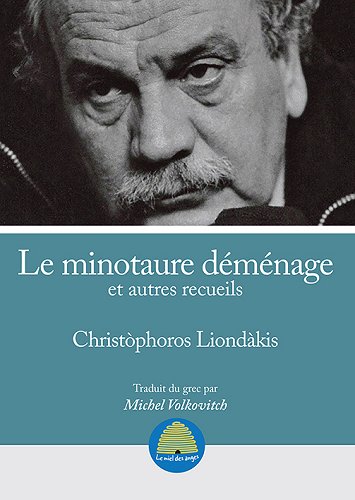 |
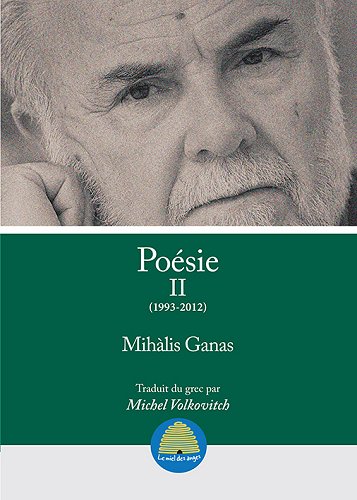 |
| Les deux rivaux... | |
(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°257 en mars 2025)