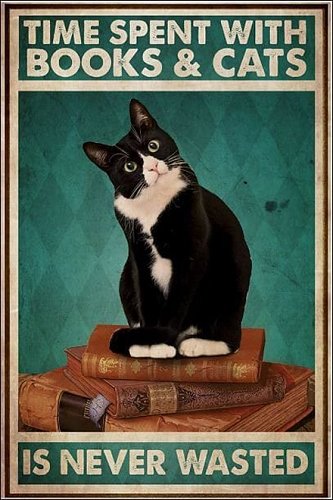
Est-il besoin...
Longtemps, je suis allé courir de bonne heure. En partant très tôt, on n'écorne pas trop la journée, on s'offre le plaisir délicat de trotter sur la chaussée tant que ces emmerdeuses de voitures dorment encore. Mais la vraie raison, c'est l'ivresse du petit jour, la lumière fraîche, le monde qui paraît tout neuf, la journée qui promet ce matin-là d'être belle. Une raison plus vraie encore : levé avant l'heure, dans les rues et les bois, je suis seul, tous ces grands espaces m'appartiennent, je fais le tour de mon domaine avant de remonter dans ma tour et d'ouvrir mes terres aux manants. En fait, certains jours, je me rends compte que non, je ne suis pas seul, que ces maisons et ces arbres sont vivants, qu'à mon passage ils m'envoient des signes et que parfois, sans autre bipède pour me rappeler à ma condition d'être humain, j'arrive à presque les déchiffrer. Et si je croise quelqu'un, qui court ou ne fait que marcher, nous nous saluons comme deux explorateurs, fraternels, avant que chacun poursuive son chemin.
Les années passent. On part plus tard, on vieillit, on ramollit. Il y a quarante ans je m'élançais à cinq heures le samedi, et voilà que je me mets en route le dimanche vers huit heures. Puis on vieillit encore, on se traîne tellement qu'on souffre d'être vu si mal en point, d'être dépassé parfois par de simples marcheurs. Les vieillards aussi ont leur fierté. Alors on recommence à se lever tôt, on retrouve peu à peu les petites heures désertes.
Un dimanche matin, cet hiver, dans les rues endormies du coteau qui mènent à Versailles en traversant Chaville puis Viroflay, je suis totalement seul. Non, pas vraiment : les chats sont là. Le premier d'entre eux sur le rebord d'une fenêtre de cuisine, en posture de sphinx, les yeux mi-clos, perdu dans je ne sais quelles pensées, remarquant mon passage, mais ne le jugeant pas digne d'attention. Puis, quelques rues plus loin, le deuxième, puis le troisième encore plus loin, chacun sur sa fenêtre, dans la même position, plongé dans une méditation identique semble-t-il, comme s'il y avait là une confrérie secrète aux membres mystérieusement, télépathiquement reliés. Alors je comprends soudain qu'à de telles heures ces lieux leur appartiennent, que je suis un intrus simplement toléré par des sages magnanimes ou tout bonnement indifférents. Je pressens qu'il n'y a pas un monde unique, mais plusieurs superposés dans le même espace, comme ici le nôtre et celui de messeigneurs les chats.
Ils ne peuvent pas ouvrir les portes, mais savent se glisser, eux, dans n'importe quel jardin ; ces jardinets de banlieue riquiqui sont pour eux des jungles somptueuses ; le froid qui m'oblige à m'agiter, pour eux c'est comme s'il n'existait pas.
J'ai l'impression de lever le coin d'un voile, d'entrevoir la vérité du monde. Je me dis que peut-être celui-ci, que nous avons bâti, que la plupart du temps nous occupons, qui semble si bien conçu pour nos déplacements, nos affairements divers, en fait nous l'avons édifié pour les chats, sans le savoir bien sûr ; qu'ils en sont les vrais maîtres, assez puissants pour nous amener à construire un monde à leur convenance, assez subtils pour nous dissimuler leur pouvoir.
Voilà bien une de ces idées idiotes nées de l'ivresse du coureur, ricane la partie de moi qui, ô tristesse, reste obstinément sobre. Et je lui réponds, qui donc nous certifie que l'ivresse est toujours dans l'erreur ? Certains humains se croient supérieurs aux animaux et même aux chats, ils se gargarisent de leur taille gigantesque, de leur aptitude à résoudre des équations mathématiques, à parler des langues pleines de mots, et que sais-je encore, mais quant à moi cette arrogance me fait un peu pitié — même si je m'abstiens de trop rabattre leur caquet à ces suprémacistes, par égard pour ces personnages complexés, fragiles au fond.
Je passe. Ce matin-là je ne lance même pas le bonjour habituel aux chats. Il ne faut pas déranger, je le sens. Je suis sur le point de quitter Viroflay, cette merveille méconnue, lieu de miracles discrets, en la remerciant de ce qu'elle vient de m'offrir, quand voici un dernier chat. En pleine rue cette fois, guère effarouché, tournant vers moi ses yeux verts. Une chatte sûrement. Le coureur, en principe, ne s'arrête guère, mais cette fois, quelques foulées plus loin, je me ravise, fais demi-tour, m'accroupis non loin de la belle et tends le bras. Un bref instant ma main la caresse, ou c'est elle qui caresse ma main, comment savoir. Puis, tranquillement, elle se détourne. Point trop n'en faut.
N'empêche, il s'est passé quelque chose. Avertie peut-être, qui sait, par les précédents veilleurs — ils ont peut-être lu mes louables pensées —, elle est chargée de me dire que j'ai réussi, du moins en partie, l'examen. Me voilà donc accepté. Promu au rang de métèque. Citoyen de deuxième classe. Sous-chat. J'en suis reconnaissant et fier, même s'il me reste à mériter de m'élever encore, en suis-je capable ?
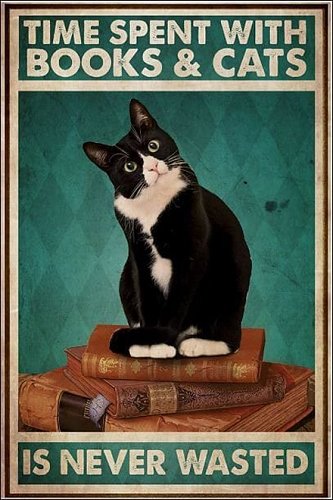 Est-il besoin... |
(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°213 en juillet 2021)