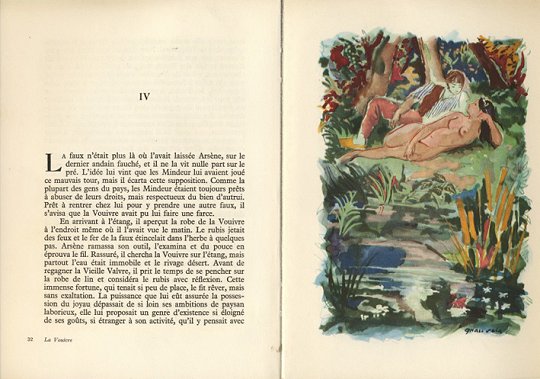
La Vouivre de Marcel Aymé.
Ai-je vraiment lu La Vouivre autrefois ? Quand la puberté m'est tombée dessus, mes parents avaient, dans leur bibliothèque pas très fournie encore, la plupart des romans de Marcel Aymé. J'en ai feuilleté alors plus d'un à la recherche des scènes coquines dont des copains m'avaient parlé. La jument verte, réputée pour sa gaillardise, s'est avérée finalement plutôt sage, mais Les tiroirs de l'inconnu m'ont offert une courte scène, entre un garçon à peine plus âgé que moi et une femme adulte, qui me troubla terriblement.
Il y avait aussi La Vouivre, bien sûr. Ce nom à lui seul donnait envie d'y aller voir, mystérieux, vibrant, voluptueux avec sa finale promesse d'ivresse, avec le triangle du v, redoublé comme dans le mot vulve que je venais de découvrir dans le dictionnaire, évoquant comme lui ce trésor caché avec ses doubles lèvres, ce graal inaccessible alors.
Picorant çà et là dans La Vouivre à la recherche des passages excitants, un peu déçu de ce point de vue, j'en ai saisi juste assez pour me faire une idée de l'histoire. Un village du Jura, deux familles ennemies, un jeune paysan qui rencontre dans la forêt la Vouivre. Cette belle créature éternellement jeune — fée ? sorcière ? déesse ? — hante les forêts, se prête aux hommes qu'elle y trouve, mais s'ils cherchent à s'emparer du bijou qu'elle porte au front, elle les fait tuer par ses serpents.
C'est l'été dernier seulement que j'ai lu La Vouivre pour de bon. Je m'attendais à une lecture sans histoire en compagnie du vieil oncle Marcel, fameux conteur dont je connais bien désormais les tours. Et je n'ai cessé d'être surpris.
C'était comme de marcher dans une forêt où l'on est passé jadis, où des sentiers connus débouchent sur des lieux étranges, et d'autres insoupçonnés rejoignent une clairière familière. Je n'avais rien vu dans ce livre jadis. C'est aujourd'hui que me frappe la forte présence du décor, son réalisme solide : ces paysans observés de près, avec leur langage savoureux, leurs activités de l'époque (1925 précisément), leurs travaux des champs d'un autre temps. Dans mes années 60, cette campagne d'avant-guerre tenait encore un peu au présent ; elle a basculé depuis dans un passé profond.
C'est aujourd'hui aussi que je remarque la finesse de touche du romancier : les êtres a priori frustes qu'il met en scène sont subtilement dépeints, parfois contradictoires, à l'image du héros, ce type un peu borné, peu sympathique le plus souvent, et tout de même attachant parfois.
Il est dépassé par ce qui lui arrive, le malheureux : la Vouivre, c'est tout le contraire de lui. C'est l'irruption du merveilleux dans ce petit monde rudement prosaïque, de la liberté dans ces existences machinales de bœufs de labour. Cette fille insaisissable, indomptable, c'est l'incarnation du paganisme, la dernière Mohicane des religions anciennes, lesquelles ne sont peut-être pas, qui sait ? tout à fait mortes. Comme elle apparaît moche à côté, la religion calculatrice, étriquée de ces villageois !
«Son corps sentait les bois, la terre, la rosée. Elle ouvrait les bras comme un arbre. La rivière passait dans ses yeux verts, et sa chevelure était noire comme la forêt qui fermait l'horizon. Sur sa peau brillaient la joie de l'été jurassien, l'innocence des bêtes du matin...»
L'oncle Aymé ne l'a pas inventée, cette Vouivre, elle court dans le folklore de sa région natale, mais il l'a enrichie, transfigurée, réinventée, estompant son côté cruel, lui donnant une fraîcheur, une candeur attendrissantes ; et lorsque vers la fin elle s'humanise, qu'elle commence à méditer vaguement sur la mort, et même, comme je la comprends ! à regretter presque son immortalité, c'est alors — j'en demande pardon à mes quelques amis fervents chrétiens — c'est alors que j'ai envie de me prosterner, non pas devant le Barbu bougon de la Bible, mais aux pieds de la jeune femme nue.
Marcel Aymé est publié en Pléiade, je l'avais complètement oublié ! J'ai même oublié que je me suis acheté naguère les trois volumes, rangés à la lettre A sur le rayon du haut, hors de portée. De toutes façons je ne pouvais faire autrement que lire La Vouivre dans l'exemplaire de mes parents, qui repose avec les restes de leur bibliothèque dans un coin perdu de la maison. Il date de 1943, un an après la parution du livre, comme le laisse voir son mauvais papier tout jauni et le vilain papier sulfurisé non moins jaune dont mes soigneux parents l'ont enveloppé alors. Ma lecture est un pèlerinage. Une étrange lecture-palimpseste, où se superposent plusieurs époques : les années 20 de l'histoire ; les années 40 de l'écriture, de l'achat du livre et de sa lecture ; mon adolescence vingt ans plus tard ; et aujourd'hui. L'étage temporel qui l'emporte étant celui de mes parents, bien sûr.
L'année où ils lisent La Vouivre est la plus sombre de la guerre. Ils viennent de se marier, de s'installer dans la grande maison, au rez-de-chaussée, dans la seule pièce alors habitable — oui, celle qui deviendra en 2018 une super cuisine ultra-moderne, on n'arrête pas le progrès. C'est là sans aucun doute qu'ils vont lire le nouveau roman de leur auteur chéri. Je ne sais lequel des deux commence — ont-ils tiré au sort ? Rudes, ces hivers de guerre, il n'y a ni bois ni charbon dans le poêle, je vois mes parents qui lisent dans le grand lit, côte à côte sous les édredons, leur haleine changée en buée par le froid, et moi aujourd'hui, qui tourne les mêmes pages à mon tour, je lis par-dessus leur épaule, je m'efforce de reconstituer leurs impressions et leurs commentaires sur le livre, mais aussi toute leur existence de ces années-là.
Elles resteront les plus dures sûrement, et les plus enchantées peut-être, de leur vie. La guerre vient de les séparer pendant dix-huit mois ; après une telle épreuve, j'imagine le bonheur des retrouvailles. Il a de quoi durer jusqu'à la mort — la suite, apparemment, le prouvera. Pour moi qui n'arriverai que cinq ans plus tard, ces terribles années de guerre sont des années de légende, étonnamment lointaines, étrangement proches, celles dont j'ai le plus la nostalgie, que je voudrais le plus visiter, invisible comme un fantôme, regardant vivre mes parents plus jeunes alors qu'aujourd'hui mes enfants, comme descendus des rares photos de ce temps-là qu'ils ont laissées, que j'ai accrochées dans l'escalier, jeunes et beaux à jamais.
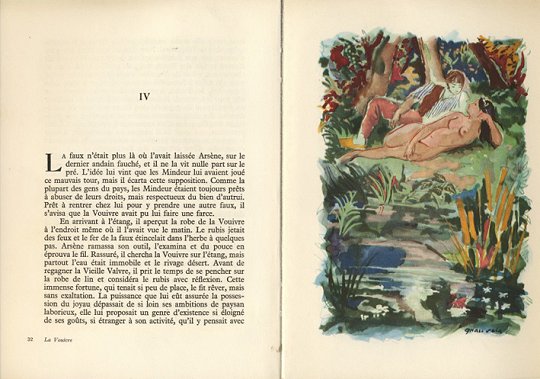 La Vouivre de Marcel Aymé. |
(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°180 en octobre 2018)