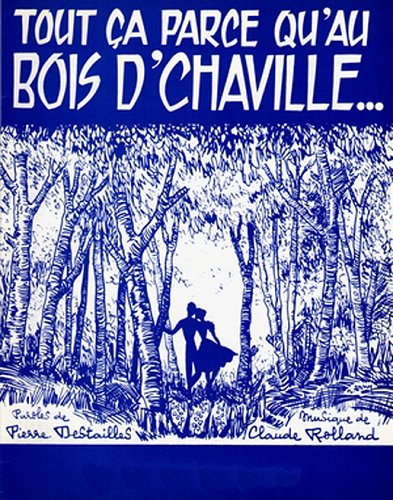
Belle chanson de 1950.
Nous râlons sans arrêt contre le froid ou le chaud, la pluie ou la sécheresse, mais en ce dimanche d'été, dans les rues de la banlieue encore endormie, qui oserait ronchonner, pour une fois ? On ne peut pas rêver temps plus doux. Le soleil cette année, souvent féroce en pareille saison, n'a pas trop joué les gros bras, il se montre par clins d'œil ce matin, derrière de beaux nuages pensifs que pousse lentement un petit vent frais qui sent la mer. 21 août, le moment sans doute le plus émouvant de l'été, l'amorce à peine visible de son déclin, le début de son automne à lui.
En attendant le retour des vacanciers, les rues presque vides encore, paysages sans personnages, cessent d'être une simple toile de fond ; les maisons reviennent au premier plan, redeviennent des êtres vivants, pour un peu elles me parleraient comme autrefois, quand nous écrivions un livre ensemble, elles et moi.
Depuis trente ans que je cours dans la banlieue de Paris, je me plais à croire que je l'ai explorée tout entière, qu'il n'y a pas la moindre de ses ruelles où je n'aie mis le pied, ce en quoi je me trompe naturellement. Il existe encore, il existera toujours des zones blanches sur ma carte, en voici une : à un carrefour de Chaville, dans la montée vers Vélizy que je connais pourtant par cœur, juste après la seconde voie ferrée, le coin de mon œil accroche l'entrée d'une rue imprévue. Droite, longue, déserte, elle est d'un calme surnaturel, son étroitesse inhabituelle et l'absence de voitures qu'elle entraîne lui donnent un petit air étrange, comme si les voitures n'existaient plus ou pas encore, et à mesure que j'avance entre ces deux rangées de maisonnettes bordées d'infimes courettes ou de minuscules jardinets, ni modernes ni anciennes, d'une mocheté paisible, tout cela m'apparaît d'une si parfaite insignifiance que je me sens peu à peu gagné par une euphorie incongrue. Un maître du zen comprendrait peut-être cette fascination du vide — même si la nudité du zen a quelque chose de bruyant, d'exubérant, d'ostentatoire à côté de cet humble fouillis suburbain, de ce palmier déplumé, de cette maison-atelier décatie aux vitres poussiéreuses, du parasol déteint sur sa mini-terrasse.
Un instant je crois que cette rue est une impasse, auquel cas elle serait sans doute la plus longue de cette famille fabuleuse — les impasses ouvrent sur le rêve, les impasses mènent aux plus profonds secrets —, mais n'en demandons pas trop, voici une rue qui la traverse. Du coup on change de nom : derrière moi, la rue Marcel Rebard à Chaville ; devant, la rue Georgette à Vélizy.
Marcel et Georgette. Des prénoms depuis longtemps disparus, plus anciens que ces maisons. Nul ne sait plus ce qu'il y avait ici au temps des Georgettes et des Marcels, voilà au moins quatre-vingts ans, et comment savoir qui étaient vraiment ce Marcel Rebard et cette Georgette-là, mais il me plaît de les imaginer à ma façon, jeunes et amoureux, un dimanche d'août, et pourquoi pas lors du plus enivrant des étés, en 1936, marchant main dans la main vers la forêt — car la forêt est là, au bout de ce qui dans sa partie finale est bel et bien une impasse, de la plus noble espèce : de celles qui tout au bout vous délivrent un laissez-passer. Une grille basse interdit l'accès aux véhicules, mais un passage étroit laisse entrer les piétons et tout de suite on est sous les arbres, dans ces légendaires bois de Chaville tant chantés, où tant de couples se sont aimés. Voilà une fin d'impasse plus parfaite encore que dans la rue Bernard-Palissy au-dessus de chez moi. La plus belle que je connaisse ?
Un sentier part sur la gauche, une pancarte nous donne son nom : Chemin des fonds du trésor. Bien vu ! Il y a un trésor dans l'histoire. Celui que j'ai cherché toutes ces années en courant les banlieues sans fin et dont j'ignore la nature, sachant seulement qu'il n'y a là ni pièces d'or ni liasses d'euros mais je ne sais quelle Belle au bois dormant immatérielle, une révélation, une illumination que je suis toujours près d'atteindre, qui m'échappera toujours et qui désormais s'éloigne avec douceur. Quel bonheur cependant de m'en sentir tout de même, encore une fois, si proche, tandis qu'au bras de son Marcel, avant de disparaître dans la forêt, Georgette se retourne et me fait de sa main légère un dernier signe.
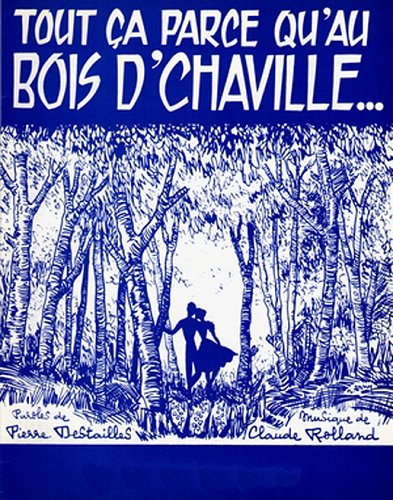 Belle chanson de 1950. |
(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°156 en septembre 2016)