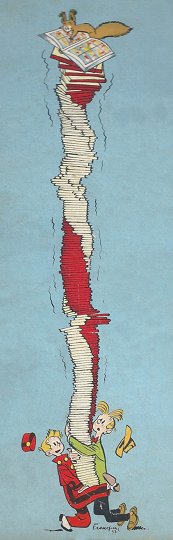
Une petite partie de notre bibliothèque...
Cela pourrait se passer en Grèce, au début des années 80, sur l'île de Lesbos. Une journée de printemps timide, peu avant Pâques. Tout en marchant dans une forêt, je lis des poèmes de Mihàlis Ganas. J'ai trente-trois ans, mon aventure grecque en est à ses premiers pas. Je ne sais pas encore qu'un jour je traduirai, puis éditerai ce petit livre entre mes mains : Μαύρα λιθάρια, Pierres noires en français. C'est la première fois que j'essaie de lire tout un recueil de poésie en grec, je bute sans arrêt sur des mots, je n'ai pas apporté de dictionnaire, chaque poème est une forêt obscure avec ici ou là des trouées de lumière, je pressens des trésors cachés dans cette poésie de Ganas et dans toute la poésie grecque, je comprends confusément que j'entre dans un nouveau royaume et qu'une nouvelle vie commence.
Oui, mais bien avant cela, pendant l'été de 1964, je suis dans un coin de campagne anglaise verte et tranquille, ô combien tranquille, et il pleut. J'ai avec moi L'idiot de Dostoïevski. Pas dans la traduction d'André Markowicz, hélas, elle n'existe pas encore, mais dans une édition du Livre de Poche en deux gros volumes. Pendant six jours je ne fais rien d'autre que lire L'idiot. Jamais je n'ai été autant plongé dans une histoire, hanté par elle, et ne le serai plus jamais. On dit qu'on «dévore un livre», mais non, c'est moi qui suis dévoré. Disons plutôt «avalé» : «dévoré» serait trop violent, s'agissant d'une histoire dont le héros, le prince Mychkine, est un ange de douceur. Ce qui me fascine, plus encore que son auteur, ce romancier génial que je découvre alors, c'est ce personnage de l'Idiot. Il devient aussitôt mon idéal, celui que je voudrais imiter à tout moment de ma vie — avant de me rendre compte, bientôt, que je ne suis pas à la hauteur.
Oui, mais la lecture primordiale, aux effets les plus profonds, les plus durables, c'est un peu plus tôt la même année. Pour le Noël de mes seize ans, j'ai reçu un somptueux cadeau : Proust dans la Pléiade, À la recherche du Temps perdu, trois volumes. Ma lecture de L'idiot, ce sera un sprint, disons un 800 mètres échevelé ; avec Proust, je cours un marathon. Pendant six mois, de janvier à juin, je ne lis rien d'autre. Je prends ma dose tous les soirs dans mon lit — longtemps, car je ne me couche plus de bonne heure —, et parfois aussi le matin au réveil, surtout lorsque la veille je me suis endormi, malgré mes efforts héroïques, en relisant une phrase aux ramifications sans fin. Car on doit sans cesse revenir en arrière, aller et venir dans la longue phrase pour tout relier, tout faire tenir ensemble, la lecture n'étant plus simplement ce long fil qu'on déroule, mais une sorte de tissage minutieux. La tâche ne me rebute pas, au contraire. Je suis bouleversé. Phrase après phrase, jour après jour, je découvre le monde. Plus tard, je ne cesserai de penser que j'ai tout appris de la vie dans le livre de cet homme dont la vie fut si étroite et médiocre. Je ne m'identifie à aucun de ses personnages, ni même au Narrateur adolescent, mais en même temps l'auteur m'est proche comme un frère. Quand je lirai M. de Balzac plus tard, je ferai partie d'un cercle d'auditeurs admiratifs face auxquels le grand homme pérore ; lisant Georges Perec, dont la moindre virgule déclenche désormais une thèse de doctorat, je me sentirai de plus en plus gêné, étouffé au milieu de cette foule savante, mais chez Proust, dont l'œuvre est pourtant l'une des plus cruellement noyées sous des déluges de commentaires, le petit lecteur de seize ans oublie tout, et le vieil homme de même, bien plus tard : Proust me parle à moi seul, à mi-voix, il a écrit tout cela rien que pour moi.
Ce serait bien de terminer là-dessus.
Oui, mais soyons honnête : le moment le plus marquant, le grand enchantement, c'est plus tôt encore, c'est le temps des premières lectures, ces histoires en images qu'on appellera BD plus tard : Le fantôme espagnol de Willy Vandersteen avec Bob et Bobette et M. Lambique, ou les aventures de Spirou et Fantasio, d'André Franquin. J'ai six ans, la petite librairie dans le bas de Sèvres expose en vitrine Il y a un sorcier à Champignac et le désir de posséder cet album est si intense que ça fait mal. En lisant ces œuvres que les gens sérieux dédaignent alors, que je relirai ensuite insatiablement, c'est la lecture que je découvre dans l'ivresse, comme quand on prend la mer pour la première fois.
Mes lectures, de Franquin jusqu'à Proust, ont un même lieu : la maison de mes parents, refuge d'une enfance et d'une adolescence passées à bouquiner, maison où j'habite à nouveau, où je finirai ma vie, où tous les volumes dont je parle ici sont présents sur l'un des nombreux murs couverts de livres du sol au plafond, étranges murailles qui protègent des violences du monde, mais du haut desquelles en même temps ce monde apparaît plus nettement que jamais, si terrible souvent et parfois si beau.
Ce texte a été commandé par la Maison des écrivains dans le cadre de l'opération Partir en livre et lu à la librairie Tschann le 25 juillet 2016. (Voir aussi les Brèves d'août 2016.)
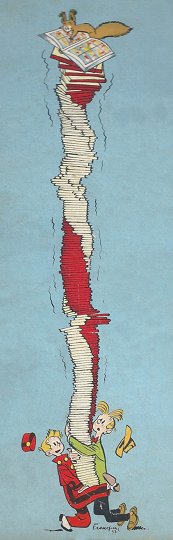 Une petite partie de notre bibliothèque... |
(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°155 en août 2016)