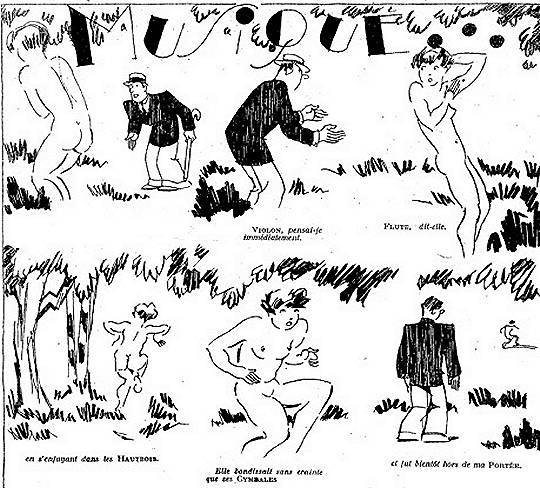
À la médiathèque du coin, sur les cinq CD auxquels j'ai droit dans le mois, j'en choisis toujours un contenant des œuvres que j'ignore. Noble curiosité, saine gourmandise ? Peut-être, mais aussi, sûrement, maniaquerie de collectionneur ou de bon élève qui ambitionne de tout savoir, et désir de frimer sur mon site en jouant les connaisseurs pointus. Je te connais, Volkovitch, comme si je t'avais fait.
L'autre jour, qu'est-ce qui m'a pris ? j'ai emporté des symphonies de Vaughan Williams ! Ce nom-là, je l'ai vu passer des dizaines de fois dans les histoires de la musique sans qu'il éveille en moi la moindre envie. À ce Ralph Vaughan Williams (1872-1958), distingué compositeur britannique, j'ai collé une fois pour toutes l'étiquette post-romantique-néo-classique, la même qu'à ses compatriotes Elgar et Delius, et m'en suis fait une image voisine de la leur, genre pépère tranquille et sirupeux.
Premier mouvement de la Sixième symphonie, qui date de 1947. Au début, il fallait s'y attendre, c'est tonitruant, ronflant, cuivré, compact, et sans audace. On dirait la musique des westerns d'autrefois, galopades et grands espaces. Pas de quoi vous inciter à écouter la suite, mais le bon élève se sermonne et continue, et là, tiens tiens, plus j'écoute plus je souhaite continuer.
La réticence du début persiste, mais au milieu des lourdeurs, des clichés, du spectaculaire facile et bruyant qui vous submergent, çà et là émergent des beautés inattendues. La matière a beau être classiquement tonale, et pas toujours originale à première vue (on entend Chostakovitch, entre autres, par endroits), la musique plus d'une fois surprend, s'écarte du chemin tracé (un peu comme chez Sibelius) et vous échappe. On remarque sans cesse davantage, dans ces vacarmes et ces virages rageurs, une insistance, une véhémence, et une angoisse qui va se répandre librement plus tard dans les mouvements lents. Un homme capable de terminer sa symphonie par un long adagio pianissimo — et d'en écrire une autre en quatre mouvements lents ! — n'est pas un vulgaire casseur d'assiettes.
Quand la musique nous plaît, elle glisse en nous voluptueusement et laisse une traînée de bonheur ; quand on la déteste, on la recrache et terminé. Mais dans les deux cas on est moins remué que par cette symphonie inclassable, mélange de grosses ficelles et de fine dentelle, où l'on est ballotté entre deux courants contraires, adhésion et rejet, dans un vertige de funambule où s'entremêlent malaise et plaisir.
Musique de film ? Peut-être, et alors ? Me revient en mémoire un cours de musique, en classe de cinquième, il y a cinquante ans. Ce bon M. Poulias nous fait écouter un morceau sans nous dire ce que c'est. Je déclare qu'on dirait «de la musique de film». Le prof est un peu choqué : il place très haut L'oiseau de feu du génial Stravinsky et sent bien ce que mon commentaire a de méprisant.
J'ai évolué depuis, autant sur Stravinsky que sur la musique de film, catégorie infiniment plus complexe que ne le croyait le petit crétin. Devenu moins raidement élitiste, je crois avoir un peu progressé. Un peu seulement. J'aimerais tant comprendre comment la musique est faite, elle a tant de choses à m'apprendre sur l'écriture des mots, sur la façon de faire avancer un texte, j'aimerais pouvoir analyser techniquement les motifs, les variations, les retours, mais rien à faire, je ne suis pas musicien, souvent je ne suis même pas foutu de reconnaître les thèmes. Je ne sais toujours pas écouter la musique — l'écouter vraiment. C'est très difficile. On doit accompagner de près son déroulement tout en reculant assez pour appréhender l'architecture. Nager dans la rivière et en même temps la contempler depuis le rivage. Un autre souvenir de lycée me revient. Cinq ans après M. Poulias, un cours de philo chez Mlle Belleuf. Elle nous raconte que pendant longtemps elle n'a pas su écouter la musique, et qu'un jour, clac, illumination, elle a tout compris.
Nous a-t-elle donné alors le mode d'emploi ? Sans doute, mais j'ai oublié ce que de toute façon je n'avais pas saisi alors. Depuis j'ai souvent rêvé à cette révélation promise. Elle me rappelle cette parole d'un de mes profs de maths : les mathématiques, souvent on n'y comprend rien, jusqu'au jour où le rideau se déchire et tout s'éclaire.
Longtemps, j'ai attendu le miracle. Côté mathématiques, le rideau était en fait une porte massive qui m'est restée toujours obstinément close, ne laissant passer que les éclats de voix de joyeux festins à l'intérieur — j'ai parlé à des matheux de haut niveau une ou deux fois et j'ai compris que leur science était pour eux pure poésie, qu'elle leur apportait ce qu'offre à d'autres la musique la plus sublime. Si j'ai longtemps gardé un tout petit peu d'espoir, c'était du côté de la musique. Quand j'ai cherché à revoir Mlle Belleuf, il n'y a pas si longtemps, je pensais surtout à lui demander la clef de ce mystère. Elle n'a pas souhaité me rencontrer. Peu après elle est morte. Pourquoi m'avoir laissé tomber, madame ?
Là aussi, j'attends devant le château ; cette fois je vois par la porte entrouverte les bienheureux convives à l'intérieur, j'entends une partie de leurs paroles, il arrive qu'on me lance une friandise, je me souviens même avoir été admis une ou deux fois sur le seuil, mais presque toujours j'attends dehors. Eh bien soit. C'est désolant, sans doute, de se sentir ainsi infirme, inférieur aux choses ; et non moins exaltant de penser à leur complexité qui nous dépasse, à toute cette beauté qu'on n'épuisera jamais.
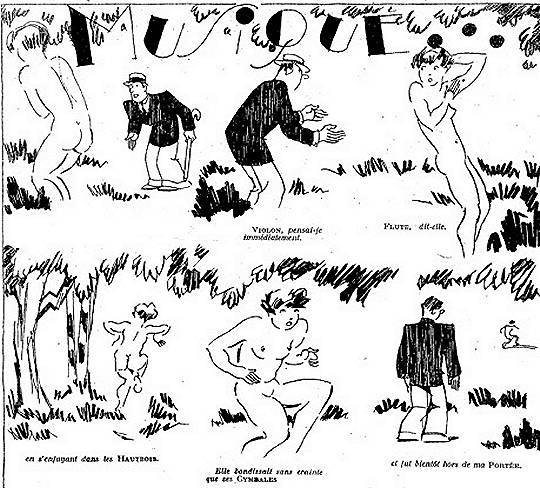 |
(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°112 en janvier 2013)