
Pier Francesco Mola, Artémis contemplant Endymion, 1660.
BRÈVES
N°112 Janvier 2013
Dieux uniques, dieux iniques ! Je les aime de moins en moins, les trois grands imposteurs, leur bonté mielleusement affichée, leur cruauté cachée derrière, ou dans le meilleur des cas leur indifférence infinie. Parallèlement je sens croître ma tendresse pour les dieux multiples d'autrefois, moins violents, plus marrants. Je me demande même si la conception polythéiste du monde, jugée naïve par les esprits forts que nous sommes, ne contiendrait pas une vérité, une sagesse perdues. «Nous ne savons plus du tout ce que c'est que les dieux» nous dit Lacan.
Voilà qu'on annonce, aux PUF, un livre intitulé Il y a des dieux ! Je cours chez mon libraire en me récitant le sonnet sublime de Nerval : «Ils reviendront, les dieux que tu pleures toujours ! Le temps va ramener l'ordre des anciens jours !»
Nous n'en sommes pas encore là. L'ouvrage de Frédérique Ildefonse, philosophe, n'est pas un hymne à Zeus et consorts, mais une réflexion ethno-philosophique à partir de phénomènes contemporains tel le candomblé d'Amérique du Sud. L'auteure oppose moins le polythéisme au monothéisme qu'au rationalisme, qui prétend tout comprendre, et qui par conséquent jette l'homme dans un monde où tout est clair, où il est libre et responsable de ses actes.
Le livre est d'un bout à l'autre une charge acharnée contre cette «frénésie de savoir» du rationalisme, et de son sous-produit jugé détestable, l'existentialisme, qui croit libérer l'homme alors que c'est le contraire : «La liberté absolue qui est aussi responsabilité absolue est une geôle», un poids écrasant. Ne pas tout comprendre, ne pas être comptable de tous nos actes, est un repos salutaire, essentiel.
Pourquoi la prière fait-elle du bien ? Elle «ne vaut pas par ce qu'elle dit», elle «ne cherche pas tant à s'attirer la faveur divine qu'à ne plus savoir ce que l'on dit», elle «vise à faire du langage une mélopée insignifiante. Quelque chose qu'on fait avec le langage qui a à voir avec la danse des derviches tourneurs.»
Ce qui pourrait passer pour une critique devient ici un compliment.
On voit le danger : faire l'éloge de l'ignorance et de la soumission, avec toutes les dérives qu'on imagine. L'auteure en est consciente, et s'en défend. Est-elle convaincante ? Son livre a au moins deux mérites. D'abord, il pose la bonne question : celle de savoir «si ce qui se passe dans ma tête est une affaire personnelle — ou si ma tête est un lieu où se produisent des phénomènes qui ne m'appartiennent pas en propre.» Ensuite, il nous indique la bonne marche à suivre, dans un difficile exercice d'équilibre entre le besoin de comprendre et le besoin de ne pas comprendre, tous deux essentiels.
Il est écrit, ce livre, de façon polythéiste, c'est-à-dire un peu bordélique, empruntant au rituel religieux et à l'art du massage leurs ressassements irritants ou bienfaisants, selon. Agaçante ou séduisante, de même, l'irruption dans la spéculation philosophique de fragments d'autobiographie — justifiés me semble-t-il, car intégrés à la démonstration. Quoi qu'il en soit, cette forme hérétique découle naturellement du sujet, en ce qu'elle s'oppose au discours rationaliste étroit. Ce livre qui dérange n'en est que plus stimulant.
 Pier Francesco Mola, Artémis contemplant Endymion, 1660. |
Un autre livre de philo ! Deviendrais-je sérieux ? Oh, il n'est pas bien long, L'invisible de Clément Rosset, aux éditions de Minuit : 80 pages vite lues, puisque rédigées, si mes souvenirs sont bons, de façon claire. Son sujet...
Bon sang, de quoi ça parlait déjà ?
D'habitude je griffonne au crayon sur la page blanche de la fin, mais là, rien. Comme si le texte lui-même l'avait été, invisible. Ça me revient vaguement... L'invisible, l'inaudible, l'impensable... tout ce qui ne se laisse pas saisir par les sens, la pensée, les mots... Beau programme. Que je n'aie rien retenu, peut-être était-ce le vœu secret de l'auteur ?
Je badine pour dissimuler ma honte.
Il y avait — ça revient toujours, peu à peu — de belles pages sur la musique, ce royaume de l'indicible. Noté deux belles citations :
«Elle est une langue que nous comprenons et parlons, mais qu'il est impossible de traduire», dit le musicologue Eduard Hanslick.
Et Proust :
«Cette musique me semblait quelque chose de plus vrai que tous les livres connus. Par instants je pensais que cela tenait à ce qui est senti par nous de la vie, ne l'étant pas sous forme d'idées, sa traduction littéraire, c'est-à-dire intellectuelle, en rend compte, l'explique, l'analyse, mais ne le recompose pas comme la musique où les sons semblent prendre l'inflexion de l'être.»
(Mais dites-moi, monsieur Marcel, n'y a-t-il pas de la musique aussi dans les phrases des écrivains, laquelle parvient à faire sentir, parfois, ce que les mots à eux seuls sont impuissants à dire ?)
Allons bon, rien noté non plus sur le bouquin suivant. C'est un roman de l'année, accompagné de bonnes critiques et dont le sujet me séduit : une fille d'agriculteur venue étudier à Paris doit s'habituer à un monde agressivement différent pour elle. Moi qui ai grandi dans un milieu urbain et plutôt intello, je suis curieux de voir mon environnement naturel perçu par des yeux étrangers, de comprendre en quoi il peut paraître exotique, intimidant, inaccessible.
Elle inspire la sympathie, cette jeune fille devenant jeune femme, qui finit par osciller entre deux mondes sans plus appartenir à aucun. Son parcours est observé avec justesse et finesse. Alors qu'est-ce qui me gêne ?
Le ton.
«[Les parents] avaient délibéré au chevet de l'enfant merveilleuse, seule fille inventée à la coda d'un quintette de fils très aînés, tous établis plus que bourgeoisement et nantis de mirifiques professions, d'épouses divines, d'enfançons idéaux, fils chargés, bourrés à craquer comme navires fabuleux de maintes promesses d'avenir». «Le rire haut juché de Jean-René couvait, fusait, éclatait, cascadait ; Jean-René savait ; alerte et précis, dégagé, il caracolait sans ambages entre latin, grec, littérature française et allusions judicieuses à Cervantès, Goethe, ou Dante dont Claire découvrait à la fois les noms, nationalités et titres de gloire.»
Phrases un peu trop longues et lourdes, «bourrées à craquer» elles aussi, adjectifs envahissants, métaphores artificielles, c'est sans doute imperceptible mais à la longue un peu étouffant : l'auteure force sa voix. C'est bien écrit — au mauvais sens du terme. Trop visiblement chiadé. Comme si la fille de paysans craignait, en suivant simplement sa nature, de ne pas être admise au club.
Mais ne parlé-je pas ici précisément comme un membre dudit club, qui refuse avec dédain l'entrée à une roturière ?
 Appliquée. |
Quelqu'un dont la petite musique chante parfaitement juste, c'est Daniel Rocher, déjà loué ici même. Je m'étais délecté de son Voyage de Monsieur Raminet, odyssée drôlatico-mélancolique, et cela me reprend avec La Croisette s'amuse, qui nous fait emmène à Cannes au moment du festival, dans des péripéties joyeusement improbables.
Tout peut arriver dans un roman de Rocher. On y rencontre même des jeunes femmes de rêve séduites par des messieurs moches et vieillissants, c'est tout dire. L'auteur mobilise, avec un culot tranquille, des personnages réels : ici, on rencontre Woody Allen en pyromane et le héros devient pote avec le prince Charles d'Angleterre. Les péripéties de l'action sont redoublées par celles de l'écriture, la langue étant maniée avec une inventivité joueuse à la Echenoz. «Pendant qu'on faisait subir au car la césarienne rituelle pour la délivrance des bagages...» «...les autres tout fringants dans la violence de leurs eaux de toilette...»
Tout coule jouissivement, légèrement dirait-on, sans toucher terre, et toc ! au détour d'un paragraphe, voilà soudain une remarque profonde, doucement ironique, un brin amère :
«La Justice est seulement chargée de faire respecter le Droit, de sanctionner ses violations, et ce n'est que par d'heureuses coïncidences que, parfois, ses décisions prennent une dimension éthique, à la grande surprise de ses serviteurs : magistrats, avocats, témoins, experts, qui constatent alors avec une candeur étonnée qu'un jugement peut être juste, que les nécessités de l'ordre public peuvent s'accorder avec le respect de l'individu et que le Droit peut rejoindre la Morale.»
Cela dit en passant, avec une élégance et une pudeur jamais en défaut.
 Tout peut arriver ! |
Jouissive aussi, d'une autre façon, l'anthologie de la poésie érotique française publiée en Poésie/Gallimard sous l'heureux titre Éros émerveillé, déjà évoquée le mois dernier — en épuiser toute la matière d'un coup eût été exténuant. Plus de 600 pages ! Près de 200 poètes ! Les plus grands noms de la poésie française de tous les temps — Paul Claudel excepté ! Le livre est un peu lourd pour être lu d'une main, mais à l'âge d'Internet et de ses images rentre-dedans, l'érotisme de papier n'est-il pas plus fait pour réjouir l'âme que le corps ?
Le mois dernier, j'évoquais les riches heures de la Renaissance. Le XVIIe (on s'en doutait) et le XVIIIe (plus surprenant) sont pauvres, mais dès 1850 ça se réveille enfin. Ah ! Verlaine ! Ah ! Mallarmé, le charmant «nid moussu d'un gai chardonneret» ! Le «Sonnet biblique» de Théodore Hannon ! «La torche» de Marie Nizet ! Michaux et ses délires («Il la déjupe ; puis à l'aise il la troulache, / la ziliche, la bourbouse et l'arronvesse, / lui gridote sa trilite, la dilèche...»).
Lucie Delarue-Mardrus râle dans les bras brûlants d'une autre dame, et «Des profondeurs, en nous, grandissent, inconnues». J'aime ce halètement troublant des virgules.
Je retrouve aussi, avec émotion, ce poème superbe d'André Breton, «L'union libre», que j'avais jadis appris par cœur :
Ma femme au sexe d'algue et de bonbons anciens
Ma femme au sexe de miroir
Ma femme aux yeux pleins de larmes
Aux yeux de panoplie violette et d'aiguille aimantée
Ma femme aux yeux de savane
Ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison
Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache
Aux yeux de niveau d'eau de niveau d'air de terre et de feu
Les contemporains déçoivent un peu, souvent obscurs et affectés, genre «il aime par dessus tout quand ma grande nacre / articule sa bouche ventousée aux petites ombres dedans il / se sustente des lustres qu'il est là se verrait bien / moisir ici gamahuche dieu éberlué en son réduit».
Autre déception, ce vers d'Eluard : «Et la porte du temps ouverte entre tes jambes». Pendant près de cinquante ans, depuis le jour où Jean-Claude Pinson lut ce poème, dans la salle d'étude, à notre petit groupe d'internes plutôt frustrés, j'ai cru que la porte en question était la porte du temple — n'était-ce pas plus solennel, plus religieux, plus vrai ?
 Antonio Canova, Eros et Psyché. |
Autre retour au passé : Que ma joie demeure, roman du Giono des années 30. J'avais calé au premier tiers autrefois, alors que j'adorais Giono. Cette histoire de paysans perdus sur un haut plateau, qui sous l'impulsion d'un inconnu vont unir leurs efforts pour changer la vie, ces bêtes sauvages affectueuses, tout ce merveilleux me semblait naïf, utopique, indigeste à force d'images trop riches. La première scène, ce type qui se relève la nuit pour labourer, non, tout de même...
La revoici, cette scène, la nuit glacée, les étoiles énormes, le mystérieux inconnu qui s'approche, et cette fois je suis saisi. Je sais tout de suite que j'irai au bout. Malgré les discours des animaux et ceux du vent, ceux des hommes aussi, un peu longuets parfois, la scène du festin où l'auteur s'écoute et nous oublie un peu, malgré tout cela je suis emporté, balayé par le lyrisme débordant, luxuriant de ce Giono d'avant-guerre.
Je m'aperçois aussi que je n'avais rien compris : il n'y a pas le moindre optimisme béat dans ce livre, pas plus qu'ailleurs chez Giono, tout bonheur a son envers de malheur et le livre avance tiraillé entre le rêve et l'échec du rêve, en un perpétuel contrepoint, l'auteur tissant d'une main et défaisant de l'autre, jusqu'à la fin tragique.
D'un côté, l'exaltation. Le grondement du sang dans les veines : «C'était comme le volant des batteuses qui battent le blé. C'était comme le fléau qui bat le blé, vole, bat le blé, vole. C'était comme la peine de l'homme qui saute dans la cuve. C'était comme le galop régulier d'un chevalet s'il galope tout le temps comme ça, régulièrement, avec ses gros sabots, il va jusqu'au bout du monde, et après le bout du monde il galopera dans le ciel, et la voûte du ciel sonnera sous son galop comme la terre sonne maintenant.»
De l'autre côté, l'abattement : «Ils étaient là tous les deux, lui et Marthe, comme des déshérités et des malheureux. Tout comprenait autour d'eux, depuis la plus petite plante jusqu'au gros frêne, et les bêtes, et les astres même sans doute, et la terre, là, sous ses pieds, avec son grumelage, son feutrage, et ses veinules d'eau. Tout comprenait et était sensible. Ils étaient seuls à être durs et imperméables malgré la bonne volonté. Il fallait qu'ils aient perdu comme ça le bel héritage de l'homme pour être si pauvres, pour se sentir ainsi dépouillés, et faibles, et incapables de comprendre le monde.»
Dire que j'aurais pu rester loin de ce livre immense ! Il ne me quittera plus.
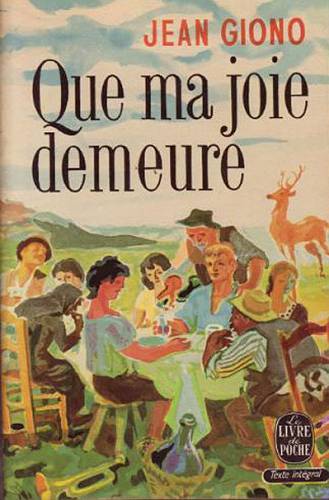 Couverture de mon exemplaire jadis. |
C'est le mois des pèlerinages. Revoilà Thérèse Desqueyroux, de François Mauriac. J'étais allé au bout voilà un demi-siècle — le livre est court. Puis j'ai longuement snobé Mauriac, Sartre m'en ayant détourné avec son péremptoire «Dieu n'est pas un artiste ; M. Mauriac non plus.»
Qui l'eût cru ? Les romans du grand Sartre, maître à penser de nos jeunes années, se sont éloignés de nous et sentent un peu le moisi, tandis que ceux de sa victime sont de nouveau là, comme neufs. J'ai récemment relu et aimé Le nœud de vipères, et Thérèse Desqueyroux à son tour me subjugue.
Il faudrait évidemment relire La nausée ou Le mur, les seules fictions encore lisibles de l'essayiste-philosophe, pour comparer de façon équitable, mais dans mon souvenir les histoires de Sartre ont quelque chose de raidement mécanique, de lourdement démonstratif, alors que chez Thérèse tout est vivant, brûlant. Et des deux romanciers, celui qui juge ses personnages comme le ferait Dieu, ce n'est pas Mauriac...
Thérèse, épouse malheureuse, révoltée, a tenté de tuer son mari ; face à elle, contre elle, toute une famille riche, bien-pensante, égoïste, figée. «Ils avaient raison de la considérer comme un monstre, mais elle aussi les jugeait monstrueux.» Le mari borné, la belle-mère et les autres, Mauriac va leur lancer ses flèches les plus assassines, mais le plus fascinant, c'est de l'observer tournant autour de son héroïne, ne cachant pas la gravité de son acte, s'échinant cependant à nous la rendre aimable malgré tout. Lui glissant entre les mains l'étendard du féminisme, puisqu'elle se révolte avant tout contre l'immémoriale soumission des épouses. Se réjouissant sûrement in petto de nous rendre complices d'une meurtrière.
Mauriac se garde bien, par ailleurs, d'expliquer vraiment le geste criminel. Tout reste insaisissable, indéfinissable, mystérieux, comme dans tout bon roman — et en même temps concret, tangible, chaque page regorgeant de notations et d'images d'une justesse cruelle :
«Thérèse quittait le royaume de la lumière et du feu et pénétrait de nouveau, comme une guêpe sombre, dans le bureau où les parents attendaient que la chaleur fût tombée et que leur fille fût réduite.»
Œuvre d'un écrivain réputé traditionnel, Thérèse Desqueyroux contient aussi certaines audaces d'écriture très réussies (certains présents de narration notamment) dont je doute qu'on trouve l'équivalent chez — par exemple — un Sartre...
 La Thérèse de Miller. |
Ce qui m'a donné l'idée de retourner chez Thérèse, c'est, on s'en doute, la sortie du film de Claude Miller adapté du roman.
Claude Miller, très bon cinéaste, nous a donné là, juste avant de mourir, un film très honorable : les intérieurs bourgeois et les extérieurs en forêt sont superbes, Audrey Tautou a bien du talent. Malheureusement, Miller a substitué aux retours en arrière virtuoses de Mauriac une narration linéaire qui banalise le film, et l'illustration reste un rien trop jolie et superficielle.
Nous n'aurions sans doute pas dû, Carole et moi, regarder d'abord la première adaptation, tournée en 1961 par Georges Franju. Un film en noir et blanc, plutôt fauché, où l'on voit peu la nature landaise, où Philippe Noiret, bien qu'irréprochable, n'a pas le physique et la bêtise du mari ; mais Franju a gardé les flash-back, il suit Mauriac pas à pas avec un dépouillement janséniste, une ferveur sombre et âpre, Emmanuelle Riva est habitée par son personnage, et le film de Miller, avec ses belles couleurs, pâlit devant cette modeste chose qui est moins un film qu'une véritable tragédie.
 La Thérèse de Franju. |
Passons rapidement sur notre Demy du mois, L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune, comédie laborieuse que Deneuve et Mastroianni ne sauvent qu'à moitié.
Days of wine and roses, que Blake Edwards tourna en 1962 avec Jack Lemmon et Lee Remick, est resté dans l'ombre, injustement — quoique disponible en DVD : cette descente aux enfers d'un couple touché par l'alcoolisme, d'une force et d'une intelligence remarquables, efficacement mis en scène, évite les clichés, le happy ending menteur et offre quelques scènes d'anthologie. Edwards n'est donc pas seulement l'homme des panthères roses...
Dernier bonheur du mois, Tabou, le nouveau film du Portugais Miguel Gomes. Le précédent, Ce cher mois d'août, nous avait déjà beaucoup frappés. Cela commence très lentement, à Lisbonne aujourd'hui, avec la mort d'une vieille dame indigne, et cela se poursuit cinquante ans plus tôt avec la même dame dans sa folle jeunesse, vivant une histoire d'amour incandescente dans une colonie portugaise d'Afrique bientôt décolonisée, dans la mélancolie de la fin d'un monde. C'est en noir et blanc, ça ne ressemble à rien, c'est surprenant d'un bout à l'autre et en même temps évident. Plein de trouvailles géniales et pourtant simples, comme de ne pas faire entendre les voix dans les scènes du passé, mais seulement les bruits. Pendant ces deux heures, le temps s'arrête. À la fin on se dit, ces trois heures m'ont semblé durer une heure.
 Ana Moreira, Carloto Cotta. |
On a un peu délaissé la BD ces derniers temps. Que deviennent-ils, par exemple, Lucien et ses potes rockers de banlieue ? Les revoilà dans un nouvel album, Toujours la banane (Fluide glacial), paru il y a déjà quatre ans. Surprise : leur papa Frank Margerin les a vieillis ! Les voilà quinquas. Lucien est marié, a deux enfants chiants et du bide. Il va retrouver ses copains, pas mal changés... À la rigolade bon enfant, toujours présente, se superpose une sourde mélancolie, qui donne à cette nouvelle aventure une dimension nouvelle, une émouvante humanité. Le plus bel album de la série, oh yeah !
 Ils sont pt'ête bien des vieux rockers... |
Et par une habile transition, voici la musique !
La star du mois est Mr Vaughan Williams. Après avoir découvert sa Sixième symphonie (cf. «Et la musique s'échappe», dans le JOURNAL INFIME), j'embarque dans la Troisième, «A Pastoral Symphony», par le London Symphony Orchestra dirigé par André Prévin. Autant la Sixième démarre avec tambours et trompettes, autant celle-ci coule avec une douceur discrète, un peu languide. Quatre mouvements, tous lents ! Ce qui n'est pas fait pour déclencher l'hystérie des foules. On a comparé l'infortunée symphonie à «une vache qui regarde par-dessus la barrière», on y a vu le compositeur «passant et repassant dans un champ labouré un jour de pluie». Ce qui ne me paraît pas totalement faux. Pourtant je l'écoute et la réécoute sans ennui — ou peut-être avec : pas moyen de savoir ce que j'en pense, si je trouve ça creux et lourd ou riche et profond. Divisé comme rarement, je me la passe encore une fois pour dissiper l'incertitude enfin — ou l'accroître encore, avec une délectation perverse ?
Le flamenco, c'est de la musique, de la danse, mais aussi des paroles. Que peuvent-ils bien raconter, les chanteurs, en s'accompagnant de la guitare ?
Je m'accroche aux murs
Quand je te croise dans la rue
Petite, pour ne pas tomber.
Ou bien :
Ta fenêtre est une prison
Mais le geôlier est à l'intérieur
Et le prisonnier dans la rue.
Ou alors :
Écoute, tu es si belle,
Que le croque-mort
En te voyant
Jette sa bêche en sanglotant.
Ou encore :
Je vais à toi comme la rivière
Va se perdre dans l'océan
Comme la pluie se noie dans la terre
Comme l'acier cherche l'aimant.
Et d'autres petites perles encore, tirées d'un livre trop mince et sûrement difficile à trouver, Je me consume 2 (Antoine Soriano). Je n'ai pas le numéro 1, hélas. Merci à la traductrice, Martine Joulia, et merci à Carole qui a sorti ce livre du purgatoire lors du tirage au sort mensuel.
 Ils se consument. |
Voilà donc janvier, déjà. Je souhaite aux volkonautes parvenus au bout de mes longues Brèves un 2013 plein de bonnes et saines lectures ; je souhaite au Réseau Education Sans Frontières, à la Cimade, à Amnesty International et autres gêneurs de faire entendre davantage leurs voix ; je souhaite aux nuls et aux médiocres qui dirigent la planète la lucidité et/ou le courage qui leur manquent ; je souhaite aux Grecs — c'est à eux que je pense le plus — le courage nécessaire pour survivre jusqu'au bout du tunnel.
Au programme de février : Giono et Tchekhov sûrement, Dostoïevski et Gailly probablement, Revaz, Rajfus, Hardy, de la BD (Lax), du cinéma (Demy, Edwards...), de la musique : Offenbach, Amoyel...
 Seins à l'air, seins à l'eau. |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Il y a des reproches qui louent et des louanges qui médisent.
Un homme qui ne montre aucun défaut est un sot ou un hypocrite dont il faut se méfier. Il est des défauts tellement liés à de belles qualités, qu'ils les annoncent et qu'on fait bien de ne pas s'en corriger.
L'honnêteté est la plus grande de toutes les malices, parce que c'est la seule que les malins ne prévoient pas..