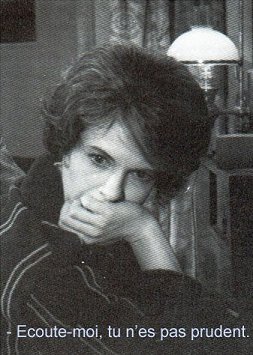
Delphine Seyrig dans Muriel
(Alain Resnais, 1963).
Ce dimanche-là vers midi, dans la grande descente du cimetière, aux premières maisons, percuté une voiture qui débouchait sans m'avoir vu. Remonté à vélo en grommelant que ça ira. Prenant ma douche, vu sur l'épaule gauche une vilaine bosse. A l'hôpital de Sèvres, on m'envoie en ambulance à Ambroise-Paré : la clavicule est en morceaux. Mais pas question de m'opérer tout de suite ! Dimanche n'est pas jour ouvrable. La nuit sera longue. Je ne souffre pas vraiment, mais ne sais où poser mon dos. Le sommeil est resté dehors. Je sais, il suffirait d'un cachet... Toutes les deux heures une infirmière vient me susurrer à l'oreille, d'une voix de sirène, Vous êtes sûr, vous ne voulez pas de calmant ? Non, pas encore. Je voudrais tenir jusqu'à l'aube, comme la petite chèvre. Et je tiens. Au point du jour enfin, la récompense : un bout de vrai sommeil, venu tout seul, pur délice.
Premier séjour à l'hôpital. Première anesthésie générale. Il fallait bien que j'y passe un jour, comme les autres. Malgré les désagréments, je me sens soulagé : je paie mon tribut, je me mets en règle. Ce qui m'attend est une épreuve, un rite de passage. De l'adolescent à l'adulte, ou de l'âge mûr à la vieillesse — comment savoir, le patient n'a plus d'âge, on m'a enlevé mes vêtements, mon alliance, je suis nu, ramené à l'essentiel, comme au début de la vie ou à la fin. On me toilette, on m'allonge sur un lit roulant, on replie sur moi un drap blanc immense, puis on me pousse dans les couloirs en un long travelling, lampes au plafond, battements feutrés des portes, jusqu'à la lumière du saint des saints — grand soleil au-dessus de moi comme dans les films, éblouissant et doux. Presque pas peur. Je suis curieux de la traversée qui commence, dont je ne garderai, je le sais, aucun souvenir. Je veux y jouer un rôle actif, malgré les apparences.
Une voix joyeuse en coulisse : Tout le monde est prêt ? On y va !
On apporte le masque et j'aspire à fond le sommeil.
Réveil. Salle inconnue. Rangée de lits, patients endormis, râle pâteux de l'un d'eux qui émerge. Des blouses blanches papotent, leur indifférence m'amuse. Aucune douleur. Je ne sens pas l'épaule, mais seulement que tout y est désormais bien rangé, propre et net. Le plus beau : l'idée qu'on peut maintenant se laisser aller, qu'il le faut, que l'effort vers la guérison passe aujourd'hui par une flemme totale.
Une journée à jouer les légumes. Le lendemain matin je m'aperçois qu'on ne m'a pas remis mon slip. Je le réclame, j'enfile aussi mon pantalon et me revoilà un être humain. Je fais les cent pas, me rassieds, mais pas sur le lit, je corrige des copies, tout un cinéma jusqu'à ce qu'il soit bien clair qu'on doit me laisser partir.
Le même soir, poésie grecque à la Maison de la Poésie. Je me dois d'y être. Une heure de métro. On me force à monter sur scène avec mon bras emmailloté-ligoté, grosse bosse cachée sous le pull, qui me donne un look mi-femme enceinte, mi-momie. On me demande un spitch, que je dois improviser — ce que je déteste. Quelques heures plus tôt j'étais une pauvre larve nue allongée dans sa chemise d'hôpital, bardée de tuyaux et de fils, et me voilà droit sur ma chaise dans la lumière des projecteurs, débitant des mots qui sortent de moi tout seuls. Le maître des lieux, Michel de Maulne, me présente comme un héros, le poète Liondàkis fait carrément de moi un saint, laissez-moi rire, je n'ai fait aucun effort, je me sens si planant délié de mon goutte-à-goutte, si fabuleusement libre. Ma perfusion du soir : ce bain de lumière. Dieux, comme je suis vivant ! — ou bien serait-ce un avant-goût de là-haut ?
Un rude moment tout de même : rentrer seul ensuite en métro, ployant sous les bouquins et les kilos de pistaches que les poètes m'ont apportés de Grèce.
Deuxième soirée de poésie grecque, même lieu, quelques jours plus tard. Sur scène, les projos dans les yeux, on ne voit rien de la salle, juste un trou noir, mais quel noir ! Chaud, vivant, respirant, pétillant — un noir lumineux, qui enivre. Jamais je n'avais connu ça. L'ivresse de mardi dernier, ce n'était donc pas seulement les dernières vapeurs d'anesthésie...
Projecteurs, drogue dangereuse. Les spots, ces despotes.
Retour sur terre. Après nos envols poétiques il faut dégager en vitesse : la bande à Terzieff joue après nous. Je quitte la loge quand le premier d'entre eux arrive. Bon sang ! Philippe Laudenbach !
Il a joué, voilà bientôt quarante ans, dans Muriel d'Alain Resnais, scénario de Jean Cayrol. Muriel, l'un de mes dix films d'île déserte, que j'ai vu trois ou quatre fois, à tous les coups différent, étonnant, bouleversant. Muriel qui est plus qu'un grand film : la vie elle-même, retrouvée. J'ai acheté le livre et appris tous les noms des acteurs. Je secoue la main du malheureux, je bredouille d'émotion comme s'il était le neveu du bon Dieu. À sa place je serais furax : toute une vie consacrée au Théâtre, et voilà ce qu'il en reste, un petit rôle de merde au cinéma.
À la troisième soirée, une semaine plus tard, je sacrifie aux mondanités dans le hall, baillant d'ennui, quand passe Dieu lui-même : Terzieff ! Beau comme jadis, dans un manteau informe, l'air d'un prince, d'un mendiant, sourire crispé, il se faufile tête baissée entre les groupes vers les coulisses tel un amoureux en retard. Entrevu, disparu. J'ai dû rêver.
(Journal infime, 2000)
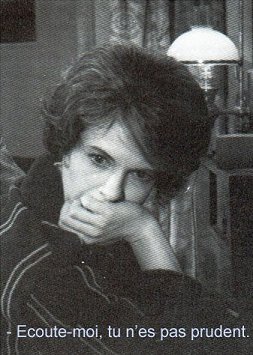 Delphine Seyrig dans Muriel (Alain Resnais, 1963). |
(publié dans PAGES D'ÉCRITURE N°10 en juin 2004)