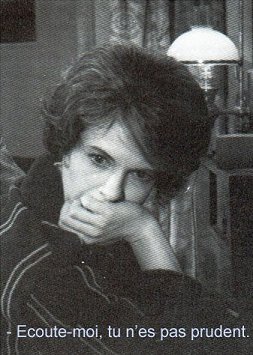
Delphine Seyrig dans Muriel
(Alain Resnais, 1963).
PAGES D'ÉCRITURE
N°10 Juin 2004
Ce dimanche-là vers midi, dans la grande descente du cimetière, aux premières maisons, percuté une voiture qui débouchait sans m'avoir vu. Remonté à vélo en grommelant que ça ira. Prenant ma douche, vu sur l'épaule gauche une vilaine bosse. A l'hôpital de Sèvres, on m'envoie en ambulance à Ambroise-Paré : la clavicule est en morceaux. Mais pas question de m'opérer tout de suite ! Dimanche n'est pas jour ouvrable. La nuit sera longue. Je ne souffre pas vraiment, mais ne sais où poser mon dos. Le sommeil est resté dehors. Je sais, il suffirait d'un cachet... Toutes les deux heures une infirmière vient me susurrer à l'oreille, d'une voix de sirène, Vous êtes sûr, vous ne voulez pas de calmant ? Non, pas encore. Je voudrais tenir jusqu'à l'aube, comme la petite chèvre. Et je tiens. Au point du jour enfin, la récompense : un bout de vrai sommeil, venu tout seul, pur délice.
Premier séjour à l'hôpital. Première anesthésie générale. Il fallait bien que j'y passe un jour, comme les autres. Malgré les désagréments, je me sens soulagé : je paie mon tribut, je me mets en règle. Ce qui m'attend est une épreuve, un rite de passage. De l'adolescent à l'adulte, ou de l'âge mûr à la vieillesse — comment savoir, le patient n'a plus d'âge, on m'a enlevé mes vêtements, mon alliance, je suis nu, ramené à l'essentiel, comme au début de la vie ou à la fin. On me toilette, on m'allonge sur un lit roulant, on replie sur moi un drap blanc immense, puis on me pousse dans les couloirs en un long travelling, lampes au plafond, battements feutrés des portes, jusqu'à la lumière du saint des saints — grand soleil au-dessus de moi comme dans les films, éblouissant et doux. Presque pas peur. Je suis curieux de la traversée qui commence, dont je ne garderai, je le sais, aucun souvenir. Je veux y jouer un rôle actif, malgré les apparences.
Une voix joyeuse en coulisse : Tout le monde est prêt ? On y va !
On apporte le masque et j'aspire à fond le sommeil.
Réveil. Salle inconnue. Rangée de lits, patients endormis, râle pâteux de l'un d'eux qui émerge. Des blouses blanches papotent, leur indifférence m'amuse. Aucune douleur. Je ne sens pas l'épaule, mais seulement que tout y est désormais bien rangé, propre et net. Le plus beau : l'idée qu'on peut maintenant se laisser aller, qu'il le faut, que l'effort vers la guérison passe aujourd'hui par une flemme totale.
Une journée à jouer les légumes. Le lendemain matin je m'aperçois qu'on ne m'a pas remis mon slip. Je le réclame, j'enfile aussi mon pantalon et me revoilà un être humain. Je fais les cent pas, me rassieds, mais pas sur le lit, je corrige des copies, tout un cinéma jusqu'à ce qu'il soit bien clair qu'on doit me laisser partir.
Le même soir, poésie grecque à la Maison de la Poésie. Je me dois d'y être. Une heure de métro. On me force à monter sur scène avec mon bras emmailloté-ligoté, grosse bosse cachée sous le pull, qui me donne un look mi-femme enceinte, mi-momie. On me demande un spitch, que je dois improviser — ce que je déteste. Quelques heures plus tôt j'étais une pauvre larve nue allongée dans sa chemise d'hôpital, bardée de tuyaux et de fils, et me voilà droit sur ma chaise dans la lumière des projecteurs, débitant des mots qui sortent de moi tout seuls. Le maître des lieux, Michel de Maulne, me présente comme un héros, le poète Liondàkis fait carrément de moi un saint, laissez-moi rire, je n'ai fait aucun effort, je me sens si planant délié de mon goutte-à-goutte, si fabuleusement libre. Ma perfusion du soir : ce bain de lumière. Dieux, comme je suis vivant ! — ou bien serait-ce un avant-goût de là-haut ?
Un rude moment tout de même : rentrer seul ensuite en métro, ployant sous les bouquins et les kilos de pistaches que les poètes m'ont apportés de Grèce.
Deuxième soirée de poésie grecque, même lieu, quelques jours plus tard. Sur scène, les projos dans les yeux, on ne voit rien de la salle, juste un trou noir, mais quel noir ! Chaud, vivant, respirant, pétillant — un noir lumineux, qui enivre. Jamais je n'avais connu ça. L'ivresse de mardi dernier, ce n'était donc pas seulement les dernières vapeurs d'anesthésie...
Projecteurs, drogue dangereuse. Les spots, ces despotes.
Retour sur terre. Après nos envols poétiques il faut dégager en vitesse : la bande à Terzieff joue après nous. Je quitte la loge quand le premier d'entre eux arrive. Bon sang ! Philippe Laudenbach !
Il a joué, voilà bientôt quarante ans, dans Muriel d'Alain Resnais, scénario de Jean Cayrol. Muriel, l'un de mes dix films d'île déserte, que j'ai vu trois ou quatre fois, à tous les coups différent, étonnant, bouleversant. Muriel qui est plus qu'un grand film : la vie elle-même, retrouvée. J'ai acheté le livre et appris tous les noms des acteurs. Je secoue la main du malheureux, je bredouille d'émotion comme s'il était le neveu du bon Dieu. À sa place je serais furax : toute une vie consacrée au Théâtre, et voilà ce qu'il en reste, un petit rôle de merde au cinéma.
À la troisième soirée, une semaine plus tard, je sacrifie aux mondanités dans le hall, baillant d'ennui, quand passe Dieu lui-même : Terzieff ! Beau comme jadis, dans un manteau informe, l'air d'un prince, d'un mendiant, sourire crispé, il se faufile tête baissée entre les groupes vers les coulisses tel un amoureux en retard. Entrevu, disparu. J'ai dû rêver.
(Journal infime, 2000)
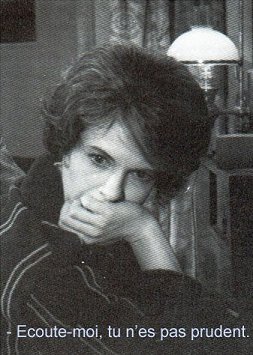 Delphine Seyrig dans Muriel (Alain Resnais, 1963). |
Répertoire des délicatesses du français contemporain, de Renaud Camus. J'espérais trouver un concurrent pour mon Verbier, mais non : négligeant les œuvres de ses confrères, qui ne lui inspirent nulle tendresse apparente, l'auteur ne s'intéresse qu'au français des médias et de la rue. Il le fait de façon rigide, normative, négative, pédante et ronchonnante, avec un mépris souverain pour tous ceux qui ne causent pas comme lui. Sa diatribe exhale une infinie tristesse : le français fout le camp, tout fout le camp, Renaud Camus est aussi seul que Roland sonnant du cor.
Le plus sinistre dans l'histoire, c'est de penser à ce que fut cet homme-là jadis, à ses Chroniques achriennes par exemple, où il apparaissait rayonnant et fier, brandissant son homosexualité, niquant gaiement les interdits. (Un peu pharisien, à vrai dire, dans son dédain de l'hétéro.) Et aujourd'hui voilà le bandeur solaire changé en vieux ratatiné.
Mais pourquoi s'énerver ? Personne n'a défendu ce bouquin, en a-t-on seulement parlé ? C'est le Journal du même qui a capté l'attention, à cause de quelques lignes puantes sur les Juifs. Or c'est en lisant le Répertoire... qu'on trouve la clef du scandale : non, ce type n'est pas virulemment raciste, il ne veut sûrement pas qu'on tue des Juifs, et peut-être pas qu'on leur pique leur boulot. Il n'aime pas les autres, c'est tout — surtout ceux qui ne lui ressemblent pas. Il est en même temps obnubilé par la peur de passer pour sympa — c'est à dire, selon lui, démagogue, laxiste, faible. S'il s'est collé un masque de raciste, c'est d'abord pour qu'on le déteste. Il nous tend des verges pour le battre... La peur de l'autre prend parfois de ces formes tordues. D'où cette haine affichée pour les jeunes, et ceux qui s'en occupent : les profs. Ô paradoxe ! Comme si une partie de ceux-ci n'étaient pas, dans la défense du français académique, ses alliés les plus sûrs. Renaud Camus, l'apothéose du masochisme et de la confusion.
Mon agacement est hypocrite. Je ferais mieux de m'avouer à quel point j'ai jubilé en dévorant son pensum, tant cette caricature sert de repoussoir au Verbier. Tant ce vinaigre lui donne un goût de miel.
Mon but à moi n'est pas d'exclure à grands coups de gueule, mais d'accueillir, de récupérer tout ce qui peut l'être, en patient chiffonnier de la langue. D'ouvrir les discours figés dans leur pureté à l'aventure des mélanges, des croisements.
(Journal infime, 2000)
Bonnes résolutions. Posé sur ma table de nuit un imposant pavé : les œuvres complètes de Cioran, haut-lieu de la pensée et de l'écriture. Le lendemain ma mère me passe les dernières Brèves de comptoir, ce recueil de propos ramassés dans les bistrots. Par quoi commencer : l'ambroisie ou la petite bière ? le dessus du panier ou le fond de la poubelle ?
Cioran attendra. Paresse d'esprit ? Bien sûr, mais pas seulement. Les humbles Brèves m'apportent davantage, avec leur boue pleine de pépites, ça fermente, ça bouillonne, ça vit, ça incite à écrire ; tandis que l'admirable prose de Cioran est raide, close, étouffante comme la mort.
(Journal infime, 2000)
Ils sont gentils, aux éditions du Petit Matin. On se tutoie, on s'embrasse. C'est bien commode la gentillesse : allez donc râler contre d'aussi braves gens quand le chèque se fait attendre six mois, un an, un an et demi... C'est vrai qu'ils ils ont de réels problèmes d'argent. Cette année, tu te rends compte, me disent-ils, on ne partira même pas en vacances ! (Ils habitent une belle maison à la campagne, les pauvres.)
J'ai publié chez eux il y a dix ans un superbe récit, authentique de bout en bout, dont la force résidait en partie dans cette authenticité. Sur la couverture (illustration hideuse + faute de français en 4e de couv.), ils ont marqué «roman». Ils n'ont rien inventé en fait : c'est un vieux truc d'éditeurs de seconde zone, finauds faute d'être fins, qui croient ainsi attirer le gogo. Car les «romans», c'est le bruit qui court, se vendent mieux que les «récits».
Le journal d'Anne Frank, roman. Ouais, bonne idée, coco.
J'étais fumasse et ne l'ai pas caché. Cinq ans plus tard, je leur confie tout de même un autre texte traduit : encore un témoignage. L'auteur n'est pas un pro de l'écriture ; il raconte l'épisode qui a marqué sa vie, au plus près de ses souvenirs. Ce récit est un hommage à une personne réelle, passionnément aimée, disparue. Pour l'auteur, c'est plus qu'un livre : un devoir sacré. Il insiste : avant le texte, sur une page blanche, il a mis ces mots en gros caractères : «Ceci est une histoire vraie.»
Voici le volume du Petit Matin. Tiens, jolie couverture ! Un frais minois, des couleurs pimpantes (le livre est une tragédie noire). J'ouvre... Stupeur. Ils ont osé ! Ils ont encore frappé ! «Roman traduit du grec» ! Quant à la phrase d'annonce, n'osant tout de même pas l'éliminer, ils l'ont collée... en première ligne du texte.
Un roman qui s'annonce «histoire vraie»... J'imagine le vertige du lecteur non prévenu. J'imagine aussi la Ve de Beethoven, par exemple, avec au tout début, avant po-po-po-pom, un roulement de tambour ajouté par l'éditeur.
Je ne vous raconte pas le chagrin de l'auteur, assistant au massacre du haut des remparts de Thessalonique.
J'ai envoyé une lettre de protestation furibarde. M. et Mme Petit Matin, affectant la surprise, l'ont pris un peu de haut, genre Nous on est des pros, on sait ce qu'il faut faire, pourquoi tu t'énerves, tu deviens chieur, mon vieux...
Cinq ans plus tard, je ne suis pas calmé, et l'auteur toujours pas payé.
Adieu, Petit Matin. Le chieur ne vous emmerdera plus. Il cherche ailleurs (et trouve encore) des éditeurs sérieux. Mais si c'était en son pouvoir, il vous collerait dix ans d'interdiction d'éditer, minimum, pauvres nuls, pour tripatouillage aggravé, histoire de vous apprendre à respecter tous ceux, auteurs, traducteurs, lecteurs, à qui vous devez la vie.
Nuit, nuit, ô nuit, sans aucun signe perpétuel —
je vois l'infini d'une illusion d'obscurité,
je vois seulement que je ne sais pas voir,
tout est noir ici — alors que doivent être les gouffres,
au-delà des espaces, au-delà des étendues,
que doit être la terre du châtiment, et les ténèbres —
en cette révocation où me mène la pensée,
dans cette matière glacée, dans ces voiles de néant,
ô guides insaisissables d'un char
tombé à jamais dans les ravins obscurs,
tandis que deux yeux surpris et parfaitement aveugles
fixent l'inexistence.
Nuit, nuit, ô nuit, pleine de signes perpétuels —
je vois l'infini d'une illusion d'éclairs,
je vois seulement ce que je ne sais voir,
tout est plein d'étoiles — alors que doit être l'Eden,
au-delà des espaces, au-delà des étendues,
que doit être la terre de l'extase, et l'érèbe —
en cette soustraction où me mène la pensée,
dans cette porte cachée, ces lueurs de firmament,
ô traces indélébiles d'un océan
étalé à jamais jusqu'au fond de l'inconcevable,
tandis que deux yeux vides et parfaitement troubles
voient se dresser
la splendeur d'un Corps.
(...) Hauts paysages de l'Ascension, cieux invités à l'éclatant mystère,
je vous ai vus au bout de la soirée à la frontière entre triomphe et déclin.
L'amertume du temps retombait, pénombre mauve, quand du plus lointain de la terre surgit une lumière vespérale,
ou plutôt un vague fantôme de lumière, au-dessus de la ligne des collines et des vignes,
lumière vert-de-gris, sans but ni cause, illumination de bon augure, comme une chambre fermée dont la porte s'ouvrant déverse
une lueur. Et moi qui regardais sans réfléchir, à la vue de mon voisin aux yeux soudain humides je compris qu'une chose profonde avait lieu, soulevant une émotion mêlée de peur, tandis qu'au loin
des troupeaux d'agneaux me rappelaient les cloches d'une vérité naturelle à jamais sacrifiée,
et que devant moi j'apercevais accrochée aux épines un cœur tout rouge la rose
participer à cette heure de crainte, penchée tous pétales ouverts...
Cohortes de Dieu, l'heure finit par venir où par-dessus épreuves et tourments
un doux crépuscule dissipe les brumes de notre vie,
et dans la nuit imminente, ouvre un passage, nous appelant provisoirement
à cela seul, à cela seul que nous méritions de vivre.
(Mihaïl)
(réponse sur le numéro de la citation...)
L'art est avec l'amour le plus court chemin d'un homme à un autre.
Les livres ne valent que par le livre supérieur qu'ils nous conduisent à imaginer.
Les livres qu'on a aimés font partie de nous, comme un muscle ou un nerf.
L'imminence d'une révélation qui ne se produit pas, est peut-être le fait esthétique.
Comme si l'on écrivait à partir d'un savoir. C'est l'inverse qui est vrai : on ne peut bien écrire que de ce qu'on ignore. On ne peut bien écrire qu'en allant vers l'inconnu — et non pour le connaître, mais pour l'aimer.
Les nouvelles pages ce mois-ci ?
Des souvenirs d'école primaire au lycée de Sèvres (1951-58) dans MES ÉCOLES sous le titre «Des charmes sans pareil(s)».
Une nouvelle rubrique, ELLE, MA GRÈCE, où je sers quelques tranches du livre homonyme (celles que je peux montrer sans me brouiller avec pas mal de gens). On commence par un petit tour en Crète et sur d'autres îles.
Dans MADE IN GREECE, «Médecines crétoises», recueil de formules magiques pour guérir certaines maladies. Puis nous restons en Crète avec la présentation du dernier roman de Ioànna Karystiàni, Un costume dans la terre, qui nous fait connaître l'île et la Grèce d'aujourd'hui, très loin des chromos pour touristes. À mon avis, un grand bouquin, plus encore que La petite Angleterre — ce qui n'est pas peu dire.
Plus deux nouvelles pubs — sans alcool, mais non sans jolies filles.
Dans les années 20, sur l'île Seguin, il y avait de la verdure et des guinguettes. Renault, installé à Boulogne en face, a tout envahi, tout bétonné. Puis s'est taillé. La grande usine abandonnée va disparaître. Certains crient au sacrilège : on détruit un Temple du Travail, on insulte la classe ouvrière, on désespère à nouveau Billancourt ! Pauvre Billancourt, que de conneries n'aura-t-on pas dit en ton nom... L'architecte Jean Nouvel, humoriste à ses heures, a même comparé la sinistre carcasse au krak des chevaliers de Saint-Jean d'Acre !
Moi, je me sens partagé : 5% de nostalgie bébête, 95% de soulagement. On nous annonce, entre les futurs bâtiments, quelques espaces verts et un sentier sur les berges. Ma mère va donc bientôt reconquérir l'île Seguin, elle qui n'y avait plus mis les pieds depuis 1925, et moi je serai de la fête à ses côtés.
En attendant, que les âmes sensibles se rassurent : je n'en ai pas encore vus, des anciens ouvriers venus contempler le massacre en famille, pleurant tous comme des veaux.
Si les actions des anti-pubs du métro ne me transportent pas d'enthousiasme, la réaction du camp d'en face me rapproche plutôt d'eux. Depuis que j'ai appris le montant des amendes que la société Métrobus, reine de l'affichage souterrain, réclamait contre les gribouilleurs (les juges eux-mêmes, horrifiés, les ont largement réduites), je suis pris moi aussi d'envies furieuses de barbouillage, rien que pour dire aux types de Métrobus ce que je pense de leurs histoires de fric. Les doigts crochus de ces êtres-là sont plus obscènes que des braguettes béantes.
Mille fois plus obscènes, les nouvelles d'Irak.
M. Poutine s'est déclaré profondément déçu par le comportement des militaires américains à l'égard de leurs prisonniers indigènes : «Trop doux, vos gars ! Des vraies lopettes !»
Le journaliste Jean-François R., cinquante et unième étoile du drapeau, nous a confié : «Ces rumeurs sont un mensonge grossier, une nouvelle invention des intellos gauchistes, fourriers d'un antiaméricanisme primaire !»
Une invention ? J'espère bien. Je ne peux croire que des femmes puissent elles aussi pratiquer la torture. Si nos sœurs s'y mettent, quel refuge nous restera-t-il, bonne mère, dans ce monde barbare de bêtes à couilles ?
Marie, mon ex-étudiante au DESS de traduction littéraire, a découvert volkovitch.com, souhaité me revoir, puis m'a fait l'honneur de m'inviter à l'une des soirées-lecture de sa bande. Nous étions donc une douzaine l'autre soir, assis par terre dans une pièce minuscule, chacun lisant à tour de rôle des textes qu'il aime. Ils ne s'en tiennent pas là, ces jeunes bibliophages (tous moins que trentenaires) : j'entends parler de courses au trésor dans Paris, de bouquins déposés sur des bancs publics et autres animations à la gloire du livre. On dit que les jeunes ne lisent plus, mais de telles fines équipes, quand j'avais leur âge, où se cachaient-elles donc ?
En ouvrant le livre d'un copain on tremble un peu : si l'on n'aime pas, que lui dire ? Avec Jean-Pierre Martin, aucun souci : tout ce qu'il écrit m'enchante. Nous avons fait un bout d'études ensemble jadis (cf. Rencontres avec les dieux), puis Jean-Pierre est allé militer en usine, y a vécu de quoi nous donner (bien plus tard) un des grands livres sur l'après-68, Le laminoir (Champ Vallon), avant de retourner à la terre, puis, sur le tard, de se mettre à l'enseignement et l'écriture. Ses Sabots suédois, fraîchement parus chez Fayard, prolongent la ligne autobiographique du Laminoir. Ils sont le récit de sa période verte, succédant à la rouge, où l'auteur fabriqua et vendit des sabots quelques années sur les hauteurs de l'Auvergne profonde.
L'équipée des babas, on croit connaître, elle fait même grassement rigoler certains ; l'auteur devance les rires, n'hésitant pas à se payer sa propre fiole, mais son refus des facilités — raillerie méprisante ou nostalgie naïve —, sa façon de marier dérision et ferveur nous offrent une image enfin juste d'une réalité trop oubliée ; l'Homo Baba Nostalgicus Ruralis, comme il l'appelle, devient un ami, un frère lointain, on se dit même qu'après tout cette espèce disparue a sûrement des leçons à nous donner. Oui, ce livre fait réfléchir — sans qu'on s'en aperçoive, tant on est captivé par ses bonheurs d'écriture, ses accès parodiques, ses élans héroï-comiques et toutes les nuances d'un chatoyant humour. Car l'humour, le Jean-Pierre, il en déborde.
L'humour... Lu jadis un Que sais-je ? de Robert Escarpit, intitulé L'humour, une petite merveille. On en sortait parfaitement (et joyeusement) informé sur ce thème capital.
S'agissant d'humour, Dominique Noguez est l'un de nos auteurs les mieux pourvus. Même si son excellent dernier opus, L'homme de l'humour, adopte un ton plutôt sérieux : l'humour n'est pas marié à la rigolade, Noguez le démontre en 70 pages très denses flirtant avec la philo, qui décrivent la forme extrême de l'humour, devenu attitude existentielle. L'homme de l'humour qui apparaît là est mieux qu'un sage, un héros ou un saint — et trop parfait pour exister. Noguez nous laisse avec plusieurs personnages fascinants, réels ou non, connus ou non, qui ont approché l'idéal, et une foule de subtiles remarques à méditer, où la force subversive de l'humour apparaît plus que jamais.
Noté une page d'une habileté diabolique où dans l'une des incarnations (quasi christique) de l'homme de l'humour, on finit par reconnaître... Renaud Camus ! C'est ce qu'on appelle un brillant paradoxe. Sans doute le comble de l'humour.
Réussi à trouver, enfin ! deux bouquins dont je rêvais.
Serpentine, de Mélanie Fazi, n'a qu'un seul tort : sa maison d'éditions, Oxymore, peine à parvenir aux libraires... Mélanie fut mon étudiante il y a six ans, j'étais curieux de la lire : elle m'a épaté, la bougresse. Ce recueil de nouvelles fantastiques a toutes les séductions du genre — sens du récit, de l'atmosphère, foisonnement de l'imaginaire —, avec en prime une réelle épaisseur humaine, et la densité d'une écriture sans fausses notes. Une sacrée maîtrise chez un auteur de vingt-huit ans.
Jean-Yves Jouannais, lui, est un fouilleur du réel, observateur de ce qu'on ne sait pas voir, découvreur de merveilles dédaignées. J'avais savouré de lui un livre définitif sur ce personnage-clef, le nain de jardin (Des nains, des jardins, Hazan). Je n'ai pas été déçu par Prolégomènes à tout château d'eau. Quel titre ! Quel texte ! En quelques pages, on fait le tour du château d'eau, cet objet aussi méconnu que magique.
Qui aime châteaux d'eau et nains de jardin est du même coup mon ami.
Longtemps cherché en vain ce texte, d'abord confiné sur Internet, aujourd'hui publié dans une collection confidentielle. Inventaire/Invention est d'abord une revue sur Internet (www.inventaire-invention.com) qui organise lectures et débats et publie sur papier de tout petits volumes. Au programme de la collec, du beau monde : Bon, Bouvet, Janvier, Lang, Mauvignier, Pirotte, Roubaud, Séréna, Viel...
La plupart des livres sont épuisés, comme on dit curieusement — y compris certains qui pourtant pètent le feu ! Pour en retrouver quelques-uns, testé la solution proposée par une pub dans Le Monde : 600 000 livres épuisés répertoriés, qu'on peut commander par Internet (www.chapitre.com) ou à la librairie Le tour du monde, 29 rue de Condé, 75006 Paris. Expérience concluante : sur cinq titres épuisés depuis longtemps, ils m'en ont trouvé deux — dont Armen, déjà évoqué ici. Frappé par l'efficacité, la simplicité du système, par la compétence et la gentillesse de l'accueil au magasin.
Grâce à chapitre.com, je viens donc de vivre en mer des instants inoubliables.
Armen, qui donne son nom au récit de Jean-Pierre Abraham, se trouve plus loin que le bout du monde, au large de l'île de Sein. L'auteur, qui passa quelques mois dans ce phare perdu vers 1960, nous fait partager sa traversée de l'hiver dans l'inconfort, le dénuement et la peur. Plus loin de la terre, dans un sens, que les astronautes alors à venir.
On pense aux explorateurs d'autrefois. Ou aux moines. Ce gardien de phare embarqué dans son aventure immobile, son ascèse dangereuse, est un peu leur frère, à cela près que sa recherche à lui apparaît plus extrême, et plus mystérieuse encore. «J'attends», dit l'homme, sans savoir quoi. Il a répondu à un appel impérieux, vague et pourtant évident. À l'immensité des éléments, à son désarroi non moins immense, l'humble guetteur d'infini oppose les gestes infimes des tâches quotidiennes. (On lit la page sur l'astiquage des cuivres en retenant son souffle.) Un livre de Reverdy et des reproductions de Vermeer l'aident à tenir, vacillant, obstiné. Rude histoire, accablante parfois, mais combien de livres parviennent-ils à nous imprégner peu à peu comme celui-ci, combien nous laissent-ils en fin de parcours l'âme à ce point agrandie ?
Merci à Françoise, merci à l'ami Alain qui m'ont guidé vers Armen, dont l'auteur est mort il y a quelques semaines sans faire de bruit.
Armen absent des librairies ! On croit rêver...
Visite annuelle au lycée Molière chez les khâgneux de mon amie Jeannine Garson. Au programme : traduire la poésie. Moment jouissif pour moi, comme toujours (cf. Rencontres avec les dieux).
Le dimanche 6 juin au matin je serai à Metz, Jardins de l'Esplanade, pour causer traduction dans le cadre de l'Été du livre (etedulivre.com).
Dans le numéro de juin du Nouveau recueil, un dossier grec préparé par Jean-Baptiste Goureau, avec notamment des textes de Jude Stéfan, Jean Roudaut, Dominique Grandmont, une étude sur Macriyannis, un conte traditionnel, un extrait de théâtre d'ombres... J'évoque pour ma part le musicien Vassìlis Tsitsànis et l'écrivain Còstas Taktsis.
Le 1er juillet, sur volkovitch.com, après un coup de vélo sur les chemins d'Île-de-France, on saluera Nabokov et Chardonne, on se souviendra pieusement de Yourcenar, on examinera dans quel ordre Larbaud, Duras ou Gailly posent leurs mots, on traversera la province grecque sur fond d'anciens chants populaires avant de faire le tour du monde avec la jeune Catherine Avermouck, héroïne d'Une petite ouvrière, notre nouveau feuilleton. Qu'on se le lise !