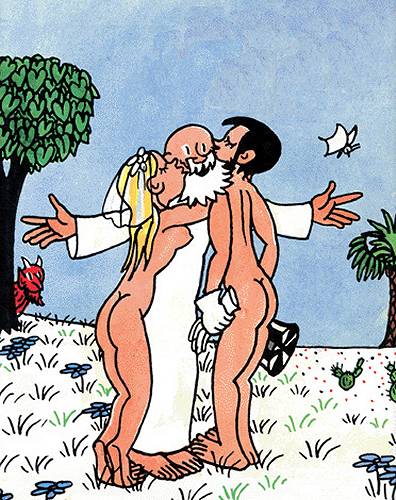
— Enfin, j'existe !
On imagine l'andouille comme un ballot, un benêt ; celle de ce mois, au contraire, est une grosse tête ! un pro de la pensée ! l'homme fort de la philosophie française ! Dans un de ses livres, un best-seller, il a trucidé Dieu ; plus tard, il a mis à poil, puis châtré à mort papa Freud ; il s'apprête à ridiculiser une fois pour toutes, je l'ai lu dans Paris-Match, ces petits connards d'écolos qui après ça rentreront sous terre, verts de honte. Cette star de la philo chasse les idées reçues, déboulonne les idoles, sa prose brillante s'étale dans livres et revues, son verbe éclatant subjugue des salles remplies d'adorateurs. Grâce à Michel Onfray, la philosophie a quelque chose d'Allègre (Claude).
Mais qui es-tu, Volkovitch, pour t'attaquer à pareil monument ? D'où te vient l'audace de flairer l'andouille en la personne de ce géant ? Avoue, pygmée !
Pour tout confesser, la source de ma fielleuse rancœur, c'est ma croyance quasi religieuse en ce que Freud a découvert — et non en l'homme Freud, qui m'importe peu. Qu'on essaie de nier l'inconscient, ou ne serait-ce que l'utilité de la psychanalyse, comme s'y essaie Onfray, et l'on me trouve prêt à mordre.
Ayant décidé, à titre exceptionnel, de lire sérieusement ma victime avant de baver sur elle mes insanités, j'aurais dû logiquement me plonger dans Le crépuscule d'une idole, sous-titré L'affabulation freudienne. Eh bien non : je risquais de m'énerver grave. Et surtout, c'eût été trop facile. Je préfère m'imposer la lecture du Traité d'Athéologie, de chez Grasset.
Un vrai défi ! Si j'en crois le résumé de l'ouvrage, puis sa quatrième de couve, je me trouve en accord profond avec l'auteur : je partage son incroyance, j'approuve sa description féroce du mauvais côté des trois grandes religions monothéistes ; sa démolition de saint Paul est cruelle, mais réjouissante, tandis que sa vénération pour Epicure me parait tout à fait sympathique et fondée.
Mais alors, où est l'andouille ?
Elle met du temps à prendre forme. Le lecteur d'Onfray est d'abord bluffé :
«On ne tue pas un souffle, un vent, une odeur, on ne tue pas un rêve, une aspiration. Dieu fabriqué par les mortels à leur image hypostasiée n'existe que pour rendre possible la vie quotidienne malgré le trajet de tout un chacun vers le néant.»
La pensée n'est pas d'une totale fraicheur, j'en conviens, mais quelle poésie ! Et quelle science ! «Hypostasiée»... Le tout un chacun des lecteurs, à qui l'œuvre visiblement s'adresse, va se ruer sur son dictionnaire, et moi de même. Un terme ésotérique çà et là décorant la prose onfraisienne, c'est l'idéal pour éblouir le lecteur, dissiper le vague malaise qui peu à peu le gagne tandis que la religion est sous ses yeux déconstruite. Car tandis que les ploucs dans mon genre simplement démontent, notre homme fait partie de ceux qui déconstruisent, ces prestidigitateurs ; il parvient ainsi à dissimuler, sous un nuage de mots savants, le spectacle de son andouillerie qui gonfle, lentement mais sûrement.
Il y a d'abord la sensation d'un manque, d'une tromperie sur la marchandise. L'auteur concentre ses tirs sur christianisme, judaïsme et islam, sans un mot des autres religions. Les bouddhistes, les animistes, ça compte pour du beurre ? N'a-t-il pas un petit côté andouille, cet ethnocentrisme naïvement arrogant ?
Il y a pire : le côté massif et sans nuances de la critique. La monochromie du tableau lui ôte sa vraisemblance. Nos trois religions ne font-elles vraiment rien que du mal, doit on les jeter tout entières aux poubelles de l'histoire ? Peut-on vraiment les accuser de «haine de l'intelligence», alors qu'elles ont eu recours à l'intelligence plus qu'à leur tour, leurs zélateurs déployant depuis deux mille ans des trésors d'ingéniosité, des raffinements inouïs de casuistique, pour justifier les croyances les plus scandaleuses, les plus idiotes ?
Aux mains d'Onfray, la philosophie quitte le tricotage de concepts pour la charge au bulldozer, le bombardement au napalm, le marteau-pilon broyant la noisette. Ce qui gêne à mesure qu'on le lit, c'est plus que tout ce côté répétitif, incantatoire : haine de l'intelligence... haine de l'intelligence... haine de l'intelligence... lancinant leitmotiv — mais tout chez Onfray revient sans cesse comme les litanies à la messe, comme s'il s'agissait non pas de convaincre, mais d'envoûter, de soûler, de faire passer en force des idées qui ne passeraient pas en finesse. Résultat : plus l'auteur enfonce le clou, plus il s'enfonce avec. Et lorsque, dans le chapitre «Les compatibilités christianisme-nazisme», par ailleurs judicieux par endroits, on lit que les Évangiles et Mein Kampf sont compatibles et que «les chambres à gaz peuvent donc s'allumer au feu de saint Jean», on s'étonne un peu tout de même, on a presque envie de défendre le christianisme à nouveau voué au bûcher.
Qu'il est maladroit, l'apprenti déicide... On ne tue pas Dieu. Onfray le sait pourtant, il l'écrit lui-même : «Le dernier dieu disparaîtra avec le dernier des hommes». Nier Dieu, c'est croire en lui encore. Taper dessus, c'est le ranimer. La seule chose qui puisse, non pas le tuer, mais l'affaiblir, le mettre hors d'état de nuire, c'est l'indifférence — celle d'un agnostique dans mon genre, ou même celle de croyants tièdes à la foi mollassonne. Mais si l'on s'obstine à en découdre avec Lui, il faut y mettre de la nuance, de l'élégance, la légèreté joueuse de l'humour, de l'ironie. La pensée, la parole doivent se faire vives comme l'oiseau, au lieu d'imiter le bouledogue et le rhinocéros.
Faut-il en vouloir à Onfray ? Lui-même, dans son pavé anti-freudien (j'ai fini par y jeter un œil), soutient que la pensée d'un philosophe sort tout entière de sa biographie, et ne vaut que pour sa propre personne. Avec deux exceptions : Nietzsche (son dieu à lui) et lui-même bien sûr. Pourquoi ce traitement de faveur ? À quelques pages de là, l'auteur nous révèle que dans son âge tendre il passa quatre ans pensionnaire chez les pères. Il y souffrit tant que la vengeance, pour lui, des dizaines d'années plus tard, se mange encore brûlante. On comprend tout. On lui pardonne tout.
Et même, on le remercie de nous éclairer un peu plus sur l'andouillerie, concept finalement plus complexe que je ne prévoyais, plus insaisissable, ainsi que sur l'intelligence — autre anguille philosophique. L'une et l'autre ne sont pas toujours antinomiques. L'intelligence, loin d'être la «vertu sublime» que décrit Onfray (dans une formulation étonnamment peu philosophique), est capable du pire comme du meilleur. L'andouillerie ne vient pas toujours d'un manque d'agilité intellectuelle. C'est une affaire de regard. Le point commun entre toutes les andouilles honorées ici au fil des mois : leur cécité, partielle ou totale. Elles sont aveugles à la réalité ainsi qu'à elles-mêmes. D'où leur commune carence en humour, cette vertu sublime, fille de la lucidité ; d'où aussi, c'est lié, la haute idée qu'elles se font de leur personne.
On pourrait presque oser cet axiome : tout vaniteux est une andouille.
Très fier de moi, je me récompense d'un petit éloge de Freud pour finir :
«Au pied de son divan, vers 1900, un médecin viennois découvre l'inconscient, les mécanismes du refoulement et de la sublimation, l'existence de la pulsion de mort, le rôle du rêve et mille autres trouvailles qui révolutionnent la psychologie alors à son stade préhistorique ; il met au point une méthode qui soigne, apaise, guérit les névroses, les affections mentales, les psychoses...»
De qui est-ce ? D'un certain Michel Onfray, dans le Traité d'Athéologie, cinq ans avant qu'il se mette à pisser compulsivement sur l'idole...
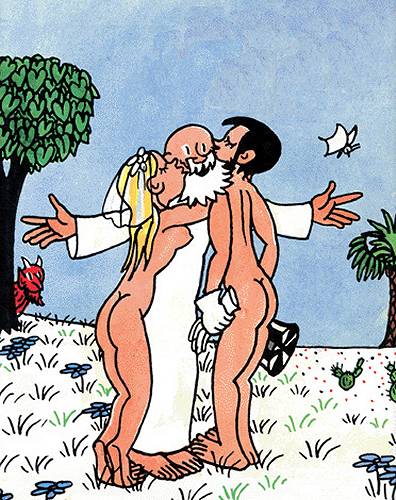 — Enfin, j'existe ! |