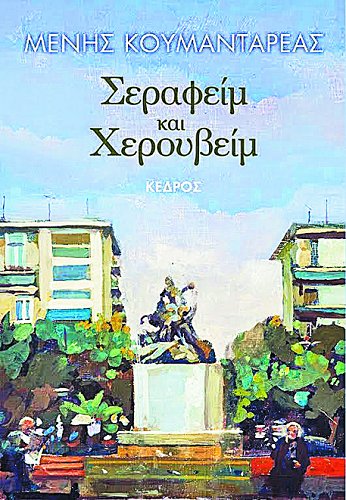
LA FEMME DU GÉNÉRAL
On l'a démolie, c'est vrai, la vieille maison en face de chez nous. Avec ses deux étages, ses tuiles rouges et l'araucaria dans la cour. Et les traces de balles de décembre 45. Mais moi, malgré l'immeuble qui a poussé à sa place, je la vois toujours.
L'été surtout, vers sept ou huit heures du soir, quand le soleil, après nous avoir tourmentés tout là-haut, descend pour se coucher derrière le mont Egàleo, sur les vitres qui reflètent la rouge féérie, je vois des lueurs, des ombres qui courent, à travers des stores à demi fermés j'aperçois un coin de chambre, un lit-cage à boules de cuivre, et allongé dessus un corps vêtu de blanc. La seule tache blanche dans la conspiration rouge du soir. C'est Mme Sàssi, la Sàssi, comme l'appelaient les voisins, à commencer naturellement par notre concierge le Hibou et notre bonne, la vieille Penelòpi.
Oui, je me rappelle bien cette maison. Néoclassique, simple et solide, comme savaient les faire les ouvriers d'autrefois, avec ses figures aux quatre coins du toit qui me semblaient, quand je partais pour l'école, des coqs prêts à chanter. Un lierre la recouvrait discrètement du côté ouest, comme pour la protéger de la réverbération, jusqu'au second étage où seul le balcon le dominait. Un balcon à l'ancienne, dont le fer forgé dessinait deux oiseaux au long bec, aux serres crochues — des dragons, pensais-je —, que ma mémoire embellit. Sur ce petit balcon donnant à l'ouest, le matin, après y avoir aéré les draps, étalés sur une chaise cannée à dossier rond, Mme Sàssi sortait armée de son grand bloc à dessin et de son chevalet. Car elle était peintre, disait-on dans le quartier.
Son mari, le général Sàssis, bien bâti, bronzé, voire corpulent, plus tout jeune, marchait en s'aidant d'une canne. On entendait, je me souviens, son pas incertain vers midi, et alors le portail de leur cour grinçait, orné de simples pointes en fer comme dans les châteaux du Moyen-Âge. Ce grincement m'indiquait le retour du Général. Au même bruit, aussitôt, madame Sàssi refermait son bloc et repliait son chevalet. Comme si le retour du Général la chassait d'un monde où elle seule pouvait entrer.
Le reste du temps, la maison était soumise à une discipline sévère. Derrière les rideaux à demi tirés, je devinais les allées et venues du Général, je le voyais dans la cour attacher son chien de chasse, un bâtard, lui donner à manger, à boire, le caresser — c'était sans doute le seul être que sa main caressait —, et alors son visage perdait cet air sévère et lointain du guerrier. Il était à la retraite, et le bruit courait qu'il devait sa mauvaise jambe à la campagne d'Asie Mineure.
Ma mère en le voyant éprouvait toujours une émotion particulière : il devait lui rappeler son père à elle, qui lors des Guerres balkaniques avait été l'aide de camp du roi Constantin. À preuve une très vieille photo du journal Akròpolis où derrière le Chef des Armées on distinguait la noble silhouette d'Aristìdis Angelòpoulos-Athànatos — ma mère avait porté ce nom. Elle parlait sans cesse d'encadrer la page, négligeait sans cesse de le faire, si bien que le papier avait fini par jaunir, brouillant l'image du grand-père à jamais.
Cependant les mauvaises langues — le Hibou en tête — soutenaient que la blessure du Général était due à un simple accident, qu'il s'était tiré dessus en nettoyant son arme. J'admettais cette version, sans sous-estimer les guerres auxquelles il avait dû prendre part ; elle me semblait mieux correspondre à l'expression toujours sombre et distante de cet homme, et il me plaisait d'attribuer sa blessure à un duel de l'ancien temps — comme dans les livres de Tourguéniev et Tchekhov que je dévorais —, duel sûrement causé par une rivalité amoureuse. J'imaginais une femme toujours vêtue de blanc, allongée, une main hors du lit, ses cheveux dénoués où jouait un rayon de soleil. Qui était-ce ? Mme Sàssi elle-même — Kekilìa, comme elle se prénommait ?
Que le Général se soit battu en duel pour sa femme, cela me semblait autant croyable qu'incroyable. En dehors de cela, ces deux-là semblaient être le jour et la nuit. Peut-être, à une certaine époque, au début de leur mariage, le Général avait-il adoré sa femme. Mais c'était alors précisément, peut-être, que Kekilìa était tombée amoureuse d'un jeune officier d'ordonnance de son époux. Ce devait être un grand romantique, me disais-je, aux longs cheveux blonds, avec une petite moustache claire à reflets blonds, un peu comme les cheveux de Kekilìa. Je le voyais toujours fourré chez eux, suivant le Général comme son ombre, élégant, rêveur, les yeux vissés sur la maîtresse de maison. Un soir, peut-être, l'époux étant à la chasse, tous deux s'étaient trouvés, dans cette même chambre, que les lueurs du couchant et les volets entrouverts me laissaient deviner. Peut-être aussi, qui sait ? était-ce le fantôme de l'officier perdu que la femme du Général s'efforçait de retrouver sur la toile. Car une chose était sûre : même s'il s'était blessé, le Général l'avait tué — liquidé. Lavant l'honneur de son foyer une fois pour toutes.
Avec les années, l'éclat du Général n'avait cessé de pâlir. Je me souviens de lui dans ses dernières années, la démarche plus lourde, sa canne peinant à le soutenir. Le portail de fer avait un grincement rouillé, et le vieux chien hurlait de temps à autre, comme pris d'un pressentiment. Le couple à présent restait enfermé pendant des heures dans la maison, une maison dont ne sortait pas le moindre bruit de voix, mais rien que de la poussière le matin pendant le ménage, tandis que le soir une brume se déposait sur les hortensias du balcon, bouchant les trous laissés par les balles.
Les hortensias de la femme du Général étaient aussi hauts que moi, touffus et frais, et elle les arrosait tous les soirs, jetant à nos fenêtres un regard distrait — un peu narquois sans doute face aux balcons sévèrement géométriques de notre immeuble, construit entre les deux guerres, précurseur de ceux qui allaient suivre. Son œil, parfois, s'attardait sur moi, puis se détournait. Elle sortait rarement désormais pour peindre. J'imaginais son chevalet relégué dans un coin de la chambre comme son bloc à dessin fermé, sous la poussière et les toiles d'araignée. Je désirais la revoir sur son balcon, enivrée comme une rose au soleil, absorbée dans sa tâche, son œil distrait tombant de temps à autre sur le monde extérieur, sur ses habitants, et parfois, comme surprise de se voir observée, me sourire. Qui sait pourquoi elle me souriait ? J'étais flatté, croyant être le seul dans le quartier à qui elle montrait ses éblouissantes fossettes. Peut-être devinait-elle que moi aussi je barbouillais du papier, et m'efforçais maladroitement de remplacer la vie par une autre, plus riche, plus généreuse. Comme si chacun de nous avait plusieurs vies à vivre...
Mais la vie était encore belle et simple alors, dans notre quartier, les trams jaunes passaient en ferraillant dans l'avenue Patissìon, l'arrivée du métro — toutes les demi-heures — était marquée par des groupes de gens montant les marches sans anxiété ni bousculade, une voiture passait en klaxonnant et les taxis noirs à marchepied, dont le museau carré s'ornait d'un ange à petites ailes, attendaient patiemment leurs clients, alors en nombre limité. La place aux mûriers était toute fleurie au printemps, des petites feuilles vertes pointaient comme des yeux, et en plein été la poussière s'élevait dans une ivresse de robes imprimées, de mousselines, de messieurs en costumes clairs impeccables, tandis que des serveurs vêtus de blanc traversaient la rue du Trois-Septembre, des crèmes glacées plein leurs plateaux.
Pendant l'hiver de 45, le Général mourut. Le maudit chien hurla toute la nuit. Au petit matin, on trouva un sombre faire-part collé au montant du portail, qui ce jour-là grinça sans arrêt, laissant passer une foule de gens. Les employés des pompes funèbres, les parents, le fils du défunt — militaire lui aussi, qu'on voyait pour la première fois, petit sous-lieutenant maigrichon à la barbiche en pointe. La vieille Penelòpi pleurait et se lamentait en accourant nous informer la première, d'un ton tragique propre aux femmes du peuple : «ah quel malheur, le Général n'est plus, quel malheur, il est mort ce brave homme, et cette brave dame qui reste seule comme le roseau dans la plaine, ah la malheureuse...», et elle se griffait les joues.
Nous restâmes plusieurs jours sans voir la femme du Général. Les volets étaient clos, toute la maison recroquevillée sur elle-même, barricadée, livrée aux araignées. Mais au bout d'une douzaine de jours, un matin, soudain, les volets s'ouvrirent et la femme du Général, comme par magie, apparut.
On se serait attendu à voir une femme de quarante-cinq ans vêtue de noir, blême et abattue. Mais elle portait un négligé jaune tirant sur l'orange, dont les larges revers s'ouvraient sur un décolleté audacieux, ses cheveux étaient relevés en chignon et elle tenait — mais oui — son bloc à dessin. Elle s'assit sur une chaise dans un coin du balcon et après avoir examiné un peu l'hortensia, puis jeté un coup d'œil aux géraniums et aux œillets, elle fit le geste de leur jeter une poudre — magique, à ce qui me sembla, car les jours suivants nous les vîmes se dresser et fleurir. Comme si tout, d'un seul coup, dans la maison et au dehors, se réveillait, ressuscitait. Jusqu'aux traces de balles, cicatrisées elles aussi.
Dès lors, chaque matin, s'abritant du soleil dans le renfoncement de la porte-fenêtre, Mme Sàssi, Kekilìa, posait son chevalet et poursuivait son œuvre en toute quiétude. Elle devait être en grande forme, car je la voyais souvent les joues en feu, l'œil brillant, se pencher pour piqueter son tableau de petites touches, puis, comme repoussée soudain en arrière par un grand coup de vent, s'éloigner de deux pas, contempler la toile à distance, et revenir pour corriger ou ajouter un détail. Elle portait toujours de longs déshabillés jaunes ou roses, et ses cheveux châtains aux reflets roux s'argentaient vaguement aux tempes. Elle ne faisait pas le moindre effort pour les cacher. Tout son être semblait régénéré, assuré soudain d'atteindre un but qu'elle poursuivait sûrement depuis des années. À présent, on le sentait, elle en était proche.
Jamais je ne l'avais vue aussi belle qu'en ces jours de 45.
C'est alors, pendant les pauses de son travail et celles de mon étude, que s'instaura entre nous un dialogue timide. Elle, d'abord, se penchait à son balcon.
— Bonjour, tu vas bien ?
Et moi, baissant les yeux :
— Ça va, merci, et vous ?
Ces petits intermèdes me troublaient tant qu'ensuite, pendant longtemps, je voyais des plaies sur les jambes des saints dans le livre d'Éducation religieuse, et des petits chapeaux sur les racines carrées.
— Qu'est-ce que tu lis ? demanda-t-elle un jour d'une voix sonore comme un coup de trompette.
Je la regardai.
— Je fais mes devoirs... dis-je d'une voix faible et retournai au livre ouvert devant moi.
— Tes devoirs... fit la voix moqueuse venue du balcon d'en face, comme un écho.
— Et vous, dis-je hardiment, incapable de souffrir plus longtemps, qu'est-ce que vous peignez ?
— Bien des choses, fit-elle d'un air mystérieux — l'air de dire, on n'en finirait pas —, viens voir un jour de plus près.
J'approuvai joyeusement de la tête. Mais je me trouvais alors en pleine panique à cause des examens, et d'autre part je ne souhaitais pas que ma famille soit au courant. Pour rien au monde je ne voulais que des tiers interviennent avec leurs commentaires profanateurs. J'aurais droit, c'était mathématiquement sûr, à leurs remarques ironiques, «qui se ressemble s'assemble», «les deux dingues font la paire», et ainsi de suite. Pour ne rien dire des commentaires du voisinage qui déjà se déchaînaient : le deuil n'avait même pas duré quinze jours, le tombeau du général à peine refermé elle ne pensait plus qu'à ses pinceaux. On eût dit que la peinture avait le pouvoir magique de profaner la mémoire des hommes.
À la fin de l'année scolaire nous délaissâmes provisoirement la place Kyriakou et partîmes en vacances à Kifissia — telle était la coutume alors — où nous avions loué une maison. Si bien que pendant tout l'été je perdis de vue Mme Sàssi, la Sàssi comme l'appelaient les gens du quartier, qui goûtaient peu les comportements trop modernes. Assis sous un platane à l'ombre épaisse, l'eau coulant à mes pieds dans les rigoles — on n'avait pas encore asséché Kifissia —, je barbouillais mes papiers, mes pensées tournant autour de la femme du Général. Elle est en train de peindre, sûrement, pensais-je. J'avais l'impression d'un compagnonnage entre nous. Lisant ces jours-là «Sous le chêne royal» de Papadiamàndis, je me sentais possédé moi aussi, hanté.
L'hiver suivant, un hiver froid où l'on ne parlait que des combats de la guerre civile et des difficultés économiques — mon père rentrait du bureau toujours pensif, son regard semblait me traverser —, l'ombre de Mme Sàssi restait derrière sa fenêtre, lointaine et inaccessible. Je distinguais son chevalet, ses mains qui s'affairaient, leurs belles veines devenues plus saillantes, un tas de chiffons pleins de peinture autour d'elle, où elle s'essuyait les doigts, de beaux doigts blancs. Les rares fois où un rayon de soleil l'attirait sur le balcon, nos regards se croisaient. Et ses questions reprenaient.
— Eh bien, notre jeune homme a-t-il oublié sa promesse ?
— Non, pas du tout, disais-je, rougissant jusqu'aux oreilles.
— Alors quand nous fera-t-il l'honneur de nous rendre visite ?
— Dès qu'il pourra, répondais-je, à la troisième personne moi aussi, ravi de ce que nous ayons inventé un code à nous.
Mais je ne cessais de penser à ma famille et j'hésitais à avouer que je devais demander leur accord. Telle était alors la règle entre parents et enfants.
— Viens la semaine prochaine, sans faute, quand j'aurai terminé, dit-elle, désignant du menton le chevalet qui attendait dans l'ombre, à quelques centimètres du lit dont les franges dépassaient et tombaient en pluie.
La semaine prochaine arriva et je rongeais mon frein. J'avais fait le nécessaire, prévenu mes parents que peut-être, un des après-midis qui venaient, je prendrais le thé chez la femme du Général.
— Le thé ? demandait mon père, soupçonneux. Et tes devoirs ?
Et ma mère :
— Que vas-tu chercher là, je ne comprends pas, tu es un enfant, elle a plus de quarante ans...
Mais ce qui les préoccupait, aucun doute, c'était le qu'en dira-t-on. Cela seul comptait pour eux.
— Eh bien d'accord, je t'attends demain, me dit un jour Mme Sàssi, demain cinq heures, ça te convient ? Et n'oublie pas — elle eut un sourire qui me sembla ironique — apporte tes écritures, qu'on y jette un coup d'œil.
— Mes devoirs ? dis-je, feignant l'ignorance.
— Non, dit-elle avec un sourire coquin, ce que tu gribouilles...
J'en eus les jambes coupées, délicieusement.
Cette nuit-là mon sommeil fut agité. J'avais sans cesse devant les yeux le matériel de peinture, le lit blanc à boules de cuivre, et j'étais pris d'une ivresse. Je nous imaginais assis l'un en face de l'autre, je rêvais de voir son visage, ses yeux humides et distraits, d'entendre le son de sa voix un peu rauque, vaguement ironique, et sous je ne sais quel prétexte m'asseoir au bord du lit, sentir un peu la fraîcheur des draps qui embaumaient sûrement la lavande, tandis qu'elle me demanderait, en effleurant ma main :
— Eh bien dis-moi ce que tu fabriques, ce que tu mijotes — tu ne veux pas me lire quelque chose ?
J'aurais mieux aimé mourir plutôt que de lire pour cette femme inaccessible. Ce que j'écrivais, à côté de son travail à elle, me semblait nul, même pas digne qu'on le mentionne. Par contre, je mourais d'envie de voir ses tableaux, de me perdre dans leurs couleurs.
Mais que peignait-elle donc ?
Des paysages tropicaux, sûrement, pensais-je, avec des palmiers, des mers d'Orient lisses comme des miroirs où passaient des felouques pleines d'indigènes. Le genre d'images qui abondaient dans les livres de Jules Verne. Ou plutôt non. Elle devait s'en tenir à ce qu'elle connaissait, ce qu'elle avait vécu. Elle peignait peut-être, qui sait, notre quartier, sa propre maison, ou notre immeuble, ou encore la place Kyriakou dans une brume de chaleur à quoi se mêlait la vapeur montant des crèmes glacées, où se fondaient et se pâmaient les couleurs. Le désir de voir et d'apprendre à travers les yeux d'un autre les secrets d'un art voisin, était-ce donc cela qui me poussait chez la femme du Général ? Ou me suffisait-il de voir les yeux de Kekilìa et d'entendre sa voix ? À moins que ces deux désirs n'en fassent qu'un ?
La visite chez la femme du Général n'eut jamais lieu.
Le lendemain matin, j'avais commencé à me préparer, à choisir les vêtements que j'allais mettre, lorsqu'un court billet de Mme Sàssi nous informa qu'une indisposition la clouait au lit. Son petit carton blanc corné — comme ceux de Séraphin — me fut remis par Penelòpi. La vieille avait les yeux brillants et son sourire, où quelques dents manquaient, semblait vaguement triomphant.
— Elle est comme ça ! dit-elle sans détours, elle ne tient pas sa parole. Elle n'a pas de parole, cette femme-là.
Le verdict de mes parents ne fut pas moins écrasant.
— Avec tout ce qu'elle fume, dit mon père lors du déjeuner, ça ne m'étonne pas qu'elle ait la tuberculose !
— Dire que tu aurais pu boire dans la tasse de cette femme ! dit ma mère toute pâle. Un peu plus et tu l'attrapais aussi...
Et comme j'avais l'air abattu, et que cela continua toute la semaine, mes parents tâchèrent de me distraire par tous les moyens, promettant que nous irions ce samedi-là au cinéma, et le lendemain chez ma tante Dòra, qui habitait place Agàmon, voir mes cousins et écouter Yòrgos, le plus jeune, jouer du piano. La «Lettre à Elise» de Beethoven et «Rêve d'amour» de Liszt.
La fenêtre de la femme du Général mit un très long temps à se rouvrir. Pendant tout l'hiver elle resta hermétiquement fermée, les rideaux tirés, le chevalet et le lit à franges invisibles. Il pleuvait beaucoup, il y eut même de la neige. Assis derrière ma vitre, le livre de géométrie sur mes genoux cachant dieu sait quels autres livres, je levais les yeux vers la fenêtre fermée d'en face. Un poids se posait sur ma poitrine, et le sommeil sur mes paupières.
J'imaginais toujours la même chose. L'ouverture de la porte en fer, qui grinçait affreusement — comme au temps du Général —, la montée des marches, et elle sur le perron, son déshabillé entrouvert sur la poitrine, m'offrant son sourire à fossettes et me laissant le passage. Mais j'avais beau imaginer, impossible de me représenter précisément la chambre, les bruits, les sièges, les tasses à thé, le bloc à dessin, le grand lit blanc. On eût dit qu'un bandeau me couvrait les yeux, une censure m'empêchait de poursuivre, et toujours je perdais le fil, m'énervais, jetais au loin les livres défendus et rouvrais celui de géométrie. Je voulais revenir sur terre, et j'y parvins, cet hiver-là du moins.
C'est alors qu'on apprit par le bouche à oreille que l'état de la femme du Général empirait. Elle était, disait-on, très malade, on avait dû la transporter à l'hôpital dont on ne savait si elle ressortirait vivante. À la même époque, en plein hiver, on nous informa qu'elle avait vendu sa maison et qu'à sa place, bientôt, on allait construire un immeuble.
La maison aux quatre coqs et aux deux dragons s'effondra sous mes yeux. À mesure qu'on la démolissait, les murs intérieurs apparaissaient un à un, l'un dans les tons roses, l'autre bleu ciel. Là où naguère se trouvaient des chambres, des meubles, des habitudes, pendaient à présent de grands morceaux de plâtre que retenait l'armature métallique du bâtiment, comme un fil où seraient suspendus les destins humains. Et tandis que les examens approchaient, mon désespoir fut à son comble un matin quand les ouvriers vinrent couper l'araucaria. Chaque coup de hache éloignait mon enfance un peu plus. Cet arbre m'avait servi à compter les hivers et les étés. À présent je sentais que c'était la fin. Bientôt la maison fut tombée, on posa les nouvelles fondations, on monta les échafaudages. Un nouveau monde, en béton, sortait de terre.
Je passai les examens tant bien que mal et l'été, comme toujours, nous partîmes pour Kifissia.
Cette fois nous n'allâmes pas dans la maison au platane. Nous logions à l'hôtel, entourés de personnes âgées, et je me baladais seul à vélo, sans amis, sans but et sans frein. Je n'écrivis pas un mot de tout l'été. Le platane me manquait. La compagnie de cette femme aussi. J'étais désespéré à l'idée que l'automne venu je ne pourrais pas retourner chez elle. Car j'y étais déjà allé en imagination, une seule fois. Inoubliable.
Bien plus tard, une fois l'immeuble construit, la femme du Général vint s'installer dans un appartement au troisième étage, en compagnie cette fois de son fils, le sous-lieutenant, entre-temps promu au rang de capitaine, qui avait coupé sa barbiche en pointe et laissé poussé aussi sec une épaisse moustache. Kekilìa, comme par miracle, avait vaincu la maladie — disait-on dans le quartier — mais c'était désormais une infirme.
Je la revis sur le balcon de l'immeuble que s'efforçaient de décorer des géraniums anémiques, un soir d'été où elle sortit vêtue d'une longue robe noire, comme si le deuil qu'elle avait ignoré revenait soudain se venger. C'est à peine si elle me jeta un bref regard distrait, ne m'ayant peut-être pas reconnu — j'avais grandi pendant tout ce temps, bien qu'on m'ait coupé mon arbre — et elle se hâta de rentrer dans sa pièce obscure.
Cette pièce, le peu que j'en aperçus, était un salon assez luxueusement meublé, aussi distingué qu'insignifiant. Pas de chevalet, de bloc à dessin, de lit blanc aux franges tombant comme la pluie. Mme Sàssi elle-même, Kekilìa, avait des cheveux presque blancs — d'un blanc teinté de rouille — qu'elle ne se donnait pas la peine de teindre, et toute son allure sentait la négligence et l'abandon. La fée n'était plus qu'une femme comme les autres.
Dès lors, ses apparitions à la fenêtre se raréfièrent, son regard, chaque fois qu'il se tournait vers nous, était vide comme dans l'ivresse, et les mauvaises langues du quartier disaient qu'elle s'était mise à boire seule. Souvent, les soirs d'été — qui n'étaient plus les mêmes qu'avant, avec le bruit assourdissant, les gaz d'échappement qui salissaient le ciel —, je voyais une vieille femme assise à l'intérieur, sans la moindre lumière, à part une mystérieuse lueur clignotante. La jolie femme, apparemment, avait abandonné ses crayons et ses couleurs. Perpétuellement allongée, elle regardait la télévision. Et elle avait, perpétuellement posé à côté d'elle, un verre d'alcool.
Pendant ce temps, Penelòpi ne travaillait plus chez nous, le Hibou avait abandonné sa loge, ma grand-mère était dans l'autre monde, mon père devenait plus sombre et ma mère plus nerveuse, excédée par les tâches ménagères. Quant à moi je n'étudiais plus, n'ayant pas de projets précis. Tout avait changé.
Ce qui ne changeait pas mais prospérait toujours, c'était, insistantes et sans remède, les rumeurs concernant cette femme. Selon certains, pendant que son fils était à la caserne, elle recevait des amants en cachette — des hommes très jeunes, de plus en plus jeunes — et que ce n'était pas la première fois, qu'elle avait fait la même chose dans sa jeunesse, du vivant de son époux. Ces rumeurs et la méchanceté des gens se déchaînaient au point que certains soirs je croyais entendre les pas du Général, puis le grincement du portail. Un bruit sec retentissait à mes oreilles, comme un coup de feu, et alors, dans le silence tendu qui suivait, je savais que l'honneur de la maison était vengé, que les rêves étaient morts. Pendant ce temps, un verre se vidait, un autre venait le remplacer, tandis que clouée dans un fauteuil poussiéreux elle regardait encore et encore la télévision.
Jusqu'au jour où la sirène des pompiers, un matin, vint semer la panique dans le quartier. En rentrant à midi j'appris que la femme du Général s'était endormie dans son fauteuil en laissant la télévision allumée. Le feu avait pris dans l'appartement, l'immeuble et la pauvre femme avaient été sauvés de justesse. Elle, avec des brûlures au second degré.
Malgré tout — à ce qu'on dit — elle vit encore. Mais très vieille sans doute, et oubliée. Elle ne sort jamais et trouve moyen de boire bien qu'on le lui interdise. Les soirs d'hiver, quand le vacarme de la rue s'apaise, je tends l'oreille et alors je crois l'entendre. Elle hurle toute seule. Comme le chien de son mari. Les sirènes de pompiers, les bruits, les émanations, tout se mêle dans mon sommeil, je me réveille trempé de sueur et m'assieds à mon bureau, devant une page abandonnée la veille. J'essaie de voir où j'en étais, comment continuer, le faut-il, et tournant les yeux sans cesse vers la fenêtre je tâche de percer l'obscurité où baigne la rue.
Voici la vieille maison, l'araucaria, les coqs sur le toit qui chantaient à l'aube, les dragons du balcon. Et voici le chevalet. Posé dans l'ombre, il attend. Dans le soleil de la fin de journée, qui après avoir culminé là-haut, descend pour se coucher derrière le mont Egàleo, je vois courir des lueurs, des ombres. Alors je me lève, je mets mes beaux habits, je me coiffe et me voilà prêt à descendre les marches.
L'invitation de la femme du Général tient toujours.
Mènis Koumandarèas est mort assassiné en décembre 2014, à 83 ans. J'ai dans mon tiroir un livre entier de lui, Séraphins et Chérubins, l'un des plus beaux, qu'il ne verra donc pas traduit en français. Les nouvelles qui constituent ce recueil paru en 1981 peuvent être vues comme les chapitres d'un roman, ou peut-être d'un récit autobiographique. L'une d'elles, «Christos», se trouve déjà ici même ; voici maintenant «La femme du Général», en hommage à l'ami disparu, et en attendant la parution de l'ensemble, dans quelques mois, quelques années ou quelques décennies.
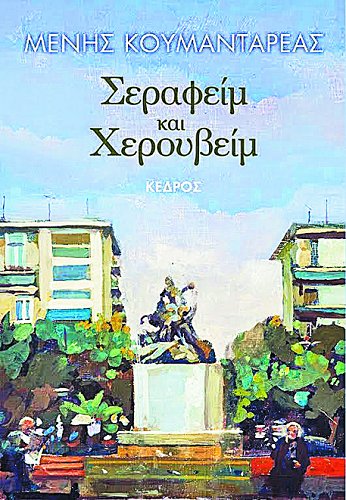 |