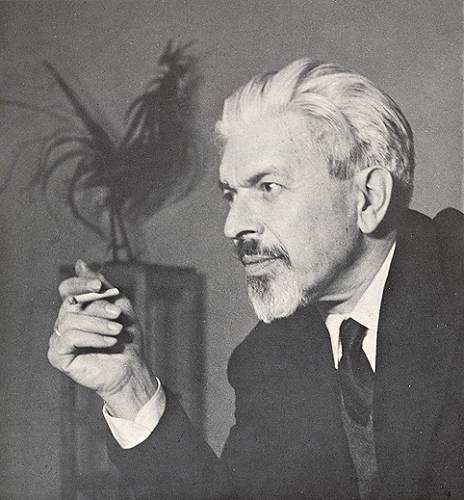
Andrèas Embirìkos.
Buissons de l'incubation
Et chardonnerets dans des cages de verre
Trônent parmi les parfums d'une journée au sang chaud
De leurs frissons des sons jaillissent et retombent
Et les fenêtres soudain s'ouvrent et s'ouvrent aussi les sources
Et les enfants courent chercher leur pain
De leurs doigts coulent des étincelles
Ils se changent en oiseaux qui transfusent
Une tiédeur accrue par le soleil
Dans les terres et les vagues
Dans les montagnes et les sporades
Où tout pulse et attend
Les orgasmes de l'été.
Au fond de notre soif les poulains fumants
Vont et viennent agneaux dans la bergerie
Avec des rubans verts comme les prairies
Avec des colliers vert émeraude
Comme ceux qui descendent
Entre les seins de femmes décolletées
Avec des formes de feuille de platane
Soudain une femme se déshabille
Et s'installe nue et pleine de grâces
Au milieu des feuillages d'un arbre
Attendant on ne sait quoi —
Sans doute la manne céleste
Sans doute son amant.
Rien ne retient une abysse de sirènes
Elle descend plus au fond étaler ses plages
Pour les amours des belles créatures
Montrant leurs seins sur leurs paumes posés
Sous les yeux des tritons tout nus
Parmi les algues des villes de la mer
Ou dans le vert des grottes englouties
Sans les ragots des places publiques
Reflets brillants appâts lumineux
Qu'aussitôt les tritons empoignent
Avec des rires et des brasses rapides
Vers les sirènes plongeant tout joyeux.
Chat sur les marches en sa splendeur
Chaton dans le lit telle une femme
Femme telle un chaton sous la caresse de mes mains
Main qui sais glisser caressant
Des jardins féminins les roses
Telle une rose des vents qui roule
Chariot dans les pétales de rose
Telle une prière de derviche qui tourne et tourne
Et à la fin tombe en extase.
Les hautes fenêtres de Colombie
Loin de l'Amazone pleurent les amazones
Qui ont perdu les rênes des chevaux
Et maintenant courent presque nues comme des nuages
Sur l'herbe de leur liberté
Perpétuels vaisseaux de leur propre voyage
Avant de dégrafer leurs tuniques
De sortir leur poitrine
D'aller dormir dans les bras de leurs cousins
Gardant l'écho de Santa Fé en mémoire
Et le cours du Rio Bogota dans leur corps
Qui trace entre leurs seins
Un autre partage d'amours nocturnes
Malgré les sifflements des serpents
Du fleuve Amazone qui les a baptisées
Malgré le grouillement des alligators
Du fleuve Amazone qui les a vénérées
Malgré le bourdonnement des insectes terribles
Du fleuve Amazone qui les a caressées
Dans les plus denses des plantations de plantes odorantes
Du fleuve Amazone qui les a marquées
D'une contrée vierge elles émettent le vœu
Comme cadeau du printemps comme un grand midi
Et face à elles à présent debout
Des géants doux intelligents tranquilles
Éblouis palpitants les contemplent
Avec des mains larges puissantes que parfois
Tandis qu'ils regardent et attendent
Ces géants fourrent dans leurs poches.
De nombreuses femmes sont pareilles
Aux tourbillons de danses de l'ancien temps
Où coquettement elles se balancent
Et nues jusqu'à la taille tourbillonnent
De leur mémoire jusqu'aux jardins et leur verdure
Le soir quand les feuilles chuchotent
Sous les lumières qui brillent aux arbres
Et les enfants rougissent près des citernes
Et leurs baisers ont un goût de résine
Leurs mains posées
Sur les seins des danseuses
Et leurs chevelures.
Écoute le son il casse les pierres
Et des étoiles filantes s'abattent sur les pistes
Sur les terrains les ballons sautent
Comme des ballons de rugby des melons
Dans les tribunes les dames élégantes
Et les jeunes filles en pull-over
Applaudissent et crient sans cesse
«But ! But ! dans les filets de l'ennemi
Mais jamais dans les filets de la mort.»
Dans le sable on sème les fleurs
Des hippocampes car sont brisés les fils
De la barrière énorme
Alors que couve avec passion dans le sable
La lézarde laquelle ne s'est pas traînée en vain
Jusqu'en bordure des eaux
Avec le vieux phare sur la hauteur
Qui regarde
Les étoiles du couchant et les amoureux
À l'heure des amours dans les prés
Du pacage des bœufs d'une nouvelle récolte
D'humains libérés par couples
De la vraie vie insouciante
Du vrai travail partagé
En actes et œuvres plus grands
Que la queue d'une baleine énorme
Quand elle gifle la mer et frappe
Les vagues juste en face du phare
Au lieu de nourrir de gros oiseaux
Qui mangeaient les souris naguère sur les tuiles
D'un matou puissant dont les griffes
Sont teintes en rouge par une jeune paysanne
Pleine d'ardeur aux bijoux joyeux
D'origine printanière et d'azur
Le cœur tout plein de chardonnerets en feu.
La nature est comme un grand jet d'eau
Qui toujours qu'on le veuille ou non nous emporte
Arrive l'heure où baluchon sur le dos
Nous plongeons dans le sommeil
Comme les cloches des plongeurs
Dans les abysses des nombrils de la mer
Cherchant explorant trouvant
Des désirs en éveil tels des troupeaux compacts
Mêlant leurs cris aux fleurs
Dans la flore du fond des abysses
Comme sur la terre dans les prairies
Quand écartant les ombres nous courons
Vers nos plus hauts sommets
D'où à perte de vue * nous voyons le monde
Ou vers des bouquets d'arbres près des côtes
Où des enfants portant des gris-gris sur la poitrine
Jouent nus et tombent dans les filets des pêcheurs
Pleins de clameurs joyeuses qui sont comme les échos
Des cris des Achéens devant les murs de Troie.
Une statue prend vie elle descend
De son socle et découvre
Dans la brume de l'été une ville toute jeune
Ses bâtiments élevés à l'entrée
Ses jardins insondables à certaines heures
Où le mystère se dissimule
Où les fleurs frémissent
Où celui qui se cache sent le besoin de se montrer de respirer
Tandis que dans les faubourgs les cigales font la fête
En haute fréquence perçante inlassable
Vague venant submerger tout l'espace
Chaque vibration chaque grincement est plus intense
Chaque vibration est une cigale
Chaque cigale est une vibration
Qui se développe s'élève et culmine
Tandis que transpirent les corps et les troncs d'arbres
Et la résine déborde des godets
Posés par les servants des arbres
Afin de recueillir les grosses gouttes
Qui se décollent et tombent une à une
Comme des bonbons translucides que désirent
Les plus modernes des enfants bouche ouverte
Et leurs âmes déployées dans l'air.
Du défoulement l'ambre noir
Se reflète aux coquilles éclatantes
Comme l'écho qui revient puis se brise
Bulles en éveil et capsules
D'une rangée de phénomènes qui se trouvent
Non dans l'hésitation des générations à venir
Mais dans l'envoi droit en l'air des injures
D'un clair-obscur géant sur le monde
Et des nouveaux rallumages qui tendent
À devenir théâtre
Dans la timide prolongation du silence
Qui malgré tout se brisera un jour.
Les blés dorés
Les plaines couvertes de coquelicots
L'ivresse des métiers à tisser dans la main
De la bonne sœur isolée qui s'agite
Dans les tièdes nuages d'une scène imaginée
Ou la terrible peur de la famine
Adroit remède à la fuite du temps
Ardent effort d'instauration d'une présence.
Le limaçon assiste le petit navire
Près de la mer l'archange livre bataille
Aux escadrons de cavalerie qui chargent
Comme un panache de fumée verte
Sans la moindre
Minuscule parcelle
D'indignation.
La force du destin reçoit le témoignage d'hommes
Aux membres ensanglantés par les membres de leur famille
La tyrannie des uns sur les autres et les yeux largement ouverts
De l'inquiétude continuelle des uns
De la protestation perpétuelle des autres
Ils ont appris des mouettes les cris qu'ils doivent émettre
Depuis la terre et à travers les arbres
Dont les feuillages souvent laissent monter les soupirs de la ville
Et descendre les fourmis jusqu'aux racines de la maison
De la femme dont le nom est Dévoilée
Personne n'est plus absent de la chambre
Où l'on a tué Dévoilée
Un jour (après midi)
Un jour avant sa sieste
Et à l'entrée les assassins ont dit
«À présent elle repose
Comme Sappho dans les bras des filles et de Morphée»
Et vraiment tout comme Sappho
Dévoilée dormait ou s'éveillait
Instruisant les jeunes filles s'adonnant au plaisir
Tantôt avec elles et tantôt seule
Toutes ses meilleures élèves
Toutes le buisson ardent toutes frottant leurs seins
Vases pleins d'élégance et de lait
Du lait de la volupté toujours au bord de déborder
Et à présent comme au temps de Sappho
Les meilleures élèves de Dévoilée
La suppliaient de les envelopper toutes
Dans les voiles de navires qui accomplissent en plein rêve
Leurs voyages cajolés par la brise
La coque plongée profond dans les eaux des caresses
Dans les vagues des grands frissons
Dans les mers de la mémoire
De toutes les filles et les jeunes gens qui savent
L'importance des pôles et de toute zone tropicale
Et la valeur des dévoilements ultimes
Des filles et des garçons tous poulains et pouliches au sang chaud
Qui courent dans les prairies avant de prendre un peu de repos
Où de goûter les plaisirs amoureux dans l'herbe
Quand la lance du désir aiguillonne les sens
Que s'agitent les gris-gris et que s'agitent les corps
Et que tressaillent
Comme des balles en caoutchouc les seins
Sur la cendrée des ruts et des saillies
Sur la cendrée de la volupté
Sur la cendrée des caresses douces ou débridées
Et que tous les harnais et les colliers sonnent comme des sistres
Sur les corps des athlètes de l'amour
Des athlètes qui pas un instant cette année
Ne cesseront leurs lascifs exercices
Korês kouros chevaux
Devant les élèves interloquées de Sappho
Qui contemplant la mort dans l'âme
Les jeux des garçons et des filles
Se tordent de jalousie
Jusqu'aux pointes dressées des seins
Et des vibrants clitoris
Depuis le plus profond du cœur
Jusqu'aux extrémités de l'âme
Tandis que sont répandus les écrits du destin
Par les donneurs de brillants oracles
Sur des étoffes transparentes qui montrent
La palpitante rondeur des tétons et tétins
Et la verge pleine dure dressée
Devant les juges du troisième avènement
Par un courant de haute tension non convertible
Pour l'octroi d'une grâce à certains condamnés
Sans parler pour soi et sans fraude
Mais avec la franchise d'un homme nu en pleine Assemblée
Sur le haut piédestal d'une gloire immense
Acceptant toute enquête constatations et précisions
Et rejetant toutes les mondanités douteuses
D'un journal au service d'intérêts sombres et odieux
Et même ceux de casinos
Journal qui vend les eaux pures des villes d'eaux
Et convertit ses colonnes
En stalactites glacés
Au lieu de soutenir les amoureux et leurs jardins
Comme en pleine Assemblée l'homme honnête et nu
Au lieu de palpiter comme un cierge de sperme de grand cétacé
Comme un cierge qui brûle sans se consumer
Cierge dressé tout droit
Égal en gloire au feu du soleil.
1
La locomotive du matin
Dans la fumée de ses vapeurs
De ce nuage qui nous appelle
Et transforme les hommes.
2
Les cristaux de l'accalmie
Sont eux aussi des fleurs
Houleuses et duveteuses
Comme les étoiles toutes en éclats irréfutables.
3
Branches penchées
Troncs tout droits
Dans les torrents les gouverneurs des visions
Coulent dans le reflet des couleurs mobiles
Tantôt dans la lumière tantôt dans les frissons lascifs.
4
On compare le silence à un roc
Et pourtant à son sommet fleurissent
Les troupes de la vie et de la mort.
5
La vedette rapide
Est un bec d'aigle
Ô sifflements du destin
Sur les vagues assaillantes portées
Par les chansons de l'écume.
6
Sur le rivage
Une secousse parcourt la baleine
Ses paupières s'ouvrent et les syllabes
De l'écho s'échappent.
7
Yacht enfant du goéland
Ta coque est prise
Entre les bras sans fin
De la mer et de l'océan.
8
Les mains s'étreignent et les feuilles tombent
Le ciel entier grandit
Et ressemble à nos yeux
Quand nous voyons au loin.
9
Tes pas résonnent
Dans le baiser reçu de toi et je viens prendre
Dans mes filets la barque
Qui aujourd'hui m'amènera près de toi.
10
Passion inlassable
Faveur invariable
Ennemis de la vieillesse
Ruban d'or
Au front des immortels.
11
L'action n'est pas comme les vitres brisées
Ses feuilles ne tombent pas malgré l'adversité
Elles poussent et elles s'étalent
Ses fleurs pareilles aux roses
Qui rougissent à la lumière de chaque matin.
12
Les nourrissons de l'aube dans les bras de sa mère
Et sa mère dans les bras de la forêt.
13
Les aigles voguant là-haut
Le bec ouvert
Mangent comme si c'étaient des algues des Sargasses
L'atmosphère si dense
De la saison d'hiver
De la ville en hiver.
14
La vision dans le silence
Source de rêves en éveil.
15
Nul ne se tourmente
S'il n'a pas dans sa poche une pierre.
16
Brise coulant sur ta chevelure
Dans ta tête le tumulte du monde
Et je suis près de toi comme un gros ramier
Piquant du bec sans cesse tes seins.
17
Les sapins ruissellent
Pleins du jaillissement des poèmes
Fraîcheur de l'onde et des merveilles
Sources et actes de jacinthes.
18
L'instigateur de la fête
Voit frémit et s'écrie enfin :
«Ô la source du temps !»
Contrepoids pour tout drame la tendre anémone
Annonce l'apparition d'un peu de justice
Et soudain la cassure des tiges les plus fines
Amène intégrité rétablissement plénitude
Comme un mouvement ascendant puis descendant
De berceau de l'euphorie
De va-et-vient sur la balançoire d'une fille
Qui ne s'isole ni le matin ni le soir
Dans des marais de haine ou de rancune.
La joie teint les joues en rose
Les festins du monde n'ont pas le moindre sens
On a beau dire on a beau parier
L'ardeur des chevaux sera toujours superbe
Surtout à la fin de la course
Les racontars ont beau s'emballer
Les vignes n'en feront pas moins leurs grappes
Et la verdure sera toujours arrosée de sperme.
Les lèvres d'un feu brûlantes
S'ouvrent pour lancer leurs baisers
Intacte dans la douce chaleur
Une femme appelle à grands cris
Les hirondelles à se jeter dans ses bras.
Aussitôt des chansons résonnent
Qui instinctivement jaillissent
Comme le moût des grappes d'un muscat sucré
Jusqu'à ce que les coupes débordent
Avant de se vider cul sec.
Les traces ultimes de pudeur s'en vont
Et des cris déments leur succèdent
Les doigts palpent les seins des jeunes filles
Voici que les vieux les jeunes les enfants
Ruissellent comme sous la pluie les arbres
Ou comme les lances des pompiers
Après usage de la pompe à eau.
Nous sommes dénigrés déshonorés nous perdons aux dés
Mais rien ne nous empêche
De nous lever d'appareiller
Comme nos pensées les plus belles
De s'évader de se lancer
Sur ces vagues qui nous attendent.
Les dilatations elles aussi ont des besoins
Étant liées à leurs douleurs
Elles rient nerveuses dans les plis de leurs rires
Ramassent les filets rouent de coups le passé
Toujours pareils aux messagers qui contournent les caps
De tous les malheurs qu'ils rencontrent.
Pas d'alluvions sans verser de sang
Pas d'explosions sans éclairs
Rude le rhéteur de la réforme
Des décors où des religieux
Cachent sous leur habit des petits enfants
Aux yeux de tous détournant la peur
De tout changement de tout arrangement des astres
Avec les femmes délicieuses des aghas.
Leur chagrin déchire les harems
Les narghilés vont vite le narguer
Les brumes des conflits de l'âme
Les heurts des guerres de partis
Rouvrent les plaies et de leurs cris
Font appel aux médecins.
Et avec leurs herbes voici qu'arrivent les hommes
De la consécration cyclique des martyrs
Dans des pays de lamentations dans des lieux arides
Et voici la venue d'autres heures
On dirait une restauration de la justice
Devant la douceur de la bonté
Des purs et des prospères.
Et voici que les temps changent
Les cales des sultans sont vides et même
Si aujourd'hui pachas et cubiculaires mangent encore
Les voiles et les velours de vieilles concubines
Et les prêles aux longues queues des
Dans quelques années tout cela ne sera plus.
Car il est absolument sûr
Qu'un jour viendra bientôt
Un jour pareil à une femme blanche
Un jour de triomphe
Puisque la libre volonté
Les «Ooh» et les «Aah» de la passion ardente
La sortie des forêts de l'ennui
La destruction des liens de tout esclavage
Font mûrir dans notre chair
Les actes et la gloire de l'histoire future.
Ô comment donc peuvent-ils rester cachés
Les resplendissants pédagogues de l'amour
Puisqu'ils sont prêts pour s'élancer
Puisqu'ils sont prêts pour s'accoupler
Avec toutes leurs cymbales éclatantes
Avec toutes leurs touches levées
Leurs instruments palpitants débordants
Leurs cordes tendues
Leurs âmes ouvertes
Malgré le papier des emballages
Et les cris et les chuchotements
De diplomates entièrement responsables
De toutes les déformations mensongères
Dans les écrits de la vie quotidienne
Dans les écrits de la vérité.
Oh comment diront-ils leurs vraies paroles
Des fioles secrètes enferment la pudeur
Des oiseaux terrifiés s'envolent
Et une enfant aux tétins durs
Tremble plus terrifiée encore.
Mais les temps changent
Les filles aujourd'hui reçoivent
Le premier jour timidement
Le deuxième et les suivants hardiment
Les flèches des meilleurs archers
Et les longs cris traînants
Des mouettes les plus hautes.
Des mots informes hier et aujourd'hui formés
Se souviennent des rochers de vos malheurs
Dans chaque souvenir des anciennes injustices
Dans vos premiers pas
Des mots informes hier mais aujourd'hui formés
Francs limpides avérés
Après la répression des craintes initiales
Après la déflagration des actes pleins d'audace
De ces actes qui provoquent
Les vibrations les plus profondes
Du crépuscule jusqu'à l'aurore
De la chair jusqu'à l'âme
Et jusqu'au tréfonds.
Oh oui les temps changent
Les vibrations désormais libres
Les pensées et les actes
Que plus rien n'entrave
Débordent et se déploient
Délicieusement huilés dans les bras des amours
De toute jeune fille qui exulte
Puis demeure extasiée tenant
L'obélisque près de sa bouche.
Nos cercles nous ressemblent
Ils ont les dimensions de nos visages
Ils ont l'éclat de nos yeux
Ils avancent comme des wagons de marchandises
Et baisent le bout des seins des filles
Qui montent vers l'âge adulte
Comme des fumées de locomotive dans le ciel
Avant que baissent les feux
Quand les flammes sous les chaudières font rage
Et que nous taillons le plaisir
Penchés ou couchés sur des draps
Tout blancs aux odeurs de lavande rangés
Dans des coffres sculptés très-précieux.
Sans eux nos maisons seront fermées
Et les fleurs des jardins fanées
Sinon viendront toujours à nous
Des veaux à voix humaine
Des veaux sans vachers
Superbes prophétiques aux très grandes bouches
Aux yeux de velours immense.
Les mots qui coulent de ces bouches-là
Ressemblent au lait jailli
Des seins serrés qui palpitent
Chaque fois qu'on les presse ou les trait
Des seins serrés bien pleins
D'une femme matutine ou d'une fille de l'étoile du soir
Aux yeux verts étranges étincelants
Qui désirent voir au cœur de l'été
Une nuit pleine de merveilles
De feux de bengale de paradis.
La pierre brille comme l'agate
Deux mots s'en vont expirent
Devant l'œil qu'on voit dans les églises
Les vagues jouent avec les dauphins
Au bout de la terre une terre nouvelle s'inaugure
Avance et tu verras.
L'étoile du soir aux diamants irisés
Ne l'ennuie pas
Parle-lui
Caresse-la
Apporte-lui à boire du lait en boîte
On pardonne à midi parfois
Plus facilement que le soir
Souvent la Tour Eiffel ressemble
À un jet d'eau matinal
Il désire jouer
Tout éclabousser
Même si devant elle défilent
Les formations
Les bouches à feu
Et les chars de combat
De l'École Militaire *.
Grande instructrice l'armée avec sa flotte
Première au front et sur l'écume d'Aphrodite
L'asphalte des fondeurs ne lui convient guère
La gloire marche mieux dans la poussière des avenues caillouteuses
Sous des drapeaux
Troués par les balles des combats
Voilà pourquoi il faut bannir l'asphalte
Je suis désolé
Il le faut.
Grande instructrice l'armée avec sa flotte
De toutes les catastrophes
Et pourtant sur le front, dans les campagnes et dans les villes
Nous attendent
La gloire et l'écume d'Aphrodite
Bien au-delà des stèles des musées
Droit au cœur de la vie quotidienne
L'asphalte des fondeurs ne lui convient guère
La gloire marche mieux dans la poussière des avenues caillouteuses
Non pas sous des drapeaux troués par les balles
Mais sous la lueur des ciels libres
Voilà pourquoi il faut bannir l'asphalte, les guerres, les combats
Je suis désolé
Il le faut.
Ici un peu partout
Errants les chiens hurlent
Mais d'autres voix s'entendent
Sublimes qui psalmodient
Approchez recevez le trèfle
Et la gomme embaumée
Les lamas les pumas du Pérou
Les faucons de l'Équateur
Ô grands cols et hautes villes
Villes qui le soir ferment leurs portes
Comme les fleurs timides leurs pétales
Et villes toujours ouvertes comme des femmes accueillantes
Mexico Puebla Vera Cruz
Et les grands mâts totémiques
Les peuples du Yucatan
Les peuples des Maya
Sorts sortilèges et sorcellerie
De Mitla Uxmal Chichen-Itza
Ô contrées du soleil et des sucs de la terre
Contrées aux creux secrets aux seins dressés
À la fente cachée par des feuilles de peyotl
Et plus loin encore
Santa Fe de Bogota Lima Montevideo
Brazil — non pas Brasilia, mais Brazil —
Contrées plantées serré comme des dents d'alligator
Ô contrées amazoniennes
Leurs cavaliers leurs amazones
Et leurs assauts du soir dans les pampas et la prairie
(Ô matins à cheval au bois de Boulogne
Opéra opéra de Paris
Arcs de triomphe
Et divas blanches comme des cygnes
Picasso et danseurs à la Nijinsky)
Et Montezuma s'en va aussi
S'en va aussi
Chevauchant un poney
Entre deux haies de jaguars joueurs
Accompagnés de temps en temps par la musique des Cangaceiros
Montezuma s'en va aussi
Traversant les prairies de l'Atlantique à cheval
Avec une enfant assise en croupe
Une enfant aux seins nus
(ô Minehaha — Eau riante)
Montezuma s'en va
Des amulettes sur la poitrine
Des plumes dans la chevelure
Montezuma s'en va
Des plateaux mexicains
Aux plaines européennes
Et quelque chose dans son allure
Évoque Saint-Georges
Quand il prononce des mots magiques
Quand il dit «Quetzalcoatl»
Tandis que les cœurs se réjouissent
Devant la gloire de midi
Devant la gloire des Aztèques
Montezuma s'en va
Chantant clamant
Et psalmodiant parfois
Des mots proches d'Alleluia
Un trèfle dans le cœur
Une lance à la main
Et tandis que l'éclat de sa race
Paraît sur ses dents blanches
Et qu'aux seins de la jeune enfant
Deux perles de lait s'égouttent
Le voici qui arrive
Qui monte sur une colline
Plante un mât au sommet
Pour placer tout en haut
Un aigle deux lotus
Et l'étoile à cinq branches.
Le déroulement de tout vrai renouveau
Ressemble à l'incessant débordement
D'un grand pichet entre les mains des échansons
Ou de fleurs dans des panières pleines
Portées par des jeunes filles aux seins dénudés.
Chacun des débordements
Chacun des renouveaux
Est un enfant qui apparaît
Devant les yeux éblouis des vieillards
Qui ainsi et seulement ainsi
Voyant nus les membres de la jeunesse
Entendant les coups d'ailes des petits d'oiseaux
Ou les chants des filles et des adolescents
Ainsi et seulement ainsi peuvent rajeunir
En recevant leur jeune vigueur
Même si les vieillards ne saisissent pas
Un par un les mots des odes et des chants de guerre
Même s'ils qualifient
Ces chants d'inintelligibles
Inintelligibles
Car les poussins n'ont jamais connu
Les maîtres de l'ancien temps
Et le carquois de la dialectique
De nombreux maîtres de bas étage
D'enseignements rivaux du passé.
Ràga-paràga voilà le chant de guerre
Dans la langue de ceux qui parlent à l'univers
Ràga-paràga de la voix la plus claire
Dans des régions d'anachorètes et dans les plus grandes villes
Ràga-paràga aujourd'hui et demain
Ràga-paràga comme un pas d'éléphants
Qui passent pleins d'assurance
De temps en temps baignés
Par le grand fleuve Zambèze
Ràga-paràga comme les tressaillements des jaguars
Dans les feuillages et sous le regard de tranquilles écureuils
Ràga-paràga comme le battement de la queue d'une baleine
Quand elle jaillit des profondeurs comme Aphrodite
Ou Notre Dame apparue dans l'écume
Et joue dans le soleil à la surface
Écrasant s'il le faut les baleiniers
Si ces chasseurs avides de sa graisse
Persistent plus qu'il ne convient
Dans leur odieuse offensive.
Ràga-paràga voilà le chant de guerre
Dans les champs et dans les cités
Dans les plaines et les montagnes
Dans les rues et les ruelles
Quand dans le monde s'accomplit un fermage
Comme à l'instant du plus complet accouplement
Pareil à une approbation foudroyante
Avec des «oui» des «oui» encore des «oui»
Et s'il le faut lorsque le «non»
Se présente comme un obstacle
Sous le masque d'une virginité
Qu'on doit absolument percer
Si l'on souhaite assurer la suite
Si l'on veut que la mort soit vaincue
Ràga-paràga encore alors
À savoir toutes les fois que le grand bélier réjoui
Béni et bénissant tout débordant pénètre
Renversant portes et murailles
Offrant aux hommes
Des triomphes dignes des dieux.
Ràga-paràga voilà le chant de guerre
Avec un cri sonore
Contre les grands délicats les hyperéthérés
Ràga-paràga frisson profond de la terre
Et vacarme de vagues successives
Qui enfin déferlent sur les plages
Ou bien se brisent écumantes et grondantes
Sur les rochers et dans les grottes
Comme un éclat de coups de cymbales
Au-dessus du son des cordes
Ràga-paràga trompettes plus fortes
Que les trompettes de Jéricho
Et que les cordes de toute potence
Ràga-paràga contre les sophistes
Contre les imbus d'eux-mêmes et les desséchés
Ràga-paràga jets d'eau de l'esprit toujours en fleur et blancs bonheurs de la matière
Ràga-paràga pour l'exercice de la volupté
Ràga-paràga pour la poésie spermatique et de la bonté divine
Du Christ-Adonis érotique et humain
Sève de la terre Ràga-paràga
Antidote à toute mélancolie
Battement blanc velouté d'ailes d'anges
Atterrissant devant nous qui apportent
Non pas l'épée de l'Eden mais pour les affamés
Du lait sucré Nestlé en boîte avec la manne céleste
Ràga-paràga-ràga !
(Ce jour d'hui comme hier et demain)
Si peu abouties que soient les œuvres, si profond que soit le silence (malgré tout palpitant), et bien que le zéro soit formé d'un rond, telle une bouche ouverte, toujours, absolument toujours, le silence et toutes choses inabouties renfermeront un grand mystère bien plein, un mystère plein à déborder, sans vides et sans absence, un grand mystère (comme le mystère de la vie au tombeau) — l'évident, l'étincelant, le débordant mystère de l'existence de la vie, Alpha-Omega.
Lorsque laissant derrière nous Paris nous respirons à nouveau la brise du Saronique, sous la lumière amicale et parmi les fragrances des pins, dans la simplicité des mythes — contemporains et antédiluviens —, telle une salve de cuivres, ou le son vibratoire, martelé des tambours, s'élèvent en jets d'eau étincelants certains mots, mots-oracles, mots d'union et de clef de voûte, mots de portée incalculable pour le présent et l'avenir, les mots «Hourra», «Je t'aime», et «Au plus haut des cieux», et soudain, telles des épées qui se croisant s'unissent, ou le vacarme d'arrivée d'un métro impétueux dans les tunnels souterrains de Paris, les mots : «Chardon-Lagache», «Denfert-Rochereau», «Danton», «Odéon», «Vauban», et «Gloria, gloria in excelsis».
Pluvieux paysages d'automne, lorsque s'en vont les fleurs et leurs joies, que tombent soudain les feuilles, que les cris du plus haut de l'été peu à peu s'éteignent, sur les rivages et les plages où la vague, déferlante et douce, rafraîchissait les corps de ses écumes irisées, avant que décline la saison des mers toujours calmes, avant que s'efface le mois culminant de l'été.
Routes bitumées qui mènent aux villes d'hiver, à leurs avenues de pleurs et de meurtres atroces, pour l'honneur d'un frère, pour du vin versé, pour cela qui n'a pas de nom, que ne recouvre pas l'oubli, avec de blancs et noirs malheurs qui grincent aux poutres, comme la corde des pendus quand le vent agite les cadavres ballants — ces pendules énormes, irrécusables, du destin des grands mélancoliques.
Rude hiver qui vient comme un convoi ferroviaire, sous la voûte basse d'une épaisse nuée — express filant à toute allure vers un point où d'aucuns croient voir les roses lueurs d'un début éclatant, et d'autres une fin palpitant de toutes ses vapeurs.
Pourtant il n'existe point de fin définitive, pas plus qu'aucune loi absolue. Au cœur de l'hiver parfois le printemps fleurit, et au sommet de l'été on trouve un hiver.
Cependant, pour qu'en plein rude hiver le printemps revienne, il faut que puisse monter un jour au cœur de l'homme un ciel bleu, tel un poème, un doux épithalame, que cessent de s'élever à l'infini dans l'âme des cumulus, de lourds cumulus qui enferment, comme dans le grand poème «Howl» de Ginsberg, ou chez Corso dans «Alcatraz».
Mais voici, bien que j'aie relu aujourd'hui les deux poèmes, à la toute fin de septembre, ici dans l'estivale et voluptueuse Glyfàda, tandis que l'été prend fin, tandis que fait son entrée Octobre, tel un empereur vêtu de pourpre, et que s'abattent les pluies d'automne, et que résonne au-dessus des toits le roulement de tonnerre des avions, et que je hume les senteurs de la terre humide, songeant : «Mais suis-je donc en Attique, ou à Londres la mystérieuse, la cosmopolite, dans Highgate ou sur Hampstead Heath ?», tandis que dans notre jardin ne restent plus que quelques rares fleurs et que la nuit tombe tôt sur notre terrasse, ici, où le mois dernier encore les cigales vibraient de toute leur brûlante ivresse, et où tombe à présent la foudre, et où la nuit, dans les cours, hurlent les chiens prisonniers, privés d'amour, ce soir, où j'ai lu de nouveau dans les journaux du soir les nouvelles et leurs malheurs grands ou petits (Une femme s'est suicidée, mettant le feu à ses vêtements. — K. P, un bâton de dynamite dans la bouche, a mis fin à ses jours.), malgré tout cela, ou plutôt, précisément à cause de tout cela, voici qu'en ce soir d'automne, qui sans doute annonce un rude hiver, et bien que j'aie relu Ginsberg et Corso (qui tous deux m'émeuvent tant), ne me reviennent à l'esprit ni les vers de l'un, ni ceux de l'autre, mais par-dessus les vents hurlants, ululants de «Howl», les gémissements universels et les clameurs d'Alcatraz, me montent aux lèvres, en ce soir d'automne, non pas ceux d'autres poètes, mais volant comme l'alouette, les vers de Percy Bysshe l'archange :
.........................................................................
Be through my lips to unawakened earth
the trumpet of a prophecy ! O, Wind,
If Winter comes, can spring be far behind ?
|
He was BEAT — the root, the soul of beatific. Jack KEROUAC, On the road |
Ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — voyez Kerouac le Musagète qui passe, Dionysos en même temps qu'Apollon dans son pantalon étroit, souvent pas rasé, toujours beau, sans du tout craindre le déclin qui l'a nourri, car c'est lui qui apporte, dans son âme et entre ses jambes, la semence d'une grandeur nouvelle.
Ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — Kerouac passe couronné de lumière, buvant le nectar de la vie quotidienne où qu'il se trouve, buvant et offrant le nectar qui coule plus que le Niagara, quand le désir en nous l'emporte et l'homme béni prête serment sur le "par ce signe tu vaincras" de l'amour.
Ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — le grand Jack passe, voyez le donc, en bus, en train traversant les Etats-Unis (Missouri Pacific, Union Pacific, Great Northern Railroad, Rock Island Line), là où paissait le bison jadis et où sifflaient des Indiens les flèches, dans des trains ou des voitures de hasard (Dodge, Hudson, Cadillac, Ford-Galaxy, Ford Thunderbird, et je dirai aussi, avec une émotion plus profonde, la petite, la pauvre, la très douce Lizy, tas de tôle prophétique) le grand Jack passe, des rivages de l'Atlantique jusqu'aux rivages du Pacifique, par les villes et par les déserts (Denver, New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco), des calmes les plus suaves au déchaînement de la tempête sur la savane ouverte, enjambant les grands fleuves (Missouri, Potomak, Susquehanna) Kerouac passe, un mouchoir autour du cou, la ceinture tombant sur les hanches, le poète-apôtre de On the road, le poète des Subterraneans, le grand Jack passe, avec un peu de William Cody dans l'allure et dans ses cuisses robustes, chantant à sa façon des chants pleins, adamiques, des chants voisins de par leur sens profond avec les chants de Walt Whitman, qui renferment toujours toute l'ivresse de la vie et la fraîcheur de la verdure.
Oui, oui, ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — Kerouac le Musagète passe, donnant au mot hitchhiking son sens le plus sacré, croyant en Dieu par les sens, traînant après lui un chœur qui fait le tour de la planète, un chœur de garçons et de filles cheveux dénoués, aux floralies des prairies, sur les charbons ardents des voluptés, sur les charbons ardents des lubricités terrestres ou souterraines (avec le bop, le twist, le rock 'n roll, les voix des nègres), et ainsi, tandis qu'il passe — ouvrez les fenêtres, ouvrez les âmes — des entrailles de la terre et des lèvres de la jeunesse universelle jaillit et résonne jusqu'à l'Eden, et jusqu'à l'Eden parvient, cri de guerre et prière, battement de cœur géant d'orgasme qui approche, une clameur immense et souveraine :
BEAT, BEAT, BEATITUDE AND LOVE AND GLORY !
Athènes, 21.11.1963
La porte s'ouvrit, avec fracas se referma. Ceux de la maisonnette s'écrièrent «Qui est là ?» Voyant que nul n'était entré, que nulle réponse n'arrivait, ceux de la chambre conclurent : le vent a dû claquer la porte.
Pourtant le calme était absolu. On eût dit que le temps s'arrêtait. Et malgré tout, derrière la fenêtre close le rideau remuait comme un voile soulevé par des bouffées de vent. Dans la chambre quelque chose brassait l'air auparavant inerte — comme si là-bas, soudain, battaient les ailes d'une cigogne immense, comme si un archange blanc agitait les siennes, apportant la lumière des cieux dans la chambre close au bout de son épée.
La maîtresse de maison abasourdie regarda les autres. Puis tous ensemble regardèrent le vase, posé sur une petite console et tous ils restèrent sans voix... Les fleurs de papier contenues dans le récipient poussaient en un clin d'œil telles des fleurs véritables et l'humble abri embaumait intensément, comme un lieu sanctifié, un lieu saint.
Suivant et entourant les immortels des déserts et des jardins, les plantes mortelles et les humains vivent et existent. Le ciel est sans fond et la mer tout-accueillante. Les humains et les plantes vivent leur vie. À première vue, tout semble extravagant, mais un examen plus attentif de l'ensemble révèle aux yeux éblouis des observateurs que partout existe une étonnante continuité, une structure, une architecture — non pas celle de la science, ou du rationalisme, comme dans les murs de pierre ou les autres constructions, mais qui constitue l'aspect provisoire à de changeants intervalles d'une entéléchie en développement perpétuel, d'une articulation et d'une communication perpétuellement multipliées, d'un mystère en perpétuel accomplissement, que certains nomment Monde, d'autres Chaos, ou Harmonie et d'autres sagesse de Dieu.
Au milieu de cette grandeur infinie les petites choses et même les plus petites ont leur pleine importance et leur inestimable poids. Et au sein de l'incessante présence de l'indéniable ensemble des choses petites et immenses, visibles et invisibles, logiques et illogiques, derrière et autour des immortels, qui poussent dans les précipices et vivent tant dans les déserts que dans les villes, les plantes mortelles, les animaux et nous autres humains, tous ensemble, à l'intérieur et au-delà de l'individu, malgré la mort, dans les siècles des siècles, nous existons, nous prospérons.
Glyfàda, 7.7.1960
Shadrak, Méshak et Abdel-Négo prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor : «...sache bien, ô roi, que nous n'allons pas servir tes dieux ni adorer la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur... et il ordonna à des hommes vigoureux de son armée de ligoter Shadrak, Méshak et Abdel-Négo pour les jeter dans la fournaise de feu ardent... Et tous trois furent jetés dans la fournaise... Et la flamme s'élevait à quarante-neuf coudées au-dessus de la fournaise ; elle se déploya et brûla ceux des Chaldéens qu'elle trouva autour de la fournaise. Mais l'Ange du Seigneur descendit dans la fournaise avec Azarya et ses compagnons, et il rejeta la flamme du feu hors de la fournaise... il y eut comme un vent de rosée rafraîchissant, le feu ne les toucha pas... alors tous trois, d'une seule voix, se mirent à chanter, à célébrer Dieu dans la fournaise...
Livre de Daniel
Azarya, Hananya et Mishaël, Kerouac, Ginsberg et Corso ainsi qu'avant eux le grand flambeau André Breton et sa pléiade, et encore plus avant le cygne de Montevideo Isidore Ducasse, Arthur Rimbaud, Raymond Roussel, Alfred Jarry et quelques autres, comme Henri Michaux et avec eux les représentants d'autres nations, étoiles étincelantes, comme
William Blake
et Shelley
et Poe et Herman Melville
et David Thoreau
et Henry Miller
et ce grand fleuve ce chêne royal de Walt Whitman
et Hegel
et Kierkegaard
et Léon Tolstoï, tout un monde, soleil hardi, père des dieux et des hommes
et Sigmund Freud
et Anghelos Sikelianos
et Aristarque des voluptés et Constantin Cavàfis
et Marx
et Lénine
et Kropotkine
et Bakounine
et Böhme
et Nietzsche
et Victor Hugo
et Mahomet
et Jésus Christ
et aussi voilà quelques années Essenine, Maïakovski, Blok (et je pourrais en ajouter d'autres) comme les jeunes hommes dans la fournaise — chacun dans sa propre langue — même si tous n'étaient pas d'accord entre eux, tous dans la fournaise chantaient et chantent aujourd'hui encore des paroles qui traduites — par d'autres que les rationalistes — ont au fond le même sens, identiques, de même que les feux semblables — du moins ceux de même combustible —, où qu'ils brûlent, donnent une flamme inchangée.
Et les jeunes hommes continuent jour et nuit (les fervents, les brûlants d'entre vous, se penchant dans leur âme, les entendront), les saints jeunes hommes continuent de chanter.
Et tandis que les flammes du brasier, tourbillonnantes autour de leurs corps (ô Jeanne d'Arc ! ô Athanàssis Diàkos !) éclairent de rouges reflets les bâtiments de Babylone, ceux de jadis et d'aujourd'hui et les figures des Nabuchodonosor, voilà que de l'asphalte sale des avenues (lâchez tout, partez sur les routes) et des ombres de ruelles obscures, des entrailles de la terre et du tréfonds de l'âme, des jacinthes et des jasmins des jardins et du fond des récipients où sont les malodorantes ordures (lâchez tout, partez sur les routes), des cris de délices de ceux qui s'unissent et des soupirs de volupté des onanistes, des cris inarticulés des fous et des gémissements des pesants chagrins, comme une lave chaude, ou comme la trompette d'un perpétuel Avènement, mais surtout comme du sperme, du sperme qui jaillit joyeux et impétueux, ils se dressent et rejoignent le ciel (Alléluia ! Alléluia !) les yeux tournés vers les hauteurs, sans brûlure et sans l'usure du temps, béats et prophétiques dans les siècles des siècles (Alléluia ! Alléluia !), érotiques, élancés, barbichus, maintenant et toujours (Alléluia ! Alléluia !) escortés par les anges, maintenant et toujours, et c'est la venue et la nécessité (Alléluia ! Alléluia !), la venue et la nécessité de nouveaux Paradis qu'ils chantent !
Écrit à Glyfàda le jour le plus
chaud de l'été, 17.8.1963
Quand à force de foi et de bonne volonté, mais aussi par nécessité impérieuse et invincible seront créées les conditions et accomplis des travaux non de construction, ou de réflexion, mais d'une tout autre nature, au cœur du futur, au cœur des hauts plateaux et surtout au cœur de tout homme il n'y aura plus alors que la Nouvelle Ville et elle sera nommée capitale de l'indivisible et indestructible Univers.
On ne sait si l'ancienne, qui s'étend face à l'océan au pied du rocher abrupt qui ressemble à Gibraltar, on ne sait si elle sera désertée, ou si elle existera encore ces années-là, ou bien si, immense et vide, elle sera préservée comme exemplaire d'une époque misérable, sinistre, ou pour servir de musée pédagogique, rempli d'exemples à ne pas suivre. Ce qui est certain, c'est que la Nouvelle Ville sera construite, ou plutôt sera créée, et qu'elle sera la capitale du Nouveau Monde, au cœur du futur et des hommes, après des années nombreuses, douloureuses, niaises et ennuyeuses, à la suite peut-être d'un assaut décisif, après la terrifiante bataille d'un soudain Armageddon.
Je n'étudierai pas les détails. Cette époque est encore trop lointaine, pour que nous les connaissions de façon précise, ou a priori. Ce qui m'intéresse absolument — et qui devrait tous nous intéresser —, c'est que la Nouvelle Ville existera, qu'elle sera édifiée. Non pas, naturellement, par des architectes et des urbanistes arrogants, qui croient sans aucun doute, les malheureux, pouvoir d'avance organiser la vie des hommes et déterminer avec des règles, des équerres, des compas, noyant tout et noyés eux-mêmes dans leurs plans égoïstes, narcissistes (marxistement, fascistement ou bourgeoisement), l'avenir de l'humanité.
Non, la Ville Nouvelle ne sera pas construite ainsi : mais elle sera construite par tous les hommes, lorsque les hommes, ayant épuisé tous les refus, les bons comme les mauvais, face à l'éclatante lumière de l'antisophisme — à savoir la lumière de la Vérité sans dogmes, sans voiles — cesseront de plonger leurs mains et leurs pieds dans le sang et les errements les plus graves, et au fond de leur âme, dans une affirmation exaltée, laisseront tous les arbres de l'Eden, avec tous leurs fruits et sans serpents — grâce à Dieu, ou grâce aux Dieux — dans une parfaite liberté fleurir.
Oui, oui (amen, amen je vous le dis), je vous dis la vérité. La Nouvelle Ville sera construite, mais pas dans les terres basses et les marécages. Elle sera édifiée sur les hauts plateaux de l'Univers, mais ne sera pas nommée Brasilia, Sion, New York ou Moscou, cette ville sera nommée Oktàna.
Et maintenant chacun à juste titre s'interroge : «Oktàna, mais qu'est-ce que c'est ?»
Question justifiée, la réponse arrivera bientôt. Mais afin qu'elle soit pleinement intelligible, jetez d'abord un coup d'œil en vous et aussitôt après jetez-en un autre autour de vous, à droite, à gauche, en haut, en bas. Puis fermez les yeux un instant et rouvrez-les brusquement, ouvrant tout aussi largement votre âme. Vous trouverez la réponse devant vous, non seulement compréhensible, mais tangible — corps superbe, animé, vigoureux.
Et maintenant (amen, amen) je vous dis :
Oktàna, mes amis, c'est la jonction de la Terre et du Ciel, où l'un prolongé dans l'autre réunit les deux en un seul.
Oktàna c'est le feu, le mouvement, l'énergie, la parole semence.
Oktàna c'est l'amour libre avec tous ses plaisirs.
Oktàna c'est la poésie à tout instant, non pas seulement moyen d'expression, mais fonctionnement continuel de l'esprit.
Oktàna c'est cette entéléchie par quoi ce qu'il est impossible de faire advenir sur-le-champ sera finalement possible, même la chimère, même l'utopie, peut-être même un jour l'immortalité du corps et pas seulement de l'âme.
Oktàna c'est «moi» qui devient «toi» (et réciproquement) dans un jaillissement de désir, dans une sortie libératrice, dans une union divinisante, dans une adhésion suprême, qui constitue peut-être la Grâce divine, le miracle d'être en soi et hors de soi, chaque fois qu'elle s'accomplit dans l'extase.
Oktàna c'est la vision et l'intuition qui nous amènent à ressentir, à comprendre toute l'angoisse de ceux qui souffrent, les paroles symboliques de Jésus, toute la pensée des athées, les éclairs des prophètes et toute la signification des étincelantes fulgurances de Zarathoustra.
Oktàna c'est (sans pour autant dédaigner la sagesse du grand âge) la conservation à tout prix de l'âme enfantine à tous les stades de la maturité, à toutes les saisons de la vie, car sans elle la plus dorée des jeunesses bientôt tombe en cendres et part et disparaît et à sa place demeure la tristesse, le regret sans espoir et la ride morose.
Oktàna c'est la pleine innocence d'Adam, d'Adam-avec-Ève la pleine certitude.
Oktàna c'est les humains devenant des anges, mais des anges au sexe évident, marqué.
Oktàna c'est le Paradis sur terre, l'Eden sur terre, sans péché originel, au-delà de toute idée de mal, l'inceste lui-même libre partout en toutes circonstances.
Oktàna c'est l'union absolue de l'esprit et de la matière.
Oktàna c'est le maintien du contact jusqu'aux points les plus lointains de l'évolution avec toute source qui constitue vraiment des archétypes de la vie le réservoir sacré.
Oktàna c'est ce qui combat la mort et partout et toujours défend la vie.
Oktàna c'est la liberté véritable, et non cette ironie terrible, qui donne le nom de liberté à ce qui évolue ou stagne dans les limites étroites laissées aux humains par les lois inhumaines des froussards, des aveugles ou des imbéciles.
Oktàna c'est la Cité Mondiale (probable Fédération), de nature non pas politique, mais psychique, laissant intactes les particularités spirituelles de chaque totalité nationale, dans une pleine et indissoluble fraternité des nations, des peuples et des individus, dans le plein respect de chacun, car elle seule pourra en fin de compte, par la compréhension, par des assauts de bonne volonté, et en aucune façon par la violence, supprimer les classes et l'exploitation de l'homme par l'homme, liquider tout cela enfin !
Oktàna c'est partout et toujours une vie dans le plaisir.
Oktàna c'est la justice.
Oktàna c'est l'amour.
Oktàna c'est partout et toujours la bonté.
Oktàna c'est cette allégresse qui fait monter l'âme aux lèvres et aussi, dans les organes appropriés, impétueuse, la semence.
Oktàna, mes amis, c'est l'insoumission absolue à tout ce qui contredit, qui combat, qui entrave la venue d'Oktàna.
Oktàna c'est la non participation et la non réponse par la violence à la violence.
Oktàna c'est ce qu'on entend au ciel comme sur la terre chaque fois que la voix du grand messager, de l'Ange du Seigneur, comme à travers un porte-voix supraterrestre, vrombit.
Voilà en quelques mots bien clairs, mes amis, voilà ce que c'est, Oktàna.
Et maintenant j'ajoute :
Ceux d'entre vous qui sont las de se laisser mener, dans ce monde injuste et stupide, par les menteurs, les sophistes et les démagogues, ceux d'entre vous qui sont las d'être renvoyés par leurs geôliers comme des paquets de chiffons chez Caïphe et avant lui chez Anne, qui attendent que vienne l'Heure bénie, éclatante et louée de chacun, ceux pleins de ferveur, ceux pleins d'ardeur, ceux qui désirent changer la misérable réalité présente, qui attendent que vienne l'Heure, ceux pleins de ferveur, ceux pleins d'ardeur, qu'ils viennent et clamons ensemble (maintenant et toujours, maintenant et toujours) comme une prière et comme un hymne guerrier, clamons ensemble, d'une seule âme, d'une seule voix — OKTÀNA !
Glyfàda, 20.8.1965
Dans certains lieux les mains ont un autre nom. Dans les monts d'Épire volent des gypaètes. La mer plisse et exulte. Sur les places dégagées en mars les enfants lancent des cerfs-volants de papier de toutes couleurs.
Rouges, verts, jaunes et parfois bleus, ces aigles de papier aux longues queues échevelées volent au-dessus de la ville, comme dans les hautes montagnes au-dessus des fougères les aigles.
Extatiques les enfants lèvent les mains. Ils montrent les comètes en papier aux longues queues. Dragons célestes plus haut, les avions grondent et écrivent en fumées blanches au firmament les mots :
KALA LEONA NOLA PY.
L'heure est toute blanche ; l'extase est bleue. La ville fume de volupté. Les enfants agitent leurs mains et, encore, de leurs bouches comme des jets d'eau ces mots jaillissent :
KALA LEONA NOLA PY.
Glyfàda, 9.7.1960
À Conrad Russel Rooks
Un jour que je descendais la rue des Philhellènes, le bitume ramollissait sous nos pas et dans les arbres de la place on entendait les cigales, au cœur d'Athènes, au cœur de l'été.
En dépit de la forte chaleur, la circulation était animée. Soudain passa un corbillard. Derrière suivaient cinq ou six voitures avec des femmes vêtues de noir, et tandis que frappaient mes oreilles des bribes de lamentations, la circulation un instant s'interrompit. Alors, quelques uns d'entre nous (inconnus les uns des autres dans la foule) se regardèrent anxieusement dans les yeux, chacun s'attachant à deviner les pensées de l'autre. Puis, d'un coup, tel un déferlement de vagues rapprochées, la circulation reprit.
C'était juillet. Dans la rue passaient les autobus, pleins à craquer d'une foule transpirante — hommes de toute sorte, minces kouros et hommes faits pesants portant moustache, dames grosses ou squelettiques, jeunes femmes et lycéennes en grand nombre, sur les croupes fermes et les seins palpitants desquelles de nombreux hommes entassés là, comme il est naturel, s'efforçaient (tous brûlants, tous dressés comme le gourdin d'Héraklès), chose habituelle en de tels lieux, la bouche ouverte et l'œil rêveur, de porter la main, geste rituel et considérable, laissant tous croire que c'était par hasard, en raison de l'affluence, que les affolantes rondeurs des accueillantes jeunes femmes et lycéennes étaient la cible, dans les véhicules, de ces gestes voulus et extatiques — frôlements, pincements et frottements.
Oui, c'était juillet ; et ce n'était pas seulement la rue des Philhellènes, mais aussi le Bastion de Missolonghi et Marathon et les Phallus de Délos qui palpitaient frémissants dans la lumière, comme dans les étendues desséchées du Mexique palpitent les cactus tout droits du désert, dans le mystérieux silence entourant les pyramides aztèques.
Le thermomètre montait sans cesse. Ce n'était pas de la tiédeur, mais de la chaleur — la chaleur qu'engendre un soleil vertical torride. Et pourtant, malgré la fournaise et la respiration pressée des gens haletants, malgré le passage peu auparavant du cortège funèbre, aucun passant ne se sentait lourd, et moi non plus, bien que la rue fût brûlante. Quelque chose en moi, bruissant comme une cigale, m'obligeait d'avancer, d'un pas léger, fréquent. Toutes choses autour de moi étaient limpides, tangibles par la vue elle-même, et en même temps cependant, tout devenait presque immatériel dans la fournaise — gens et bâtiments — tant et si bien que le chagrin des affligés lui-même semblait s'évaporer tout entier ou presque, sous la lumière égale.
Alors, le cœur battant à grands coups, je m'arrêtai un instant, immobile au milieu de la foule, tel un homme qui reçoit une révélation soudaine, ou quiconque voit devant lui un miracle s'accomplir, et je m'écriai, couvert de sueur :
«Dieu ! Il faut cette fournaise afin qu'advienne pareille lumière ! Il faut cette lumière pour qu'un jour nous arrive une gloire commune, une gloire pour tous les hommes, la gloire des Hellènes, qui les premiers, je crois, ici-bas en ce monde, ont changé en ferveur de vivre la peur de la mort.»
Un homme athlétique (ce pourrait être l'homme de Néandertal, mais non), utilise des extenseurs à élastiques. Il est presque nu. Durant son exercice, l'athlète étire les élastiques, écartant les bras ou les élevant, et de temps à autre s'accroupissant.
Cependant, cette image initiale en engendre de nouvelles, car en plus du serrement des élastiques il en est beaucoup d'autres, innombrables, puisque les seins sont serrés dans leurs soutien-gorge, et les passagers entassés dans les autobus, les allumettes dans leurs petites boîtes, les fidèles dans les églises et les âmes dans des carcans ou de terribles forteresses. Ce qui crée du même coup le besoin de sortir du lieu où l'on se trouve si confiné — des boîtes, des soutien-gorge, des cinémas, des églises, des Bourses, des tribunaux, des forteresses et des prisons.
Le maire de la ville, à la fin de la messe dans la cathédrale, donne le signal du départ. Tous s'en vont, à l'exception des saints et des petits enfants. Les saints célèbrent les martyrs de toutes les époques, de tous les martyrologes. Les enfants jouent sur le sol de l'église, édifiant avec des cartes à jouer de grands châteaux, dans lesquels s'accomplissent des mystères, des viols, des prières, des disputes, des noces, des baptêmes et des aspersions à coups de bottes de basilic frisé odorant. Les saints comme les enfants agissent en état d'exaltation, et après le départ des fidèles, s'adonnent en toute quiétude à leurs occupations. Et tandis que les fidèles se dispersent aux quatre points cardinaux, dans le lieu sacré (entre-temps quitté par le clergé), les enfants poursuivent leur jeu avec les cartes, et les saints, leurs regards tournés vers la coupole, psalmodient à présent, à pleine voix, célébrant les martyrs de toutes les époques, afin que soit confirmée l'opinion de ceux qui croient qu'ont existé partout et toujours des âmes extatiques, même dans les grottes d'Altamira.
Et les enfants, en toute innocence, en pleine exaltation, continuent de jouer avec leurs cartes, construisant des châteaux. Et les châteaux, avec toujours la même constance étrange, s'élèvent, se dressent et puis tombent, comme les réputations et les gloires, comme le rideau des théâtres, comme tant et tant de cerfs-volants, comme tant et tant de montgolfières.
Qu'importe le départ du maire, des notables et de la foule. Les enfants demeurent, de même que les saints. Le lieu sacré a une haute coupole. Les mots et les bruits résonnent avec une grande clarté. On entend même distinctement la chute d'une petite épingle. Sous la coupole, les enfants continuent de construire leurs châteaux de cartes, et les saints de louanger et célébrer. Soudain, le dernier château à peine achevé tombe d'un coup. Mais il ne tombe pas tout seul ou conformément au désir des enfants. Un violent séisme l'abat et en même temps s'effondre la coupole de l'église et une grande partie des énormes murs.
Et maintenant l'opinion prévaut, parmi les habitants de la ville, que le maire a bien fait de partir à temps accompagné du commun des mortels, des notables et de la foule, d'autant plus que le séisme n'a frappé que la cathédrale. Cependant — et c'est cela qu'il faut graver sur les tablettes —, au milieu des ruines, au milieu de la désolation, les enfants insouciants continuent de jouer avec leurs cartes sur le dallage de l'église et les saints, impavides, continuent de psalmodier, louant et célébrant, tandis que le vent qui tourbillonne et siffle dans les ruines, apporte un accompagnement mélodieux aux psaumes des saints et des chuchotements passionnés des enfants.
Et maintenant je dis, qu'importe si se sont écroulés la coupole et les murs. Qu'importe si le lieu sacré n'existe plus. Le lieu est recouvert à présent par la coupole céleste, plus haute et supérieure à l'autre, plus haute et supérieure et inébranlable, remplie de lumière et d'éternité.
Quand le corps du silence est vivement agité, comme une femme jouissant dans son sommeil, ou lors d'une ardente étreinte amoureuse, ou comme le corps d'une jeune fille prise d'une fureur sacrée quand le silence le plus profond est au bord de devenir source ; quand sans motif, et de façon inespérée, une petite fille relève sa robe et révèle à tous le tendre abricot de son pubis, dans toute sa grâce duveteuse et gonflée, sans pudeur, sans honte ; quand une écolière à son pupitre soudain se dresse devant l'institutrice, face à la classe éberluée, et dans d'évidents tremblements rend des oracles en des termes sublimes ; quand lors d'un calme plat violemment bruissent les feuillages des arbres comme si se déchaînait un grand vent ; quand du tronc d'arbres sans résine sort une sève épaisse et que les jeunes lotus mûrissent le temps d'un éclair ; quand sans la moindre pluie la terre autour de nous se mouille, comme à l'approche du jaillissement d'eaux secrètes, ou que soudain s'ouvrant à nos pieds un cratère montre jusqu'au fond les entrailles rouges de la terre ; ou encore, quand la nuit les étoiles scintillent trois fois plus sous la voûte céleste et que les tiges dressées vibrent et que toutes les fleurs et même les bourgeons s'ouvrent tout grand d'un coup ; quand toute la création est en liesse et que certains buissons s'enflamment sans se consumer — alors, ô alors du bout du monde et de l'univers, un message pareil à «Le Christ est né», un grand message arrive pour tous :
«Âmes et corps, soyez en joie ! Eros a gagné la bataille ! L'Hadès est vaincu. Ce soir est né un enfant divin ! Ce soir est né un grand poète !»
Par les douces journées de septembre, quand il ne pleut pas encore, que l'écoute des bruits est plus faible et le goût des heures plus fort qu'en été, que dans les jardins s'ouvrent les grenades, que vibrent les tiges des fleurs toutes droites, que les ibiscus flamboyants palpitent dans leur pourpre, tous pareils à des mariés pleins d'assurance qui frappent à l'huis de leurs belles, alors, comme si c'était toujours l'été (car quelle que soit la saison, le désir est toujours estival), les âmes sont dans l'allégresse, et l'Amour, l'archange le plus blond du Paradis, s'exclame pour tous les corps qu'il touche :
Jette tout et dévêts-toi.
Oublie tout ce qui fait peur.
Printemps, hiver ou été —
en tous lieux et à toute heure —
mon épée vient avec toi.
Bien des années ont passé, et dans le même temps (au loin) seulement trois ou quatre bateaux. Mais ces bateaux ne se sont pas arrêtés, n'ont pas remarqué, pas vu l'étendard de la solitude, l'étendard de la vérité lointaine, qui jour et nuit, en vain, claque au point culminant de l'île, ils n'ont pas vu le chiffon blanc, tout ce qui reste du trois-mâts «Terre promise» qui sombra corps et biens (pour une cause inconnue) à l'exception d'un passager, loin dans les mers du sud.
L'île est fertile, couverte de verdure. Riche en noix et en fruits. Riche en oiseaux (des oiseaux de Paradis), en animaux. Mais elle n'a qu'un seul habitant — le naufragé.
Cet homme est ingénieux et vigoureux. Il a inventé bien des choses. Il a réalisé, sans aide aucune, des travaux que jalouserait une communauté nombreuse d'industrieux ouvriers. Oh oui, si cet ermite n'était pas seul, il serait comme le roi d'une contrée bénie.
Mais qu'est-ce qu'un royaume, qu'est-ce qu'un roi, même si l'on choisit l'Eden comme territoire, quand dans la solitude la plus absolue, on exerce son pouvoir comme quelqu'un qui verse de l'eau dans un tonneau sans fond, comme quelqu'un qui ouvre et ferme une lourde porte qui ne mènerait nulle part. Qu'est qu'un roi quand le monarque n'a même pas le droit de dire : «Je m'appelle Adam».
Bien des années ont passé et le naufragé attend toujours. Ses mains sont devenues calleuses, sa peau a bruni sous les rayons brûlants intraitables, qui font gonfler les fruits et blanchissent les ossements des charognes, là où les laissent à nu les vautours et autres carnivores.
Bien des années ont passé, et aussi trois ou quatre bateaux, sans approcher, sans s'arrêter, sans voir... Des rivages aux buissons, des plages aux denses végétations, le temps a planté ses coquilles. Çà et là, sur le sable, se pétrifient sous le soleil les cadavres noirs des tortues mortes. Cependant la mer n'a rien apporté d'autre sur l'île que le bouillonnement de l'écume, que le clapotis des larges vagues, qui ne savent rien d'autre que leurs propres secrets.
Oh si seulement jaillissait des noires abysses, oh si apparaissait du moins, ne serait-ce que de loin, un grand cétacé ! Alors sans doute pourrait se reproduire, en juste odeur de sainteté, en saveur douce de sel humide, l'ancien miracle de Jonas. Oh oui, si passait par l'île cette gloire des océans, la baleine, la reine des mers, la grande souffleuse ! Même si elle ne se montrait qu'au large, la montagne flottante, même si la trombe ne se laissait voir que de loin, même si elle n'approchait pas tel une nef bénie, quel heureux présage déjà ce serait !
Mais jusqu'à aujourd'hui, jamais on n'a vu passer la baleine, son pompon liquide nulle part n'est apparu. Seuls les galets du rivage, le sable lisse et plus loin la mer si large s'étendent et s'étendront alentour de l'île, telle une éternité inexorable et morne — jusqu'au jour où viendra la baleine (qui viendra sans aucun doute, mais quand ?), éclaboussante et criante, sa tête énorme sortant des eaux, luisant comme la proue d'un navire.
Cependant, pas moyen de savoir quand cela se produira, et le naufragé attend toujours. Les souvenirs, bien qu'ils aient conservé leur teneur en sentiment, ont perdu leur netteté. Les mots eux aussi ont perdu leurs contours sonores, et désormais ressemblent à de l'argile, à l'aide de quoi l'ermite modèle de nouveaux mots (réceptacles nouveaux des mêmes anciennes notions), des mots totalement à lui, des mots que l'ermite profère en communiant avec ce qui l'entoure, ce déferlement orgasmique de tous les éléments, lorsque souvent, dans les fourrés ou sur le rivage, il se lève et crie : Àhar, lamir, iskhar, manik, noùma, rapànda, ànda ! ajoutant à ces mots d'autres du même genre, tous prononcés avec une telle passion qu'ils semblent sortir non pas des lèvres d'un mortel, mais de la grande bouche du ciel au-dessus de l'île : Pàthe, singa, allasoni, pèngge, kimè, vonda, ounòra ! dit d'une voix si tonnante, que d'un rivage à l'autre et à l'intérieur luxuriant des terres l'île retentit d'un écho géant :
«PÀTHE SINGA ALLASONI PÈNGGE KIMÈ VONDA OUNÒRA !»
Et c'est ainsi que tous les jours, tantôt à l'aurore, tantôt à midi, parfois même la nuit, surtout à l'heure où les singes, célébrant la création, s'accouplent sous les arbres, l'ermite, se trouvant lui-même en pleine érection, en solidarité pleine et entière avec la faune copulante qui l'entoure, s'exclame :
«KÀME LÀMA HAMI AKHMAR PÀNE AMBOR ELMÀNA !»
Et sa voix contient toujours une passion si effrénée, que l'île où l'ermite règne seul semble tonitruer longuement tout entière avec lui, tantôt : «KÀME LÀMA HAMI AKHMAR PÀNE AMBOR ELMÀNA !», tantôt : «PÀNE OOOH-OOO AAAH-AAA OÙA-OÙA ELMÀNA !»
Et cela chaque jour, car le dur labeur ne suffit pas, ni le repos, ni la rêverie, ni les jaillissements voluptueux du sommeil, et cela tout le temps, de jour et de nuit, jusqu'à la venue de la Baleine, l'arrivée du grand cétacé, la Baleine, la Baleine, le Messie tant désiré, apportant l'allégresse aux visionnaires, offrant bonheur aux humains et justice aux anachorètes, aux ermites, aux précurseurs.
(Oktàna)
Luxe, luxure, luxuriance : on pourrait presque résumer ainsi l'œuvre d'Andrèas Embirìkos, l'un des poètes majeurs du XXe siècle grec. Il vécut entre 1901 et 1975, voyagea beaucoup hors de Grèce, connut André Breton et bien d'autres et introduisit dans son pays, outre le surréalisme, la psychanalyse qui devint son métier. Son premier recueil, Haut-fourneau, en 1935, secoua violemment une poésie grecque alors un peu sage par ses images délirantes et son refus des conventions littéraires ou morales. En 1945, Domaine intérieur prenait ses distances avec l'orthodoxie surréaliste tout en affirmant dans une langue incroyable, d'un archaïsme à la fois aristocratique et déconneur, une sensualité exubérante, un amour inépuisable pour la chair des femmes et aussi celle des mots. Merveilleux Embirìkos, qui tournant le dos à la grisaille et la noirceur du monde, nous entraîne dans des jungles d'images, chantant à jet continu la beauté des corps et l'éternel retour du désir.
Si j'ai tardé à traduire Embirìkos, c'est que d'autres s'en occupaient, que des publications se préparaient, disait-on. Ne voyant rien venir depuis vingt ans, sinon Haut-fourneau, traduit par Jacques Bouchard pour Actes-Sud, j'ai décidé qu'il était temps de m'y mettre avant que nous soyons tous morts. Je donnerai ici toute l'année des extraits de deux recueils posthumes, alternant les vers libres de Ce jour d'hui comme hier et demain et les poèmes en prose d'Oktàna. Certains de ces derniers ont été publiés dans l'Anthologie de la poésie grecque contemporaine en Poésie/Gallimard. Le reste, inédit.
Je voulais associer à mes traductions celles de Michel Saunier, grand traducteur devenu trop silencieux, dont je crois savoir qu'il a dans ses cartons tout ou partie d'Oktàna. Il me répond qu'il ne retrouve plus son Oktàna français ! Pour rendre hommage au talent de mon confrère, je ne peux que conseiller à tous une autre de ses traductions, superbe comme toujours : Argo, nouvelle d'Embirìkos, chez Actes-Sud. On constatera que lui et moi n'avons pas systématiquement essayé de traduire la katharèvoussa (langue savante) du poète, considérant que le français ne s'y prêtait guère et que l'essentiel était sans doute ailleurs.
Embirìkos est aussi l'auteur d'un énorme roman érotique, Le grand Oriental, publié longtemps après sa mort et qu'on ne lira pas de sitôt chez nous : le goût de l'auteur pour les très jeunes filles déchaînerait les foudres de nos ligues de vertu...
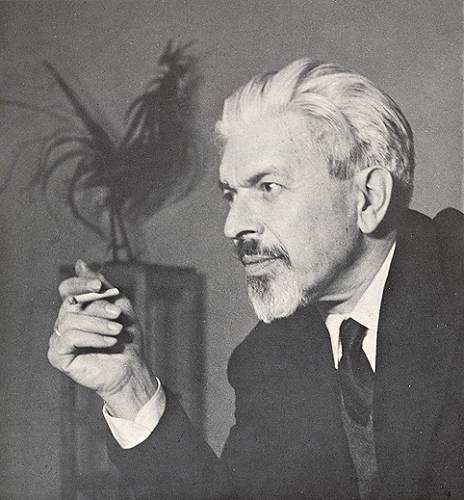 Andrèas Embirìkos. |