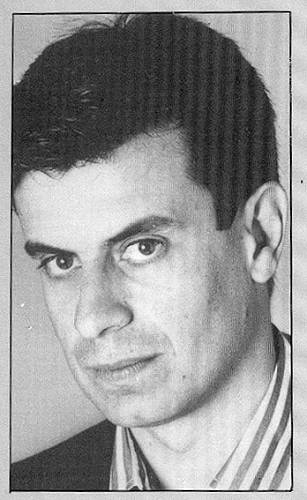
Dimìtris Houliaràkis.
Je sentis sur moi le poids du temps
et la vie m'apparut comme une fumée un rêve
s'effaçant dès que le jour le touche
une lampe quand son huile épuisée
sa flamme en vain s'obstine.
Je voulus m'éloigner pas moyen
mon corps lourd attendait la terre.
Je me mis à trembler pleurer me découvrant
moi aussi mort anonyme
dans les rangées sans fin des trépassés
un défunt oublié des années dans la terre
un défunt qui marche courbé
dans les steppes glacées de la mort
Je regrettai ma vie les jeunes années
quand mon corps désespérément luttait
pour dompter ses élans mais l'espace
que je reçus n'était qu'une pierre
d'où contempler le chagrin de mon âme.
Et soudain je vis une église et je vis
les terribles îles je sentis
la grange obscure de mon corps.
Avec peine la porte s'ouvrit vision lugubre
on eût dit la veillée d'un défunt
l'accompagnement d'un défunt.
Je m'écartai regardai égaré
et j'entendis alors une voix dans mes entrailles
déroulant une histoire oubliée :
Dans le déchirement de l'abandon final
du corps dans la solitude de la pierre
qui soudain pousse droite et froide sous la tête
se trouve le point que tu recherches
quand tu y seras
n'hésite pas un instant
le noir sentier qui s'ouvre devant toi
suis-le écarte les feuillages
puis fais halte le cœur pur
devant les blocs entassés en désordre
que ceux qui savent appellent rempart
mur des lamentations des larmes
à la lueur de la lampe tu verras
d'un côté toi vivant pleurant
de l'autre le mort qui lui tend
suppliant la main.
Et je vis autour de moi les dépouilles sinistres
les restes épars de mes jours
qui brûlaient lentement jetant de tristes lueurs
sur des murs battus abattus.
Sorti sous un ciel de pierre
j'avançai dans les oliviers cherchant
dans le fruit âpre un réconfort.
Mais voilà qu'ils étaient durs et froids et en guise
de fruit des blocs de pierre.
Sur une pente raide je t'ai trouvé qui attendais
et je crus que tu me tendais la main
pour te retenir
ton vêtement gris cendre effleurait
les asphodèles rehaussant
de l'instant l'éclat surnaturel.
La pierre dessèche la vie la pierre
est sans entrailles dis-tu avant d'étendre
autour de toi la trame du silence.
Une force invincible me courba
et je sentis une odeur de rance
agenouillé en larmes devant toi
je t'appelai et te crus mon père je t'appelai
et te crus mon frère.
Plus loin je vis mon cœur ouvert
un très ancien bloc brûlé au vent du sud
un bourgeon fleurissant ce matin
je regardai les yeux clos et vis
à travers les branches du précipice
à travers le suaire lourd que jette
sur nous le brusque vent du nord.
Un air épais à présent se concentre
au-dessus de ce coin désert
les heures se sont éteintes et les vents
regarde-les qui attendent
mon premier pas dans le vide.
D'un bout de la vie à l'autre
je passerai d'un pas lent
et dans mon cœur coulera
une eau amère et la mémoire
délivrée s'envolera craintive allumant
au néant une veilleuse éternelle
La mer à présent vire au noir
la nature est figée dans l'attente
l'éclair ne se cache pas à l'œil exercé
et l'ombre fuyante qui éclaire
une vérité morose une vérité
plongée dans le rêve des pierres.
Au-dessus de mes jours veille une lourde cloche
mon seul héritage l'oubli
(La dépouille des jours)
Bouche ne vois pas l'Érèbe
qui craque et s'ouvre devant toi
bouche ne t'affole pas sur les cimes
n'incise pas ta langue au rasoir
bouche ne crache pas tes petites dents
ne te ferme pas ne t'ouvre pas
bouche ton sang mis à mort
tiens-le contre ton palais
La boîte noire de notre vie
qui la trouvera dans les débris calcinés
qui l'en sortira délicatement et qui
se penchera sombrement sur elle
pour étudier les causes de la tragédie ?
Et quand bien même, à quoi bon, puisque
est arrivé ce qui devait arriver
puisque tout pâles nous retournons sur le dallage
défoncé de nos jeunes années
sans plus connaître personne
sans rien chercher.
Ainsi donc mieux vaut qu'elle disparaisse
notre boîte noire
qu'elle pourrisse quelque part dans les champs
que l'herbe sur elle s'étende muette
et totalement la recouvre
ne laissant qu'un renflement du sol
et c'est tout.
Ils disparaissent les footballeurs
de notre jeunesse
dans l'indifférence générale
ils disparaissent ils vont vers leurs amis
qui attendent à Superga
ils disparaissent icares dans leurs avions
— leurs visages avant le choc
un instant seulement s'étonnent —
ils disparaissent nos amis nos parents
ils embarquent vers des ports secrets
et nous disparaissons hélas nous aussi en silence
nous nous rappelons nos jours de gloire
nos heures brillantes
et nous pleurons.
Indécis passifs pitoyables
comme Elpinor nous avançons dans la vie
sans donner ni recevoir
sans efforts inconsidérés
traînant nos jours muets
jusqu'au dernier souffle
improductifs.
À nos obsèques de rares amis
viendront glacés maussades
ils sont partis comme ils ont vécu
diront-ils.
à la mémoire du poète Còstas Karyotàkis qui s'y noya
Nuit revêts d'un humble lambeau
le corps qu'a emporté la vague
jouet déglingué que la vie rejeta
aux rivages déserts de l'Épire.
Envoie un voile vaporeux
couvrir le front glacé les yeux
verse une brise de mai souffle chaud
sur les membres blêmes les lèvres
mauves à présent scellées
Nuit mon amie défais les cheveux
qu'ils attirent le corps dans la cascade noire
enferme-le doucement dans ta folle étreinte
dans ton sein parfumé qu'il y trouve
un dernier havre à l'abri des vents
(Superga attend)
Lâche tes chiens féroces Fiumicino
aiguise tes couteaux jette
sur moi tes lumières
puis libère-les qu'elles me démembrent
que tes sirènes étouffent mes hurlements
éparpille mon peu d'habits
dans le tourbillon des vents
creuse mon tombeau dans tes champs immenses
au milieu du grand couloir
enterre mon corps oublie-moi là
sans croix sans nul autre signe
seuls aromates la graisse des moteurs
de ses pilotes les sueurs froides
et peut-être qui sait un jour
sur ma tombe un DC 10
avec son huile son kérosène allumera
une veilleuse funèbre
Quel vent quel orage Seigneur
peut libérer ta colère tes mains
et les poulies qui feront descendre
le corps dans sa fosse humide
quelle poussière se lèvera quelle clameur
chemise blanche à même la peau
nous vêtira de terre ?
Pendant des nuits Seigneur nous restons muets
voyant se dresser nos poils et nos ongles
face à l'éclair qui les brûlera
pendant des nuits nous écoutons la langue
sa respiration terrifiée, la parole
que nul n'écoutera jamais
pendant des nuits la main cherche l'autre main
en bas au fond dans la carrière
obscure de la peur.
Seigneur prends tes serviteurs en pitié
pardonne aux pauvres que nous sommes
nous ne savions pas ce que nous faisions
prends avec toi dans les ténèbres
notre âme.
(Superga attend)
C'était ce n'était pas l'aurore
je me trouvai marchant livide au long des rues
d'un bourg que terrifiait le prodige.
Entre les grilles une lueur pâle
souvenir d'enfant mort vingt ans plus tôt
chant d'oiseau expirant pensai-je râle ultime
d'un homme poignardé dont la vie
s'éteint dans la poussière.
Et je vis le cheval seul au loin et je vis
les tristes heures s'allumer une à une
un chant s'éleva sombre funèbre
qui se changea en pleurs.
Lentement monta la voix grêle apeurée
mince tremblante face à l'arrogance
aveugle de la sauterelle rouge.
Mais qui donc était mort qui pleurait-on ?
Pas de réponse ; un brouillard
s'étendit alentour.
Je sentis une brise glacée
et je me vis entièrement nu
un frisson parcourait mes membres
et je pressai le pas
il me semblait chercher
sans trop savoir quoi.
C'était une époque indécise
comme un avril en plein hiver
dans un pays sans ciel
sans le moindre bruit d'animaux
Où étais-je impossible à dire
lieux familiers pourtant
comme s'ils venaient d'une autre vie
ou de brumes rencontrées en rêve.
Je regardai autour de moi je découvris
une sorte de tombe toute fraîche
un vent éteint roula plus loin
et j'entendis des paroles affligées
je m'approchai je vis
la fosse qui s'ouvrait profonde
ma fosse et moi.
Tout ici bas oublié obscur
le pas incertain mesurant l'herbe
le silence partout épais intemporel
chair molle et paupière lourde
non de sommeil mais de mort.
Torpeur et léthargie partout enserrent
mon cerveau la pierre a laissé je crois
son huile sainte couler sur ma langue
et je m'abandonne à sa froide sorcellerie
jouet entre ses doigts raides
proie de la noire étreinte.
Je vois d'étranges formes je vois des ombres
elles me font signe leurs lèvres bougent
et pas un son n'en sort
pleines d'une lourde tristesse
debout arbres couleur de cendre
elles plient et s'agitent au vent
un chant de deuil passant leurs gencives nues
formes trompeuses des vieux des vieilles tendent vers moi
leurs mains flanqués d'enfants livides
d'adolescents de jeunes filles d'hommes d'âge mur
de femmes au voile noir j'avance au milieu d'eux
touche leurs haillons vois leurs visages
leurs vies gâchées
en tâches insignifiantes et je crie frères
mes frères dans vos terribles ténèbres
ne m'oubliez pas mais ils ne peuvent entendre
âmes et ombres ailes battantes là-bas
n'ont que paroles muettes et que regards
aveugles et elles s'en vont.
(à suivre)
(La dépouille des jours)
Son pauvre père quiconque se rappellera
et communiera dans l'ombre
avec ses larmes noires
le front de sa mère quiconque embrassera
faisant trembler la flamme
d'une bougie sur ses joues blêmes
sa propre dépouille quiconque veillera
et dans les heures du sommeil
sans éveil se perdra
la folie quiconque touchera
c'est lui qui sera l'Elu
et il ira prêcher.
Je pense à elles au déclin du jour dans leurs chambres
traînant sans but leurs pas lourds
muettes l'œil terne examinant
leurs vies désertes.
Elles parlent à voix basse
avec l'homme à jamais disparu
à qui par un soir de cendre
elles ont fermé les yeux.
Puis serrant la robe de chambre sale
sur leur corps maigre flétri
elles fixent un regard mort
sur la rue vide et sombre.
Comme je les plains ces femmes
ces vies peu à peu éteintes
pareilles aux cierges d'une chapelle perdue
qu'on alluma et qui se consument seules.
Visage aimé aux yeux éteints posés sur moi
tes cheveux noirs ont perdu dans le sable
leur couleur tes lèvres sont glacées
et tes joues roses ont blanchi comme la mort.
Beau visage qui es-tu
quels étaient tes aïeux quels tourments t'ont brisé
quels heureux corps t'ont touché
Visage adoré je n'ai pour toi
que des mots tendres tu me ressembles
toi solitaire dans le musée froid mausolée
moi seul aussi au désert du monde.
(La dépouille des jours)
Où tournerai-je où entrerai-je
dans quelles galeries quelles inavouables eaux troubles
s'est perdu le sens la substance inaltérable
que tète un essaim de mouches quelle imposante abysse
et quelle cloche à matines au-dessous de moi battra des ailes
quelles mains s'agiteront quels yeux seront ouverts
quels fronts récolteront l'aberrant baiser qui regarde
par dessus la plus haute marche
au-delà plus rien n'est rien
les jours aveugles seulement et les mois
pleins d'iode et de pansements les mois
et les soirées se levant vers l'arrière
et une voix en moi demande
quels mots quels doigts quelles peaux dois-je dire
dans ces buissons où le gibier
attend renâclant par à-coups
depuis des années l'inévitable chasseur
quels mots quelles couronnes quelles eaux courantes
laisserai-je sur les fronts anonymes
sur les fronts vides
les fronts infortunés tout froids.
et comme si l'entendaient
par leurs oreilles coupées les voleurs de bétail
comme si le regardaient des yeux éteints
au Samedi saint le sommeil s'est déchiré
laissant tomber des milliers de cierges
que tenaient des filles maigres et la fièvre
a ouvert un sillon dans la terre sèche de l'esprit
l'ombre a fleuri cuivre oxydé
et la nuit a ouvert la prière a ouvert
ses possessions la rambarde tordue
a ouvert tranquillement les eaux usées de la mort
la peur a semé langage étrange le tonnerre a semé
la chair a balancé les fleurs cendreuses
d'Avant d'À présent d'Après et immobile
a pris sur elle toute la panique de la pierre.
Viendra l'heure qui ne connaît d'autre aspect
viendra l'instant qui ne connaît d'autre sommet
à la nuit dans l'ombre penché
et le corps humilié s'inclinant sans un mot
ira s'étendre amer sur le Seuil.
J'ai laissé des herbes et des rivières au jardin de ma tête
écumer j'ai laissé des teintes mauves
d'automne des rochers des joncs serrés
qui n'arrivent pas à brûler pourtant
pour obstruer l'entrée du rêve.
Que la parole se lève en des prairies sauvages
que le simandre de bois sur des rives imprévues
résonne et que le deuil du corps
une fois seulement dans la vie traverse
de part en part le cocon pierreux de son silence
je ne saurais le nier.
Ici donc j'attendrai ici
pour goûter au recul du chaos
et traverser du sommeil les Symplégades
ici j'attendrai
de distribuer l'ultime vérité
aux yeux assoiffés des fidèles
ici je ressusciterai encore et encore ici
pour vivre dans ma mort noire.
(La dépouille des jours)
La flamme éteinte par un souffle glacé
je reste oubliée là un temps incalculable
passent des filles qui me font signe puis des femmes
puis des vieilles puis plus rien et moi j'attends
mais quoi ? — vêtue de noir — pourquoi ?
mon corps s'est voûté je suis pleine de rides
tirer sur mon châle arranger mes cheveux
à quoi bon depuis l'Oural jusqu'au fin fond
du Kamtchatka nul n'est plus là.
J'entends seulement une cloche une lourde cloche
fondue à l'ancienne sur le sol russe
le bronze bouillonne dans la matrice de terre
et sans arrêt les ouvriers frappent et frappent
j'entends une cloche une cloche sans cesse à mes oreilles
— les ouvriers frappent et frappent — indolente et funèbre.
Je n'aime personne je ne me souviens de personne
mes doigts mes poumons sont figés
désert glacé mon esprit sombre dans mon corps
en longs manteaux des ombres sillonnent la neige
soudain je deviens à l'hippodrome de Byzance
un jeune serviteur fasciné regardant
s'ébrouer dans l'enclos de fiers destriers
soignés par des étrangers misérables
aux façons grossières en absolu contraste
à l'absolue noblesse des animaux.
Et me voici dans un navire qui prend le large
ne voyant ni terre ni ciel mais seulement
les murs jaunes les pâles veilleuses tremblantes d'une ville
la révélation se traîne sur des voix basses
partout le gel une lumière sale
et ma vie enfermée en cet instant.
(Loubianka : à Moscou, prison bien connue et siège de services de la sûreté de l'état soviétique. Anna Akhmatova s'y rendit après l'arrestation de son premier mari, le poète Nikolaï Goumiliov, qui fut exécuté en 1921, mais aussi lors des arrestation suivantes, de son fils, Lev Goumiliov, et de son troisième mari, l'historien d'art Nikolaï Pounine, qui finit par mourir en prison.)
Un amour brûlant aveugle
sans limites et sans retour
voilà ce qui t'a obscurci l'esprit
ce que les autres ont appelé trahison
n'était l'ultime effort pour sauver celui
que tu aimais plus que ta vie ;
certains ont évoqué un arrangement
avec les prêtres mais moi je sais
ce sont là mensonges et honteuse calomnie
les misérables Pharisiens t'ont pris au piège
se sont servis de ton âme naïve
pour s'assurer de Lui.
Calme-toi maintenant Iscariote calme-toi
grimpé sur le figuier
la corde au cou
les années passant tu ressembles
à un rameau en cendres un de plus
(un peu tordu un peu mis au ban)
sur le large tronc ;
le sang de l'injustice racheté par la douce
rencontre offerte par cet arbre
aux voyageurs à pied aux travailleurs des champs.
(Vie recluse)
On dit que par delà les mers et les terres
il est une île et des rochers rugueux au bout
où des vies rugueuses et des âmes racornies
dans des ruines ont trouvé refuge.
Les murs gardent des marques de fumée
et le soir un cortège fou de danseurs hideux
sort avec pipeaux et tambours dans Broadway
(ainsi nomme-t-on dans la prison l'étroit couloir
entre les cellules — dans l'une on fête
Thanksgiving dans l'autre les gars sur la tête
ont des citrouilles de Halloween
ailleurs on pend un noir en chemise de nuit crasseuse
les mains liées dans le dos).
Oui les torches se multiplient
les bourgeois du Klan sont en route pour casser
des crânes l'essence coule au bloc D
sur les quais le transfo les génératrices
l'air est épais bien que tournent
lentement les ailes du moulin géant
on attend une lettre en vain.
Éteignez la lumière, éteignez, le shérif et son détachement
ont gagné les collines les vieilles Chevrolet grincent
«Qu'est-ce que c'est, qui est là ? Halte-là !»
On dit que par delà les collines il est un lac
Muir Woods déborde d'immenses séquoias millénaires
des ruisseaux cristallins rafraîchissent les premiers indigènes
ceux qui sans savoir s'égaillent dans la forêt
ne détiennent pas le lourd destin le sang honteusement versé.
Leon Whitey Thompson, Papillon, Al Capone,
l'Homme-Oiseau, tous les autres, soyez prêts.
Par delà la barrière les autoroutes
encombrées de camions l'industrie n'arrête pas
des trains-containers apportent le tumulte aux terres rouges
d'Arizona tout le pays halète en dormant
rêve d'une abondance multicolore vrai rodéo
le conte de fées s'achève ici sur les matelas douillets
dans les plumes d'oie du vieux grenier
la douce odeur du bois pourri lessivé
et la tarte aux pommes qui gonfle dans le vieux four à bois
tous à présent docilement attendons
la première lueur de notre nouvelle journée
(de ce ciel bas personne jamais ne s'est évadé).
(Vie recluse)
Ils sont couchés s'étreignant désespérément
entre eux rien que la lave et les siècles
les vêtements de l'homme sont d'un noble
elle une femme du peuple — pas une esclave — plus jeune que lui
ses mains sûrement piquetées de henné
ses cheveux savamment tressés
à la mode de ce temps-là
ses lèvres embaumaient sans doute la myrrhe de Syrie
mais tout cela nul autre ne l'a vu
dans la chambre de l'hôtel bon marché
c'était un couple illégitime sans doute.
Ce qui ressort de leurs attitudes la peur
non du spectre de la mort qui vient
mais la peur d'être séparés.
En cela du moins le Vésuve a été doux —
à l'instant de les séparer les unissant
à jamais dans un rugissement ultime.
Maintenant je le sais je ne trouverai pas ce lieu que je cherche
avec fureur si longtemps
sans compter peines et privations
sans ménager mes compagnons
plus d'une fois trahis.
(Ils ne doivent pas, mes compagnons, soupçonner
que dans ces divines montagnes ils s'échinent en vain.)
Du fond de la gorge monte la voix de l'Urubamba
près de nous des oiseaux gazouillent — se moquent-ils ?
et la pluie tombe sans trêve monotone et grise.
Nous ne verrons pas le Temple du Soleil c'est écrit
nous ne retrouverons pas ceux que nous aimons
nos clinquantes armures sont ternies
et je vois une ombre (prélude à s'entretuer)
gagner le regard de chacun de nous.
Ce lieu peut-être l'avons-nous entrevu
mais Virakotsa nous a rendus aveugles
ou l'a couvert d'épais nuages
et nous rongés par l'alcool et la fièvre
nous l'avons pris pour un rêve puis oublié
une fois nos yeux rouverts.
Cette jungle je le sais à présent
cette jungle va nous engloutir
et l'Inca tout-puissant nous couvrir d'injures
pour notre imprévoyance notre arrogance notre rapacité
notre destin — quoi de plus juste —
c'est dans ce lieu nous perdre à jamais.
|
Sur le chemin de Huinay Huayna au Machu Picchu au lever du jour le jeudi 16 décembre 1999 |
(Vie recluse)
Guadalcanal, je t'ai vue surgie de l'océan
le crépuscule te rendait incertaine
la végétation folle trompait les sens.
qui es-tu vérité mensonge comment savoir
dans le sable creusé la vision terrible
d'un homme qu'a rendu fou le barrage des bombes
à l'horizon se dressent des colonnes d'eau
ça sent la sueur la pisse et le soufre
Guadalcanal, tu es ces montagnes indestructibles
ces oiseaux de paradis ces serpents
tu es cette jungle pourrie ces pieuvres pourpres
la solitude qui tue l'embuscade sournoise de tes buissons
Guadalcanal, tu es les eaux glacées
les brumes soudaines la bruine d'après-midi
la boue les plages et leur démence
la mitrailleuse faucheuse les coups étouffés dans la nuit
la cervelle éclatée les mouches dessus
tu es l'agonie les larmes les supplications
et cette balle tirée pour moi.
Guadalcanal, tu es une effervescence de l'âme
que peuplent combien de fous combien d'illuminés
combien d'enfants en liesse rêvant de te voir
Guadalcanal, tu n'es rien et tu es tout
tu es un spectre qui palpite sur l'écran vide
avec vieux sous-titres glaces et graines de tournesol.
Guadalcanal, jardin de rêve jardin de mort
j'aime ton allure étrange
les autres une fois partis je serai là encore
à plat ventre dans les hautes herbes
les oreilles bourdonnantes
après la foudre de ton orage virginal.
Tes créatures courent toutes se cacher
et moi pétrifié chasseur
en même temps que gibier
Robinson à l'envers
oublié par le temps.
(Guadalcanal, la plus grande des îles de l'archipel des Salomon, dans le Pacifique, fut le théâtre de combats meurtriers entre Américains et Japonais entre août 1942 et février 1943.)
(Vie recluse)
Dimìtris Houliaràkis était l'un des quatre jeunes poètes invités dans l'anthologie Gallimard, il y a sept ans, avec Stratis Pascàlis, Thanàssis Hadzòpoulos et Costis Guimossoùlis. Je m'aperçois que le «jeune poète» fête cette année ses cinquante ans. Incroyable.
Sa poésie avait doublement sa place dans l'anthologie : pour sa valeur propre d'abord, mais aussi pour ce qu'elle nous révèle de l'âme grecque. On y rencontre souvent la mort. Le poème chez Houliaràkis est souvent un cheminement vers elle, une descente aux enfers. Cette poésie volontiers narrative, parfois visionnaire, baignant dans une lumière sombre, dit la peine des hommes, la vanité de tout, la folie de tout, la menace diffuse du destin, avec une amertume qui aime à se teinter d'ironie et un lyrisme qui allie souplement le solennel au familier. L'ironie amère, c'est l'héritage de Karyotàkis, poète majeur des années 30 encore inconnu chez nous ; l'alliance de noblesse et de simplicité, encore une fidélité aux anciennes traditions grecques.
Défense des seins et des becs (1983), Les métaux noirs du désir (1985), Superga attend (1987), La dépouille des jours (1994), Vie enfermée (2002) : en vingt ans, Houliaràkis nous a donné cinq recueils seulement. C'est aussi un traducteur virtuose et inspiré, qui a fait passer en grec, notamment, Yeats, Kipling, Joyce, O'Neil et Schultz.
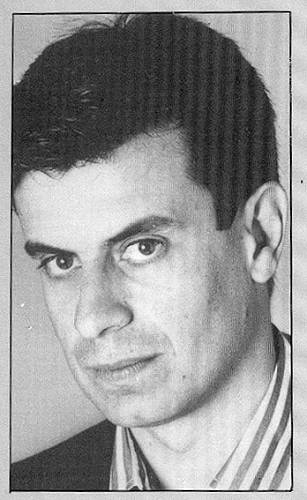 Dimìtris Houliaràkis. |