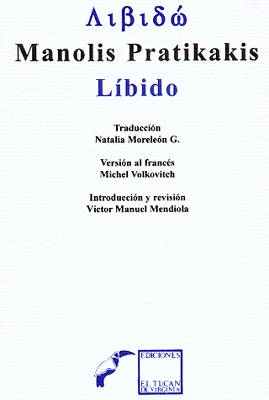
Manòlis Pratikàkis
Une invisible
pulsation
vive, assoiffée comme
une biche
éternellement descend
à la source.
Entrant dans tes soirs solitaires dans tes nuits solitaires comme autrefois j'entrais dans les bois et les oiseaux tressaillants du soir et les dauphins soudains battant des ailes au fond des arbres, je tâtonne en des lieux inconnus, sur des corps anonymes, de petits embryons de voix. Toi orientée vers un point lumineux, lisant le grand livre de la mer quand passe dans les galets celui que j'étais cet inconnu avant qu'on me coupe les ailes et que la moitié de moi reste au fond de la mer libyenne, face aux roseaux d'une jeunesse où soufflait un autre vent, aux petits cafés, à leurs vagues de chagrin aux fenêtres ouvertes et leurs lunes, marchant seule sur la rive, reflétée dans les rêves, et moi te parlant dans les rochers te retrouvant dans toutes les visions, jaillissante.
Au fond de toute chose, multipliée, géographie de la beauté, me laissant et revenant vers moi jusqu'aux bruyères les plus lumineuses.
La source qui bruissait en nous est tarie, tandis
que traînent dans les couches d'air épaisses
nos soirs blafards.
Quand la nuit tombe et que ta bouche
comment n'est-elle plus qu'un nid abandonné
de terre et d'herbes.
Quand la nuit tombe et l'enfance
remonte. Souviens-toi
nous passions les années, nos paroles
exhalaient un parfum
de tempête
nos rires étaient les autres clapotis
sur les galets. Tu étais une lueur
à mon côté marin là-bas, qui faisais resplendir
profondément toutes paroles
tous sentiments tels d'innocents poissons dans les
abysses.
J'étais la mer pour t'attendre pendant
ton absence, que tu viennes baignée à demi
dans la pensée, à demi dans la sensation. Ton trésor
était le fruit venu des lendemains
des hommes vers l'île où la lueur
de l'éventuel empêchait le soir
de tomber.
Ta bouche
margelle secrète
du printemps.
Ta voix
est l'eau d'un puits
pour que montent les mots en plein
jour et que je te connaisse
lumineuse, terrestre
présence.
Existante, indéfinie, je te regardais dans les yeux
au-dessus des eaux en extase
de l'espace
hors d'atteinte.
Aile esseulée cherchant l'autre
oiseau fugitif au mât
de mes poèmes.
Existante, indéfinie ; toute chose
en toi est née pour le passage
de soi-même aux miracles ;
pour que toujours tu respires dans l'absence
comme une bête en sa tanière
pour qu'à jamais je cherche
tes traces.
Tes formes changeaient de couleurs à la lumière
de ma pensée. Tu marchais solitaire
méduse immense de la nuit
des eaux.
Qui m'apportait douleur de mal d'enfant
métamorphose
pour être avec toi toujours le temps du feu
dans le bois pourri, la blessure
de ta beauté, un
acte multiplié
de mise au monde.
Voix première qui dessines mon ouïe.
Première vue qui modèles mes yeux.
Toi qui m'ébauches dans la lumière et me reprends
dans les rêves, lit frais
du feu.
En toi palpite un oiseau d'avant
le malheur du langage.
Une faim profonde avant la bouche, l'instant
qui me regarde passer
inchangé.
Avec ton sens métamorphosé me levant
dans les mots. Et les mots se lèvent alors comme
des petits enfants respirent
avec le sang et les fleurs.
Souffle qui me remets au monde.
Souffle qui nous ramènes
au plus vert
des protoplasmes.
Fleuve profond de l'été tu descendais dans la
soif et moi qui traduisais mon âme en visions
mûries peu à peu en toi près des abruptes
rives, et moi qui écrivais un poème et mes
doigts se couvrant
de feuilles vertes.
Ainsi reflété en toi reflet redoublé
aux jardins où tu vendangeais les couleurs les
frissons inconnus. Toi d'être ainsi parlée
ainsi bue tu étais l'instant vert la germination
tes deux seins oasis au désert où rosissait la lumière soleil enfant.
Et ces cheveux dans l'été passage
d'oiseaux la bestiole qui tremblait lumineuse
en nous quand nous parlions
une autre langue à l'écriture
inconnue, alphabet secret qui ouvrait
une porte pour s'éveiller différents
dans tous les rêves. Tu tenais ma pensée
et naufragé je naviguais sur le radeau
de tes bras.
Mercredi soir, c'est donc moins la joie de bientôt
te rencontrer, que la lueur sur les maisons désertes laissée
par ce qui tient dans ta main blanche
et que je ne peux voir, car mes yeux
sont partis déjà pour mieux te
contempler aux petites heures où tu te caches, où tu
es près de quitter le monde, pour être en arrivant
toujours une autre qu'à nouveau
il nous faut tel un parfait martyre
déchiffrer du début.
Dans une chambre fermée toute blanche au fond de l'océ-
an, un vieux miroir d'argent au mur im-
mobile où nous pouvons enfin voir
de quel côté nos pas résonnent,
ces chemins qui nous dépassent. De quel côté penchent
les visages de tous ceux
que nous avons ou n'avons pas été.
Silencieuse dans les eaux muettes
de mon sommeil.
Deux longues rames aux épaules
tu vas frappant la partie éteinte
du temps et tout au fond
brille le rivage
des petits garçons que j'étais.
Par les crevasses des paysages les champs de ruines
tu revois parfois ton visage ; parfois même
tu découvres tes formes
noyées dans des eaux lointaines
et les images qui toujours voudraient s'in-
carner dans ses vertèbres nues.
Se lèvent alors de petits mondes et des paupières
en de tendres ténèbres. On les modèle en des grottes même avant
telles des formes encore vertes et tels des souffles violets venus
d'une ouverture embaumée. Et dans les actes nos mains fleurissent. Et nos mains en nous
sont d'argile.
Quelle bouche contient la source.
Quelle main déracine les orties
de nos âges.
Qu'il n'existe plus de ravine obscure
de douleur.
Aucune nuit des hommes n'est impraticable.
Alors j'ai vu par la porte entrouverte à la lueur
soudaine de l'éclair l'autre espace.
Proues aperçues un instant dans l'ombre.
Les forêts qui frémissent les voix silencieuses qui paissent
dans la vision comme des chevreuils
dans la verdure.
Car c'était un parfum avant d'être poussière ; un sommeil
un rouge de cri une poitrine
sur le rivage. Ouvert afin que le ciel entre
et teigne en bleu nos paroles.
Quand j'étais le rossignol afin
que tu sois la ravine.
Quand j'étais la haute mer des yeux
afin que tu
jaillisses.
Dans nos sommeils couraient torrents et cascades
en un paysage musical.
Des chemins où luisaient nos pas dans la
nuit comme des pièces d'argent.
Des membres qui tentaient de ressusciter en des bran-
ches fraîches dans la nature où s'éveillaient les voix des
fleurs ; murmures du corps, images
coupées du côté de la nuit où l'Eurotas
à nouveau passa perpétuel
étincelant pour aujourd'hui baigner
dans les remous de nos rêves Hélène.
Touffu et furieux j'étincelle
dans les fureurs couteau rouge planté qui cherche
à s'emparer de sa gaine de pourpre.
Voués au meurtre où tout au fond une matrice
essaie la résurrection.
Une fontaine d'herbes et de cris, coups d'ailes sans nom
dans l'extase.
Acte mortel comme si l'acte
entraînait et portait dans son sein
le mobile.
Cet enfantement à l'envers.
Une grande épée tournoie entre les mains
prêtes pour le feu. On dirait qu'un trou s'est ouvert
dans le sol, on y a jeté la graine.
Et hors de la matrice de terre
est apparue la tête et la chair comme une aurore
et les autres membres des fleurs.
Et l'Hadès est en émoi car les morts
se retournent.
Puis la douleur a façonné au fond de nous
sa fleur comme le souffle
d'un nouveau-né.
Dans la pierre qui soudain sentait l'eau s'éveillaient
les larmes.
Et le rire de la Mère a refleuri dans le jour.
Et sa dépouille dans les sables.
Dans les épaisses ténèbres étincelaient de tendres
gisements ; apparut un instant l'intelligible cra-
tère la cause tel un instinct dans la fièvre, la source
et le clairon de la solitude les terres : de l'or.
Et voici, des aveugles aux six-cents yeux aux
trois mille bouches.
Dans les épaisses ténèbres les vers luisants
comme ils étincelaient, luisaient
dans les eaux noires tandis que l'étrave du corps
glissait de la forêt
à l'Argo son navire, et des planches
à leur essence
marine.
Ou encore dès que la lame touchait la meule et des lu-
mières s'en échappaient reflé-
tant l'arbre perdu et sa toison d'or
dans le précipice ;
au fond des eaux de nos soupirs noyé cet
ange.
Ce passage d'eau par le côté où s'ouvrent
les rochers ; roulement d'yeux vers le vent lumière
jaillie dans le juillet des
mousses.
Les voici visages éclatants les voici éblouissants lavés
au bruit confus de la marée dans
les grottes ; le spasme lumineux : colombe bleue
dans les fissures de l'être
soudain décrochée de
sa nuit.
Fièvre de la chair
— d'une grande sensation
qui te cherche —
Sueur sur la peau dans la
nuit : éblouissement de rosée
sur les feuilles
d'une autre
aurore.
De porter ainsi dans la soif ton Argo
toujours tu rames de sensation en symplégade
et de faim de caresse en toison d'or.
Avec cette herbe rare quelque part en elle au fond
dans l'ombre et la lumière mourant et dans la pensée qui s'ouv-
rait une autre route apparue
dans l'impérissable.
Elle avançait et volant toujours
quelque feuille d'arbre à l'Auberge de Gravias, une profonde
voyelle de fleuve et le flutiau du noyé
en elle, une grande rose aux ténèbres
de la tempête.
Ô ce voyage vers la mer où nous menait-il?
vers la prairie ? le ciel ? tu soupirais emplissant la chambre
de pois en fleur, de petits cris rouges, dans les
draps poussaient des oiseaux, leur secret
babil et tu criais vers moi, aux confins
de la chair et de l'imaginaire
ô c'est la nuit serre-moi qu'illuminé
je t'illumine, il faut nous regarder l'un l'autre et descendre
aux Enfers parés de fleurs et de fruits.
Vagues de lumière qui l'emportent
et la disent.
Vagues de la mer dans une île
qui voyage.
Comment conserver une forme
qui était là pour nous
seuls
clair d'étoiles de ses rêves.
À l'heure où la nuit tombe sur le port en bas quand les chaînes
remontaient et qu'entre nous une petite bête est restée
prise au piège.
Femme fleuve limoneux cette douce poitrine autrefois
secrète oliveraie des mains ; la lumière devenue
lance pour l'enfant inconnu de notre voix.
Comme ces regards : la musique des yeux,
les petites cascades muettes.
À l'heure où la nuit tombe, les routes sous les étoiles, verre
brisé, femme privée de l'os des
accoucheurs, quand ta voix heurtée aux pierres n'est plus
qu'une image en verre ensanglanté.
Désertée
église pillée sans icônes
et les ovaires coquilles vides
en l'Océan.
Jeté sur les galets à moitié mort les
vagues m'ont abandonné.
Au fond la Libido s'éloigne elle n'est rien
qu'un virage une trompeuse
vision.
Vaisseau trouble et obscur
qui de partout prends l'eau
femme
quand tu as détourné le visage
et la lueur de l'aube
et le lait de tes seins
la chaux maternelle
coulait
sur
le tombeau
trop vert encore.
Et puis la mer encore ces draps qu'une lumière
a emportés changés en vagues nous recouvrant per-
dus dans les profondeurs du sens des
voyages nous les élus
des rencontres.
Là où les eaux nous n'entendions que bruis-
sements dans la nature et la pluie verte issue
du corps charnu d'un
nuage.
Puis ces grincements de navire qui mon-
tait un peu vers la lumière et beaucoup vers l'ombre.
Un navire qui sombre et renferme son
naufrage ; un navire noir qui aborde
l'abîme
de nos instants.
En moi maintenant un fleuve charriant ro-
chers racines de la montagne, voix
d'anciens chants un deuxième corps
qui me cherche lumineux comme l'étoile.
Manòlis Pratikàkis, né en 1943, d'origine crétoise, vit à Athènes où il exerce la psychiatrie. Dans la quinzaine de recueils qu'il a publiés, on retrouve l'influence des Présocratiques, une familiarité profonde avec la pensée taoïste et une conscience écologique aiguë qui fait de son œuvre un long dialogue avec la nature.
J'ai accueilli son Urne d'abondance de 1995 dans mes Cahiers grecs en version intégrale, puis un choix de poèmes dans l'anthologie Poésie/Gallimard. Auparavant, dans les années 80, j'avais donné aux Cahiers du Confluent d'Yves Bergeret des extraits de son troisième livre, Libido (1978). J'ai regretté alors de ne pas pouvoir publier le tout : musicien dans l'âme, Pratikàkis construit ses recueils comme une symphonie dont les thèmes seraient des images ou des idées, où chaque poème est une partie de l'ensemble, indissociable de lui. Une telle unité est en même temps d'ordre philosophique : elle met en scène le cheminement vers le satori — ce moment d'illumination où s'accomplit l'union des contraires, où se dissout le dualisme, où le moi se perd dans le grand Tout tandis que tourne l'immense roue héraclito-taoïste de l'éternel retour, où vie et mort naissent l'une de l'autre sans fin.
Mon désir de publier Libido en entier a fini par être exaucé grâce à ma très chère amie mexicaine, Natalia Moreleon, qui a bien voulu inviter ma V.F. dans un volume trilingue aux côtés de sa version espagnole du poème. Ledit volume, publié en 2001 à Mexico aux Ediciones El Tucan de Virginia, est évidemment introuvable en Europe. D'où ce recours à Internet...
La poésie lumineuse et charnelle de Libido a été mise en musique par Yànnis Markòpoulos, qui en donne une lecture jolie, charmeuse, que j'ai entendue chez le compositeur, chantée par lui mais qui doit bien exister sur disque — en Grèce uniquement.
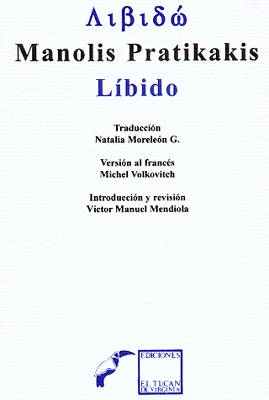
|