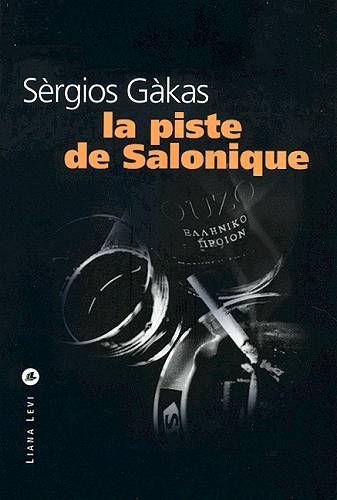
Sèrgios Gàkas
Je ne connaissais pas Gàkas avant que l'éditeur Liana Levi m'envoie son livre. Je savais qu'il était né en 1957 à Athènes, qu'il avait étudié le théâtre à Paris avant de devenir metteur en scène en 1979 dans son pays, et qu'il avait écrit deux pièces pour jeune public avant de publier ce roman, son premier, un polar.
Le plus simple sera de recopier ma note de lecture :
L'histoire se déroule en Grèce à la fin des années 90. Un quadragénaire alcoolique, avocat raté, se laisse entraîner par une femme riche et trop belle dans une histoire de plus en plus glauque. Il mettra au jour peu à peu tout un nœud de vipères (magouilles politico-financières, chantages, meurtres, disparitions, vengeances...), affrontera quelques crapules (dont un riche et puissant industriel), puis, au final, un psychopathe. La piste de Salonique, à première vue, est un roman noir fidèle aux canons du genre, bien ficelé, efficace, remarquablement écrit, de façon dense, vive, percutante, avec son lot d'archétypes, d'action, de mystère, d'atmosphère, de noire poésie, avec le ton hard-boiled des grands classiques, les brèves scènes d'humour, et aussi (mais de façon discrète) un peu de la gouaille imagée plaquée là-dessus naguère par les traducteurs français de la Série Noire. L'auteur a semble-t-il conçu son livre aussi comme une sorte d'hommage à un genre. De ce point de vue, c'est déjà une très belle réussite, étonnante de la part d'un quasi débutant.
Mais tout comme les meilleurs polars, La piste de Salonique ne se réduit pas à un exercice de style. Gàkas a bien réussi à greffer la réalité grecque sur ce folklore étranger. La Grèce d'aujourd'hui, en pleine évolution économique et sociale, est présente à l'arrière-plan, dépeinte par petites touches de façon très juste, sans concession au folklore. Le décor — Thessalonique l'hiver, froide, pluvieuse, brumeuse, à la fois réelle et rêvée — est inoubliable. Les personnages dépassent les conventions dont ils sont nés pour acquérir une vraie épaisseur — à commencer par le pitoyable héros-narrateur, dont la verve grinçante, le faux cynisme et le vrai désespoir sonnent juste. On peut entendre à tout moment, si l'on tend l'oreille, sous la pulsation du swing propre au polar, une petite musique personnelle.
J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce polar grec, et je ne suis pas le seul. Le dossier de presse comporte une demi-douzaine d'articles louangeurs, d'où j'extrais notamment ceci : «Le texte de Gàkas, telles les poupées russes, déborde d'histoires et de trouvailles articulées de façon habile et tout à fait naturelle.» «L'intrigue est serrée, le rythme nerveux. Gàkas tisse avec une remarquable habileté l'histoire grecque contemporaine, et tient le lecteur en haleine.»
Voilà, me semble-t-il, un roman qui mérite amplement de passer les frontières.
Il les a donc passées, grâce aux éditions Liana Levi qui m'en ont confié la traduction. Comme je le prévoyais, je ne me suis pas ennuyé une seconde. L'éditeur ne m'a pas fait de misères. Il a fort gentiment écrit mon nom en 4e de couv seulement, et en tout petit, pour m'épargner en cas de protestation des lecteurs. Mon seul regret : le titre qu'on m'a imposé, où Thessalonique est rebaptisée Salonique... Mais le travail avec le relecteur maison, Matthieu Gorse, a été amical et enrichissant.
Déjà un article dans Le Monde, signé Gérard Meudal :
«Premier roman remarquable... Transposition très réussie du «hard boiled» américain dans la Grèce des Colonels. Avec une véritable ambiance et quelques portraits inoubliables.»
Eh bien voici le début de cette Piste de Salonique :
Lundi 9 janvier
Il me fallut trois heures pour écluser l'armagnac que le Vieux gardait dans les toilettes pour je ne sais quelle grande occasion. Si l'on y ajoute les verres de cognac bus à ses funérailles, je lui avais rendu un hommage plus que suffisant. Il devait être satisfait. Cela se voyait d'ailleurs à son sourire sur la petite photo encadrée — seul élément décoratif sur son antique bureau de bois. Le Vieux avait dû sourire dès le jour de sa naissance. Mais je ne saurai jamais, hélas, s'il souriait à l'instant où la valve en plastique de son cœur cessa de fonctionner sur un parking désert de l'autoroute.
Dans l'agence immobilière voisine une radio rivalisait avec une énervante machine à écrire. «Ce soir je vais partir Je ne te ferai plus souffrir...» Ne voulant pas pleurer, je fixai toute mon attention sur une mouche du troisième âge qui depuis un bon moment s'efforçait de me dire je ne sais quoi. Une mouche seule en plein hiver. Je ne ressentais pour elle aucune pitié.
Je me mis une cigarette au bec, mais avant que je l'allume la toux monta dans ma gorge et m'étouffa. Les larmes aux yeux, je parvins à gagner la fenêtre et à l'ouvrir. Il pleuviotait. La pub Amstel géante sur la terrasse d'à côté était encore éteinte et le reste du paysage n'avait rien de d'excitant. Je regagnai ma base. La mouche récupérait ses forces sur le l'agenda en se demandant si c'était le moment de sauter par la fenêtre dans l'avenue Stadìou. Je lui avouai mon désir d'acheter un chapeau pour cacher le petit espace nu en formation sur le haut de mon crâne. Elle me snoba totalement. Je me pelotonnai dans mon manteau et au fond du fauteuil.
Désormais j'étais seul. L'avocat Loukas Marsèlos, le brave petit vieux qui m'avait pris comme associé pour avoir été comme les deux doigts de la main avec mon père, ne supportant pas de me voir traîner en dilapidant les débris de la fortune familiale, avait tiré sa révérence une fois pour toutes, laissant un bureau sans la moindre affaire en suspens. Comme s'il l'avait prévu.
À l'enterrement le notaire Lìlis m'avait dit que les seules possessions du Vieux étaient le petit deux-pièces où il vivait, la Hillman où il avait rendu l'âme et trois millions de drachmes à la banque. L'appart et la Hillman étaient pour moi et les trois millions pour Médecins du monde. «Heureusement qu'il ne les a pas légués au Parti», lançai-je, et aussitôt je le regrettai : le notaire aux cheveux blancs avait la larme à l'œil. Lìlis, le Vieux et mon père, dans les années 50, s'étaient offert la tournée des îles. Les bagnes de Makronìssi, Aï-Stràtis et Yoùra, charmantes villégiatures, avaient accueilli ces hommes de gauche. Ils s'en étaient bien sortis, si l'on excepte certains détails, tels que la santé, la vie familiale ou les finances — rien d'important, et d'ailleurs ces choses-là ne les avaient jamais tellement préoccupés. Le Vieux avait épousé une sainte qui l'avait aimé et chouchouté jusqu'à ce que sa méchante maladie l'emporte. Lìlis avait dédaigné les joies de la vie conjugale, et quant à mon père, après l'échec de son mariage, il s'était réfugié dans les profondeurs d'une papeterie, à la comptabilité. Lorsque cinq ans auparavant il s'était pendu à un arbre dans un parc d'Athènes, Loukas et Lìlis s'étaient battus à qui me prendrait sous son aile. Alors âgé de trente-quatre ans, j'étais doté d'une licence en droit qui n'avait jamais servi et d'un cerveau à moitié fondu dans l'alcool. Loukas l'avait emporté, faisant de moi son associé dans son bureau d'avocats. Les deux premières années je réduisis un peu la consommation et tâchai de me rendre utile. Les affaires dont nous nous occupions étaient simples, faciles et ennuyeuses. Ennuyeuses plus que tout. La troisième année, Loukas se mit à courir les médecins. Il claqua toutes ses économies en pontages et espaça ses visites au bureau. Pour égayer la routine, j'ajoutai un peu de whisky au café du matin. Un an avant sa mort, malgré mes protestations, le Vieux replongea dans le boulot. Un jour il but mon café par erreur et faillit tomber raide. Il disparut pendant une semaine. Je le cherchais partout, en vain. Il reparut soudain, un dimanche après-midi chez moi, posa une bouteille d'ouzo sur la table de la cuisine, lava deux verres et les remplit. Il s'assit, me demanda une cigarette, l'alluma — je ne l'avais jamais vu fumer après ses opérations —, trinqua et but une gorgée. «Un petit verre de temps en temps, ça fait circuler le sang» dit-il en me clignant de l'œil. Il consulta sa montre et m'ordonna de m'habiller. Il conduisait son Hillman verte comme un possédé en chantant d'une voix enrouée des chants de partisans. Le parti nous éclaire Marchons sous sa bannière. On arriva au stade de Nèa Smýrni où le Paniònios jouait contre Aris Salonica — c'était la saison où l'équipe de mon père, du Vieux et de Lìlis avait été reléguée en deuxième division. Après le match il m'offrit un verre au 16. Il ne but que de l'eau. Il ne parlait que du Paniònios et de son glorieux passé, de Saravàkos, Hàïtas, Lìmas, Jacques Latouché la panthère haïtienne, des gentillesses que mon père et lui lançaient aux arbitres vendus, et me décrivit dans tous les détails la finale historique de la Coupe en 79. Pendant les rares pauses de son monologue, il me prenait tendrement la main, attendant une promesse. Je rentrai chez moi poursuivi par son douloureux sourire.
Le lendemain matin je décidai d'arrêter l'alcool. J'allai chez un psy et en six mois redescendis à trois verres par jour. Peu à peu je retrouvai tout ce que j'avais perdu en croyant que la vie est facile. Je me remis à lire, à sortir au cinéma, à faire la cuisine, à me laver tous les jours, à regarder les femmes. J'avais repris les kilos nécessaires pour soutenir mon mètre quatre-vingts, dormais sans lumière allumée et me sentais prêt à remplacer ma télé en noir et blanc par une en couleurs. Tout cela jusqu'au jour — le vendredi d'avant — où le Vieux m'annonça qu'il allait à Thessalonique voir un vieux copain. Je tentai de le persuader de prendre le train, mais rien à faire. Il se séparait rarement de son épave.
Le samedi après-midi je fus prévenu par l'hôpital de Lamìa. Le notaire se chargea des formalités, et moi j'entamai une longue discussion avec William Teacher, Alexander Gordon et d'autres bons vieux potes, qui ne te laissent pas en carafe comme l'avait fait le Vieux.
J'avais dû dormir un bon moment. Quand j'ouvris les yeux, une obscurité glacée s'insinuait par la fenêtre. Je me levai péniblement en m'appuyant sur les bras du fauteuil. Dans le bureau voisin le chanteur Dalàras était près de faire sauter le poste avec ses cris inarticulés en espagnol et la mouche s'était évadée, pour lui échapper sans doute. La pendule marquait huit heures dix quand on frappa à la porte. Elle s'ouvrit aussitôt. Sans me laisser le temps de dire «entrez». Je regrettai de ne pas avoir fermé à clef, trop tard. Une femme était là devant moi. Grande, mince, belle. Je ne sais pourquoi, je pensai que ce pouvait être une pute aussi bien qu'une bonne sœur. Elle portait un long manteau noir, les cheveux tirés en arrière. Pris d'un vertige, je cherchai un point où accrocher mon regard. Je trouvai un canard en argent épinglé à son revers. Elle inspecta le bureau d'un coup d'œil et ne trouvant rien d'intéressant elle me montra ses yeux. Verts. Deux flammes sombres, bonnes pour éclairer le cœur de l'enfer.
— Le bureau de maître Marsèlos est bien ici ?
Elle parlait à voix basse, comme si quelqu'un dormait dans la pièce à côté. Je ne répondis pas. Après deux jours de tentatives héroïques pour m'habituer à l'imparfait, le présent de sa phrase remuait trop de choses en moi.
Je voudrais voir maître Marsèlos, reprit-elle un peu plus fort.
Excusez-moi un instant, dis-je, et je courus me réfugier dans les toilettes.
Je fermai la porte derrière moi et me regardai dans le miroir. Si l'homme que je vis m'avait demandé du feu dans la rue, il m'aurait fait fuir. Je me passai le visage à l'eau froide, me peignai, comptai jusqu'à cent et sortis. Debout devant la fenêtre, les mains dans les poches de son manteau, elle respirait l'air pollué de l'avenue. Elle se retourna et m'adressa un sourire de commande.
— J'ai rendez-vous avec maître Marsèlos. À huit heures. Il n'est pas là ?
— Asseyez-vous, je vais vous dire.
Elle s'assit en face de moi et attendit.
— Maître Loukas Marsèlos est mort il y a trois jours. D'un infarctus.
— Comment ?
— Son troisième. On l'a enterré aujourd'hui.
Sans un mot, elle prit un paquet de cigarettes dans la poche de son manteau et en alluma une. Ses mains tremblaient.
— Je suis... j'étais son associé. Simeòn Piertzovànis.
— Oui, j'ai vu votre nom dans l'entrée, balbutia-t-elle. Je ne savais pas qu'il avait un associé.
Quelques secondes passèrent. Ses ongles teints en rouge. Je regardai discrètement les miens. Ils étaient noirs.
— Je ne sais pas quoi dire. Il s'était chargé d'une affaire me concernant et je suis venue de Thessalonique pour lui parler.
— Vous allez devoir chercher un autre avocat. Notre bureau va fermer.
Je me sentais soudain étouffer en sa présence. Je me levai pour lui faire comprendre qu'elle devait débarrasser le plancher. Elle semblait hésitante, comme préoccupée par quelque chose dont elle se demandait s'il fallait m'en parler ; moi, en tous cas, j'étais sûr de ne pas vouloir l'entendre. Elle caressait le canard d'argent tout en se mordant les lèvres.
— Je sais que ce n'est pas le moment, mais si vous retrouviez le dossier de mon affaire, je vous en serais reconnaissante. Je m'appelle Dàfni Kyprianìdi.
Je me demandai si elle était impolie ou simplement idiote. Heureusement je me rappelai les paroles du Vieux : les seuls êtres qui méritent le respect sont les pauvres, les fous et les femmes, ce qui m'aida à me contenir et à lui parler le plus gentiment que je pus.
— Madame, pour l'instant je suis sur les genoux. Je pense que ça se voit. Je n'ai pas dormi, j'ai trop bu, je n'ai pas le moral. Je n'ai qu'une envie, être seul.
— Mais...
— S'il y a un dossier, je le déposerai ce soir au bar qui se trouve au rez-de-chaussée. Vous le trouverez facilement. Il y a un 16 clignotant sur la porte.
Elle baissa les yeux.
— Excusez-moi, vous avez raison... je vous comprends.
Elle lâcha le canard, se leva et me tendit la main. Elle était glacée. Avant de sortir elle se retourna.
— Condoléances, murmura-t-elle avant de fermer la porte derrière elle.
Je fermai les yeux. Encore ce putain de vertige.
Le lendemain matin j'irais au marché m'acheter un petit canard. Un nouveau-né. On m'avait dit qu'il se passait un mois avant qu'ils grandissent et deviennent moches. Je le garderais pendant un mois, puis je l'offrirais. Ou je le mangerais et les remords me pousseraient au suicide.
Le 16 ouvrit en 1970, avec des capitaux de George, un Grec d'Amérique, propriétaire d'une chaîne de magasins de nourriture pour chats et habitant permanent de Missula, une petite ville du Montana. Il était revenu en Grèce à l'été 69 pour ses vacances, après dix-huit ans d'absence, avec sa femme mexicaine et ses trois enfants. Le premier soir il resta barricadé dans une suite de l'hôtel Grande Bretagne en compagnie d'une bombonne de gin-tonic, à observer l'Assemblée nationale depuis sa fenêtre. Le lendemain matin il mit sa famille, ses chats et sa domesticité dans un bateau à destination de Rhodes et se mit en route. Le troisième jour il découvrit Aristìdis dans une cahute au fond d'un quartier pourri. Ensemble ils dénichèrent Fànis dans une tannerie en grande banlieue. Tous trois, par une nuit d'hiver en 1950, avaient embarqué la caisse de la filature où ils travaillaient depuis l'âge de quinze ans. Ils avaient alors dix-huit ans, le sang chaud et ne supportaient plus les baraques abritant les lamentations défraîchies de leurs parents, réfugiés d'Asie mineure. Après le boulot, ce soir-là, ils se cachèrent dans l'usine et attendirent patiemment que le comptable ait fini de compter. Dès que la lumière de son bureau s'éteignit, George jeta de l'étoupe enflammée dans un hangar et les deux gardiens affolés se précipitèrent pour empêcher le désastre. Aristìdis et Fànis les enroulèrent dans des sacs, frottèrent le museau du comptable avec une serviette imbibée de chloroforme, empoignèrent la serviette au trésor et prirent la fuite. Plus tard, en examinant leur butin, ils constatèrent l'étendue de l'exploitation de la classe ouvrière par le capital. La serviette du comptable contenait la paye du personnel et non, comme ils croyaient, la recette du point de vente en gros qui se trouvait dans la cour de l'usine. Avec la maigre part qui lui revenait, George alla chercher fortune en Amérique. Il la trouva. Fànis, qui travailla davantage que lui, gagna juste de quoi marier sa sœur, tandis qu'Aristìdis tuait le temps en changeant de boulot comme de chemise. En cet inoubliable été de 69 il jouait les réceptionnistes dans un hôtel de Plàka. George leur offrit un mois de bamboula, laissant sa famille rôtir au soleil de Rhodes. Ils avaient pour QG l'hôtel Grande-Bretagne. Chaque soir ils préparaient un nouveau plan d'attaque sur l'une des boîtes de nuit à la mode et se réveillaient chaque matin dans les bras d'une nouvelle pute. Le troisième jour George leur donna rendez-vous à la statue de Kolokotrònis. Il les attendait une enveloppe à la main. «Vous voyez le doigt du héros ?» demanda-t-il. «Il nous montre la route. Dans le Montana on dit que le commun des mortels doit suivre le chemin tracé par les héros.» Intrigués, ils marchèrent dans la direction montrée par le doigt héroïque et se retrouvèrent dans une galerie de l'avenue Stadìou. George sortit une clef de sa poche et ouvrit la porte d'une boutique vide. «J'ai terminé les contrats ce matin», dit-il en leur tendant l'enveloppe. «Cette boutique est à nous. Ce sera le meilleur bar d'Athènes. Demain les menuisiers seront là et dans un mois on installera tout l'équipement — frigos, air conditionné, la totale. On mettra la télé dans le coin là-haut. Les gains sont pour vous tant que je suis en Amérique. Si un jour je reviens, vous me donnerez un tiers. Il ne reste plus qu'à trouver un nom.» Ils se mirent d'accord sur «16», en l'honneur du 16 décembre 1950, jour du hold-up à la filature. George n'est pas revenu depuis. De temps à autre il leur téléphone depuis Missula et leur chante l'hymne national dans une langue bizarre, alcoolisée.
Pendant ces vingt-cinq ans rien n'a changé au 16. Le même comptoir allongé, le petit coussin au bout pour accueillir les coudes soutenant les têtes qu'alourdissent les défaites et les projets foireux, le miroir que recouvrent à présent des centaines de cartes postales — signaux de danger en couleurs, envois de clients contraints d'abandonner, si peu que ce soit, leur refuge —, la photo de Robert Mitchum jeune à côté de la télé noir-et-blanc, la vieille carte du Montana avec une fléchette plantée dans Missula. Un lieu immobile où l'on n'entend jamais de musique, où les verres sont le prolongement des mains et l'aboutissement des rides d'avocats retraités, de journalistes fatigués, d'ex-filles de rêve qui ont passé la cinquantaine. Une église trop sombre pour accueillir des icônes de saints, mais assez claire pour recevoir ceux qui souhaitent se confesser dans l'alcool, dans l'espoir, encore, de changer leur passé.
— Tu penses à Loukas ? me demanda Aristìdis en posant devant moi une vodka avec des glaçons et deux rondelles de citron.
Le bar était tranquille. La grande affluence durait de midi jusqu'en début de soirée. Vers huit heures la plupart des clients retournaient dans leurs foyers pour profiter d'un dîner chaud. Fànis prenant toujours le premier service, de midi à six heures, Aristìdis, dès que la salle se vidait, allumait la télé pour les infos, toujours sur la chaîne publique. Puis il éteignait, sauf s'il y avait un match, de football bien sûr. Le basket est un sport bien trop rapide pour que les habitués du 16 puissent le suivre. Je levai la tête et retrouvai la tête chauve que je voyais tous les jours depuis cinq ans.
— Non, je pensais à toi, à Fànis et au Ricain.
— Pourquoi ?
— Pour ne pas penser à Loukas.
Un client l'appela pour payer. Aristìdis lui offrit le dernier verre et revint vers moi.
— Qu'est-ce que tu vas faire du bureau ?
— Je laisse tomber.
— Et pour gagner ta vie ?
Bonne question — de ces questions qui la plupart du temps rendent la réponse difficile. Une chose était sûre : je ne pouvais pas garder seul le bureau. D'ailleurs je ne le voulais pas. Chaque fois que je devais aller au tribunal, je tremblais comme si c'était moi l'accusé. Je n'ai jamais été de gauche, sans doute par réaction contre mon père, et sur le plan moral je n'ai pas de quoi me vanter, mais dès que j'entrais dans le temple des faux serments et de l'embrouille, j'avais envie de gerber. Comme ces gamins qui haïssent l'école et qui, des années plus tard, dès qu'ils sentent quelque part l'odeur d'eau de cologne qui infestait le bus de ramassage, sont pris d'une crise d'allergie. J'ai pris le mauvais chemin, je le sais, c'est même là ma première pensée au réveil et la dernière quand je m'endors. Sous la dictature j'ai eu mon bac avec mention, puis j'ai passé ma licence vite fait, et dans les années 80 j'ai compris que pour survivre dans le marigot il me fallait devenir un hybride entre Tintin et Dracula. J'ai préféré gagner mon argent de poche au poker et fréquenter des filles riches, qui me trouvaient cynique, auto-destructeur et blessé par la vie. Au bout d'un moment, bien entendu, celles qui avaient un peu plus de cervelle qu'une bûche s'apercevaient que derrière la vitrine se cachait un flemmard peureux. Au début je buvais pour passer un bon moment, puis pour passer le temps, et à la fin pour faire passer les mains qui tremblent et la terreur de la nuit qui vient. Quoi de plus simple. Pas d'angoisses existentielles, d'amours malheureuses : rien qu'une habitude. On met du whisky dans son café comme d'autres du lait ou du sucre. La chose la plus facile est de fonder sa vie sur l'alcool et la plus difficile est d'admettre qu'on le fait parce qu'on est idiot.
— Alors, monsieur Simeòn, comment vas-tu gagner ta croûte ? redemanda Aristìdis.
— J'ai sept cent mille drachmes à la banque. Quand je serai à sec, je trouverai quelque chose.
— C'est vrai, ça te laisse deux mois pour réfléchir.
Il m'abandonna pour calmer deux journalistes sportifs qui se crêpaient le chignon quant à la validité d'un but du Panathinaïkos. C'est ça, un bon barman. Il te jette un os puis te laisse te ronger les sangs, sachant que tu vas boire encore deux ou trois verres avant d'aboutir à une conclusion ou une décision qui le lendemain matin aura été engloutie dans le trou de ta mémoire. Non que la question de mon avenir ne m'ait pas préoccupé, suite aux derniers événements. L'aspect financier surtout s'était déjà mis à titiller ce que les spécialistes appellent «instinct de conservation», des fois qu'il arriverait à le réveiller. Comme tout le monde, j'étais loin de mépriser l'argent. Je dépensais tout sans réfléchir, d'accord, mais dans les moments difficiles, quand je ne pouvais pas faire ce que je voulais, étant fauché, cela me rendait fou. Et je ne supportais pas l'image d'un quadra enfermé chez lui, qui boit du cognac au goulot et joue aux échecs tout seul.
Je commandai une autre vodka et décidai d'aborder ce problème épineux quelques jours plus tard, en émergeant du deuil de mon associé. Les journalistes à côté avaient surmonté leur différend grâce à l'intervention d'Aristìdis le Juste, et lui expliquaient comment ils avaient disposé dans leur bureau, avec une habileté satanique, un miroir publicitaire dans le but de parier sur la couleur de la culotte d'une jeune stagiaire. Quand la porte s'ouvrit sur la femme aux yeux verts en manteau noir, les deux compères, suspendant leur discussion, se penchèrent sur leurs verres, sans doute pour préparer leur prochain mouvement. Aristìdis, homme de sang-froid, regagna son poste derrière le comptoir. Un anesthésiste quinquagénaire, à trois tabourets de moi, était tellement bourré que même si Kolokotrònis était entré à cheval dans le bar, il l'aurait accueilli du même regard vide. La femme n'eut aucun mal à me repérer. Elle s'assit à côté de moi, fit un sourire angélique et commanda une vodka sans glace. Quelque chose avait changé sur elle, mais quoi ?
— Salut, dit-elle, et elle déboutonna son manteau.
Je hochai la tête.
— C'est bien ici, ajouta-t-elle en examinant le miroir aux cartes postales. À Thessalonique il n'y a plus d'endroits aussi tranquilles.
Aristìdis posa devant elle la vodka, une serviette en papier pliée et une coupelle pleine de pistaches.
— Je suis venue tard le soir, comme vous m'avez dit. Je vous prie de m'excuser pour mon comportement de l'autre fois. J'étais encore étourdie du voyage et...
— Ça ne fait rien, c'est normal.
— Oui, peut-être, dit-elle en avalant une gorgée. Vous voyez, je fais comme les Russes, je ne mets jamais de glaçons dans la vodka.
— Les glaçons gâchent l'alcool.
— Pourtant vous en mettez.
— Je ne peux pas faire autrement.
— Pourquoi ?
Je lui montrai discrètement Aristìdis qui suppliait le médecin de laisser sa voiture au garage et de rentrer chez lui en taxi.
— Et alors ? murmura-t-elle.
— Il ne me laisse pas faire, il a peur que je devienne comme Eltsine.
Elle rit poliment. On devine l'âge d'une femme à ses rides quand elle rit. La dame à côté de moi devait avoir dans les trente-cinq ans. Elle alluma une cigarette, préparant son entrée en matière. Je la devançai :
— J'ai trouvé le dossier que vous me demandiez.
Pas un mot. Elle attendait que je poursuive. J'y allai :
— Il était vide.
— Comment ça ?
— Un dossier bleu en carton bon marché. Loukas utilisait toujours des dossiers bleus en carton bon marché. Dessus il avait écrit Dàfni Kyprianìdi. Dedans il n'y avait rien.
— Vous êtes sûr ?
— Absolument.
— Peut-être a-t-il laissé sur l'ordinateur quelque chose qui...
— Loukas ne touchait jamais à l'ordinateur.
Son étonnement se changea d'un coup en inquiétude.
— N'est-ce pas étrange, M. Piertzovànis ?
— Pas tant que ça. S'il n'y avait pas de pièces officielles, tout ce que Loukas pouvait mettre au dossier, c'était le reçu de l'avance.
— Je ne lui avais pas encore donné d'argent, il avait refusé.
— Eh bien alors, nous ne vous devons rien.
— C'est vrai...
Elle éteignit sa cigarette et resta pensive un instant. La vodka mécontente attendait ses lèvres, mais celles-ci jouaient nerveusement avec deux rangées de dents parfaitement blanches.
— Aviez-vous discuté de cette affaire avec votre associé ?
— Non.
Elle but une gorgée, puis tout de suite une autre. Comme pour se donner du courage.
— Je me disais que peut-être vous pourriez...
— Désolé, je vous l'ai dit, le bureau va fermer.
— Si je vous parlais de l'affaire...
— Il y a des milliers d'autres avocats, et entre nous, plus capables que moi.
— Il ne s'agit pas vraiment d'un travail d'avocat. C'est une affaire très importante pour moi...
— Désolé.
— Votre associé était vivement intéressé... il avait pris la chose très à cœur.
— Madame Kyprianìdi, je dois beaucoup à Loukas, mais il est trop tard pour payer ma dette.
— Écoutez-moi seulement... Je vous paierai le temps que vous y passerez.
Son regard m'implorait. Il me sembla que ses yeux allaient verser des larmes vertes. Je me demandai depuis combien de temps je n'avais pas parlé avec une femme aussi belle.
— Laissez-moi vous inviter à déjeuner, demain... Simplement pour parler. Vous n'avez rien à perdre ! Et puis... je ne vous le dis pas pour vous allécher... ne le prenez pas mal... j'avais dit à votre associé que j'étais disposée à bien payer.
Elle me toucha la main.
— Je vous en prie...
Je me sentais fatigué, vidé. Je lui donnai rendez-vous à deux heures à l'Idéal. Elle me remercia d'un sourire de petite fille, me serra la main très fort et partit sans terminer son verre, craignant sans doute que je change d'avis, laissant derrière elle un parfum à la rose et un type à la cervelle pleine de cendres.
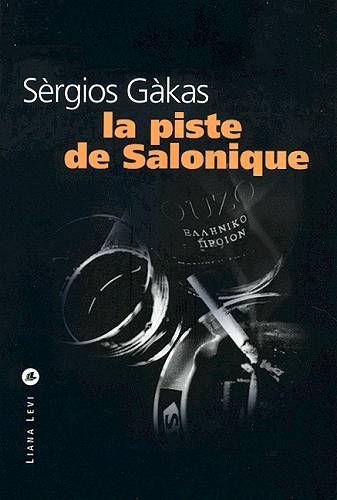
|