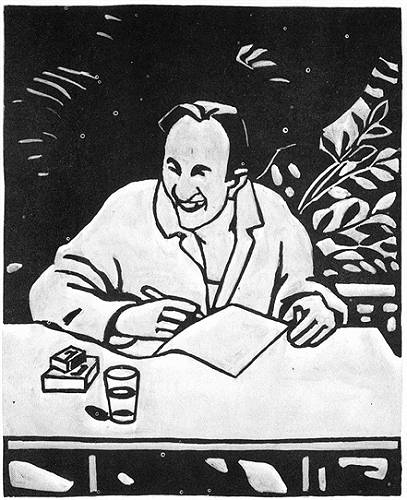
Màrios Hàkkas.
Màrios Hàkkas
Ça nous avait bouffés de l'intérieur à notre insu. Cette salle de bains grand luxe, avec l'hippocampe en blason sur le carrelage, la cane et les petits canards tout autour, les cygnes, les poissons paradisiaques, le lavabo, la cuvette, la baignoire, le bidet, tout le bataclan, étincelant de tous leurs feux, avaient agi en douce, pénétrant au plus profond de nous comme les termites dans le bois, et on se sentait tout vides.
Je me rappelle, quand je suis arrivé de mon village à Athènes pour la première fois, j'ai loué une chambre sans WC. Il y avait bien des cabinets rudimentaires dans la cour, mais il fallait descendre un escalier en bois, tout noir, qui grinçait dans un boucan à réveiller les morts. Un soir où il pleuvait, pris de coliques en pleine nuit, j'ai fait dans un journal et après avoir joliment emballé tout ça — j'ai même fait un beau nœud avec un ruban — de bon matin, en allant au travail, j'ai déposé le paquet au milieu de la rue. Vous vous rappelez sûrement combien de paquets de ce genre on trouvait dans les rues à l'époque. Certains donnaient des coups de pied dedans pour en deviner le contenu. Quelqu'un, dit-on, en avait même apporté un au commissariat sans l'avoir ouvert et demandait une récompense. Eh bien, c'est un paquet de ce genre que j'ai fait un jour moi aussi, et d'y penser après tant d'années, j'en ris encore.
En ce temps-là, j'étais un homme plutôt gai, aux besoins limités. Je ne me rasais que deux fois par semaine, quand j'avais rendez-vous sur la colline avec une fille qui était toujours pressée de rentrer. Elle faisait toujours le mur : son frère était sévère, une mentalité de Sicilien. Je l'ai épousée. Ce que j'avais de mieux à faire. Plutôt qu'elle se fasse tabasser chaque fois qu'elle rentrait tard... D'ailleurs, c'est la destinée de l'homme, à ce qu'on dit du moins. Du coup, je me suis retrouvé avec tous mes boutons solidement cousus ; c'est quand même un avantage, une sécurité, quand même. Ah ! les premiers temps... Chemises repassées, linge propre, chaussures cirées, j'étais toujours tiré à quatre épingles.
Elle avait une petite maison à son nom : une seule pièce mais une grande cour, et petit à petit, avec nos économies, on a fait d'autres pièces et la cuisine. Bref, il y avait du progrès. On a acheté frigo et machine à laver, la vie devenait plus facile.
La seule chose qui a traîné, c'est le cabinet. Dans une petite baraque au fond de la cour, des cabinets turcs m'obligeaient à m'accroupir tous les matins et comme je n'étais pas habitué à faire de la gymnastique, c'était un bon exercice. Dans la baraque, il y avait un petit réservoir à robinet que je remplissais tous les matins pour me laver. Pour le bain, le baquet. Quel cirque le samedi soir ! Ma femme me flanquait dedans et me frottait jusqu'au sang.
Je continuais à progresser. Aide-comptable, j'avais encore les traites de la chambre à coucher, un ensemble mastoc avec tables de nuit et lampes de chevet, bleu clair pour moi, rose pour ma bourgeoise. Puis je suis passé comptable et on a acheté un petit terrain à crédit. On a même planté deux-trois arbres qu'au début — ma femme insistait — j'allais arroser tous les dimanches. Après, ils ont crevé : trop à faire ; j'étais chef-comptable, avec un bon salaire, en quelques années on a eu tout ce qu'il fallait — salle de bains mise à part. Elle serait le couronnement de vingt ans d'efforts.
«On l'aura bien un jour, cette salle de bains», disais-je à ma femme qui n'arrêtait pas de râler et de se plaindre : quand on avait quelqu'un à la maison et qu'il voulait aller au petit coin, elle ne savait plus où se fourrer. D'ailleurs, au point où on en était, le cabinet, ce n'était pas une affaire. Et comme on met le meilleur de soi-même pour des choses qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie, pour les cabinets, j'ai fait mon possible pour arriver à quelque chose de vraiment beau : pour m'y sentir bien, j'ai mis des carreaux hors de prix qui formaient un ensemble bizarre de divers motifs, l'équipement sanitaire indispensable, et bien sûr un bidet.
Le reste ne me gênait pas. Je m'en fichais pas mal. Tous ces objets ont une certaine utilité et puis, à notre âge, on peut se permettre quelques menus plaisirs. Mais le bidet me tapait sur le système, et après, tout le reste s'y est mis. Le bidet. Constipé comme je suis, je l'avais de longs moments en face de moi et j'avais l'impression qu'il me narguait avec sa tronche allongée, un oeil bleu, l'autre rouge, triangulaires sur le front, globuleux comme ceux d'une grenouille, sa bouche engloutissant tout dans son cloaque avec un brusque râle à la fin, comme s'il susurrait : Regarde ce que j'ai fait de toi. Tu te rappelles le jeune homme que tu étais à ton arrivée ? Tu parles d'une histoire, mon pauvre, une vie pour une maison ! Je suis ta récompense. Vingt ans de travail pour te laver dans un bidet. Regarde ce que tu es devenu !
Pendant vingt longues années, de mon plein gré (ce qui est le pire), j'avais trimé comme une bête pour me retrouver en face de tous ces objets, inutiles à mon avis, et qui, même s'ils ne le sont pas, bon Dieu! ne valent pas le sacrifice de ce qu'on appelle vie et jeunesse. Mes plus belles années, je les ai gaspillées comme la Fourmi, à m'échiner pour cette foutue maison, pour installer enfin ce bidet. Son cloaque a englouti vingt ans de ma vie et me voilà vidé, pressé comme un citron, ratatiné, tout ça pour un bidet.
Sur ces pensées, j'ai tiré la chasse et je suis allé à la fenêtre respirer un peu, écouter la ville. Il montait de partout un bruit étrange. Rien à voir avec le bruit familier des autos : un glouglou insistant, qui recouvrait les autres rumeurs. En tendant l'oreille, j'ai compris. Tout le bassin attique n'était plus qu'un immense bidet, on était tous assis dessus et on se lavait, on se lavait et dans un déluge, des centaines, des milliers de chasses d'eau saluaient notre progrès.
Traduction : Noëlle Bertin
Le visage de l'homme assis à côté de lui ne lui rappelait rien, malgré le sentiment persistant de l'avoir rencontré quelque part, de s'être trouvé un jour avec cet homme dans une relation complexe et obscure.
Ses traits ne lui disaient rien, tous très ordinaires d'ailleurs, sauf le nez : après avoir dévalé tout droit, il s'achevait soudain par une étrange excroissance pendante sous les narines. Eh bien ce nez aussi, avec la chute si remarquable, lui restait inconnu.
À vrai dire ce sentiment persistant de déjà vu s'emparait de lui quand l'homme lui tournait le dos pour regarder dehors par la fenêtre, quand on ne voyait pas son visage mais une partie de sa nuque, les cheveux sur son crâne et la courbe qu'ils décrivaient du haut jusqu'en bas.
Mystère ! Jusqu'à présent sa mémoire ne l'avait pas trahi. Sorti de prison au bout de vingt ans, il ne s'était trompé pour personne. Quand il rencontrait dans la rue de vieux amis, ou même de simples connaissances, il se souvenait de tous. Avec son voisin de bus, pas moyen.
Et pourtant, chaque fois que l'homme se détournait, montrant sa nuque, ses épaules, une infime inclinaison de la tête, quelque chose lui disait tout au fond de lui que cet homme était bien plus qu'une vague relation. Il se lança : «Vous me connaissez ?» «Non», fit l'autre, étonné. Il se présenta. «J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré.» Il donna son nom. «Moi pas, en tout cas», dit l'autre. «Je dois faire erreur.» «Ça m'arrive à moi aussi. Finalement je ne crois pas qu'on se connaisse.» «Excusez-moi.» «Non, vous avez bien fait ! Plutôt que de vous casser la tête.»
Et il vit l'homme se détourner. Se détourner cette fois complètement, si bien qu'apparut, outre son dos presque en entier, l'arrière de son crâne tel un faciès plus expressif encore qui l'emplit de terreur, un deuxième visage, bien connu, très bien connu qui le regardait fixement, provoquant chez lui un tremblement irrépressible, surtout dans les jambes, prêtes à se lancer vers ce crâne-visage qui reculait, s'éloignait, qu'il devait suivre à une distance d'environ six pas, les yeux fixés sur ce dos, cet aimant puissant qui l'attirait à sa suite, la main moite dans la poche de son imper serrant la crosse glacée d'un revolver Smith & Wesson.
Ce revolver lui avait été remis chargé au carrefour, l'instant d'avant, puis on lui avait montré l'homme de dos : «C'est lui». «La nuque raide ?» «Oui. Une vraie ordure. L'autre jour il a tiré sur l'un des nôtres. Le gars lutte contre la mort.
Il serra la crosse et avança dans la foule. Machinalement ses doigts effleuraient les balles, dont l'arrière dépassait un peu du barillet. Il ne pouvait en toucher que quatre. La première, celle qui allait se loger dans la partie gauche du dos qui avançait, était cachée dans le prolongement du canon. Il tira le cran de sûreté et fit jouer légèrement le barillet. Maintenant il avait le doigt sur le bout de plomb prêt à se planter par surprise dans ce dos qui ne se doutait de rien. Il voyait déjà la secousse, la nuque pencher en avant, les jambes fléchir avant que n'arrive la seconde, la troisième, la quatrième peut-être s'il le fallait, toutes au même point, à gauche et au centre, jusqu'à ce que l'homme s'écroule à plat ventre sur le bitume.
Notre gars lutte contre la mort», se disait-il sans cesse, mais toi, ordure, tu n'auras pas le temps de faire ouf !» Il pressa l'allure et parvint à une distance de six pas.
«Une sale petite ordure en moins.» Avec le revolver, ils lui avaient aussi refilé cette pensée. «Une sale petite ordure en moins», il n'avait plus que cette pensée en tête, qui le poussait vers l'acte à venir. «Petite ordure», les mots frappaient son palais desséché derrière les dents, tandis qu'il voyait la foule se raréfier. Sa main tenait solidement la crosse, l'index replié sur la détente.
Pe-tite-or-dure», ça montait en lui, il s'approcha à quatre mètres avec un gémissement de moteur en colère, puis plus près encore, à un mètre, et sortant l'arme en un éclair il pressa la détente furieusement. Il n'entendit rien. Deuxième tir, clic ; troisième tir, idem. En une fraction de seconde il vit la nuque sursauter, prête à se retourner. S'il attendait encore, l'autre allait faire demi-tour, sortir son pétard vite fait et ne le raterait pas. Trop tard pour essayer la quatrième balle. Il leva bien haut le revolver et l'abattit sur le crâne. «Ohh !» fit une voix nasillarde et il s'enfuit en courant vers la gauche dans la rue déserte.
Qu'avez-vous ?» lui demanda l'autre d'une voix nasillarde, le voyant tout blême, les lèvres crispées, le front moite. «Je suis malade en bus, parvint-il à dire, surtout à l'arrière.» «Vous avez l'estomac fragile ?» «Il me fait mal de temps en temps», avoua-t-il. «La vache, moi c'est pareil. Quand il est en plein travail, il m'asticote le salopard. Je vais vous donner un conseil pratique : essayez cinq gouttes de citron le matin à jeun.»
Peu à peu son visage s'apaisait. Si seulement l'autre pouvait ne pas se retourner, ne pas lui tourner le dos, lui évitant ainsi ce coup de poing à l'estomac, ce pincement au cœur et ce mouvement inconscient de la main vers la poche comme quand on cherche machinalement son briquet lors d'une conversation houleuse, un geste comme celui qu'il avait fait jadis, sur le même rythme, avec les mêmes réactions psychologiques, dans une autre vie oubliée tout au fond de lui-même, qu'il ne voulait plus jamais revivre.
«Ne te retourne pas», voulut-il crier, mais un cauchemar en lui empêchait sa voix de sortir. «Ne détourne pas ton nouveau visage», lui sembla-t-il balbutier, «celui que je vois pour la première fois, avec ce nez qui appuie sur les mots (cing gouttes de citrong le mating a jeung), montre-moi ton vrai visage, le nouveau, pas cette nuque raide qui durcit mon regard, qui fait plonger ma main au fond de ma poche et serrer le revolver pour une affreuse reprise de la tentative ratée, laisse-moi voir ton autre visage, qui libère ma main pour qu'elle serre la tienne avec chaleur.»
Il lui empoigna la main droite. «Enchanté», dit-il d'une voix presque inaudible. «Je suis enchanté de cette rencontre», dit-il encore, un peu plus nettement. L'autre le regardait, égaré. Tandis qu'on secouait sa main il parut se reprendre, et parvint à demander, non sans mal : «C'est toi ?»
«Oui», avoua-t-il sans hésiter. «Mais j'ai payé de près de vingt ans de prison pour une autre affaire où je n'avais rien à voir. Tout le temps que j'ai passé au trou, c'était comme si je payais pour ton histoire à toi, même si en fin de compte je t'avais raté. Aujourd'hui, en voyant ton vrai visage, j'ai l'impression d'acquitter ma dernière dette.
Un indicible chagrin se dessinait sur le visage de l'autre, une amertume au coin des lèvres. «Toi tu as vu mon vrai visage. Mais moi, comment je verrai celui de votre gars, qui n'est plus là ? Il a lutté en vain. Il est mort quelques jours plus tard. Il revient toujours dans mes rêves, à plat ventre sur le bitume, toujours un dos brisé, un homme vu de dos qui s'effondre, jamais de visage.» Il s'était de nouveau tourné vers la fenêtre, sans doute pour cacher ses yeux embués, ou éviter les yeux de l'autre.
L'autre voyait de nouveau la nuque, cette nuque autrefois inflexible se couvrir de rides, peu à peu fléchir, parcourue d'un léger frisson, se briser, et seul le col empêchait la tête de tomber sur la poitrine. «Nous tous qui avons vécu ces choses-là, poursuivit-il d'une voix incolore sans cesser de regarder par la fenêtre, nous sommes tous dans le même bateau.»
Il se tut. Il attendait sans doute une approbation pour tourner le visage, et l'autre en guise de réponse porta sa main tremblante sur l'arrière de sa tête, caressa doucement ses cheveux, la courbe qu'ils décrivaient du haut jusqu'en bas, atteint la nuque ridée, puis le col et s'y arrêta. «Un cheveu, dit-il, un cheveu sur votre col. Permettez que je l'enlève.»
C'est une déformation de la célèbre pensée de Kant — I can't, I can't — portant non sur les mots, mais sur le sens, qui détermine ma position ultime : une sorte de raillerie à l'égard des étoiles, un rabaissement continuel des corps célestes et une tendance à les confondre avec les corps humains, ou même le corps social dans son entier.
Kant admirait l'harmonie dans les cieux, et moi devant ces espaces j'ai des pensées tout autres. Le firmament tient-il fermement ? Frissonne-t-il comme moi par les nuits d'hiver ? Souffre-t-il de solitude et de l'absence de sens ?
Deux choses me rendent toujours perplexe : la confusion en moi et la bousculade inutile des étoiles au ciel, que font-elles donc là-haut ? Une lumière faiblarde et une décoration le plus souvent superflue. Et même si, comme dit Kant, elles ne se rencontrent pas, on ne sait pas ce qu'il y a eu dans le passé, ni ce qui peut arriver dans le futur. D'ailleurs, les humains aussi sont parvenus à éviter les collisions entre corps animés, c'est une simple affaire de régulation du trafic par des ordinateurs, pour moi du moins ça ne prouve rien, ça me laisse totalement froid.
Au fond, être une étoile, ça n'a rien d'extraordinaire. Je peux devenir tout entier lumière, en injectant dans mes veines et mes ganglions, et même sous ma peau, une certaine dose de phosphore. Je serai un buisson perpétuellement ardent, et mobile en plus. Pas comme ces vers luisants qu'éteint le premier nuage qui leur passe devant, ou bien moi-même rien qu'en fermant les yeux. Je suis bien supérieur aux étoiles. Je peux dire «bonjour, cher monsieur Oulkèroglou» ou «Comment allez-vous, madame Bitzìdou». Je peux même dire «tsilibik», alors que toutes les étoiles ensemble ne peuvent même pas dire «tsil».
Quant à l'harmonie en nous et hors de nous, je m'en tape. J'en ai ma claque de toutes ces harmonies, étoiles-voiles, colombes-tombes, ça me fait gerber, alors que la disharmonie pour moi c'est jubilatoire, même étoiles-quéquettes et tant pis si ça ne colle pas, disharmonisons un bon coup, après tout ce qu'on a souffert avec les rimes faciles, les cris des bouzoùkis électriques, les barbituriques, l'électronique si peu lubrique. Je préfère un retour à la source, à la fente, les cheveux-de-Vénus en larmes et les satyres qui les écartent ruisselants, pour que je touche la racine.
Toi, Athènes, l'harmonie pour toi c'est d'acheter et en même temps de te vendre. Du «tout à une drachme» jusqu'à des îles et des mers au plus offrant. Je vends moi aussi ma jeunesse à bas prix pour échapper à la ville des marchands, je donne une couille contre deux yeux noirs, huit heures de ma vie contre une chemise, mes poèmes en pâture au premier venu, mon coeur qui brûle de voir une lumière éternelle émerger puis l'héberger.
Et l'Étoile du Berger alors, que croyez-vous qu'elle fait ? Elle tremblote d'angoisse, sans doute qu'elle sent venir sa fin et implore de l'aide en sachant bien que celle-ci ne viendra jamais. Pourquoi fait-elle durer son angoisse, elle qui de toutes les étoiles apparaît la première, le soir, avec ses appels sans réponse ? Qu'elles s'entrechoquent à la fin ! On verra bien, j'aurai moi aussi ma part du tressaillement cosmique.
Car c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'émotions, je suis presque vide et j'ai besoin d'un grand chambardement dans l'univers qui réponde au mien : comètes sorties de l'orbite et tournant contre nous une queue menaçante, étoiles de première grandeur se perdant dans l'infini et d'autres inexistantes qui prennent leur place, le Sagittaire qui jette enfin son arc, le Verseau, source perpétuelle, qui fait couler ses cheveux blonds dénoués comme une cascade allant se perdre dans un gouffre, et se jette hors du chaos du monde.
Je suis fatigué de la science, de l'approche sociologique. Je recherche une société où ce sera partout la pagaille : des étoiles de première grandeur jouant le rôle de figurants, des manifestants et des tanks dans les rues, qui a commencé on n'en sait rien, chacun se cachant derrière les autres (j'exécutais les ordres, patron, qu'ils te disent), des quidams assis dans le bus, des premiers ministres qui font la queue pour monter.
Je n'aime pas les sociétés parfaites, les esthétiques, les harmonies. Faut que tout cloche quelque part, les corps, les groupes, l'univers, que tout s'écroule. Et en plus, aucun désir de reconstruire. Au contraire, folle envie de voir les ruines se répandre. De toute façon, ceux qui disent mettre de l'ordre, gouvernements, popes et compagnie, ne font qu'aggraver le désastre autour d'eux.
Désormais aucune finalité, aucune logique ne m'exprime, et surtout pas la mort inéluctable de certaines cellules, d'organismes qui ont bouclé leur cycle et ne reviendront plus. Dans mon propre organisme aussi je veux que les cellules se querellent, défendent leurs anciennes positions, résistent, qu'au lieu d'être chassées elles restent là une fois mortes, provoquant l'insurrection générale.
Je suis allé sur la tombe de Marx. Pour y arriver j'ai traversé un parc avec deux étangs et j'ai vu un écureuil à qui j'ai donné du chocolat. Il l'a pris dans ses petites pattes et s'est mis à le grignoter. Puis je suis entré dans le cimetière. En prison j'avais reçu quelques plaques de chocolat dans un paquet. Naturellement je les avais distribuées à mes amis. Quand je me suis disputé plus tard avec un autre détenu, il m'a lancé : «Tu m'en as pas dounné à moi, du choucoulat...» C'était un montagnard, condamné à vie. Quelques jours plus tard il a signé sa déclaration de repentir et nous a quittés. Le cimetière était vieux, oublié. Dans le fond, les tombeaux des juifs à l'abandon. Le sien se distingue des autres. Une grande tête en granit. Il a écrit Le Capital, il aimait sa femme, et Friedrich lui filait de l'argent de poche. En l'an 2000 après J.-C. il y aura des milliards d'hommes adultères. En l'an 2000 Le Capital sera enfin traduit correctement, on pourra savourer sa vigueur, son ironie. Je regarde la tombe en mâchant mon chocolat. D'habitude les gens déposent des gerbes ou posent des bombes. Je sifflote la chanson «Oh Carol...» J'ai envie de pisser. Personne. Je vais un peu à l'écart et me soulage contre une haie. Voilà l'écureuil, apparemment parc et cimetière communiquent ; il me fait signe avec les pattes de devant qu'il n'a plus de chocolat. «Écoute, petit, si c'est encore toi je ne t'en donne plus. Ces choses-là doivent se partager équitablement entre tous. Ça ne se fait pas d'utiliser ses relations.» Un jour j'ai distribué cet article, rare en prison, à mes seuls amis, résultat : l'autre a signé sa déclaration. Je n'en ai pas dormi pendant quelques nuits. A cause de moi Marx a perdu un partisan, et là, maintenant, devant sa tombe, je ne veux pas que ça m'arrive encore. Je tiens à mon sommeil.
D'ailleurs j'ai signé moi aussi — non par manque de chocolat bien sûr, j'avais d'autres raisons. C'est que l'un de nous répétait sans arrêt «Vladimir a dit», et puisqu'il l'avait dit, nous on devait faire comme lui. Ce qui me déplaisait le plus, c'est qu'il l'appelait Vladimir comme s'ils avaient été cousins. Un autre l'appelait Ilitch. Karl, ils en parlaient rarement, et Friedrich encore moins. Pourtant ils aimaient citer la phrase «Laissez les morts continuer leur chemin», prononcée par quelqu'un ensuite. Tous ceux d'ensuite ont dit n'importe quoi. Moi j'aimais l'autre Vladimir, Vladimirovitch, le poète à la mèche rebelle qui s'imprimait «à coups de masse dans le crâne du monde», sans doute parce que très tôt il a eu des doutes, et sans doute aussi à cause de cette balle qui s'est plantée dans son crâne à lui.
Tout est parti de cette tête en granit qui se dresse devant moi : les uns et les autres, ceux d'avant et ceux d'ensuite, les bons et les mauvais, sauf que les bons n'ont pas fait de vieux os, les djougachvilains leur sont tombés dessus et les ont liquidés, il n'est resté que les imbuvables. Vous me direz, «trouvez-moi une casserole qui fasse bouillir le lait sans qu'il déborde». Voilà ce que j'essaie de faire depuis tant d'années, chaque matin je me dis que je vais l'empêcher de monter, mais je me fais avoir à tous les coups. On s'est tous fait avoir, et Marx lui-même aussi sans doute : car les types imbuvables en question, je ne crois pas qu'il en aurait voulu.
Hàkkas en aura bavé toute sa vie. Né en 1931 dans une famille pauvre, il grandit sous l'Occupation, puis la Guerre Civile. Devenu communiste, il est persécuté en même temps par la droite au pouvoir, qui l'envoie en prison pour quatre ans, et par le Parti, que sa franchise indispose. Il vit de petits boulots, représentant, artisan, consacrant tout son temps libre à l'association culturelle qu'il a fondée avec des amis. A trente-huit ans il attrape le cancer et meurt trois ans plus tard.
Ses écrits : quelques poèmes, trois pièces en un acte, trois recueils de nouvelles. C'est tout. Une oeuvre en miettes, comme sa vie. Des pages volées à cette vie trop dure, puis à la mort ; les unes griffonnées en hâte sur des paquets de cigarettes, les autres dictées sur des lits d'hôpital. Au fond, vu les circonstances, Hàkkas n'a pas peu écrit, mais beaucoup...
Comme tout ce qu'il a laissé, Le bidet (1970) et Les cénobites (1972), ses deux grands recueils, sont d'abord une chronique : l'histoire d'une vie, la sienne, à peine teintée de fiction ; et en même temps, celle de sa génération. Une autobiographie collective.
Ils étaient jeunes, idéalistes, et la plupart ont héroïquement résisté à la répression. Vingt ans plus tard, on les retrouve embourgeoisés, avachis, vaincus par le confort moderne. (Enfin, tout est relatif : ce que l'auteur reproche à ses compatriotes, c'est de se faire installer... un bidet.) Triste Grèce des années 60, encore secouée par son passé, déjà bousculée par le futur. Le bidet, ricanant requiem pour une génération foutue, festival de sarcasmes et de provocations diverses, en trace un portrait plein de rage, d'humour, de féroce lucidité.
Mais Hàkkas n'est pas seulement un virtuose de la satire. Il a beau râler, sa tendresse affleure à toutes les pages ; il n'y a qu'à l'entendre évoquer Kessariani, le faubourg populaire d'Athènes où il passa toute sa vie, où se déroulent ses histoires, et les petites gens qui l'habitent. Et puis Hàkkas n'a pas l'esprit sectaire, le monde pour lui n'a pas cette allure bien carrée, les bons ici les méchants là-bas, si rassurante pour les naïfs. Il sait voir les pailles et les poutres dans tous les yeux — y compris dans les siens. Où a-t-il donc appris ça, en ce temps-là ?
En plus il est maladivement honnête. Il dit tout, c'est plus fort que lui. Voilà ce qui l'a perdu — et sauvé. Hàkkas est grand pour avoir vécu, pensé, écrit, non comme on le lui disait, mais comme il le sentait ; pour avoir été libre, de plus en plus. Et Dieu sait combien c'est difficile — surtout quand à vingt ans on était à genoux devant la statue de Staline. Les livres de Hàkkas (c'est là un de leurs points communs avec l'impressionnant Toi au moins, tu es mort avant de Chrònis Mìssios), sont l'histoire d'un homme qui peu à peu, à travers mille épreuves, se libère des autres et de lui-même.
Mais justement, si Hàkkas est devenu un écrivain majeur, c'est que cette liberté conquise, il sait aussi, comme Mìssios, la faire passer dans les mots. Dès les premières nouvelles du Bidet, il a trouvé sa voix, ce ton à la fois désinvolte et brûlant, tout en ruptures, dérapages, télescopages, bouffées de fantastique et d'absurde... Mais c'est le cancer qui va le mener plus loin encore.
Sans doute, la maladie n'a pas bouleversé sa trajectoire d'écrivain : en découvrant le mal dans son corps, Hàkkas a dû y voir une confirmation, une cristallisation en lui du mal qui l'entourait ; dans ce qui lui reste à écrire, déchéance physique et décomposition sociale serviront de métaphore l'une à l'autre. Le cancer a surtout joué un rôle d'accélérateur : des derniers textes du Bidet, oeuvre d'un condamné à mort, aux Cénobites écrits par un mourant, on voit l'homme et l'écrivain mûrir à toute allure, jusqu'aux trente pages hallucinées qui viennent clore ce volume et sa vie. Une débâcle et une envolée, la narration qui part en tous sens, rêves, souvenirs, visions, monologues à plusieurs voix, phrases explosées, mots qui éclatent en assonances, en calembours — le bouquet final.
L'étonnant, c'est que malgré douleur et désespoir Hàkkas n'ait jamais cessé d'écrire, de lutter, avec l'allègre furie de celui qui donne tout ce qu'il a. Contrairement au Mars de Fritz Zorn, autre grand livre inspiré par le cancer — et dont la seule lecture a de quoi le donner —, Le bidet et Les cénobites ne sombrent pas dans la déprime. Ces pages dilatent le coeur en même temps qu'elles le serrent ; entre angoisse de mourir et jubilation d'écrire, elles émettent jusqu'au bout une lueur qui réchauffe, intermittente et obstinée comme un clignotement d'étoile. Des médecins grecs les ont fait lire à leurs patients condamnés, pour les aider à mieux mourir ; quant à nous autres, les sursitaires, comment ne pas être fiers de lui, de cet homme seul et minuscule dans la nuit éternelle, ce nargueur de néant, lançant jusqu'à la fin ses fusées — si vivant jusque dans la mort ?
Voilà ce que j'écrivais, en guise de postface, dans le choix de textes publié chez Maurice Nadeau, en 1997, sous le titre général Les cénobites.
Traduire Le bidet, et surtout Les cénobites, fut un travail passionnant car difficile, parfois impossible. Il a fallu renoncer à trois nouvelles du premier (15 pages en tout) et à deux longs textes du second (65 pages), pleins de jeux de mots longuement filés, dont il ne serait pas resté grand-chose en français.
Hàkkas est doublement obscur. Il l'est d'abord de façon délibérée, par endroits, pour les Grecs eux-mêmes, et il n'était pas question de l'édulcorer en explicitant. Mais ses textes, par ailleurs, fourmillent d'allusions à la réalité grecque de l'époque, et là il convenait d'aider le lecteur français, par les deux procédés classiques (les notes en bas de page étant désormais jugées ringardes, à juste titre) : notes en fin de volume, brefs éclaircissements intégrés de façon indécelable au texte.
Je n'aurais pu saisir moi-même toutes ces allusions sans l'aide providentielle de Marìka, veuve de l'auteur — la seule veuve d'écrivain, je crois bien, qui ne m'ait pas fait souffrir mille morts. Je suis allé la voir chez elle, en banlieue, dans la maisonnette où Màrios et elle avaient vécu, où le fameux bidet trône toujours dans la minuscule salle de bains, sous les poissons paradisiaques. Nous avons passé trois jours entiers à relire tous les textes ensemble mot par mot. Nous avons visité tous les lieux, le monastère, le champ de tir, accompagnés de Spyros Hàkkas — celui-là même qui un peu plus tard, hélas, animé des meilleures intentions, lors de la réédition en un volume, allait corriger certaines des «négligences de style» du frère bien-aimé.
J'avais associé au projet trois jeunes traductrices, Noëlle Bertin, Yseult Dimakopoulos et Dominique Dourojeanni. Non pour gagner du temps — dans ces cas-là on en perd plutôt —, mais pour leur mettre le pied à l'étrier. Nous avons procédé de la manière habituelle : j'indiquais les passages à reprendre, expliquais pourquoi, lisais leur nouvelle version et ainsi de suite jusqu'à ce que satisfaction réciproque s'ensuive. En ce temps-là j'étais généreux.
Comment publier chez nous pareil auteur, étranger, Grec de surcroît, et tout de même assez atypique ? Si Maurice Nadeau n'avait pas existé, Hàkkas et moi étions foutus. Ce fou de Nadeau a dit oui tout de suite, sachant sûrement quels risques il prenait. Moi, toujours candide, incurable optimiste, j'espérais toucher quelques lecteurs. Ce fut notre bide le plus total — nous avons pourtant pris d'autres sacrées gamelles ensemble... Un seul article, dans la Quinzaine de Nadeau — c'était bien le moins —, plutôt tiède, qui déplorait le malencontreux «jeu de mots involontaire» du titre, lequel était on ne peut plus délibéré... Une poignée de lecteurs, à peine plus que pour la poésie. Un bouquin bientôt pilonné. L'ami Màrios — ami que je n'ai pas connu, ami tout de même, aimé autant qu'admiré — enterré pour la deuxième fois.
N'empêche, si c'était à refaire, je serais partant. Encore assez fou.
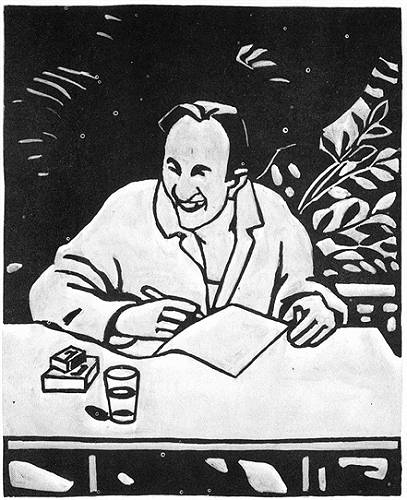 Màrios Hàkkas. |