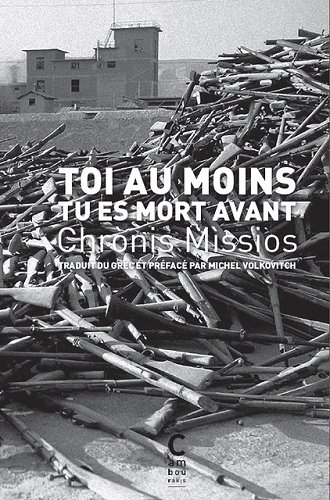
Chrònis Mìssios.
Lu le livre au printemps 86. Traduit 30 pages à l'été 87, montrées sans succès, pendant deux ans, à plusieurs éditeurs (Gallimard, Seuil, Laffont, La Découverte, Arcane 17...). Traduit 10 autres pages fin 87. Puis 28 mois d'interruption. Livre accepté par les Éditions du Petit-Matin fin 89. Repris la traduction en avril 90. Premier jet terminé en septembre, cinq mois plus tard (moyenne : deux pages par jour). Deuxième couche en septembre-octobre (sept pages par jour). Troisième une semaine plus tard (trente par jour) et quatrième en décembre (cinquante par jour).
Collaboration avec l'auteur : deux séances de travail (été 87 je crois, été 90), plus une au printemps 90 avec sa femme ; deux lettres (printemps et automne 90).
Tout au long du travail, tenue d'un carnet de bord avec, page par page, la liste des mots et expressions importants et récurrents, ou susceptibles de l'être. En même temps, prise de notes sur les problèmes de traduction, dans les marges du livre ou sur feuilles volantes. Enfin, rédaction de ceci en décembre 90.
Problème essentiel: conserver la dimension orale du livre. Un immense dialogue à une voix. Torrentiel (très longs paragraphes — jusqu'à trente feuillets), brutal (dans son vocabulaire et sa syntaxe), parfois obscur (ellipses, dialogues non marqués — qui dit quoi?).
Lectures (ou relectures) préparatoires, avec prises de notes.
Le café du pauvre d'Alphonse Boudard.
Dictionnaire du français parlé de Bernet et Rézeau. Pêché quelques mots, quelques tournures.
Touchez pas au grisbi d'Albert Simonin. Bon livre au demeurant, mais qui sous ses audaces de vocabulaire (inutilisables car trop typées) conserve une syntaxe très sage — le contraire de ce qu'il me faut.
Voyage au bout de la nuit de Céline.
Il aurait mieux valu Mort à crédit et la suite, où la syntaxe vole en éclats. (Trop peut-être: Mìssios ne va pas si loin.)
Butin plutôt maigre. La question reste posée: où prendre des leçons de parole écrite en français?
Travail sur le lexique.
Recours à l'argot ? Quelques injures et expressions spectaculaires mises à part, il y a chez Mìssios moins d'argot qu'on ne le dit — ce qui me paraît correspondre aux habitudes du grec : je ne sais si le vocabulaire d'argot y est moins riche que chez nous (sans doute : l'argot est un phénomène urbain, or le grec est resté proche de ses racines paysannes) ; en tous cas il me paraît moins employé, à niveau de langue égal. Je suis donc souvent amené à injecter quelques mots argotiques. Mìssios n'a qu'un mot, par exemple, pour désigner le détenu, même dans ses dialogues : celui qui correspond à «détenu» ; en français, je peux difficilement me passer de «taulard». Un seul mot en grec, de même, pour la nourriture, le repas : le mot le plus neutre, qui chez moi devient presque toujours «la bouffe». «Les persuader par des paroles» (p. 115- 129) devient «les avoir au baratin» etc.
Mais surtout pas d'excès ! pas de pastiche de Série noire !
Traduction = compromis perpétuel : je dois donner un équivalent plus qu'un calque (donc je rajoute un peu d'argot), mais en même temps garder un peu de la nudité, de la naïveté du grec en la matière — et par conséquent rester lexicalement un peu plus pauvre qu'on ne l'attendrait.
Éviter les expressions trop typées nationalement ou localement : écarté ainsi «bidasse» ou «pastis». Je me sépare même, la mort dans l'âme, d'un «adieu berthe» auquel je tenais beaucoup. Écarter aussi tout terme d'argot rare, inconnu du lecteur moyen, qui serait ressenti comme trop typé : il faut un argot pas trop neuf, déjà porté, passe-partout.
Le titre. Un journaliste grécophone l'a traduit ainsi dans un article : Encore heureux qu'on t'ait buté avant ou même T'as bien fait d'clamser. Le premier, à la rigueur, encore que «ils» (les fachos) soit préférable à «on» (nous, les cocos). Mais en grec, pas un seul mot d'argot dans le titre — d'où mon choix.
Langue de quelle époque ? L'histoire se déroule de 47 à 73, et pour l'essentiel autour de 1950. Mais la narration a lieu plus tard (disons 1980). D'où un va-et-vient linguistique entre deux pôles éloignés de trente ans. Tantôt le narrateur parle comme en 50 (émotion du retour dans le passé, nécessité de se faire comprendre d'un interlocuteur mort en 47), tantôt son moi présent apparaît : certaines pages sont visiblement écrites par un intello post-marxiste — vocabulaire spécialisé etc. Décalage conscient et avoué quand le narrateur est obligé d'expliquer certains mots («Les homosexuels — les pédés mon vieux»), ou quand des mots trop savants pour l'interlocuteur sont suivis de l'incise «comme on dit» (j'ai dû en sucrer plusieurs, quitte à en rajouter deux ou trois en cas de besoin, quand le seul mot à ma disposition n'était pas assez familier).
En général, choix d'un vocabulaire peu marqué historiquement, utilisable en 50 comme aujourd'hui. Mais on peut jouer un peu entre les deux dents de la fourchette : j'accueille délibérément, d'une part quelques termes un peu datés («impec»), et d'autre part, avec prudence, un ou deux mots («intello», plus rigolo que «grosses têtes») trop récents pour 1950, mais possibles plus tard. En revanche, les dealers resteront des revendeurs (question d'époque, mais surtout à cause de l'anglicisme), et les «toxicos» se changent en «camés».
Cas intéressant: «clope», qui passe du masculin au féminin vers 1960 ! Je choisis logiquement le masculin, tout en sachant que de jeunes lecteurs m'accuseront d'ignorance. Tant pis.
Outil précieux entre tous: le Dictionnaire du français non conventionnel de Jacques Cellard et Alain Rey.
Acheté tout à la fin le Bouquet des expressions imagées, de Claude Duneton, qui me fournit aussitôt quelques bonnes solutions («la crème des femmes», que je n'aurais trouvé nulle part ailleurs).
Mots typiquement grecs. Les garder, les adapter ?
La couleur locale, je ne suis pas très pour. Ici comme ailleurs, il me paraît plus utile de rapprocher ces histoires grecques de nous plutôt que de jouer sur l'exotisme. Un «màngas», c'est autre chose qu'un mec, avec «mec» je perds la moitié de l'effet ; oui, mais en gardant «màngas» j'en perdrais les trois-quarts.
En revanche, quand un de ces mecs exprime son admiration pour un autre en le qualifiant (p. 56-65) de «derviche», je n'ai pas le cœur de chasser ce derviche-là ; je me contente de le vêtir d'un léger «comme on dit nous autres», en espérant que le contexte suffira pour éclairer. Conservé aussi quelques termes très typés (tiritòmba, amanès, tsiftetèli...), sans chercher d'équivalent français à tout prix, et sans me croire obligé de les expliquer quand ce n'est pas nécessaire pour suivre l'histoire.
«Les durs de Psirri». Psirri est une place aux abords de Plàka. Ce nom ne disant rien aux Français, je traduis par «durs du Pirée», ce qui est plus parlant. Il y aura sûrement quelqu'un, ici aussi, pour me traiter d'ignare.
Mais l'essentiel, c'est le travail sur
la syntaxe.
Pronoms personnels.
Le grec rend «on» par «tu» et «ils», entre autres. Pour plus de familiarité, je les garde au maximum : les «tu» renvoient à l'interlocuteur muet, réactivant ainsi le dialogue, et les «ils» évoquent de façon vague et obsédante les geôliers, le pouvoir. D'autant que neuf fois sur dix je réserve «on» pour «nous», les prisonniers, les victimes.
Gardé aussi, à tous les coups, ce va et vient du vous au tu, naturel en grec, rarissime en français.
Le grec, langue non cartésienne. La passion plus que la raison. Et en particulier le grec de Mìssios, qui emprunte beaucoup (pas tout) au parler populaire.
Phrases peu coordonnées, voire lambeaux de phrases juxtaposés («Deux mois plus tard, à la Sûreté, j'étais à l'isolement, ils ont autorisé ma mère à m'apporter des affaires.»; p. 212-231 "... le dimanche, lever aux aurores, grande tenue, rasés de frais, une deux, une deux, à pied du troisième au premier bataillon." ; p. 180-199, «on installe notre barda, revue, c'est bon, vous êtes libres»). Phrases déglinguées, parfois carrément déviantes : incorrectes, ou changeant de direction en cours de route («Comment diable s'est-il souvenu de moi et il a...» — et là la phrase interrogative devient affirmative.), cf p. 155-171, p.62-71, «Les jours où vous recevrez...» p. 75-86, une phrase inachevée, sans principale.
Tenté de conserver cette syntaxe, pour sa force émotionnelle, et sa liberté — liberté de la langue, la seule qui reste au prisonnier... Garder ce côté chaotique, la plupart de ces «fautes de grammaire». Ne pas expliciter plus que le grec (sauf pour quelques allusions historiques, mais c'est un autre problème).
D'abord écrit : «C'était un fou tranquille, sans la moindre agressivité.» En relisant, je reviens au mot-à-mot, plus abrupt : «C'était un fou tranquille, pas la moindre agressivité.»
Ambiguïtés. Ex. «à cause du frère» au lieu de «à cause de son frère». Ou «...on a eu les mères, les sœurs, les avocats, tout le monde. Elles s'évanouissaient au parloir...» Ça, aucun problème. Mais je ne veux pas suivre le grec jusqu'au bout dans ses salades de pronoms, du genre (p. 72-83) «Les infirmiers l'ont emmené à l'hosto avec une jambe cassée. De la même façon ils [les détenus, sujets de la phrase d'avant] ont flanqué le pope dans la marmite aux fayots.» Donc «il s'est retrouvé à l'hosto...»
«Impropre», «inexact», «incorrect»... Feus mes profs auraient couvert de rouge la copie de l'élève Mìssios.
«Il avait réduit comme un embryon» pour «Il avait réduit aux dimensions d'un embryon». D'accord, le propre d'un embryon c'est au contraire de grossir, mais tant pis, je me plie au grec sans trop hésiter.
J'aime ces deux violences qui travaillent ensemble : celle de la brièveté, celle de l'incorrection.
«Il s'y attendait que tu passerais par ici.»
«Je réfléchis au moyen de les coincer» devient «Je réfléchis à comment les coincer», beaucoup plus percutant. (Ce même comment, quinze ans plus tard, donnera des vapeurs au puriste Renaud Camus, qui verra en lui le symbole même de l'ignorance et de la barbarie.)
Écrit d'abord timidement «Collez-le vous dans le cul !», puis adopté une phrase moins orthodoxe, «Collez-vous le dans le cul !», qui déboule avec plus de naturel et de puissance.
Les «que» et les «ne».
«Que» rend de grands services. À la place de «dont» («des prières qu'on en voyait pas le bout»), de «pour que», de «si bien que». Sans parler des «que je lui dis» (à consommer avec modération).
Les «ne». Impossible de les garder tous. Impossible de n'en pas garder quelques uns. Décisions au coup par coup, parfois difficiles, repentirs nombreux. J'aurais du mal à théoriser jusqu'au bout mes choix. En tous cas, je n'hésite pas à appliquer les deux solutions opposées à quelques mots d'intervalle. Trouvé après coup un soutien chez Claude Sarraute (Allô Lolotte, c'est moi Coco): «Elle n'est pas mal. Même assez mignonne. Sauf quand elle porte des lunettes. Ça lui va pas. (... 2 lignes) Elle n'arrête pas de les paumer. (... 2 lignes) Je sais plus.»
Question de grammaire, mais aussi de contexte: le narrateur saute moins les négations quand il discute avec les policiers (cf p.117-131), ou quand le ton se fait didactique (encore que, dans ce dernier cas, l'élision du «ne» puisse servir à contrebalancer le côté langue de bois). Également, p. 80-92, conservé les «ne» par souci de clarté, pour mieux distinguer les plans (passage du discours — sans ne — au commentaire sur le discours — avec).
Les temps.
Dans la V.O., narration partagée entre aoriste (proche du passé simple) et présent de narration, avec passages très fréquents de l'un à l'autre, comme l'autorise le grec. On peut même rencontrer un présent ou un aoriste isolé. Passage à l'intérieur d'une même phrase (p. 90, l. 20-22). Le français étant bien plus raide à cet égard, je ne peux suivre que de loin, arrondissant les angles sans les faire disparaître. Priorité au présent, plus direct. Aucun passé simple, rien que le passé composé ; comme il est plus lourd, j'en fais parfois un présent. Problème : où changer de temps ? L'idéal est de jouer sur l'ambiguïté du passé composé, là où il peut être compris soit comme un passé, soit comme un présent. cf. p. 37-45.
Tâché de préserver ce va-et-vient au maximum, en gardant par exemple les imparfaits intercalés dans le présent de narration (alors que j'aurais pu en faire des présents). On peut ainsi rendre plus forts certains moments: p. 26-34, «La pute me file un coup dans les reins, vu que j'étais sur le ventre, et la lumière s'éteint. Je me suis réveillé à l'infirmerie.» J'aurais pu bien sagement écrire «je suis sur le ventre»,mais je n'aurais pas eu ce vertige tournoyant (quatre verbes, quatre changements de temps!), avec le «s'éteint» plus brutal encore d'être encadré par des temps du passé.
Autre problème de temps intéressant, p. 55-65, le paragraphe «Le troisième jour...»
Conservé aussi des concordances des temps qui traînent un peu la patte. Exemple p. 20-28, «en voyant la marchandise, on comprendrait que <ce magasin> est une épicerie...»
Coupé les phrases le plus rarement possible, et jamais dans le cas de phrases longues, dont la longueur est un élément essentiel. Pas touché aux paragraphes, bien sûr.
Rythme.
Mìssios retrouve la tonalité de l'oral tantôt par le resserrement, tantôt au contraire par l'expansion, la répétition. Moi je travaille surtout dans la brièveté : question de tempérament, sans doute, mais aussi de génie de la langue. En suivant le grec, cette langue qui prend son temps, je crains parfois de m'enliser, d'ennuyer. Mon moyen à moi de retrouver la parole, c'est de faire de ma phrase un geste, le plus vif possible.
La phrase est obscure? Pas grave. Mais que le rythme soit clair. (Même chose pour Cheimonas).
Concision. Muscler la langue.
Comme pour Cheimonas, suppression de quelques pronoms personnels pas vraiment indispensables, et de nombreux «et». «Et», ce grand mou.
Privilégier les mots d'une syllabe. Côté coup de poing. p. 116-130, «... putain de ta mère, de ta sœur, de ta femme, et j'en passe. Il cogne, il jure; moi, rien. Je le vise droit dans les yeux.»
Peut-on aller jusqu'à couper?
Membres de phrase apparemment inutiles, qui alourdissent le texte et entravent l'émotion. ex. pp. 186-205, 188-207, sqq. Élagage discret.
Un problème: la dualité linguistique (style familier / style intello). A priori, une écriture hétérogène, pourquoi pas. Seulement voilà, les «passages intellos» me paraissent nettement moins bons : rhétorique, langue de bois, catéchisme. Pas question de gommer ce conflit interne ; tenté du moins de l'atténuer sournoisement.
Remplacement de l'abstrait par le concret. «Dommages psychiques et corporels» devient «dommages dans la tête et dans le corps».
Coupures, ou dégraissages : p. 124-139, «...comment défendre l'unicité de l'être humain, qui constitue la condition élémentaire du développement de la société humaine dans la direction d'une humanisation de l'homme et de la production de sa civilisation.» Cela devient : «comment préserver le côté unique de chacun, ce qui est la seule façon d'aller vers une société meilleure, plus humaine et civilisée ?» cf. p. 151-193.
Problème des répétitions — comme dans tout texte de prose grecque (cf Hadzis). Entre littéralisme (tout garder) et ethnocentrisme (couper tout ce qui répète), entre l'indigeste et l'insipide, louvoiement hypocrite, comme toujours, au coup-par-coup.
Allé jusqu'à employer trois fois «était» en trois lignes (p. 77-89). En fait, qui s'en apercevra?
Répéter en atténuant : soit par une variation légère («gars... garçon» au lieu de «gars... gars», «veine... veinard» au lieu de «veine... veine»), soit en ne répétant qu'une partie (au lieu de «propriétaires du mouvement» deux fois, «propriétaires / patrons du mouvement».)
Tout fait pour préserver les répétitions sonores. Exemple : formules à rime interne (avec — souvent — rythme redoublé), très fréquentes, vrai leitmotiv.
P.108-112, «èrmous ki èrimous» = «délaissés et désertés», qui devient «couillonnés, abandonnés».
P. 156-173, «èkthetos / ènthetos» = «exposé, à découvert» / «inclus dans un groupe». En français : «toujours en danger, jamais rangé».
«Vrè aman, vrè zaman» (lamentations supplicatoires) = «il me prie, me supplie».
«To pìsma fèrni prìsma» («l'entêté récolte des bosses») = «qui s'entête perd sa tête» (évidemment on force un peu sur la menace...).
Nombreuses onomatopées: «doùkou-doùkou» (bruit du moteur d'un vieux rafiot) = «touf-touf», mais aussi, ailleurs, «tout doux, tout doux» ; «gàha-goùha» (toux caverneuse) = «et je te râcle et je te crache».
P.112-124, mot-à-mot «criminels ils nous montent, criminels ils nous descendent» = «ils nous traitent de criminels sur tous les tons». Rendu (faute de mieux) par une allitération :
«Ils nous traitent de crapules, de criminels».
Autres leitmotive: injures («koufàles», «karyòlides»), jurons («hès'ta»). Pas respecté de stricte équivalence entre termes de sens voisin (ex. les variations sur le thème «femme de mauvaise vie» ou «homme efféminé») ; conservé seulement la fréquence.
«Ti na pis» = (toujours) «Quoi dire».
«Tèlos» = (presque toujours) «Enfin bref».
Cas de «etc». En grec, deux formules : «kè ta tètia», «kè ta rèsta». Triché un peu en variant, mais la présence de «et tout» suffit à faire le liant : et tout, et tout et tout, et tout ça, et tout le bazar, et tout le bastringue, et tout le bataclan, et tout le toutim...
Vers. Comme dans presque tous les livres, quelques vers ici ou là. Une strophe de Lorca (pas retrouvé l'original), sans doute en vers réguliers (p. 134). Un quatrain de chant patriotique (p. 112), un quatrain de chanson gaillarde (p. l03), un quatrain de rebètiko (chant populaire urbain, p. 28), une petite valse (p. 28), tous quatre rythmés et rimés. Un poème de Sefèris (p. 240) et un autre anonyme (p. 66), tous deux en vers libres.
Règle d'or : traduire aussi — et surtout — la forme, à savoir les rythmes et les rimes éventuelles.
Le premier vers du Lorca me donne beaucoup de mal. Tout rentre bien dans le moule octosyllabique, sauf lui : «Si je meurs, laisse la fenêtre ouverte» = dix syllabes. Rien que je puisse couper. Je suis à deux doigts de céder. Au dernier moment, opté pour «Si je meurs, ne referme pas». La fenêtre est déplacée au v.3, «de mon balcon je l'aperçois», qui devient «de ma fenêtre je le vois». Ledit balcon étant déjà présent au v.5, il reste donc présent, et dans l'affaire je gagne une rime — une assonance — en [a].
Mon rebètiko est correct, mais pas du tout dans le style.
Jeux de mots.
Il est strictement interdit d'écrire: «Jeu de mots intraduisible en français». On arrive toujours à s'en sortir — presque toujours...
Ici, le nombre des jeux de mots montre à lui seul quel rôle central ils jouent.
D'abord, étant souvent le résultat d'une confusion de mots, due au manque d'instruction des personnages, ils jouent un rôle de caractérisation sociale ; ensuite, plus sournoisement, ils sont à relier au thème de la folie menaçante : le langage flageole, comme un sol qui se dérobe sous les pas. Et en même temps leur humour et leur poésie parfois viennent contrebalancer l'horreur du récit, comme un contrechant sous un chant ; sans eux, un équilibre serait perdu.
Le «baintotal», p. 68-79. Le narrateur craint qu'on lui administre de la «scopélamine» — une drogue genre sérum de vérité ; en fait, le vrai nom («scopolamine») est déformé par ignorance, de façon expressive (cf. «skòpelos», l'écueil — menace de naufrage). Faute de jeu de mots sur scopolamine, j'ai recours au penthotal, plus connu chez nous, que je transforme en un «baintotal» inquiétant lui aussi...
La «colle active» (p. 125-140). Les prisonniers politiques pratiquent la «collective» (mise en commun de leurs biens) ; en grec le mot est peu connu, car d'origine étrangère, si bien que les droit commun entendent à sa place «kòlo ktìpa» («frappe le cul»). En français, c'est la «colle active» qui s'impose toute seule, moins drôle, moins saugrenue, mais dotée en revanche d'une certaine logique poétique.
Ailleurs, c'est moins évident.
P. 160-177, un condamné à l'audition du jugement est scandalisé par le «dix ans de détention» («irkti») que vient d'annoncer le juge et qu'il croit signifier «dix ans dans la gueule» («rikti»). Que puis-je tirer de «détention», «réclusion» et autres ?... J'en suis réduit à jouer avec «sursis»: le malheureux croit qu'on va lui imposer dix ans «sans sourcils !» Joyeusement farfelu, certes, mais à la limite du crédible.
Ailleurs encore, la débandade... Le grec dit (p. 87-99):
«L'Histoire écrira nos noms, ne serait-ce que sur ses couilles.» Et l'autre répond : «L'Histoire est femelle, elle n'a pas de couilles.» L'expression «écrire quelque chose / quelqu'un sur mes couilles» (= «s'en foutre totalement») est courante, on peut la rendre, faute de couilles françaises, par «L'Histoire écrira nos noms, même si c'est pour se torcher avec.» Mais alors, la réplique doit sauter.
De plus en plus bas. P. 177-195 : «Où habites-tu au Pirée ?» demande l'officier. «Sur une chaise, quand je suis fatigué» répond le taulard insolent. Car le verbe employé par l'officier veut dire à la fois «habiter» et «s'asseoir», «être assis». Je suis contraint d'oser ceci : «Et au Pirée, où tu habites ? Entre mes jambes, comme d'habitude.» Heureusement la scène autorise les plus abominables calembours...
P. 157-175, deux jeunes pas bien malins, avec des accents provinciaux pas possibles, d'où quiproquos. Du second épisode je me tire tant bien que mal. L'un raconte que le docteur lui a coupé le bout de sa quéquette, en lui disant de ne pas s'inquiéter, simplement il s'est fâché. Qui ça, le docteur? Non, ma quéquette. (L'autre a compris, au lieu de «elle a un phimosis», «Thìmosse» («il s'est fâché»). En français: «...j'ai demandé au douctour si c'était sérioux, i m'a dit que c'est nourmal, l'est un fimoussi. Infirme aussi ? Le docteur ? Non, ma quéquette.»
Pour l'épisode juste avant, vraiment pas fier de mes variations sur le mot «aperçu», mais le passage est difficile à couper...
Pire encore. Au lieu de «malheur aux vaincus», qui comme beaucoup de formules consacrées se dit en langue savante, le narrateur comprend (p. 131-146) «malheur à Ittimène» (nom de femme imaginaire) et se demande ce qu'a fait la pauvre pour mériter cette avanie. Faute d'avoir trouvé un jeu de mots correspondant («vingt culs» serait vraiment trop nul), j'en suis réduit à couper deux phrases.
Mais jamais on ne se décourage. A peine au tapis, on se relève, on contre-attaque ailleurs. Ex. p. 143-159, un personnage fait un lapsus (apparemment non signifiant), que j'enrichis un peu : «prends cet argent» devient «prends cet urgent». Au lieu de «La mort n'a rien pu contre moi», «la mort s'est cassé le nez». Ou bien, p. 88-101, au lieu de «Chacun réagissait à sa façon» (l'un se gratte la tête, l'autre crache, le troisième se gratte les couilles), glissé un «Chacun réfléchissait à sa façon» qui me paraît plus marrant. Ou p. 118-132, des ouvriers américains se mettent en grève : «stop pour le travail». Mon petit coup de pouce : «niet pour le boulot». P. 200-269 (pour rattraper mes lamentables variations sur «aperçu»), le prisonnier qui se masturbait autrefois trois fois par jour, et qui maintenant a une belle femme et cinq beaux enfants, lance au narrateur, avec son accent péquenaud : «Toi qui me disais que de joui (= jouer) comme ça on devient tari (= taré). Double jeu de mots absent du grec...
Le droit au joker. Dans tout travail de longue haleine, je me sens autorisé au moins une fois à me payer un petit solo perso, (un peu comme la cadence d'un concertiste, mais en bien plus court, deux mesures à tout casser, et dans le style du reste bien sûr). Dans ma toute première traduction, Sainte-Maure de Dracodaïdis, c'est l'auteur lui-même qui m'avait chargé d'étoffer une énumération («Mets m'en deux lignes). Ici, où ai-je placé mon joker ? Peut-être p. 208-227 sqq, où je rends un «pauv'malheureux» (récurrent qui plus est) par un affectueux «crapule». C'est un passage que j'ai traduit sans dictionnaire grec-français, en vacances ; j'ai rendu «magoùfis» par «crapule», au feeling ; quand plus tard j'ai découvert mon erreur, j'ai tout de même gardé mon «crapule», qui m'a paru mieux rendre le côté tendresse bourrue du personnage.
Une autre de ces interventions arbitraires, mais délicatement jouissives : au lieu de «La Sainte Vierge te tient par la main», «Tu es sur les genoux de la Sainte Vierge».
Transcription des noms.
Mon système habituel.
Un problème : Aphrodìti ou Afrodìti? J'opte d'abord pour le «f», qui sans occulter la référence mythologique la rend plus discrète ; finalement je choisis «ph», pour la faute d'orthographe que cela me permet d'ajouter au petit mot écrit par Aphroditi p. 140-185 : «Jetème. Afroditi»
Ponctuation.
Rajouté quelques majuscules (Parti, Sûreté, Direction...), ne serait-ce que pour la clarté. Et aussi des guillemets-pincettes («instruction révolutionnaire»). Quelques points-virgules, car mieux vaut ça que de couper les phrases ; pourvu qu'ils ne soient pas ressentis comme trop raffinés...
Un passage dont je suis content, p. 178-196 : «Un homme lourd, brun, velu, bas de cul, taciturne.» Progression rythmique (de une à trois syllabes), répétition de [u], tout ça pour rendre le côté massif et pesant du personnage. (Évidemment il a fallu coller un «bas de cul» à la place d'un «de petite taille»... Quelques lignes plus bas, le même : «lourd, dur, seul». Les monosyllabes. Les deux [r] en fin de mot. Le [l] au début et à la fin, qui fait de l'ensemble un tout fermé, compact.
Oui, mais n'est-ce pas justement trop bien, trop léché, trop écrit ? N'a-t-on pas l'impression, en me lisant, de voir un bourgeois déguisé en prolo ?
Une autre traduction de certains passages, due à Roger Milliex, parue dans le Monde diplomatique. (Sa version du titre: Heureusement toi tu as été tué à temps.)
P.168-186.
Version Milliex :
Donc, j'avais expliqué à l'autre mes positions : il remue la tête et me dit «Je te comprends, le Salonicien, tu en as tant bavé, tu es fatigué, c'est normal. Mais là où je ne suis plus d'accord avec vous, c'est que vous ne le disiez pas tout de go et sans crainte, au lieu de vous retrancher derrière de prétendues divergences idéologiques et politiques, alors qu'il s'agit d'un tout simple problème humain et si naturel. Résultat : vous portez préjudice au Parti... «
Je ne peux pas encore préciser le sentiment qui dominait en moi : fureur ? pitié ? amertume de voir les gens en arriver là ? Celui-là était un homme intelligent, cultivé, toujours très doux. Je lui fais : «Que te dire, mon vieux Mitsos ?» Je vais te répondre point par point et un peu brutalement ; qui sait ? Peut-être tu vas comprendre.
Ma version :
Donc j'expose mon point de vue, le type hoche la tête et me dit, je te comprends, Salonique, après tous ces malheurs tu es fatigué, c'est normal. Mais là où je ne suis plus d'accord avec vous, c'est qu'au lieu de l'avouer bien en face, courageusement, vous attribuez ce problème humain si simple et naturel à des soi-disant divergences idéologiques et politiques, ce qui en fin de compte fait du tort au Parti... Je l'ai regardé. Je ne peux toujours pas distinguer quel sentiment l'a emporté alors en moi : fureur ? pitié ? amertume de voir où en arrivent les gens ? Ce type avait toujours été très doux, intelligent, cultivé. Je lui dis, Mìtsos, qu'est-ce je peux faire... Je vais te dire les choses une à une, brutalement, tu comprendras peut-être.
(L'original se présente sans alinéas ni guillemets.)
Je pique au confrère son «tu en as tant bavé», nettement meilleur que mon «après tous ces malheurs», en le modifiant un peu : «tu en as tellement bavé» me paraît plus dans le ton. J'ai envié un moment son «Résultat...», évidemment plus nerveux que mon «ce qui en fin de compte» ; finalement je ne veux pas changer, ce n'est pas le moment de faire percutant, il faut laisser couler jusqu'au bout comme dans l'original cette phrase un peu soûlante de baratineur professionnel...
Trouvé après coup, dans le Duneton, cette phrase de Montaigne qui me remplit d'aise, tant elle résume mot pour mot ce que j'ai voulu faire en travaillant sur Mìssios, et plus généralement ce que je veux faire en traduisant mes Grecs :
«Le parler que j'ayme, c'est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche ; un parler succulent et nerveux, court et serré, non tant délicat et peigné comme véhément et brusque.»
Premier contact de ma V.F. avec le public : oral, comme il se doit. À Strasbourg en janvier 89, lu trois pages (p. 84-87). À la qualité du silence des auditeurs, et à leurs commentaires ensuite, compris que Mìssios avait sa place chez nous, et qu'il la trouverait un jour.
En novembre 90, une fois la traduction terminée, raconté le livre à mes enfants Ariane et Damien (9 et 8 ans) en leur lisant plusieurs passages. Là encore, transmission orale...
Si j'ai tant voulu traduire Toi au moins..., c'est aussi pour des raisons personnelles. Moi qui suis né en décembre 47, au moment où le jeune Mìssios attendait la mort, qui ai toujours vécu protégé, qui n'ai jamais eu à risquer quoi que ce soit pour défendre mes idées, je me sens une dette vis-à-vis de ceux qui ont tout souffert et tout donné. S'ils ne sont pas morts en vain, si leur sacrifice peut encore trouver un sens, et un peu de leur force d'âme, peut-être, passer en nous, c'est qu'un livre les a tirés de l'oubli. En tâchant de le faire connaître hors de Grèce, j'ai d'abord voulu être, dans les pas de Mìssios, l'humble serviteur de ces morts. Et j'ai le sentiment d'avoir un peu, moi aussi, donné (ou rendu) la vie. Traduit-on pour autre chose ?
Avant de m'attaquer à ce livre, je craignais d'être obsédé par lui, accablé par la douleur et l'angoisse dont il est plein. En fait je n'ai pas tellement souffert ; le chirurgien pendant l'opération est trop concentré, trop absorbé par une foule de problèmes techniques... Je me suis plutôt senti porté par l'énergie vitale du texte, l'allégresse de l'écriture, son humour. Un grand livre est toujours consolant. J'avoue quand même que plusieurs fois, en plein travail — pour la première fois de sa carrière — le petit chirurgien a eu les larmes aux yeux.
Le texte ci-dessus est destiné à quelques amis et à d'éventuels traducteurs (jeunes ou moins jeunes, de grec ou d'autres langues) qui souhaiteraient visiter la petite cuisine d'un confrère. En attendant de le déposer avec un exemplaire de la V.O. et de la V.F. à la bibliothèque du Collège d'Arles, je l'envoie à mon éditrice. Elle le fait lire à la correctrice, que je ne connais pas encore. Quand celle-ci m'appelle pour m'annoncer l'envoi des épreuves, elle me confie qu'après avoir lu ces notes elle n'a plus tellement osé corriger mon travail ... Je n'avais pas pensé que ma B.A. pédagogique serait si tôt récompensée !
En fait ma relectrice a quand même sévi. Je ne lui en veux pas trop : elle a joué son rôle, celui de gardien de la langue, signalant les écarts de langage et suggérant des solutions plus orthodoxes. Tant qu'elle se borne à proposer, sans imposer...
Ses interventions (appuyées par une page d'explications) visent donc à rendre le texte plus proche du «bon français». Dans «Sa nana c'était Patrocle ou pas ?» eIle gomme le «c'», et dans «avec son violon et l'étoile jaune sur sa veste» elle transforme le «sur» en «de» (pour qu'on ne croie pas, j'imagine, que le violon est lui aussi sur la veste) ; elle tique sur les «souviens-toi», répétés six fois dans les quarante premières lignes ; me signale que «day by day»» veut dire «jour après jour», alors que Mìssios et moi lui donnons le sens d'«un jour sur deux» ; transforme le «fric-frac» des clefs en «clic-clac» ; n'aime pas «nana», jugé trop récent, qu'il faudrait remplacer par «poulettes», «souris» ou «pépées», et «baintotal» («pentho» ferait mieux l'affaire) ; enfin la ponctuation (domaine d'élection des correcteurs) est normalisée — discrètement il est vrai.
Je ne suis pas toujours d'accord, loin de là, et ne me gêne pas pour rétablir mon texte — surtout quand «squelette» (il s'agit d'un homme très maigre) devient un «moribond squelettique» — là, je suis indigné ! Mais d'autres corrections sont les bienvenues, comme cet «adéquat» dans la bouche du maître d'école, qui remplace avantageusement mon «idoine». Et dans plusieurs cas où les déplacements de virgules me paraissent inutiles sans pour autant me gêner, je laisse courir — soyons diplomate.
Après la lecture des épreuves (en cinq jours), je tape la bafouille affable que voici :
17.2.91
Merci pour vos suggestions, toujours stimulantes. Je les ai examinées avec soin et suivies plusieurs fois, mais pas toujours — d'où ce petit mot pour expliquer certains choix.
La ponctuation d'abord. J'essaie de ponctuer de façon expressive, en suivant moins la syntaxe et l'usage que l'émotion et la respiration. D'accord pour quelques arrangements de détail, mais ici surtout je crois que la ponctuation doit rester un peu rudimentaire, et même, peut-être, vaguement fautive — comme la syntaxe de Mìssios. Je suis gêné entre autres par la virgule suivant le tiret, qui me paraît trop raffinée, trop analytique.
«Souviens-toi». Il m'arrive de limiter certaines répétitions quand je les trouve trop lourdes. Ici, j'aime bien, c'est envoûtant mais avec discrétion.
«Nana» est attesté dès 1950 (cf. Dictionnaire du français non conventionnel); je l'ai quand même remplacé par «môme», qui au fond me convient mieux, sauf en quelques points où «môme» ne coIlait pas.
«Clic-clac» me paraît trop net et propre. Les prisons grecques de 1950, ce n'était pas Fleury-Mérogis... Il faut un peu de rouille dans ces vieilles serrures. D'où «cric-crac» (attesté pour le métal, cf. Dictionnaire des bruits, p.127).
Mìssios a bel et bien écrit «squelette», et non «moribond squelettique» ! C'est une figure de style qu'il serait fâcheux de gommer.
«Baintotal» (suite). Nous sommes d'accord : C'EST un lapsus analphabète, et non un jeu de mots. Le narrateur est un pauvre gamin illettré, paniqué... Je dois vous faire un aveu : ce bain terrifiant qu'il imagine est l'une des deux ou trois trouvailles dont je suis vraiment content...
«day by day». L'erreur n'a pas échappé au prof d'anglais que je suis. Si je ne la corrige pas, c'est qu'elle a une fonction : montrer que ces jeunes gens ne sont pas diplômés d'Oxford — ou d'ailleurs...
Phrases incompréhensibles :
1) «Certains qui ont des problèmes sexuels». Il n'y a rien à comprendre. Le personnage ignore le sens du mot «sexuel», c'est tout. Le texte grec n'est pas plus éclairant.
2) En serrant Aphrodìti dans ses bras, Salonique ne ressent pas ce à quoi il s'attendait : elle n'est plus pour lui une amante, mais une mère. J'ai corrigé pour que ce soit plus clair.
Désolé, vous trouverez aussi quelques corrections de dernière minute. J'avais pourtant revu mon texte à fond plusieurs fois...
etc.
Réception du livre le 14 mars 91.
Grand moment d'angoisse, comme toujours.
La couverture, un désastre, plus encore que d'habitude au Petit-Matin : la photo, aucun rapport avec l'histoire ; mon paragraphe de présentation, maladroitement abrégé ; l'extrait choisi, trop violent ; il y a même une coquille («commencèrent» au lieu de «commencent»); et surtout, ce récit d'événements authentiques est qualifié de «roman» !
(Imaginons un instant : Le journal d'Anne Frank, roman. Si c'est un homme, roman.)
À l'intérieur, je fais d'étranges découvertes. Ma traduction de Lorca a été remplacée par une autre ; dans les vingt premières pages, il y a 23 divergences entre le texte imprimé et celui de mon tapuscrit, dont 19 me déplaisent : des virgules rajoutées, quatre phrases coupées, deux mots changés, une faute de grammaire...
Je sais, c'est bien peu de chose, le texte n'en souffrira pas vraiment. Pourtant j'en suis malade. Question de principe: sans mon droit au final cut, je me sens tout nu, sans défense.
Lettre à l'éditrice. Conversations téléphoniques. Tout s'arrange : on me prouve que ces corrections, je les ai vues sur épreuves, et acceptées... Incroyable. Avoir laissé passer tant de choses ! avoir coupé des phrases ! Moi qui suis tellement maniaque sur ce point...
J'adresse mes plus plates excuses aux deux dames, injustement soupçonnées d'avoir trafiqué ma prose.
Cela dit, je m'en veux d'avoir, en relisant les épreuves, cédé si souvent. J'ai voulu être courtois, mais ce n'était pas le moment. Chacune des virgules rajoutées (pas besoin de recourir au tapuscrit, je les repère quasiment toutes) me coupe dans mon élan de lecture comme un croc-en-jambe. Il faudra que je revoie tout ça pour la deuxième édition...
Pour la deuxième édition, attendre encore un peu.
Pourtant la presse n'a pas été mauvaise : un long papier très élogieux de Michel Grodent le fidèle, dans Le Soir ; un autre de Vassilis Vassilikos dans La Quinzaine, un (plus inattendu) de Suzanne Bernard dans Révolution ; quelques lignes un peu tièdes de Vassilis Alexàkis dans Le Monde. À quoi s'ajoute une Agora de Gilles Lapouge, sur France-Culture, où Costa-Gavras est venu défendre le livre avec moi.
Seulement voilà, le public n'a pas suivi. Les articles sont sortis bien trop tard, en ordre dispersé. Et quand bien même... Qui s'intéresse à la Grèce aujourd'hui — à part les Grecs eux-mêmes, et quelques éditeurs français courageux?
Après deux ans de mévente l'éditeur m'annonce qu'il va pilonner — à moins que je ne rachète le stock au prix du papier. J'en commande hardiment cent. Impossible, répond-on : le stock ne peut être divisé, c'est tout ou rien. Il en reste combien ? Mille. Que faire ? J'allonge 3000 F, recueille les condamnés dans la grande cave de mes parents et pendant des années je m'efforce de les caser. Le livre poursuit une vie souterraine. J'offre des exemplaires aux amis, aux étudiants, aux élèves. Certains lecteurs abandonnent : trop cafardeux. Certains s'enflamment. Un ami qui travaille dans une municipalité communiste m'en achète vingt pour les offrir à ses collègues et rendre les Rouges verts de rage. La psychanalyste Françoise Davoine m'en achète quarante pour les participants à son séminaire, en vue d'une séance consacrée à Mìssios, sur le thème «Comment supporter l'insupportable ?»
En 2004, je mets en ligne les premières pages et ma préface sur mon site, volkovitch.com, et propose d'envoyer des exemplaires gratuits à qui le voudra contre remboursement des frais d'envoi. Trois ou quatre internautes se manifestent.
2007. On dirait que ça bouge à nouveau. Pascale Arguedas, tombée amoureuse du bouquin, met en ligne les premières pages sur son site littéraire calou.net. Le scénariste de BD Sylvain Ricard propose une adaptation en images aux éditions Futuropolis. François Bon décide d'accueillir Toi au moins... chez publie.net, la maison d'édition en ligne qu'il est en train de créer.
Relecture de l'ensemble. Menus changements, et surtout :
— allègement de certaines phrases trop virgulées par la correctrice, que je veux rythmer de façon plus variée, rendre moins convenues, plus vivantes ;
— suppression des points-virgules, que personnellement j'adore mais qui me paraissent un peu trop raffinés ici (je les remplace par de simples virgules, par deux points, par un tiret, voire par un point, moi qui d'habitude coupe très rarement les phrases) ;
— majuscules introduisant les dialogues après deux points ou une virgule, pour être plus clair (pas totalement convaincu : certains passages passent mieux, d'autres en sortent un peu alourdis).
Qui verra la différence ?
Mai 2019. Réédition aux éditions Cambourakis.
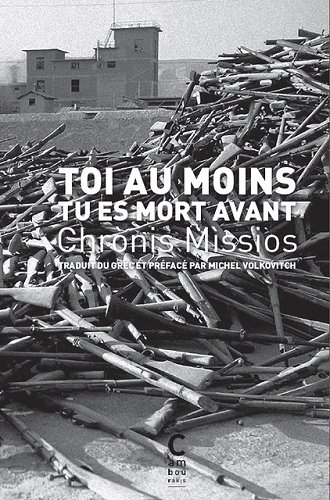 Chrònis Mìssios. |