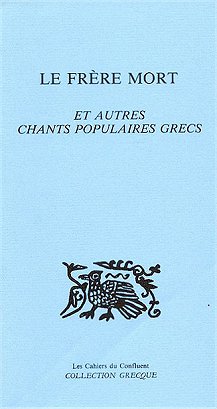
Mère aux neuf fils, tu avais une fille,
une fille chérie, tu l'aimais plus que tout,
douze ans tu l'as gardée à l'abri du soleil.
Tu lavais, tu peignais ses cheveux dans le noir,
tu les frisais aux étoiles avant l'aube.
Alors de Babylone on demande sa main ;
très loin d'ici, en pays étranger.
Huit fils ont refusé, seul Constantin dit oui.
Mère, envoie-la, envoie donc notre sœur
en pays étranger, où je m'en vais moi-même
pour oublier ma peine et fonder ma maison.
Tu es sage, mon fils, mais c'est bien mal parlé :
s'il me vient mort, s'il me vient maladie,
peine ou bien joie, qui partira chercher ma fille ?
Il prend Dieu à témoin, Dieu, les saints et les saintes :
Mère, s'il te vient mort, s'il te vient maladie,
peine ou bien joie, j'irai chercher ma sœur.
Et quand on l'eut mariée, en pays étranger,
vint l'année bissextile et ses mois de furie,
l'épidémie faucha les neuf garçons.
La mère alors est seule, un fétu dans la plaine,
sans ses enfants, le fruit de ses souffrances.
Les herbes folles ont envahi sa cour.
Devant huit tombes elle se frappe et se lamente ;
de Constantin elle ouvre le tombeau.
Lève-toi, fils, je veux revoir ma fille.
Tu as pris à témoin Dieu, les saints et les saintes,
s'il me vient peine ou joie, d'aller me la chercher.
Il se soulève, il saute hors de la fosse,
son cheval est nuage et ses habits d'étoiles,
sa lune l'accompagne, il va chercher sa sœur.
Il passe des montagnes, il en passe encor d'autres,
et la trouve dehors se peignant sous la lune.
Dès qu'il la voit, de loin il la salue.
Partons, petite sœur, notre mère t'attend.
Mon petit frère, que viens-tu m'apporter ?
Si c'est la joie, je mets mes bijoux d'or ;
sinon, je te suivrai, mais telle que je suis.
Partons, ma sœur, viens telle que tu es.
Sur le chemin où tous les deux cheminent,
on entend les oiseaux, et les oiseaux se disent :
As-tu vu ? Une belle entraînée par un mort !
Entends-tu, Constantin, ce que les oiseaux disent ?
«As-tu vu ? Une belle entraînée par un mort !»
Des oiseaux fous, laissons dire les fous.
Quelle douleur, et que c'est triste à voir,
c'est vivants qui s'en vont marchant avec les morts !
Entends-tu, Constantin, ce que les oiseaux disent ?
Les vivants, disent-ils, s'en vont avec les morts.
— Laisse-les donc, laisse-les donc parler.
J'ai peur de toi, mon frère, et pourquoi cette odeur ?
Hier nous étions à l'église Saint-Jean,
les encensoirs étaient bourrés d'encens.
Sur le chemin plus loin d'autres oiseaux leur disent :
— Dieu tout-puissant, tu fais là grand miracle :
une fille aussi belle entraînée par un mort...
La fille l'entendit, son cœur en est brisé.
Entends-tu, Constantin, ce que les oiseaux disent ?
Mais où sont tes cheveux, où ta moustache épaisse ?
— La maladie m'a jeté à la mort,
m'a pris mes cheveux blonds, pris ma moustache épaisse.
Ils trouvent la maison fermée, barricadée.
Aux fenêtres partout des toiles d'araignée.
Mère, ouvre-moi, ouvre, voici ta fille.
Tu es la Mort ? Va-t'en, je n'ai pas d'autre enfant,
ma fille est loin, en pays étranger.
Mère, ouvre-moi, ouvre, c'est Constantin.
J'ai pris Dieu à témoin, Dieu, les saints et les saintes,
s'il te vient peine ou joie, d'aller chercher ta fille.
Le temps d'ouvrir, elle a rendu l'esprit.
Quarante-cinq maçons et soixante apprentis
au pont d'Arta ont travaillé trois ans.
Le jour ils bâtissaient, le soir tout s'écroulait.
Gémissent les maçons, pleurent les apprentis.
Tous ces efforts gâchés, tout ce travail en vain,
bâtir le jour, et le soir tout s'écroule.
Sur l'autre rive un oiseau s'est posé.
Il a chanté, mais pas comme un oiseau,
il chantait, il parlait dans la langue des hommes :
— Le pont ne tiendra pas, s'il n'enferme quelqu'un :
pas d'orphelin, d'étranger, de passant,
mais du maître maçon la femme, la très belle,
qui vient tard le matin à l'heure de midi.
Quand le maître maçon l'entend, la mort dans l'âme,
pour elle au rossignol il confie un message :
Traîne pour t'habiller, pour venir à midi,
traîne en marchant sur le chemin d'Arta.
L'oiseau l'a mal compris, l'a redit autrement :
Presse pour t'habiller, pour venir à midi,
presse en marchant sur le chemin d'Arta.
La voilà qui paraît, loin sur la route blanche.
Quand le maître maçon la voit, son cœur se fend.
De loin elle salue et de plus près leur dit :
— Bonjour à vous, maçons et apprentis,
mais qu'a donc votre maître, et pourquoi cet air sombre?
— Son anneau est tombé, là, sous la première arche.
Qui descendra au fond, qui trouvera l'anneau?
— Ne t'en fais pas, maître maçon, j'y vais.
Je descendrai au fond, je trouverai l'anneau.
Elle est à peine entrée, à peine descendue.
— Tire la chaîne, ami, tire-la vite,
j'ai bien cherché partout, n'ai rien trouvé.
Un lance de la chaux, un saisit sa truelle,
et le maître maçon jette le plus gros bloc.
— Malheur à nous, à notre affreux destin!
Nous étions en naissant, les trois sœurs, condamnées :
une au pont du Danube, une au pont sur l'Euphrate,
et maintenant, moi la plus jeune, au pont d'Arta.
Comme tremble mon cœur que tremble aussi le pont,
et comme mes cheveux que tombent les passants !
— Femme, change de mots et de malédiction.
Tu as un frère au loin, il passera peut-être.
Elle a changé de mots et de malédiction.
— Comme tremblent les monts que tremble aussi le pont,
et comme les oiseaux que tombent les passants!
Car j'ai un frère au loin, il passera peut-être.
On chante aux monastères, on chante à chaque église,
Sainte-Sophie sonne ses dix-huit cloches.
Alexandre, le roi, reste encore endormi.
Sa mère à son chevet lui parle et le supplie.
— Debout, mon fils ; debout, ma vie ; debout, mon roi,
pars à l'église, ouïr la bonne parole.
Il se dresse, il se lève, il se met en chemin.
Devant marche sa mère et sa sœur vient derrière ;
entre les deux, le roi, tel un fruit desséché.
Quand l'église le voit, tous ses murs se crevassent ;
là où chantaient les prêtres, où psalmodiaient les diacres,
au fond dans le Sanctuaire, on entend une voix :
Dehors, bandit ; dehors, maudit ; dehors, mon roi.
Sa mère à ses côtés lui parle et le supplie :
Qu'as-tu donc fait, mon fils, qu'as-tu donc fait, mon roi
Pour que Sainte-Sophie ne veuille plus de toi ?
Mère, aide-moi, je dois me confesser.
C'est moi ton confesseur, dis-moi tous tes péchés,
dis-les, mon fils, je vais les pardonner.
— Quand tu me fis partir, à mon premier voyage,
nous étions une foule, on avait peu de place. Tous attachaient leur cheval aux buissons,
et j'attache le mien à l'anneau d'une tombe :
un cheval noir, il est tout seul, il joue,
il tire, il pousse, il ouvre le tombeau
et je vis une fille, enterrée de trois jours,
de longs cheveux tressés, de belles boucles,
un visage brillant, plus beau que le soleil,
et, m'inclinant, j'ai embrassé ses yeux,
ses noirs sourcils, ses mains croisées, ses lèvres rouges.
Pour ce péché, mon fils, il n'est pas de pardon ;
pars au désert, pars dans un monastère,
passe ta vie en jeûnes et en prières.
Cette terre où nous marchons
tous un jour y rentreront.
Cette terre l'affamée
frappez-la frappez du pied.
Cette terre au vert manteau
mange les jeunes les beaux
et me mangera aussi
de ma mère enfant chérie.
Cette terre l'affamée
frappez-la frappez du pied.
C'est un petit oiseau posé sur la charrue.
Il chante au laboureur, mais pas comme un oiseau :
Il chante et comme un homme il dit des mots.
Tu sèmes, laboureur, point ne récolteras.
Qui te l'a dit, l'oiseau, qui t'a dit ça ?
Hier aux cieux j'écoutais les anges deviser,
ils te comptaient parmi les trépassés.
Les oiseaux m'ont menti, les rossignols de mai,
les menteurs, ils m'ont dit que jamais ne mourrai.
J'ai bâti ma maison plus haute que les autres,
deux, trois étages et soixante fenêtres.
À la fenêtre, au-dessus de la mer,
je vois les vertes plaines et les montagnes bleues,
je vois la Mort qui vient à cheval dans la plaine :
noire, vêtue de noir, dessus son noir cheval ;
noir aussi son grand chien, qui la suit à la chasse.
Écoutez ce qu'a dit la mère de la Mort :
— Femmes, cachez vos hommes, et vous, mères, vos fils ;
vous, tristes sœurs, cachez vos pauvres frères :
la Mort arrive à cheval dans la plaine ;
vêtue de noir, armée de noir, en manteau noir ;
écharpe noire au cou, tête coiffée de noir ;
traînant par les cheveux les filles, les garçons,
et les petits enfants, qu'elle accroche à l'arçon.
Voici le grand chagrin, voici l'affreux malheur :
va-t'en, va-t'en, petit enfant, c'est l'heure ;
sur ce cheval de bois, dessellé, déferré,
va-t'en gagner ta dernière demeure.
Je te croyais toujours sans eau, rivière,
mais aujourd'hui te voici toute entière.
Tu charries des rochers, des arbres arrachés,
tu charries un pommier de ses pommes chargé ;
entre ses branches un couple est enlacé.
«Ils sont mari et femme !» «Ils sont cousins !» dit-on,
mais ils sont frère et sœur, de cœur, de père et mère.
La mort a décidé de se faire un jardin :
elle a creusé, pioché, arbres planté :
garçons-cyprès et filles-citronniers,
petits enfants partout comme rosiers,
vieillards enfin, qui sont la haie de ce jardin.
La mort a décidé de bâtir un château ;
vieux, jeunes et enfants, voilà ses matériaux :
vieux-fondations, jeunes-planchers, enfants-crénaux.
Affreux sont les Enfers : on n'y voit pas l'aurore,
on n'entend pas les coqs, les rossignols.
On n'a pas d'eau, on ne met pas d'habits,
on cuit de la fumée, on mange de la nuit.
Dis-moi, dis-moi le jour où tu reviens,
que j'aille parfumer les arbres du chemin,
que je pave la cour en marbre, pour te plaire.
Quand ferez vin d'olive et huile de raisin,
quand la mer asséchée vous donnera du grain,
je reviendrai, mère, des noirs enfers.
Ne portons pas les chemises des morts,
laissons-les pendre aux ruines d'une tour,
que la poussière et le soleil les rongent
et qu'elles tombent en poudre, comme un corps.
Pour mieux t'aimer je ferai une robe,
une robe en épines, en branche de roncier ;
une vipère en guise de collier.
Que l'épine me perce et la ronce me serre,
que morde la vipère, empêchant d'oublier.
Le frère mort
Choix et traduction de Michel Volkovitch
paru en 1984 aux Cahiers du Confluent
d'Yves Bergeret
(recueil épuisé)
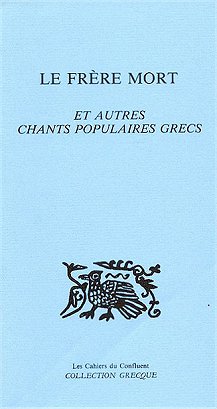
L'origine de ces chants populaires grecs se perd dans le temps et l'espace ; les plus anciens sont quasi millénaires ; beaucoup d'entre eux se promènent dans tous les Balkans et au-delà. Le frère mort, par exemple — le plus connu d'entre eux, et pas le moins étrange — a servi de trame, dans sa version albanaise, à l'un des plus beaux romans d'Ismaïl Kadaré, Qui a ramené Doruntine ? (Livre de poche).
Les derniers furent composés au XIXe siècle, mais l'ensemble est resté vivant jusqu'à nos jours. Si on ne les chante plus depuis longtemps, on les récite encore ; certains inspirent toujours des œuvres contemporaines. L'ennemi du poète de Georges Cheimonas, Ballade de Mihàlis Ganas et «La rencontre» d'Anèstis Evanghèlou (cf anthologie Gallimard), notamment, sont des variations sur Le frère mort.
Les plus beaux de ces chants étant ceux qui évoquent la mort, ce thème s'est imposé à moi quand j'ai pu en faire une anthologie, publiée par Yves Bergeret dans ses Cahiers du confluent. L'un de mes tout premiers travaux, en 1984.
Je ne crois pas que je les traduirais très différemment aujourd'hui. On peut sûrement faire mieux dans le détail, mais le principe de départ me semble bon : un poème en traduction doit rester un poème, il doit conserver sa forme, son (ou ses) mètre(s), et ses rimes éventuelles.
Il me fallait donc trouver avant tout un équivalent au vers de 15 syllabes, impossible en français car informe et boiteux ; trouver un mètre aussi familier que l'est celui-ci en grec. L'alexandrin ? Trop pompeux pour des chants populaires, sans compter le risque de monotonie. Le décasyllabe ? Plus vif, mais un peu court, il ne m'aurait pas permis de tout caser.
La solution m'est venue sans réfléchir, en tâtonnant : je me suis retrouvé à mélanger 12- et 10-syllabes (dans leur forme classique, soit 6+6 et 4+6, la poésie traditionnelle devant faire entendre, il me semble, une musique familière au lecteur-auditeur). La formule a un double avantage : une contrainte moins rude, et un rythme d'ensemble plus souple et nerveux — sans perdre pour autant la cohésion, les deux mètres ayant presque la même longueur, et le même second hémistiche.
J'ai essayé, tant bien que mal, de contrôler cette alternance à des fins expressives. Dans Le frère mort, il y a deux tiers d'alexandrins, qui forment donc le rythme de base ; les décasyllabes servent à briser le train-train, à relancer : ils sont fréquents au départ des strophes et dans les dialogues. Ils se suivent rarement (une seule fois hors des dialogues).
Pour la langue à utiliser, je n'ai pas voulu donner dans la reconstitution historique, ce qui aurait fait perdre aux chants ce qu'ils ont de plus précieux : la simplicité. J'ai tâché d'être sobre, direct, d'écrire au plus près de la parole. (Je n'ai plus cessé depuis.) En même temps, il fallait tout de même signaler discrètement que le texte n'est pas contemporain : d'où quelques touches d'archaïsme, moins dans le vocabulaire que dans la syntaxe (suppression d'articles etc.).
J'ai respecté au maximum les répétitions, bien entendu, parfois au prix de quelques acrobaties.
Pour les noms, on m'a reproché (entre autres) de n'avoir pas appelé la Mort Charon, comme en grec. Mais Charon, pour les Français, c'est autre chose, c'est le passeur : un valet, et non le roi lui-même. J'ai préféré le remplacer par «la Mort», en lui faisant changer de sexe, ce qui est loin de me satisfaire totalement, mais que faire ? La sœur, qui s'appelle Areti (la vertu) en grec, je l'ai d'abord appelée Constance, créant ainsi un effet d'écho entre la sœur et le frère, Constance et Constantin — ce qui était un peu arbitraire —, avant de carrément ne pas la nommer, faute de nom qui aille.
La première version contenait des erreurs que j'ai rectifiées dans la seconde ; j'ai encore repris le texte avant de l'inclure dans le Cahier grec consacré à Ballade, de Mihàlis Ganas, et de nouveau pour Made in Greece. Le v.3 est un emprunt à la traduction de Jean-Luc Leclanche, découverte après la première parution : sur ce vers-là ma version à moi («en douze ans le soleil ne l'avait jamais vue») était minable, et la sienne bien meilleure. Je bute encore sur le premier vers, que j'ai modifié plusieurs fois ; ma solution présente est là faute de mieux...