
Traduire en vers, c'est difficile :
BRÈVES
N°244 Février 2024
Quand je cause ici, tous les mois,
j'en informe aussitôt sans faute
les plus fidèles volkonautes
par un message en vers — pourquoi ?
Parce que les vers — les vers classiques —, j'adore les lire et en écrire. Les cadences qui balancent, les rimes qui s'arriment, c'est de l'acrobatie, c'est un jeu. D'une certaine façon, les vers c'est toujours joyeux. La rime ? Un gag. Et surtout, il y a toujours dans le vers une vague magie. «Quand on parle en vers, on dirait qu'on avance dans un rêve.» Où ai-je lu ça déjà ?
Les vers ces temps-ci m'obsèdent.
D'abord, je viens de traduire, et m'apprête à publier au Miel des anges, le grand poème d'amour du XVIIe siècle grec, Erotòcritos — un quart seulement de l'ensemble, 2500 vers tout de même, avec des rimes comme dans l'original. Deux versions intégrales existent, l'une en prose ultra-plate, l'autre en vers libres informes ; Erotòcritos n'a jamais encore chanté dans notre langue.
Ensuite, j'ai vécu l'an dernier un choc profond : l'agression subie par les vers swingants de mon cher Kavvadìas, que j'avais traduits naguère en vers, tombés aux mains d'un sagouin qui les a bousillés en leur coupant les pieds. Ce boucher détenant les droits, ma version à moi est tricarde jusqu'en 2045.
Je n'en fais pas une affaire personnelle : c'est la traduction des vers en vers qu'on attaque. Il faut réagir : je prépare, en compagnie de plusieurs grands noms du métier, une défense et illustration de notre art versificatoire, actuellement menacé — dans notre langue du moins. Traduire en vers sera publié lui aussi, bientôt, par le Miel des anges.
Enfin, je suis plongé dans la lecture d'un trésor : Le soleil d'Alexandre, où l'ami André Markowicz traduit des poèmes de Pouchkine et de ses amis avec une telle virtuosité qu'on croirait des originaux français. Nous en reparlerons le mois prochain.
 Traduire en vers, c'est difficile : |
Pour l'instant, place au vers libre, quasi hégémonique aujourd'hui.
Curieux personnage.
Devenu banal et pourtant peu banal
capable souvent du pire
et parfois du meilleur
enclin à la paresse et au n'importe quoi
mais nous donnant aussi
des musiques parmi les plus
subtiles et les plus
justes.
Écrire de bons vers libres, c'est aussi ardu que de versifier classiquement. Je rêve de l'étudier un jour, lui et la façon de le traduire, tout en craignant que le champ ne soit trop vaste et complexe pour moi.
Phénomène troublant : le développement chez nous (et pas seulement chez nous) d'un genre apparemment nouveau : le vers libre envahissant le roman ! On a parlé récemment ici même de Louisa Reid pour Riposte, de Victor Pouchet pour La grande aventure (un meuste), d'Hélène Laurain pour Partout le feu, et je rapporte dans le Coup de langue de ce mois-ci («Prose coupée») une table ronde plutôt décevante consacrée au sujet.
Ayant manqué ce jour-là l'intervention de Christophe Manon, il fallait que je répare en lisant Porte du Soleil chez Verdier.
Qu'il soit une fiction ou un récit vécu, ce livre devrait me toucher autant, eh bien non, et cela m'agace de devoir l'avouer : savoir que derrière le narrateur il y a l'auteur me remue davantage. C'est bête, non ?
Un homme, donc, voyage en Italie à la recherche de ses origines familiales, mais il sombre soudain dans une crise morale terrible, sans trop nous dire pourquoi. «Dévoré d'angoisse», «au bout du rouleau», dit-il, «je descendais les degrés de l'enfer». Mettant ses pas dans ceux de Dante, il a en guise de Virgile toutes les œuvres lues naguère qui remontent en lui, les tableaux et les fresques qu'il rencontre alors, tout cela servant de miroir à sa souffrance. Il se compare même à Jésus montant au Calvaire. Cet homme d'aujourd'hui est l'enfant des saints d'autrefois, il connaîtra comme eux la déréliction avant d'être touché par l'extase et de guérir brusquement — de façon un peu inexplicable là encore. On comprend que la fréquentation des morts a failli le faire sombrer, que de pouvoir enfin les remettre à leur place l'a délivré, on ne saisit pas bien comment mais c'est bien ainsi : ces expériences-là sont toujours plus ou moins mystérieuses et ce flou narratif les rend plus fascinantes encore.
Et si parfois nous faisons halte,
si nous sommes tentés parfois
de nous retourner un instant
afin de jeter un ultime regard en arrière
sur ceux qui nous sont chers,
prenons garde surtout de ne pas demeurer
pétrifiés par ce que nous voyons, et tâchons
au plus vite de poursuivre par le monde
la trajectoire qui nous est assignée.
Les morts entre eux, les vivants avec les vivants, c'est un peu court et désinvolte, mais qu'importe.
Ce livre qui va profond, je ne fais que l'effleurer, mais on trouve sur diakritik.com un lumineux entretien avec l'auteur. Mieux vaut lire ça que mes bricoles à moi.
Le découpage en vers ? Efficace assurément, il apporte au discours une lenteur, une solennité, qui le hausse au-dessus du quotidien ; il ajoute à l'émotion en faisant haleter légèrement la phrase.
On peut, grâce à Internet, écouter Manon lire son texte. Et là, stupeur : il coupe les vers au milieu, les lie au suivant ! À quoi bon donner à l'écrit un rythme qu'on va saboter à l'oral ? C'est quoi ce bordel ?
 Christophe Manon, 2015 |
On reste en Italie. Florence au XVe siècle. Une nuit, le peintre Filippo Lippi, moine par ailleurs, se fait gauler par le guet au retour d'une soirée chez les filles. Il plaide sa cause et en profite pour défendre aussi sa peinture, que l'Église juge trop réaliste et sensuelle.
Car, n'est-ce pas, c'est notre humeur que de nous mettre,
En peinture, à aimer des choses devant qui
Nous passâmes cent fois sans désirer les voir :
Donc elles valent mieux, peintes — ou mieux pour nous,
C'est tout comme. L'Art nous fut donné pour cela —
Dieu nous emploie à nous aider ainsi l'un l'autre,
En prêtant notre esprit. (...)
Ce monde n'est pour nous ni laideur pure,
Ni pur vide ; il possède un sens, intense et bon :
Le découvrir, tel est le bonheur de ma vie.
C'est un monologue de quatre cents vers, d'une vie intense, d'une verve éblouissante, qui par-delà le portrait fouillé d'un personnage attachant, fait revivre à l'arrière-plan la Renaissance italienne tout entière. Louis Cazamian le traduisit jadis en alexandrins non rimés (l'original ne l'est pas non plus) et son travail n'a pas vieilli.
«Fra Lippo Lippi» est tiré d'un énorme recueil de l'Anglais Robert Browning : Hommes et femmes (Men and women, 1855), cinquante-et-un poèmes, certains très longs et rudement philosophiques, d'autres d'une légèreté exquise, comme «Love among the ruins».
Relire «Fra Lippo Lippi», c'est pour moi un pèlerinage. Il me suffit de lire le premier vers,
I am poor brother Lippo, by your leave !
pour l'entendre lancé, voilà plus d'un demi-siècle, par notre professeur M. Hibon, l'accent délicieusement british, la voix et le visage colorés par le petit cognac du matin. La poésie, apparemment, était un autre de ses alcools.
Il m'a beaucoup appris. Pour moi, à cause de lui, la poésie anglaise continue de sentir un peu le cognac. Plus tard, devenu prof à mon tour, j'ai cherché à le revoir. Hibs, comme on l'appelait finement, a décliné. Moi qui n'ai jamais fermé ma porte à d'anciens élèves, je lui en veux encore un peu.
 Fra Filippo Lippi (1406-1469) |
Encore une lecture de ce temps-là, un de ces livres qu'on pense ne jamais relire après le lycée et la fac : les Lettres persanes de Montesquieu. Eh bien on a tort.
On se souvient du principe : des Persans débarquent en Occident, à Paris surtout, «qui est le siège de l'Empire d'Europe», et il suffit qu'ils décrivent naïvement nous coutumes pour qu'elles apparaissent dans leur éventuel ridicule, voire leur odieux.
En fait, c'est plus complexe : les Persans évoquent en même temps, sans sourciller, leur propre civilisation, leur machisme effréné, leur cruauté sans bornes, se révélant sur bien des points pires encore que nous.
Comble de la subtilité, les passages hautement jouissifs où l'auteur tue deux gibiers d'une seule balle. L'Italie encore :
Les femmes y jouissent d'une grande liberté. Elles peuvent voir les hommes à travers certaines fenêtres qu'on nomme jalousies ; elles peuvent sortir tous les jours avec quelques vieilles qui les accompagnent ; elles n'ont qu'un voile.
On comprend que Montesquieu n'ait pas tout de suite signé son livre : il est passablement gonflé, féroce par moments. La religion en prend un vieux coup.
Le Pape est le Chef des Chrétiens. C'est une vieille idole qu'on encense par habitude.
Un d'eux me disait un jour : «Je crois l'immortalité de l'âme par semestre ; mes opinions dépendent absolument de la constitution de mon corps : selon que j'ai plus ou moins d'esprits animaux, que mon estomac digère bien ou mal, que l'air que je respire est subtil ou grossier, que les viandes dont je me nourris sont légères ou solides, je suis spinosiste, socinien, catholique, impie ou dévot.»
Et cette phrase d'une terrible lucidité :
Pour qu'un homme vive délicieusement, il faut que cent autres travaillent sans relâche.
Le livre plaisamment commencé va s'achever de façon cruelle, par une révolte au sein du harem, tandis que la favorite se suicide après avoir maudit son seigneur et maître. Souriant, Montesquieu ?
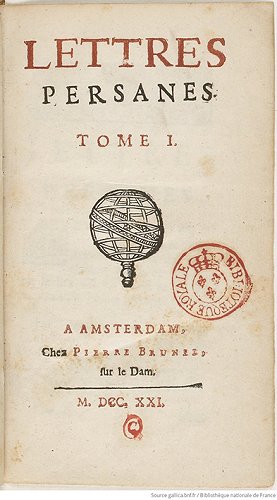 La première édition |
Presque rien lu de Jünger, il est temps. Le plus palpitant pour moi, a priori, sera son journal des années de guerre, des dernières surtout, quand ça se gâte pour l'Allemagne.
Volume III : Second journal parisien (1943-1945, Le Livre de poche), Jünger, aristocrate conservateur qui déteste Hitler et les nazis, mobilisé avec le grade de capitaine, est à Paris. Il décrit en détail ses longues promenades, ses nombreuses rencontres avec l'intelligentsia française qui fréquente l'occupant (Jouhandeau, Morand, Cocteau, Valéry, Braque...), et celles plus nombreuses encore et plus intenses avec les plantes, les minéraux et les insectes, source de moments extatiques ; ses lectures ; ses rêves ; les bombardements, spectacle «d'une extrême beauté et d'une puissance démoniaque». Dès 1943 il a le pressentiment de la débâcle à venir.
Hautain, élitiste, l'homme n'est pas franchement sympathique, mais n'attire pas l'antipathie non plus. On admire la richesse de sa vie intérieure, sa dignité dans la défaite. La noblesse de ses phrases. Qu'il est beau, ce paragraphe :
Même si tous les édifices étaient détruits, le langage, lui, demeurerait : château enchanté, avec ses tours et ses créneaux, ses voûtes et ses couloirs anciens. Jamais personne ne les connaîtra à fond. Là, dans ces puits, ces oubliettes, ces mines, il y a encore de quoi s'attarder longtemps et se perdre loin du monde.
La traduction de Frédéric de Towarnicki et Henri Plard, correcte par ailleurs semble-t-il, a plusieurs passés simples bizarres.
 Jünger à Paris. |
Jusque-là, ce mois-ci, rien que des textes passés, ou tournés vers le passé ? Il est temps d'appeler Guillaume Martin.
Il arrive au sprint. À trente ans, ce coureur cycliste professionnel, l'un des meilleurs Français actuellement (deux fois dans les dix premiers du Tour de France), écrit des livres de philosophie ! Le cyclisme a bien changé. Il y a quarante ans, Fignon passait pour un intello parce qu'il avait son bac et des lunettes.
Dans le second livre de Martin, La société du peloton, sous-titré Philosophie de l'individu dans le groupe, le petit monde du sport cycliste et la société entière, miroirs l'un de l'autre, s'éclairent mutuellement.
Le peloton est composé d'êtres solitaires qui ne peuvent faire autrement que vivre ensemble.
Nous ne pouvons vivre avec les autres, mais nous ne pouvons pas plus vivre sans eux.
La réflexion, riche en analyses pointues, en aperçus judicieux, débouche naturellement sur une critique ferme, sans être doctrinaire, du système où nous sommes tous embarqués. Et par ailleurs, le moindre attrait du livre n'est pas les échappées où le vélosophe raconte en passant son métier, ses contraintes austères, ses moments forts. Par exemple,
le surpassement, le sentiment d'être en avance sur soi-même, l'euphorie consistant à atteindre un état second où le plaisir se mêle à la douleur, où l'hyperesthésie confine à l'extase, impression de «sortie de soi-même», d'oubli de sa singularité.
Mais prenons garde à l'euphorie. Témoin cette page sur la dépression du vainqueur, du champion au sommet de sa carrière, adulé de tous :
Il ne lui reste plus qu'à jouir de cet état, à savourer. Et pourtant un mal-être le gagne, un sentiment de vacuité l'envahit. Il ne lui reste plus rien à décrocher ; Icare a accédé au soleil, et il s'ennuie. Le sportif tombe dans une détresse psychologique parce que tout va trop bien, parce qu'il se rend compte, aussi, que tout son cheminement vers les sommets avait été orchestré par un système qui lui est totalement étranger...
Notre Martin, en tous cas, semble raisonnablement heureux pour l'instant. Son lecteur aussi.
 Guillaume Martin le vélosophe. |
Mais changeons de selle, quittons le vélo, montons à cheval : une rude chevauchée nous attend avec Cormac McCarthy, De si jolis chevaux (Points), où deux cow-boys adolescents, après la guerre, quittent le Texas pour chercher du travail au Mexique et y trouvent l'enfer.
Le lecteur, lui, galope de page en page, tel un cheval que l'auteur mène avec une impérieuse douceur. On galope ? Le récit, lui, avance avec une lenteur intense, nous décrivant par le menu ce Mexique aux paysages d'une splendeur égale à sa pauvreté, les faits et gestes des deux garçons vachers, leur débrouillardise, leur endurance, leur courage, leur grandeur d'âme, leur amour passionné des chevaux, leurs épreuves terribles, leurs rencontres avec diverses personnes, d'une cruauté, d'une bêtise, d'une bonté ou d'une beauté hors du commun, selon. Tout cela raconté avec la simplicité solennelle de la Bible ou d'Homère, avec ici ou là des images d'une force peu commune qui élargissent l'horizon, déjà immense, jusqu'à l'infini.
...et il tenait le cheval par le chanfrein avec la longue tête osseuse pressée contre sa poitrine et l'haleine brûlante et sucrée de l'animal remontant des fosses sombres de ses naseaux et lui enveloppant le visage et le cou comme des messages d'un autre monde.
Comme tu es maigre, dit-elle. Il regarda dans ses yeux bleus comme un homme qui cherche une vision de l'avenir encore incréé de l'univers.
Il pensait que dans la beauté du monde il y avait un secret qui était caché. Il pensait que pour que batte le cœur du monde il y avait un prix terrible à payer et que la souffrance du monde et sa beauté évoluaient l'une par rapport à l'autre selon des principes de justice différents...
Oui, le récit par moments devient philosophique, un peu trop peut-être, il y a aussi deux ou trois tunnels inutiles, et certaines images peuvent nous laisser songeurs, comme
...et les lumières qui venaient du café et des réverbères de la place perdaient leur sang dans les flaques noires.
On pourrait reprocher à cet auteur ô combien puissant d'avoir à l'occasion la main lourde. Mais on n'en a pas envie. Ce soupçon de grandiloquence est le revers de ses qualités, et à un certain degré d'excellence les défauts parfois prennent l'allure de vertus.
Le bémol vient plutôt de la traduction. Elle m'a bien fait grincer des dents, et je n'en suis pas revenu en apprenant qui étaient François Hirsch et Patricia Schaeffer, ses auteurs. Je n'en dis pas plus pour l'instant : l'affaire mérite qu'on y revienne le mois prochain dans le Carnet du traducteur.
 L'image n'est pas tirée du film... |
Rosinski au dessin, Dufaux au scénario : la BD du jour, Blackmore (Dargaud) est un classique. Il fait partie d'une série, La complainte des landes perdues. Il y a là, dans un Moyen-Âge archétypal, un nain malfaisant dans son château, un mage barbu, une bestiole marrante, une appétissante jeune fille qui caracole presque nue, aïe les fesses, des chevaliers, des maléfices, des batailles, des morts qui parlent... Impressionnants, les dessins de Rosinski, certes, mais n'ayant rien compris à ce méli-mélo de clichés, je quitte ces landes en tapinois pour ne plus y revenir.
 Il y a sûrement une foule d'amateurs... |
Très envie, par contre, de prolonger mon voyage dans les opéras de Rimsky-Korsakov. Après l'envoûtant Kitège, Le coq d'or, plus délicieux encore, offre sur Internet, outre sa musique à la fois somptueuse et pétillante, des costumes et une mise en scène rutilants.
Et ses autres opéras ? Combien d'accessibles sur la Toile ? Quand seront-ils montés sur nos scènes ?
 Une autre mise en scène, moins slave... |
Au cinéma, quatre bons films, tous récents, venus de l'étranger.
On encense partout May December de Todd Haynes, où une actrice rencontre celle dont elle va jouer le rôle et le mari de celle-ci, qu'elle déniaisa quand il était à peine pubère. Film d'une intelligence et d'une finesse indéniables, qui crée le malaise avec talent, alors d'où vient que je n'aie pas vraiment vibré ?
Dans L'innocence de Hirokazu Kore-eda, même chose : personnages fouillés, scenario époustouflant, intelligentissime — trop sans doute ?
Davantage touché par Perfect days, où Wim Wenders suit avec une tendresse discrète l'humble quotidien d'un vieux nettoyeur de chiottes japonais.
Mais mon coup de cœur s'appelle La chimère (2023), de l'Italienne Alice Rohrwacher. Dans la campagne italienne, vers 1980, une bande de pilleurs de sépultures, genre bras cassés ; un Anglais affligé d'un don qui lui fait découvrir les trésors cachés ; des femmes, vieilles ou jeunes, qu'on a toutes envie d'aimer ; une tragi-comédie comme on sait les vivre et les faire là-bas, surprenante à tous les coins de plan, imprégnée d'une poésie, d'une magie intenses.
 Même les statues se font aimer |
Un petit tour en Grèce — il y avait longtemps. Non, pas d'îles au soleil, pas de pêcheur souriant, pas d'evzone fringant, mais l'image ci-dessous dont voici le texte traduit :
Tous ensemble pour exorciser
le démon de l'homosexualité
Veillée de prière panhellénique
Samedi 27 janvier 2024 20h30
dans toutes les églises
Les résultats ne sont pas encore connus.
Cela dit, l'église grecque n'est pas la plus conne du monde (quoique orthodoxe), la concurrence étant rude. Sa cousine de Russie, ces derniers temps, s'est révélée la plus immonde. Heureusement que l'enfer n'existe pas.
 Qu'en pensent... |
Avant de nous quitter, j'ai envie de redire, de crier un grand merci aux Soulèvements de la Terre, à Arrêts sur images, à Médiapart, à la page FB d'André Markowicz et à tous ceux qui sur la Toile ou sur le terrain bataillent pour éveiller les cervelles et les consciences endormies. On se sent grâce à eux moins seul et moins triste. Nous ne serons pas morts sans lutter.
 Sainte-Soline, juin 2023 |
Début mars, en principe, Rivière, Eliade, Bonnard, Saint-Martin, Schuiten-Peteers, Markowicz, Stendhal et Blyton.
 Will, Franquin, Delporte, Macherot, Un empire de dix arpents. |
(réponse sur le numéro de la citation...)
L'intelligence collective est un effort surhumain.
Le contenu des livres change, pareil aux fruits et aux vins qui mûrissent dans les caves.