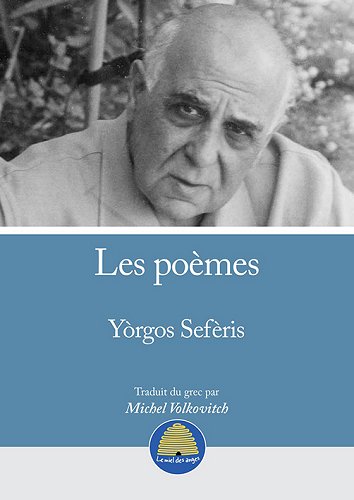
Encore méconnu...
BRÈVES
N°242 Décembre 2023
Ce connard de covid n'a pas frappé que les humains : depuis son passage, la vie culturelle essoufflée n'arrive pas à se requinquer. Naguère, certaines années, j'étais invité ici ou là deux fois par mois en moyenne ; à présent, c'est une fois tous les deux mois.
D'où mon bonheur de retrouver Lyon il y a quelques jours.
La valeureuse association Defkalion, qui se démène là-bas pour diffuser la culture grecque d'hier et d'aujourd'hui, et qui m'a si souvent invité, consacrait cette nouvelle soirée à l'imposant poète Yòrgos Sefèris. Le grand homme a dû attendre plus d'un demi-siècle après sa mort pour que paraisse l'intégrale française de ses poèmes, traduite par mes soins au Miel des anges en avril dernier. Le plus étrange, c'est que l'événement a été salué par un silence assourdissant : jusqu'à ce jour, pas un article, pas une ligne dans la presse écrite, numérique ou parlée ! On croit rêver.
Entre autres poèmes, à Lyon ce soir-là, j'en ai lu un devenu célèbre en Grèce, une fois mis en musique par Theodoràkis :
Sur le rivage de l'îlot
blanc comme la colombe,
quelle soif à midi, sans ombre,
mais saumâtre était l'eau.
Sur la blondeur du sable un nom
très cher avons tracé ;
mais il fut bientôt effacé
par un vent bel et bon.
Désirs et passions partagés,
quel souffle dans nos cœurs
a conduit notre vie ; erreur !
Il a fallu changer.
Dans la belle salle de l'Escale Lyonnaise, bien remplie, il y avait même des jeunes ! Des jeunes pour écouter de la poésie ! Certains ont même acheté des livres ! Divine surprise. Il ne faut jamais désespérer.
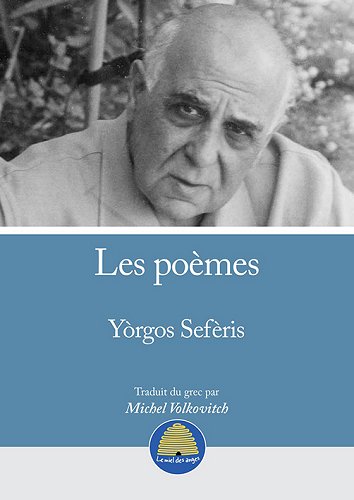 Encore méconnu... |
La Grèce toujours.
Le Miel des anges prépare sa récolte de printemps et sur le reste du front éditorial de beaux projets se précisent, mais n'oublions pas le présent et cette excellente nouvelle : un livre de Nìkos Kokàntzis.
Oui, l'auteur de Gioconda, le livre où il raconte l'amour ardent qu'il vécut en 1943, à seize ans, avec une jeune juive, avant qu'elle ne soit déportée à Auschwitz où elle mourut. Gioconda, parue aux éditions de l'Aube, constamment rééditée, a bouleversé des milliers de lecteurs et fait de l'ombre aux autres écrits de son auteur. Les voici rassemblés, toujours à l'Aube, sous le titre Le vieil homme et l'étrangère : neuf nouvelles et un livret d'opéra où revit l'histoire de Nìkos et Gioconda, sous un éclairage légèrement différent qui enrichit le récit original.
Kokàntzis a été hanté jusqu'à sa mort par celle de sa bien-aimée, dont il ne s'est jamais vraiment remis ; il l'a cherchée dans toutes les femmes qu'il a connues ensuite avant de mourir seul. Les fictions qu'il déroule ici sont comme des échos, plus ou moins directs, de l'histoire vraie ; Gioconda y est présente en filigrane. D'où l'aura supplémentaire qui entoure, aux yeux du lecteur de l'autre livre, le recueil entier, et lui donne sa cohésion.
Elles sont très disparates par ailleurs, ces histoires, et pourquoi s'en plaindre ? Kokàntzis n'a pas voulu faire carrière en littérature, on le voit ici explorer, expérimenter, sans chercher à pousser plus loin, ce qu'on regrette : les textes que nous lisons là tiennent debout tout seuls, même quand on n'y reconnaît pas le fantôme de la disparue ; on y est ému, de façon plus voilée que dans Gioconda, certes ; on y est touché par la finesse de la pensée, la subtile simplicité de l'écriture. La traduction ferme et sensible d'Hélène Zervas, ma coéquipière au Miel des anges, nous restitue intact le charme de l'original grec.
 Le nom de la traductrice est en 1re de couv !!! |
On reste encore un peu en Grèce avec Variations sur la Grèce de Lucien d'Azay. Je ne connaissais pas le nom de l'auteur, et ce livre apparu en juin dernier avait échappé jusqu'ici à mes radars, pourtant braqués sur les publications grecques. Bizarre tout de même : il n'y a donc personne, à l'ambassade de Grèce par exemple, pour noter toutes les parutions concernées et en informer journalistes, blogueurs et lecteurs ?
On lit ces Variations avec des sentiments variés : l'ouvrage est problématique, ce qui tient sans doute à la collection où il figure, aux éditions Cosmopole — dont j'ignorais tout. La quatrième de couv l'avoue ingénument : Le livre «se veut à la fois guide, rêverie et témoignage». Mais comment peut-on conjuguer l'objectivité du guide et la subjectivité de l'écrivain ? Il y a là un fourre-tout boiteux, tiraillé entre information et rêverie, où de brillantes pépites voisinent avec des faux-bijoux.
Les plus belles pages sont d'un poète rêvant sur la topographie du pays :
Cythère, larguée par la Laconie, lance le mouchoir d'Anticythère comme pour attraper en dernier recours les cornes crétoises. Pareil à la main d'Adam au centre de la fresque de Michel-Ange, le Péloponnèse tend avec regret ses promontoires vers l'Orient, auquel il jette une poignée d'archipels en guise d'adieu.
Joli passage, également, sur les temples antiques tournés vers la lumière et les églises byzantines cherchant l'ombre :
L'église byzantine est un lieu de fuite et de repli, un refuge où l'on se prosterne, à l'ombre, la tête enfouie dans les mains comme l'autruche cachant la sienne dans le sable (...) ; c'est le sanctuaire d'une civilisation clandestine, sur la défensive, menacée par les invasions slaves et arabes.
On descend trop souvent de ces hauteurs, hélas, vers des pages blablateuses ou l'auteur se plaît à parader. Il a fait de solides études classiques, ce qui est bien, et aime à le montrer, ce qui l'est moins ; le tourisme cultivé auquel il nous invite privilégie l'histoire ancienne et les chromos sur la Grèce éternelle, pourtant largement connus, sur le pays d'aujourd'hui qu'il ignore superbement, ses aspects pittoresques mis à part. Pratiquement rien sur la vie quotidienne, les poètes, les romanciers, les cinéastes, les peintres... Est-ce encore possible, une chose pareille ?
 Clichés éternels. |
Et maintenant, le contraire : un récit de voyage pertinent.
Deux écrivains et non des moindres, Christian Garcin et Tanguy Viel, qu'on ne savait pas copains, ont fait en 2019 un tour du monde original : Les USA, le Japon, la Chine, la Russie et un bout d'Europe en bateau, en train, en bus, et jamais en avion. Ils ont signé ensemble un journal de bord, Travelling, paru en Points Aventure.
Ils ne font que passer, mais ce récit tout plein de paysages, de rencontres passionnantes et de fines remarques, sonne vrai d'un bout à l'autre. Les États-Unis nous sautent à la figure,
qui prennent soin de correspondre assez parfaitement à leur caricature. Il n'y a pas vraiment, ici, de décalage entre l'image et le réel : le réel, c'est l'image, et vice-versa.
Le Japon est esquissé avec une juste délicatesse :
il fabrique ses intensités par touches et ravissements soudains, à l'image des maîtres zen qu'on voit dans certains films, si placides, si indifférents et qui soudain se révèlent plus vifs que tous leurs contempteurs.
La Sibérie profonde et la Russie en général apparaissent à peu près telles qu'on le craignait :
Comme si un accablement collectif pesait sur le destin de chacun.
À chaque fois, tout se conjugue harmonieusement : la vue d'ensemble et le souci du détail, l'observation du monde et celle de soi. Les longues traversées en cargo ne sont pas la partie la moins riche de l'équipée : nos deux pèlerins les comparent à une retraite dans un monastère, avec ses heures lentes et sereines et la contemplation de l'infini. Car cet art de regarder prend peu à peu, sans ostentation, la dimension d'un art de contempler, de méditer. Courir le monde ou voyager en soi, quelle différence pour finir, puisque nous sommes alors
comme un cavalier mongol dans la steppe qui ondule à l'infini, comme lui devenant poreux à l'immensité du monde et nous laissant traverser par elle, l'immensité devenant alors l'image la plus sûre de notre intimité, qui s'y sera noyée.
 Christian, Tanguy et l'un de leurs cargos. |
Assez bourlingué, posons-nous au sud de l'Angleterre, Sur la plage de Chesil, en 1962, avec Ian McEwan et ses deux personnages. Jeunes et brillants (lui historien, elle premier violon d'un quatuor), ils se sont mariés le jour même et s'apprêtent à consommer ce soir-là. Puceau et pucelle (!), ils appréhendent
cette redoutable épreuve qui paraissait aussi loin de la vie quotidienne qu'une extase mystique, ou que la mort même.
Après le rituel du dîner fin, vient le moment s'y mettre, et l'on nous décrit minutieusement des préliminaires lourds d'angoisse, pour elle surtout. Le french kiss lui donne envie de vomir.
Elle comprenait parfaitement que cette histoire de langues, cette pénétration, n'était qu'une répétition en miniature, un tableau vivant rituel de ce qui l'attendait, tel un de ces anciens prologues de théâtre qui vous annoncent tout ce qui va arriver.
On sent que tout cela va mal tourner, mais la catastrophe sera pire encore que prévu. (Je m'arrête avant de spoiler.)
Mon dieu, quel sujet bizarre. Soixante ans après, il nous semble totalement exotique, limite invraisemblable. Est-ce la raison de ma vague réticence ? Tous autour de moi chantent les louanges de Mr McEwan, et c'est un régal que la traduction exemplaire de France Camus-Pichon, laquelle fut il y a trente ans l'une des meilleures étudiantes que j'aie jamais eues, et pourtant je n'arrive pas à entrer dans l'histoire, tout en admirant le raffinement de l'analyse et la saveur des métaphores. Témoin celle-ci, tandis que l'épousée passe dans la chambre du sacrifice :
En changeant de pièce elle avait plongé dans un état irréel, inconfortable, aussi encombrant qu'un vieux scaphandre en eau profonde.
Je dois dire tout de même que les dernières pages, où soudain l'histoire décolle, emportent toutes les réticences et vous laissent rêveur.
 Trop compliqué... |
Jacques Perret, lui, n'est pas à la mode. Le lit-on encore un peu ? Il est vrai que ses prises de position ultra-droitières (Algérie française, garde-à-vous devant le trône et l'autel), qui ne se sont pas arrangées avec l'âge, lui ont aliéné beaucoup de monde. Chose curieuse, elles n'ont guère pollué ses grands livres (Le caporal épinglé, Bande à part, La bête mahousse...) que je lus autrefois sans me douter de rien, avec délices.
Perret était un styliste éblouissant, de ceux qui savent transformer le récit d'une soirée-loto dans une EHPAD à Maubeuge en feu d'artifice narratif et verbal. Articles de sport (Julliard) rassemble les textes qu'il consacra, sportif lui-même, à divers sports : rugby, boxe, voile et surtout cyclisme. Tout n'est sans doute pas de la même eau dans ce gros bouquin, mais ce Perret journaliste, le plus souvent, caracole sur les mêmes sommets que Perret l'auteur, avec une verve infatigable et une ironie pétillante.
Son registre d'élection : l'héroï-comique. Le cyclisme s'y prête admirablement. Les Tours de France qu'il a suivis entre 1937 et 1958 servent de tremplin à des envolées homériques ; il est dans la même échappée qu'Antoine Blondin, qui ne le bat que de justesse au sprint.
[Les coureurs] se recueillaient avant d'aborder les Pyrénées, comme de preux chevaliers à l'approche de Roncevaux, et je pense qu'ils méditaient sur le sort de Roland qui, pour son malheur, avait décollé du peloton de tête.
Le Ventoux, sur qui soufflait un vent épique, se hissait tout naturellement au rang d'Olympe.
Berrendero, le grimpeur, a chaussé les cale-pieds de Mercure ; Borée lui-même a gonflé les boyaux de Vervaecke ; Jaminet, frappé de clous au derrière, gémit comme Prométhée, enchaîné à son vélo.
Les Six-jours, sous sa plume, acquièrent une dimension cosmique, avec leur rotation perpétuelle et
la morne constance d'un mouvement astronomique ou nucléaire. Un peloton d'astéroïdes en gravitation sur l'espace courbe, une pincée d'électrons bigarrés éternellement fidèles à leur noyau.
Le talent étincelant de ce grand dilateur de rate nous ferait presque oublier son scrogneunisme politique, ou du moins le considérer comme une pittoresque lubie ; après tout, ce n'était pas un méchant, un violent, semble-t-il. Quant à la minceur apparente du sujet de ce recueil :
Applaudir un chanteur ou un sprinter, greffer des roses, tourner le madrigal, disputer le sexe des anges, peigner la girafe tandis que les prophètes annoncent la fin du monde, voilà des préoccupations qui honorent la condition humaine.
Et que fais-je d'autre ici, de même que mes lecteurs éventuels, tandis que lentement notre monde est en train de sombrer ?
 Jacques Perret. |
Voilà qu'un instant du passé s'incruste dans la mémoire comme un éclat de lumière qui vous parvient d'une étoile que l'on croit morte depuis longtemps.
C'était la période la plus incertaine de ma vie. Je n'étais rien. Jour après jour, j'avais l'impression de flotter dans les rues et de ne pas pouvoir me distinguer de ces trottoirs et de ces lumières, au point de devenir invisible.
J'ai gardé pour la fin du défilé en prose La danseuse de Patrick Modiano, son plus jeune livre, chez Gallimard comme de coutume. Et je l'ai laissé parler d'abord car je ne sais pas quoi en dire. D'abord je serais incapable de le résumer : il y a une danseuse et plusieurs hommes autour d'elle, dont le jeune narrateur, cela se passe à plusieurs époques, on saute sans cesse de l'une à l'autre, je m'y perds et l'auteur n'en serait sans doute pas fâché, lui qui fait dire à son narrateur, vers la fin du livre, que les personnages à présent disparus, soudain, n'appartenaient plus au passé mais à «un présent éternel». Comme si Modiano écrivait là, au sommet de son art, avec la maîtrise la plus discrète, la plus extrême finesse de touche, son Temps retrouvé à lui.
C'est un ballet d'ombres, de revenants, baignant dans une lumière crépusculaire comme toujours, empreint de mélancolie, mais à peine ai-je écrit ces mots que je me dis non, il y a en même temps dans ces pages une lumière douce, une joie diffuse, comme ces bouffées de bonheur à la fin d'autres de ses livres, mais disséminées ici partout, comme si la légèreté de la danseuse avait gagné le narrateur et le récit tout entier, et moi le lecteur en plus.
Je ne sais pas si c'est là le meilleur de ses romans, mais combien de livres, parmi les siens et ceux des autres, m'ont mis comme celui-ci en état d'apesanteur, m'ont à ce point serré et dilaté le cœur en même temps, m'ont donné un instant l'illusion que le malheur n'existait plus ? Comment fait-il, décidément, ce discret magicien ?
 Femme légère. |
J'avais vingt ans quand j'ai commencé à lire le tout jeune Modiano, vingt ans aussi en découvrant le poète Patrice de La Tour du Pin, dont le nom à lui seul est un poème. En rouvrant le vieux volume de Poésie/Gallimard, La quête de joie, acheté en avril 68 (c'est écrit dessus), et je retrouve en relisant les premières pages l'émerveillement juvénile d'alors :
Les bois étaient tout recouverts de brumes basses,
Déserts, gonflés de pluie et silencieux ;
Longtemps avait soufflé ce vent du Nord où passent
Les Enfants Sauvages, fuyant vers d'autres cieux,
Par grands voiliers, le soir, et très haut dans l'espace.
(...)
Et je me dis : je suis un enfant de Septembre,
Moi-même, par le cœur, la fièvre et l'esprit,
Et la brûlante volupté de tous mes membres,
Et le désir que j'ai de courir dans la nuit
Sauvage, ayant quitté l'étouffement des chambres.
Le poète a grandi dans le château familial en Sologne, au milieu des bois et des marais qui vont hanter sa poésie, une poésie où description et confession sont un départ vers une méditation de haute volée, dès le début imprégnée de foi religieuse, et l'on est stupéfait d'apprendre que l'auteur de ces premiers poèmes si mûrs, si profonds était un jeune homme de même pas vingt ans, en même temps obsédé par
Les désirs qui brûlent jusqu'à vous tordre
Le ventre en deux, dans un spasme impuissant.
Dès le début ses poèmes sont pleins de visions, d'anges, de revenants, de prophètes,
Ses yeux me fascinaient d'un éclat irréel,
De ce soleil secret dont brillent les archanges
Et les initiés aux rythmes éternels...
La quête va se poursuivre, exigeante, mue par une «haute soif de connaître» ; la fièvre du début va s'assagir, mais pas la ferveur ; la poésie va se teinter de philosophie, le poète semble même désavouer par moments «la brume du poème» — en se gardant bien de délaisser ce qu'il condamne — ; le poème peu à peu se fait prière et c'est alors que je quitte respectueusement le temple sur la pointe des pieds.
 Le château du Bignon, la demeure familiale. |
Pas besoin de croire au paradis pour tenter de rencontrer les morts. Le héros du Labyrinthe inachevé, BD du Canadien Jeff Lemire (Futuropolis) ne se remet pas d'avoir perdu sa fille dix ans plus tôt et s'éloigne peu à peu des vivants qui l'entourent, quand un mystérieux message le persuade que sa fille l'attend dans un lieu qu'il doit deviner. Il la recherche obstinément, désespérément, dans les coins les plus sinistres de la grande ville, et l'on ne sait si la retrouvaille finale est vécue ou rêvée, mais l'homme, pour finir, va renouer le lien avec les vivants. Réalisme et fantastique se seront tenu la main tout au long de cette histoire poignante, où un dessin merveilleusement expressif donne vie à une merveille de scénario.
 Will et sa fille retrouvée. |
Au cinéma, rien que des primeurs.
L'enlèvement de Marco Bellocchio, salubre critique du papisme, grandiose comme de l'opéra, nous éblouit par ses beaux décors, ses beaux visages et ses scènes spectaculaires, mais dès le lendemain le film a rapetissé.
À part ça, quatre films français sur lesquels plane, plus ou moins, l'ange du bizarre et qui tiennent le coup dans le souvenir.
Le théorème de Marguerite, d'Anna Novion, avec sa charmante et un peu folle idylle entre deux matheux de compétition.
La fiancée du poète, aussi doucement et délicieusement déjanté que sa metteuse en scène, Yolande Moreau.
Polar Park, série policière délirante signée Gérald Hustache-Mathieu, où un auteur de polars en panne et un gendarme rigide affrontent une suite de crimes tordus menant à une découverte renversante. Sacré scénar là aussi. Un régal.
Enfin, Vincent doit mourir, de Stéphan Castang, premier film saisissant, où une mystérieuse épidémie frappe (c'est le cas de le dire) l'humanité : certaines personnes déclenchent au premier regard une fureur meurtrière chez les autres. La violence, la folie collective, les parias persécutés : on n'est pas loin du Règne animal le mois dernier... et de notre société malade. Le tout, filmé de façon sûre et efficace, est d'une force terrifiante.
 Karim Leklou et sa chienne. |
Non, rien à dire sur les horreurs de Gaza, puisque la réaction la plus humaine, la plus juste — hurler sa colère aux dirigeants fous des deux bords et pleurer avec les victimes des deux côtés — risque de faire s'abattre sur nous, comme toutes les autres réactions, des torrents d'invectives. Combien d'entre nous sont-ils restés sains d'esprit ?
Mince consolation : cet incendie violent détourne un instant nos yeux d'une mort à petit feu moins brutale, mais plus générale et plus terrible encore : celle de notre planète, que les députés européens, pelotés par les lobbys, viennent d'accélérer un peu plus. Celui qui oserait réclamer la destitution et la déchéance de leurs droits civiques pour tous ces criminels passerait aujourd'hui pour un excité ; dans cinquante ans, il aura sa statue, et mes petits-enfants, je l'espère, viendront se recueillir devant elle à ma place.
Mais pour l'instant, lisons heureux, en attendant notre mort à tous.
 Il s'engraisse, il nous tue. |
En janvier ? Montesquieu, Menasse, Bisiaux, Bourliaguet, Robin, Laurain, Trondheim et quelques Suisses.
 Will, Franquin, Delporte, Macherot, Un empire de dix arpents. |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Exiger la compétence est le fait des esprits bornés. Il faut savoir donner la parole aux ignorants qui, forts de leur ignorance, peuvent s'engager hardiment et sans préjugés vers des points de vue extravagants d'où se découvriront des perspectives insoupçonnées.
Qui ne donne rien n'a rien. Le plus grand malheur n'est pas de ne pas être aimé, mais de ne pas aimer.