
Dans les années 70.
BRÈVES
N°232 Février 2023
Des arbres géants
couverts de fleurs de sang
rampent vers moi
je voudrais fuir mais je ne peux pas
je pousse un grand cri
je me réveille dans mon lit
mes mains tremblent
je n'y peux rien j'ai peur de la nuit
Mais quaaand le matin... etc.
C'est une chanson qui eut son heure de gloire dans les années 60. On ne sait trop qui créditer pour les paroles : Éric Charden, Gilles Thibaut, Monty ? Peu importe, c'est du bon boulot, ça tient le coup. J'aime beaucoup la syllabe longue sur «gééé-ants», et la musique ne manque pas d'allure avec son couplet nocturne qui piétine, tourne en rond, suivi d'un refrain diurne éclatant.
Le chanteur ? Claude François, voyons !
Ce type me fascine. Comment a-t-il pu envoûter le bon peuple avec sa vilaine voix de canard, et se faire idolâtrer à ce point, lui qui fut, de l'avis général, un mec puant ?
Je l'avoue : je me suis surpris plusieurs fois, ces dernières semaines, à visionner «Mais quand le matin» sur dailytube avec entrain. Il faut reconnaître que le petit salopard était un fameux danseur, que ses guiboles font oublier son larynx et qu'avec ses danseuses pulpeuses il offre un show étincelant. Emballé que je suis, étonné de l'être.
 Dans les années 70. |
On n'attendait sans doute pas le Cloclo de ces dames dans ces pages vouées à la haute culture. C'est le moment de rappeler qu'il y a de tout dans la culture populaire, du mauvais et du bon, des tâcherons et des artisans inspirés — de même que dans les œuvres dites sérieuses on trouve aussi du déchet. Sauf que le déchet prétentieux en impose davantage.
On ne s'arrête pas en si bon chemin : place à...
Marc Lévy !
Pourquoi diable ai-je décidé de lire son petit dernier, Éteignez tout, la vie s'allume, de chez Robert Laffont ? Ouverture d'esprit, saine curiosité, ou volonté malsaine de ricaner aux dépens de ce qu'on va sûrement trouver ringard ?
Je n'ai pas la réponse.
J'ai lu jusqu'au bout ! Un jeune homme et une femme bien plus âgée se rencontrent sur un bateau. Elle est maître-horloger itinérante, et lui organiste vagabond. Ils affrontent ensemble des péripéties qui les rapprochent, oublié lesquelles. Je me souviens seulement qu'elles sont toutes aussi improbables que les professions respectives des deux héros et que leur psychologie gravement rudimentaire. L'invraisemblance a un charme, parfois subtil, et il serait bon d'étudier pourquoi celles de ce roman tombent à plat.
Oublié aussi comment ça se termine. Ont-ils consommé ou non ? Ce qui me restera de ce livre, c'est uniquement les réflexions philosophiques récurrentes dont ces pages sont constellées.
Les souvenirs qui se conjuguent au présent engendrent une nostalgie.
Le destin n'est rien d'autre que la somme des choix que l'on fait.
Les amants sont des écrivains, leur encre c'est la vie, leur papier c'est la peau...
La vie devient si différente dès que l'on ouvre les yeux, et que l'on tend l'oreille.
À la façon dont les gens se recueillent, on distingue les vraies peines des chagrins de circonstance.
Il y a tellement de choses que l'on ne sait pas sur soi-même.
Si on fait un effort, on se rend compte que partager ce qui vous pèse sur le cœur, le rend plus léger.
Avoir la nostalgie d'une époque vous fiche un coup terrible.
C'est important de préserver la mémoire, le souvenir des moments calmes qu'on a vécus dans des vies qui ne le sont jamais, parce que là, on arrache un peu de temps à l'éternité.
Dans une vie, il n'y a pas de bonheur sans risque.
Quand l'imagination rencontre la réalité, ça fait parfois des dégâts.
Voilà que s'ouvre devant nous le chemin vers la sagesse.
Blague à part, il suffirait de pas grand-chose pour sauver certaines de ces sentences, dont le contenu n'est pas nécessairement idiot. Qu'est-ce donc qui les rend cucul à ce point ? Encore un sujet d'étude pour plus tard.
 Couvert de femmes, tout comme Cloclo... |
Encore de la provoc, ronchonnera-t-on, dans cette transition acrobatique de monsieur Lévy à monsieur Barrès. Elle obéit pourtant à une certaine logique : dans les deux cas, j'aborde pour la première fois, par goût du risque et amour du paradoxe, un auteur qui ne m'attire en rien.
Un jardin sur l'Oronte, 1922, le chant du cygne de Maurice Barrès, disponible en Folio. Au XIIIe siècle, du côté du Liban, un grand amour entre un jeune chevalier chrétien, brave et franc au double sens des deux termes et une princesse musulmane bien roulée mais manipulatrice, autoritaire, cupide et fausse. Ah, ces mahométans... Amours passionnées, trahisons et batailles se succèdent dans un Orient de carte postale, au fil de pages semées de métaphores plus fleuries que les somptueux jardins de l'émir.
Cela commençait plutôt bien pourtant :
Pourquoi me trouvais-je ce jour-là dans cette ville mystérieuse et si sèche d'Hamah, où le vent du désert soulève en tourbillons la poussière des Croisés, des Séleucides, des Assyriens, des Juifs et des lointains Phéniciens ?
Et l'on peut trouver goûteuses les dames du harem qui
s'étaient rapprochées, comme des biches si l'on apporte à l'une d'elles un gâteau, et se tenaient maintenant immobiles autour de leur reine, comme les pétales de la tulipe autour de son cœur noir.
Ensuite, l'auteur s'échauffant, ça se gâte :
Toutes ses pensées, autant de barques qui sillonnent la mer profonde et dont les voiles paraissent ou disparaissent sur l'horizon ; un souffle du ciel les balaie, et seule subsiste une mer de douleur, éternellement mouvementée par l'espérance.
Votre amitié m'est plus douce que le ciel pur apparaissant après l'orage.
N'es-tu pas l'artère qui nourrit mon cœur ?
Grand styliste, Barrès ? Enchanteur à la Chateaubriand ? Ses phrases sirupeuses ont pour moi un goût de friandise orientale d'où dégouline le miel, et je ne suis guère enchanté en lisant, par exemple — dans un dialogue en plus :
Plût au ciel que je ne fusse venu dans Qalaat, que jamais cette voix menteuse n'eût exercé sur moi sa puissance magique !
 Il avait même séduit Jeanne d'Arc ! |
Nettement plus poivré, voici un sacré roman, L'homme-dé, de Luke Rhinehart, aux éditions des Forges de Vulcain. L'histoire d'un homme qui décide un jour de jouer aux dés toutes les décisions qu'il doit prendre. D'où une série de péripéties souvent bizarrissimes, allant de la catastrophe au succès imprévu.
La grande force de ce livre, c'est qu'il surprend, déroute, met mal à l'aise. D'abord, le héros du livre porte le nom de l'auteur, on se croit parti dans l'autobiographie et peu à peu on s'aperçoit que non, impossible, c'est trop fou — à moins que... ? Surtout, que pense-t-il de ce recours aux dés, l'auteur planqué derrière son personnage, qui — semble-t-il, prend l'affaire tantôt à la blague, tantôt au sérieux ? On se sent déboussolé. L'auteur ne respecte rien. Son bouquin-brûlot remet en cause les fondements mêmes de la société actuelle avec un cynisme dévastateur, une dérision mi-réjouissante, mi-inquiétante.
Échantillon :
Freud était un très grand homme, mais j'ai comme l'impression qu'il ne s'est jamais très bien fait astiquer la queue.
— J'ai abandonné le yoga... — Pourquoi ? — Ça me rend nerveuse.
Un psy : — Je m'ennuie. J'en ai marre de voir des gens malheureux à qui j'apprends à s'ennuyer comme tout le monde.
Nous nous sommes mariés : la solution que propose la société aux problèmes de la solitude, de la luxure et de la lessive.
On regrette un peu que l'auteur, emporté par sa verve, tire un peu à la ligne. Les dés auraient dû lui en faire couper un bon tiers, mais après tout la démesure fait partie du jeu, ces 500 pages grouillent de moments jouissifs et elles n'ont pas volé leur statut de livre-culte, idole des diverses tribus libertaires, et précieuse nourriture pour tous.
 Luke Rhinehart |
Sous le signe du jeu, toujours, et de l'étrangeté radicale, ceci :
Veux-tu jouer à la pirouelle
à la redouble au rat musqué
veux-tu jouer à la sauguette
au goligode au ziponblé
veux-tu jouer au jeu de l'ange
à l'œil-au-dos au mort parlant
veux-tu jouer à cache-mésange
à mouton-bêle à baille-au-vent...
Cette liste de jeux, inventés sûrement, qui s'étend sur deux pages, c'est un poème du trop peu connu André Frédérique. Noël Arnaud l'accueillit en 1958 dans son anthologie des charabias, galimatias et turlupinades, intitulée Kouic, reprise et augmentée récemment par Patrick Fréchet aux éditions du Sandre. Sont réunis là des textes de genres et d'époques très divers, dont le point commun est d'être écrits dans une langue trafiquée, voire inventée.
Il y a là un générique de rêve, allant de Rabelais à Queneau en passant par Clément Janequin (lequel parle oiseau dans son Chant des oyseaulx), Cyrano de Bergerac, Sade, Fargue, Norge, Leiris, Ionesco, Michaux... L'ensemble est inégal, un peu longuet, les textes en langue inventée lassent vite, mais quel plaisir d'admirer certains de ces jeux avec la langue, comme celui du chevalier de Piis, qui donne en 1785 une Harmonie imitative de la langue française. Extrait :
À l'aspect du Très-haut sitôt qu'Adam parla,
Ce fut apparemment l'A qu'il articula.
Balbutié bientôt par le Bambin débile,
Le B semble bondir sur sa bouche inhabile...
Jouissif aussi, le sonnet argotique de Desnos écrit en 1944 à la gloire de certain maréchal :
Maréchal Ducono se page avec méfiance,
Il rêve à la rebiffe et il crie au charron
Car il se sent déjà loquedu et marron
Pour avoir arnaqué le populo de France.
Jeux délectables, et plus sérieux qu'ils n'en ont l'air. Noël Arnaud, dans sa lumineuse préface, montre bien comment toutes ces secousses imprimées à la langue lui font du bien, la revitalisent ; combien, face à la «grande paralysie du langage français» qu'imposa le XVIIe siècle, où l'on vit conjointement «l'immobilisation de la langue et le renforcement du pouvoir royal», contre l'hégémonie du langage «uniforme et sage, (...) normalisé, standardisé», quelques précieux hurluberlus participent à une rébellion salutaire en donnant vie ainsi à «la grande liesse des mots».
 Non seulement marrant... |
Peut-on lire un polar pour sa langue ? Oui, parfois. Tous ne sont pas écrits à la kalach. Jean-Patrick Manchette, par exemple, est un maître, avec sa langue au cordeau, sans graisse, avec juste des menues saccades, bouffées de gouaille familière ou pointes de préciosité.
Il rend l'automatique à son propriétaire. Le rire le secoue encore.
— Quand l'opération sera terminée, dit-il, j'aimerais que vous m'en fissiez don.
— C'est comme Votre Excellence le désire, hasarde le truand, que l'imparfait du subjonctif momentanément démonte.
Oufiri hoche d'un air avunculaire.
On comprend que Manchette ait servi un temps de grand-frère à Echenoz, ouvrant une porte où son cadet s'est engouffré.
L'affaire N'Gustro date de 1971, six ans après la mort de Ben Barka, qui s'en inspire de près. L'histoire est tendue elle aussi, et noirissime. «C'est un livre abominable, dit Manchette lui-même. Il n'y apparaît que la vilenie des gens.» Le narrateur est l'exact opposé de l'auteur : cette infecte crapule, facho, sado-parano, qui de coups tordus en coups fourrés finira par se faire flouer puis abattre, acquiert mine de rien une belle épaisseur psychologique, et Manchette parvient même, sans pour autant ralentir l'action, à glisser dans son polar des réflexions sur l'existence aussi savoureuses que désabusées.
Décidément, j'aime Manchette. Je goûte peu les orgies d'alcool et de violence, même dans les livres, la mention du nom des armes employées ou des morceaux de jazz qu'on entend m'agace, et ici je suis servi, mais peu importe, j'oublie tout quand je lis, par exemple :
L'Amiral s'avance vers moi. Sa démarche évoque le vacillement des temples en proie aux premières trémulations séismiques, dans quelque début de cataclysme antique.
 Himself. |
De Manchette je crois avoir lu l'essentiel, aurai-je le temps de mieux connaître Kipling ? Ce grand nouvelliste a laissé plusieurs recueils en plus des célèbres Histoires comme ça.
Ce mois-ci, lu quatre ou cinq nouvelles de lui — relu en fait, j'avais oublié... «L'homme qui voulut être roi» d'abord, cette terrible histoire de deux aventuriers minables qui réussissent à se faire aduler par des villageois crédules, avant d'être massacrés par eux à cause d'une histoire de femme. Mais cette fois-ci c'est une autre nouvelle qui m'a séduit : «Le pousse-pousse fantôme». Un homme plaque une femme pour une autre, Kitty, qu'il épouse, la délaissée meurt de chagrin, mais bientôt son fantôme réapparaît, passant dans un pousse-pousse que l'homme est seul à voir. Elle lui parle, mais — c'est là l'idée géniale — sans colère, avec douceur, elle implore, et c'est plus terrible ainsi.
La raison de l'homme vacille ; par moments
il me semblait que le pousse-pousse et moi étions la seule réalité dans un monde d'ombres, que Kitty était un fantôme, que Mannering, Heatherlegh et les autres hommes et femmes de ma connaissance étaient tous des fantômes, et que les grandes collines grises elles-mêmes n'étaient que des ombres illusoires, conçues pour me torturer.
Sa femme le quitte et il meurt.
Là aussi, une catastrophe liée à une femme...
Kipling écrivit cette histoire à vingt ans, on peine à le croire.
Trouvé dans une édition scolaire du Livre de Poche cette traduction, qui me plaît fort, due à mon amie Marie-Françoise Cachin.
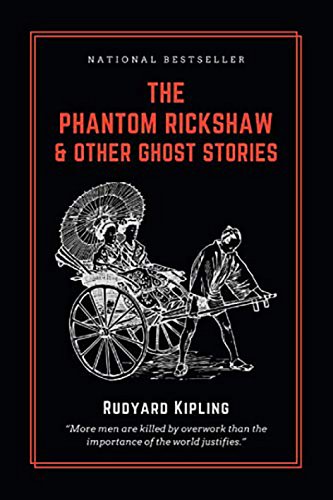 Une édition anglaise |
Et voici le rendez-vous mensuel avec ce cher bon vieux Feydeau. Place au Dindon, créé en 1896, où l'auteur apparaît en pleine forme. Ce serait, dit-on, sa pièce la plus coquine, et son acte II trépidant, tourbillonnant, où péripéties et quiproquos s'accumulent au point de laisser le spectateur — et même le lecteur — hors d'haleine, est l'un des moments les plus déments d'une œuvre pourtant balayée tout entière par un grand vent de folie.
Sous-entendus grivois et répliques d'anthologie pullulent, comme cette émouvante déclaration d'un homme à qui la femme qu'il convoite reproche ses infidélités :
Il n'y a qu'une femme qui compte à mes yeux, il n'y en a qu'une, c'est vous ! Qu'importe l'autel sur lequel je sacrifie si c'est à vous que va l'holocauste !
Quant à
Vous voudriez que nous caltassions ?,
Queneau s'en est souvenu dans son fameux «Il demanda qu'on lui foutît la paix».
 Ça commence à chauffer... |
Le volkonaute, futé personnage, l'a sûrement remarqué : cette revue des lectures du mois suit une subtile progression du décevant à l'épatant. Mais avant d'aborder les deux plus grands bonheurs de janvier, faisons une courte pause avec une autre déception : Dernier week-end de janvier, BD signée Bastien Vivès, chez Casterman.
L'auteur vient de faire parler de lui assez vilainement, ses ouvrages volontiers provocateurs sont accusés d'encourager la pédophilie. Cela ne m'empêcherait guère, je l'avoue, de saluer cet album-là pour peu qu'il soit irréprochable. S'il fallait jeter au feu les œuvres de tous les salopards, ça laisserait un sacré vide, et je ne vais pas cesser d'écouter Gesualdo, par exemple, sous prétexte qu'il a trucidé sa femme.
Il se trouve, hélas, que le week-end en question n'en finit pas, étirant sur 180 pages, avec une flopée d'images inutiles comme dans les mangas — quelle plaie, ces mangas — une banale histoire d'adultère-éclair lors des rencontres d'Angoulême dans le milieu peu excitant des bédéastes, le tout grossièrement dessiné, dans un déprimant camaïeu de gris. Triste fin janvier, vivement février...
 Un bout de la couv. |
Mes deux bonheurs du mois ne font pas la une des gazettes.
Anne Maurel, dans La fille du bois (Verdier), part sur les traces de son grand-père. Il revint abîmé de la guerre de 14, elle l'a connu mais il ne lui a jamais rien raconté de ses combats — à part une scène, un chien pissant sur un cercueil, dérisoire. Restent des souvenirs d'enfance infimes, quoique d'une précision extrême.
C'est à peine si je raconte une histoire : je cherche, le plus souvent, à mettre des mots sur de furtives survivances.
Des images à quoi d'autres images se raccrochent, tissant des liens entre les choses, entre soi et les choses, esquissant
un accord fortuit avec les choses autour de moi.
Évoquant les promenades avec le grand-père, l'auteure imagine qu'à la vue des animaux sauvages détalant,
sans doute sentait-il la même intensité, la même vivacité, la même endurance que celles qu'il avait eues et vues avoir aux soldats dans leur jeu avec la mort.
Un autre jour :
Il se baisse pour ramasser des champignons. Accroupi au pied d'un arbre, je le crois avalé par la terre. Son pantalon est du même brun fort que le tapis d'humus et de feuilles mortes noircies par la pluie, son gilet du même gris que le lichen sur l'écorce des arbres. Il a pris les couleurs du bois. Ses formes se sont dissoutes.
Magie minuscule mais profonde.
Ce livre discret va bien au-delà du récit autobiographique. Il cherche et installe une autre façon d'être au monde, ses petites histoires familiales sont une porte étroite ouvrant sur une immensité. Il nous parle à mi-voix, mais cette voix n'en finit pas de résonner.
 «Il a pris les couleurs du bois.» |
Pour finir, voici — non, revoici — le poète Christian Ducos, un habitué de ces Brèves. Cette fois, cependant, je ne reçois pas une plaquette, mais cent pages, certes aérées, où la peinture s'associe à la poésie. Aux éditions du Pauvre songe, Tableaux/Poèmes : douze toiles de divers peintres (Caravage, Rembrandt, Hokusaï, Gauguin, Cézanne, Klee, Klimt, Morandi...) accompagnées d'un poème où le commentaire s'épanche en méditation. Nombre de pages variable, sur chaque page trois tercets plus brefs encore que des haï-ku.
Le poème le plus impressionnant tourne autour de La chaise de Vincent (Van Gogh), dans un lent et patient effort pour percer son secret :
la chaise écoute
qui l'invoque
envoûte qui l'invoque
(...)
en silence elle observe
le silence
qui l'observe
(...)
comment peindre
autant d'espace
dans si peu de chaise
(...)
prisonnière d'elle-même
ses barreaux ne gardent
que le vide
(...)
au fil des jours la chaise et moi
plus ou moins chaise
plus ou moins moi
Le langage concentré à l'extrême, les sonorités souvent répétées, non par jeu clinquant mais dans une approche humble, patiente, piétinante, où la tautologie dit en même temps la présence massive et impénétrable de l'objet.
Peu de poésies sont à ce point contemplatives, dans le dénuement et la plénitude à la fois. On retient son souffle. Presque sous hypnose. On se dit qu'on va enfin savoir, peut-être, regarder.
Merci Christian Ducos.
 La fameuse chaise de Vincent. |
Au cinéma ? Mois pauvre : deux films seulement, mais mois riche, car ces deux-là, tous deux récents, valent de l'or.
Anne Maurel a-t-elle vu Vivre, film british d'Olivier Hermanus, qui reprend l'argument du film homonyme d'Akira Kurosawa ? Si oui, elle a dû l'aimer. Un vieil homme rigide, apprenant qu'il va mourir, change de cap, apprend in extremis à goûter l'existence et vit avec une jeune femme une belle histoire d'amour ou plutôt de tendresse, le tout filmé avec une pudeur et une délicatesse rares.
Je doute que Christian Ducos ait pu voir Poet, film kazakh de Darezhan Omirbayev, qui a bien vite quitté l'affiche. Cette histoire d'un poète de là-bas qui vivote sans lecteurs, sans autre lumière que sa foi dans les mots, est filmée avec un dépouillement et une intensité dignes d'un Bresson. Est-il plus beau compliment ?
Dans la grande salle déserte d'une ville de province où le poète est invité, il y a tout de même UNE spectatrice ! Ce qui rejoint mes observations personnelles de traducteur, d'écrivain et de prof : il y a toujours quelqu'un qui écoute, même si on ne le voit pas. Et moins ils sont à nous écouter, plus c'est émouvant.
On se sent riche alors. Et on repart de plus belle.
 Tête-à-tête |
En mars, retour de Nadeau ! On évoquera aussi Weiss, Aymé, Levé, Feydeau, Moulin et quelques nouvellistes anglais.
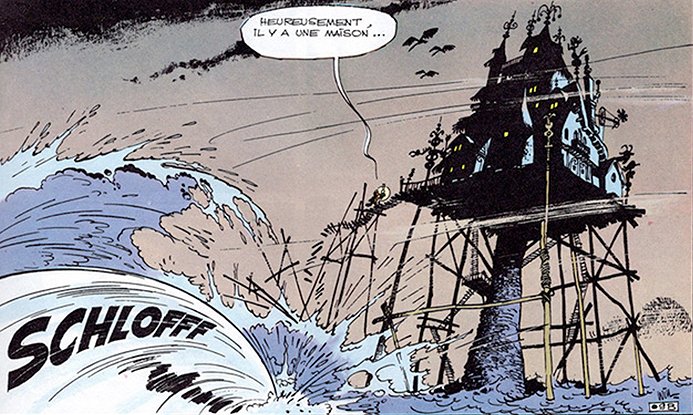 www.lesentierdugrandparis.com Will, Franquin, Macherot, Delporte, Les maléfices de l'oncle Hermès |
(réponse sur le numéro de la citation...)
J'ai compris alors, à force de fouiller dans ma mémoire, que la modestie m'aidait à briller, l'humilité à vaincre et la vertu à opprimer.
On peut trahir sans se sentir traître. Et même, avec un peu de métier, en allant jusqu'à se persuader que c'est l'autre qui l'est.