
Dédramatisons...
BRÈVES
N°209 mars 2021
Ainsi donc, récemment, des Noirs de la mouvance dite décolonialiste (ou déconnialiste ?) ont déclaré la guerre aux visages pâles. Parallèlement, des féministes pures et dures exigent ces derniers temps, non pas l'égalité avec les hommes, mais la supériorité de la femme sur l'autre sexe. Chloé Delaume, la Grande Châtreuse, décrète :
Reconnaître la possibilité de détester les hommes, c'est reconnaître la violence de leurs privilèges. (...) Cette brutale poussée féministe est saine et nécessaire. Pour ouvrir les portes qui restent fermées, des coups de bélier doivent être portés.
Suis-je le seul à sourire en voyant la héraute de la misandrie recourir innocemment, la pauvrette, à l'image macho du bélier ?
Il est triste de constater que l'anti-racisme vire parfois au racisme, et que côté cellules grises, certains Noirs ne valent pas plus cher que les Blancs, mais pas de panique : l'opprimé qui devient oppresseur, c'est un grand classique, on fait avec. Quant aux fureurs des coupeuses de couilles — sans doute ultra-minoritaires —, elles n'ébranlent en rien ma conviction que les femmes, globalement, sont meilleures que les hommes. Moins violentes, par exemple — bien souvent. Restons vigilants, mais ces débordements marginaux devraient le rester, dans ce pays du moins. On n'est pas aux USA tout de même.
 Dédramatisons... |
Ce qui m'amène à Martin Winckler.
A priori, Winckler ne peut qu'attirer ma sympathie avec son pseudo (hommage à Perec), son éditeur (l'excellent P.O.L) et son best-seller, La maladie de Sachs, chronique chaleureuse du quotidien d'un médecin de campagne, que je n'ai pas lu mais dont le grand Michel Deville a tiré un très beau film. J'ai donc sauté sur Ateliers d'écriture, publié l'an dernier chez P.O.L. L'atelier d'écriture, ça me concerne, je pratique ce sport depuis trente ans. La visite chez le collègue va sûrement m'apprendre des choses.
Eh bien non. D'abord, une bonne moitié de ce fort volume (400 pages !) nous donne à lire des textes brefs de Winckler lui-même — ce genre de textes pas mauvais, pas très bons non plus, oubliés sitôt lus. Quant à la partie atelier, elle se borne à des conseils bateau qui enfoncent une porte ouverte après l'autre, sans aborder de façon concrète le travail d'écriture lui-même, sans présenter le moindre texte des participants, l'auteur préférant nous confier les siens et détailler complaisamment sa carrière. Je gribouille d'habitude un tas de trucs à la fin du livre ; ici, presque rien. En revenant de la cueillette, mes paniers sont vides.
Conseil du maître :
Au cours de ce premier jet, ne vous souciez pas de l'orthographe, de la grammaire ou du «style». [Ce travail sur les mots et la grammaire] est secondaire à la construction du texte.
Autrement dit, le texte est un contenu auquel on donne ensuite une forme ; un corps nu qu'on habille. Le conseil semble de bon sens, il a une part de vérité, mais je crois qu'une page écrite ainsi ne volera jamais très haut. Le malentendu entre Winckler et moi est inévitable : nos approches sont trop différentes. Il nous dit quoi écrire, et moi je me demande comment l'écrire. Il dissocie le fond et la forme, qui pour moi ne font, ne forment qu'un.
Mais ce n'est pas tout. À ma déception s'ajoute le malaise. Sous prétexte que les ateliers d'écriture attirent essentiellement des femmes (les hommes ont le foot à la télé, ou s'ils écrivent ils n'ont rien à apprendre), Winckler s'adresse uniquement, tout au long du livre... à des lectrices ! Chères écrivantes par-ci, chères amies par-là... Non, je n'en fais pas une affaire personnelle, je n'ai aucune vanité de mâle, je m'avoue simplement perplexe devant cette discrimination dont l'absurdité confine à la violence. J'imagine qu'une femme normale en sera autant gênée que moi.
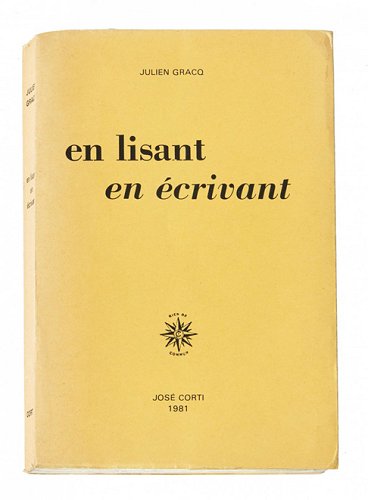 Meilleure idée... |
Jean-Jacques Rousseau m'a-t-il déçu lui aussi ? Pas vraiment, mais...
Les rêveries du promeneur solitaire, dans mon souvenir, sont un enchantement, un long rêve heureux illuminé, irrigué par la célébrissime Cinquième promenade, où le vieil homme revit les journées passées naguère coupé du monde sur une petite île d'un lac suisse. Un havre de félicité — dans son souvenir à lui du moins.
Un bon demi-siècle plus tard, l'image est différente. Dès la première phrase :
Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frere, de prochain, d'ami, de societé que moi-même...
Et plus loin :
Tiré je ne sais comment de l'ordre des choses, je me suis vu précipité dans un cahos incompréhensible où je n'apperçois rien du tout, et plus je pense à ma situation présente et moins je puis comprendre où je suis.
Sa manie de la persécution l'a cette fois brouillé avec le reste du monde. À quoi s'ajoutent les maux de la vieillesse :
...un tiéde allanguissement énerve toutes mes facultés, l'esprit de vie s'éteint en moi par degrés ; mon ame ne s'élance plus qu'avec peine hors de sa caduque envelope... (...)...je m'enivre moins du délire de la rêverie...
Oui, mais en même temps, là encore, il trouve au fond de la déréliction une paix, une joie mystérieuse :
...je me suis résigné sans reserve et j'ai retrouvé la paix. (...) ...un plein calme est rétabli dans mon cœur.
Il avait abandonné l'herborisation ; son ancienne passion le reprend, il botanise plus que jamais, et ce regain final, joint à cette sérénité, c'est bon signe pour le vétéran que je suis. Et j'aime aussi cette page où l'un des penseurs les plus vigoureux, les plus profonds, les plus originaux de son époque avoue, sans doute sincèrement :
...la rêverie me délasse et m'amuse, la reflexion me fatigue et m'attriste ; penser fut toujours pour moi une occupation pénible et sans charme.
Ma déception ?
C'est de trouver ces pages lumineuses noyées au milieu d'autres en plus grand nombre où c'est la paranoïa qui parle. Jean-Jacques est unique et tout le monde est contre lui, voilà ce qu'il ressasse entre deux extases et je confesse que cette œuvre par ailleurs extraordinaire, ensorcelante par moments, géniale par éclairs, m'a laissé à sa dernière page, atteinte non sans effort, dans un état bizarre, mélange d'admiration, de compassion et d'accablement.
 Rousseau dans ses dernières années. |
Ô surprise, ô délice, un nouveau Gracq ! On dit que des centaines de pages sont au coffre-fort jusqu'en 2027, mais voilà que pour nous faire patienter les éditions José Corti nous offrent un recueil de textes brefs, Nœuds de vie ,dans le style des succulentes Lettrines.
Quand furent-ils écrits, ces fragments ? La préface de Bernhild Boie reste étonnamment discrète. Quelques indices les situent dans le dernier quart du siècle passé, certains ayant sûrement précédé les Carnets du grand chemin, alors pourquoi cette publication si tardive ?
En tous cas, il ne s'agit pas là de fonds de tiroir : on retrouve là Gracq tout entier : géographe voluptueux (là encore, fabuleuses descriptions de paysages), historien lucide (la page sur 68, morceau d'anthologie), lecteur inspiré, étincelant dans l'enthousiasme comme dans la critique, qu'elle soit féroce ou doucereusement feutrée.
La somptueuse, l'éblouissante poésie de Mallarmé et de Valéry est un peu pour moi comme le trésor de Toutânkhamon. (...) On ouvre la porte sur le ruissellement des feux dans l'ombre, et on la referme, saisi et respectueux : un tel entassement de masques d'or, d'aromates et de pierreries — viatique funèbre pour la comparution devant quelque dieu souterrain de la poésie — n'a pas été amoncelé pour ce qui bouge encore insouciant sous le soleil.
Si seulement nos critiques osaient comme lui déployer des images !
Stendhal est porté aux nues (on s'en doutait), Hugo se fait rudoyer (il en a l'habitude), et Tolkien, qui l'eût cru, accueille une sacrée belle prise dans son fan-club. Toute cette partie critique est un régal au sein du régal.
Somptueuse, éblouissante, la prose gracquienne l'est aussi — comme celle de Rousseau, avec qui, par-delà les différences, il partage un certain goût de la solitude — mais sans la parano et sans les plaintes. Gracq a toujours caché ses chagrins ; il semble plutôt doué pour le bonheur. Témoins les récits des virées à pied ou à vélo de sa jeunesse, qui ont fait
pleuvoir sur moi cette félicité subite et sans cause qui me rend chère encore une page du Grand Meaulnes : celle où Meaulnes s'engage dans l'allée de sapins balayée de frais du Domaine perdu.
Gracq n'est pas aveugle, la plus belle page du livre, peut-être, est celle où il évoque toutes les menaces pesant sur notre monde :
La Terre a perdu sa solidité et son assise. (...) Le moment approche où l'homme n'aura plus sérieusement en face de lui que lui-même, et plus qu'un monde entièrement refait à son idée — et je doute qu'à ce moment il puisse se reposer pour jouir de son œuvre, et juger que cette œuvre était bonne.
Dans un entretien de 1986, il se déclare «tranquillement dénué d'espoir». Assez tranquillement pour ne pas trop nous saper le moral, et continuer de nous charmer comme de son vivant.
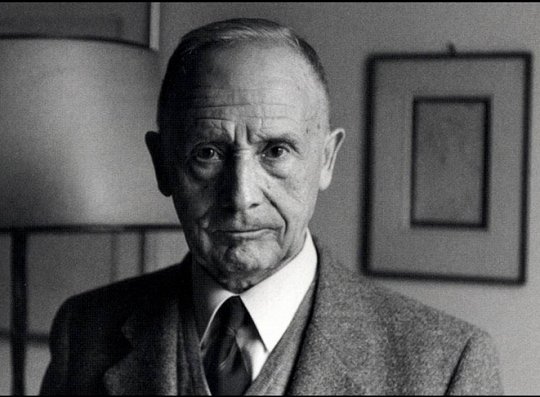 Le grand homme. |
François Sureau, ancien conseiller d'État, désormais avocat, était jusqu'ici pour moi l'auteur d'un roman impressionnant, L'obéissance (Gallimard, Brèves de décembre 2007) et de Pour la liberté (Tallandier, Brèves de décembre 2017), où en quelques pages cinglantes il montre celle-ci bafouée, dans notre pays et bien d'autres, par des gouvernants brutaux, avec la bénédiction imbécile de la majorité d'entre nous, citoyens indignes.
Sureau pourrait dire aujourd'hui : nous sommes gravement malades — moins du virus dont on parle tant que d'un cancer sournois du cerveau : la peur et sa séquelle, cette folie qu'est l'obsession sécuritaire.
Ou comment la peur du danger nous met plus encore en danger.
Je reviens à cet homme remarquable pour un texte lui aussi très bref, Le chemin des morts, en Folio. L'auteur y raconte comment, tout jeune, au Conseil d'État, il s'est trouvé devant un dilemme : fallait-il ou non renvoyer en Espagne un ancien militant basque menacé de mort là-bas ? Sureau a dû trancher, l'homme une fois expulsé à cause de lui s'est fait assassiner.
Le souvenir d'Ibarrategui ne m'a jamais laissé en repos. Il n'est pas passé un jour sans que je le revoie, debout devant nous, rue de la Verrerie, sans que j'entende cette voix sèche qui parlait notre langue et qui nous condamnait. (...) À chaque fois que ma lâcheté ou le désir de plaire me poussaient aux accommodements de l'audience, et à reculer face aux juges, il était là, dans mon dos, pour me pousser à parler fort, sans rien céder, moi qui n'aime guère combattre. Il sera là quand je rangerai ma robe noire, ayant gagné mon silence après tant de paroles dites. J'espère qu'il me laissera mourir seul, mais que je le retrouverai de l'autre côté.
Une confession courageuse, à voix retenue, sourdement brûlante. Cinquante pages à peine, qui confirment ce que je savais déjà de cet homme lucide, passionnément épris de justice, par ailleurs bel écrivain dans le genre classique, à la langue simple et forte. Savoir qu'un François Sureau existe console un peu de la vulgarité morale de nos princes. On se demande comment ce défenseur passionné des libertés a pu fricoter un temps avec le personnage qui nous gouverne. Rassurez-nous, maître : vous avez rompu, n'est-ce pas ?
 François Sureau |
Encore un livre très bref et non moins dense : Un chemin de tables, signé Maylis de Kerangal, en Folio. Mauro, enfant gourmand, devient apprenti cuisinier, puis fait son chemin dans le monde impitoyable de la restauration, de table en table, jusqu'à ouvrir son propre bistrot gastronomique.
Cuistot, un boulot ? Bien plus ! «Cuisiner tient du sport, tient de la course, endurance et sprint, haies.» Un sport de combat aussi, vu la violence des contacts humains en cuisine, des aléas financiers, des efforts à fournir. «La plus grande violence de ce métier, tu sais, c'est que la cuisine exige qu'on lui sacrifie tout, qu'on lui donne sa vie.» C'est aussi un spectacle, et un art. Après Naissance d'un pont et Réparer les vivants, l'auteure nous offre une nouvelle ode vibrante au travail qui nous remplit de compassion à l'égard des oisifs et des flemmards. Elle s'est documentée avec sa minutie coutumière, a découpé et assaisonné ses phrases avec la maestria qu'on lui connaît pour nous servir cette tranche de vie cuite à point aux petits oignons.
Mais le plus beau, c'est que ce livre subtil nourrit en nous la fascination vis-à-vis de l'art culinaire sans pour autant être dupe de cet engouement actuel un peu pathétique pour la bonne bouffe :
Quand on parle de cuisine, on ne parle pas du reste, de tout ce qui va mal dans le monde ; tu vois bien que l'intérêt porté à la gastronomie n'est jamais si fort que dans les périodes où les gens sont inquiets : ça rassure, ça rassemble, ça parle au corps, ça donne du plaisir, il y a là du partage, du théâtre, de la vérité. (...) La concurrence, la discipline, le mérite : tout le monde s'y retrouve, tout le monde se tient tranquille.
Chaud et froid, sucré-salé. Kerangal est une maîtresse queuse.
 Elle-même en personne. |
La ronde des métiers continue : après le juriste et le cuisinier, bienvenue au diplomate.
Au temps lointain de mes études, j'ai connu et admiré Stéphane Gompertz, l'un des esprits les plus vifs d'entre nous. Comme on pouvait s'y attendre, il a fait son chemin, normalien, énarque, brièvement professeur, puis ambassadeur dans divers pays. Aujourd'hui retiré, il se rend utile dans le milieu associatif.
Je ne l'ai pas revu depuis un bon demi-siècle, mais je viens de lire son livre : Un diplomate mange et boit pour son pays (Odile Jacob). Ceux qui voient dans le métier d'ambassadeur une sinécure sybaritique ouvriront de grands yeux en lisant Gompertz, qui nous dévoile toutes les charges et les embûches du métier. Il le décrit de façon minutieuse mais vivante.
Les moments chauds ne sont pas rares : on frémit en lisant les pages sur la crise de 1996 dans le panier de crabes moyen-oriental, et le COP 21 de Paris n'est pas mal non plus. Un diplomate se doit d'être attentif et subtil, car les gaffes peuvent coûter cher. Il lui faut de la prudence, mais aussi du courage ; de la souplesse, qui n'empêche pas la fermeté ; et aussi, et surtout, comme le dit le titre d'un sous-chapitre, «Il n'est pas interdit à un diplomate de manifester des qualités humaines». On imagine certains diplomates bouffis d'arrogance ; lui non. C'est un mec bien. Il n'a pas rencontré que des anges, il aurait sûrement pu vitrioler certaines pages, mais sa gentillesse naturelle l'empêche d'insister, et cette gentillesse est payante : on s'aperçoit au fil des pages que son humanité, sa simplicité, son humilité lui ont ouvert au fil des ans bien des portes.
Son livre, tel qu'il est, constitue un précieux viatique pour tout jeune diplomate, mais il a aussi de quoi toucher un plus large public, par ses qualités humaines, sa clarté, sa finesse. Gompertz, lui aussi, on est content qu'il existe.
 Stéphane Gompertz. |
Métiers (suite) : voici, dans Trois concerts, roman de Lola Gruber paru chez Phébus, le musicien concertiste et le critique musical.
Un gros roman : méfiance. Les pavés m'inquiètent. Qui peut prétendre être génial sur 500 pages ? Il faut être bien sûr de soi pour monopoliser notre attention si longtemps.
Trois personnages : un vieux virtuose du violoncelle, complètement braque, retiré des concerts ; une jeune femme qui va devenir son élève ; un critique musical surdoué dont elle va s'éprendre. Des leçons de musique. Des concerts extraordinaires. Des tas d'angoisses et de douleurs. Du romanesque en veux-tu en voilà.
Les musiciens, dans les romans, sonnent souvent faux. La vie d'un compositeur ou d'un interprète, il est vrai, n'a en principe rien de bien spectaculaire. D'où la tentation d'épicer artificiellement la soupe. Dans ce roman aussi, les caractères et les situations, quoique prenants par instants, sont souvent forcés, peu crédibles. Une tendance à la profusion, au bavardage n'arrange pas les choses. Mais en même temps on est touché plus d'une fois par des moments de grâce imprévus.
Tout ce qu'elle fait est réussi et a l'air simple, sans effort, c'est ça qui est beau. C'est comme un essuie-glace : il suffit qu'elle passe dans une pièce, après tout devient limpide et clair.
(Ce serait plus joli encore en virant «c'est ça qui est beau» et «après»...)
Le meilleur du livre : la description, inspirée soudain, de certaines pièces musicales. L'extraordinaire Sonate pour violoncelle de Kodály, par exemple, que je découvre grâce à ce livre (à voir sur youtube, jouée par Janos Starker ou Jérôme Pernoo).
Tu fermes les yeux et tu as l'impression que cette musique n'a jamais été jouée, qu'elle est en train d'arriver ici, tu ne la connaissais pas, tu entends une harpe qui se transforme en guitare, une voix de femme chaude et pleine et puis une fanfare sous le kiosque d'un jardin dans la brume de l'hiver. Tu imagines des gens danser dans la campagne à la tombée du jour et puis un groupe de trash metal, et enfin des chemins dont tu gardais enfermé le souvenir, des regards que tu es seul à connaître, dans des souffles secrets que toi seul tu entends. (...) ...tu voudrais que ça continue toujours, et quand ça s'arrête, c'est comme si tu avais tenu dans tes bras un corps chaud et mouvant et qu'il t'avait soudain quitté.
Lire Trois concerts, donc, c'est les montagnes russes. Je suis allé jusqu'au bout, pour savoir si globalement j'aimais ça ou non. Je ne sais toujours pas, et cela m'amuse autant que cela me désole.
 Elmer, acceptes-tu de répéter des quatuors avec ces trois types jusqu'à ce que la mort vous sépare ? |
De la musique à la musique des mots :
La nuit est une grande cité endormie
où le vent souffle... Il est venu de loin jusqu'à
l'asile de ce lit. C'est la minuit de juin.
Tu dors, on m'a mené sur ces bords infinis,
le vent secoue le noisetier. Vient cet appel
qui se rapproche et se retire, on jurerait
une lueur fuyant à travers bois, ou bien
les ombres qui tournoient, dit-on, dans les enfers.
(Cet appel dans la nuit d'été, combien de choses
J'en pourrais dire, et de tes yeux...) Mais ce n'est que
l'oiseau nommé l'effraie, qui nous appelle au fond
de ces bois de banlieue. Et déjà notre odeur
est celle de la pourriture au petit jour,
déjà sous notre peau si chaude perce l'os,
tandis que sombrent les étoiles au coin des rues.
Pour moi, l'un des plus beaux poèmes de toute la poésie française. Il en existe une version plus ancienne, plus classique, très belle aussi, que je découvre ce matin dans la Pléiade consacrée à son auteur, Philippe Jaccottet. Il écrivit cette première «Effraie» en 1948, dans ma petite ville, tandis qu'à quelques rues de là je dormais, nourrisson, dans mon berceau.
Le poète nous a quittés. Moi qui ne l'ai jamais rencontré, j'en éprouve un vrai chagrin, comme de la perte d'un proche. Il n'était pas seulement pour moi un très grand poète et un traducteur admirable, mais aussi une figure exemplaire, une boussole qui indique le bon chemin.
Mon ami Jean-Yves Masson, poète et traducteur, le dira mieux que moi :
Une œuvre et une vie parfaitement accomplies en toute humilité, c'est cela, la vraie grandeur. Je l'aimais beaucoup. Son plus beau vers peut-être et la devise de tout son parcours : «L'effacement soit ma façon de resplendir.» Une lumière nous venait de Grignan qui brillera désormais autrement.
L'effacement soit ma façon de resplendir... Pourquoi ce vers s'imprime-t-il si profondément en nous ? La richesse du sens n'explique pas tout. Écoutons-le.
Effacement et Resplendir ont chacun leur domaine sonore distinct.
L'effacement soit ma façon : consonnes peu sonores, des [f] comme un souffle, des [s] susurrés, douceur des [m] ; de resplendir, les deux [d] plus affirmatifs, le [p] plus explosif ; seul le [s] est présent dans les deux parties, comme pour dire qu'il n'y a pas opposition radicale, que l'effacement et la splendeur sont liés.
L'effacement soit ma façon de resplen- : tout du long, voyelles plutôt sourdes (les nasales) ou sombres (les [a]), pour mieux faire ressortir par contraste le trait de lumière du [i] final.
L'effacement : trois syllabes, inachèvement, hésitation (à condition, naturellement, d'effacer l'e muet) ; soit ma façon de resplendir, huit syllabes également réparties, 4+4, équilibre, affirmation, éclat.
Une telle justesse musicale, une telle perfection, c'est rare mais fréquent dans ses poèmes à lui si lumineux. L'homme Jaccottet s'efface dans la nuit, sa poésie est là qui nous éclaire.
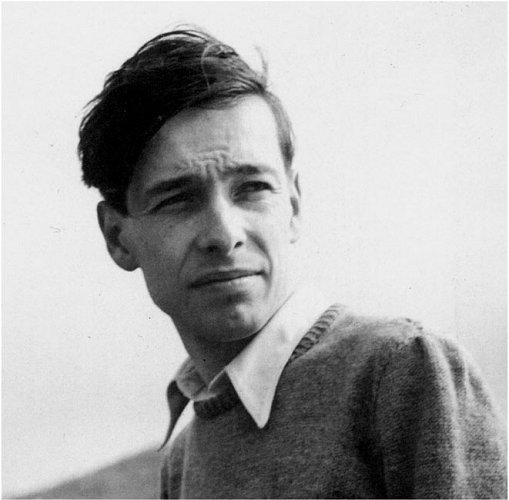 Le Poète. |
Et Nadeau, on l'oublie ? Que non ! Ce mois-ci, dans Soixante ans de journalisme littéraire, vol. 2 (Maurice Nadeau), nous explorons ses années 58 et 59, bien remplies comme les précédentes.
Certains grands atteignent leur sommet : Sarraute et son Planétarium, Robbe-Grillet Dans le labyrinthe, Gracq et Un balcon en forêt. Nadeau accueille avec enthousiasme La révocation de l'édit de Nantes de Klossowski et Le livre à venir de Blanchot (tout en reconnaissant qu'il ne comprend rien à ses romans, lui non plus). Il pleure la mort prématurée de Jean Reverzy, admirable auteur du Passage et de La place des angoisses, et il semble bien qu'il ait vraiment aimé son Corridor, incompréhensible cauchemar. Il accueille chaleureusement, venus de l'étranger, L'homme sans qualités de Musil, Le docteur Jivago de Pasternak et un peu moins chaudement Lolita de Nabokov, dommage.
Une fois encore, on découvre des inconnus qu'il donne envie de lire : Paul Tillard, Jean Douassot, Albert Palle, Jacques Howlett... On aimerait se faire plongeur et explorer ces profondeurs oubliées.
Mais le plus frappant sans doute, c'est la lettre ouverte que Nadeau lance à la figure du ministre de la Culture d'alors, André Malraux. Celui-ci affirme que depuis l'arrivée de De Gaulle au pouvoir on ne torture plus en Algérie ; or la torture continue, elle fleurit jusque dans les commissariats de la métropole et M. le ministre ne peut pas ne pas le savoir.
On a peine à croire, André Malraux, que vous ayez lu La Gangrène sans que se réveille en vous l'indignation généreuse qui vous fit dénoncer à la face du monde les bourreaux nazis ou chinois et prendre parti pour leurs victimes. Ce n'est plus en Allemagne, en Espagne, en Chine qu'on torture, mais à votre porte, chez vous, et vous n'auriez pas un mot contre ceux que vous avez autrefois voués à la vindicte ? Nous avons été trop nourris de votre œuvre pour penser que son auteur pourrait aujourd'hui la renier. Elle parle pour vous. Elle peut au besoin se dresser contre vous.
On aimerait voir le Grand Homme lisant ce message terrible. Autant que je sache, il ne moufte pas. Trop attaché au confort et aux honneurs de sa charge. Elle lui donnera l'occasion plus tard de postillonner, outre pleine de vent, sur les ossements de Jean Moulin, mort sous une autre torture. Nous ne l'entendrons jamais déclamer :
Entre ici, Maurice Audin, avec ton terrible cortège...
 Vers 2000 ? |
Le cinéma ?
La nuit des forains, de 1953, le premier grand Bergman sans doute, saisissant, dont certaines scènes retrouvent la force inouïe du cinéma muet.
Pieces of a woman, du Hongrois Kornél Mundruczó, sorti sur Netflix. Une femme accouche, perd l'enfant et peine à s'en remettre. Le spectateur aussi, après 25 minutes d'accouchement tragique. La légèreté de la caméra (plans-séquences époustouflants !) ne suffit pas à ranimer ce film plutôt lourd, que les critiques du Masque et la plume ont encensé inexplicablement.
Deux films en un mois, c'est tout ?
La faute aux séries, redoutables envahisseuses.
Nous sommes passés du délicieux Ovnis(s) de Clémence Dargent et Martin Douaire au Bureau des légendes d'Éric Rochant, déjà connu de tous, mais après les dix épisodes de la première saison la force des situations, du scénario et de l'interprétation sont telles que l'obsession menace et qu'il faut faire une pause, sous peine de voir un espion dans toutes les personnes qu'on croise. On y reviendra, c'est un meust.
En attendant, place à une autre merveille, non moins obsessionnelle : En thérapie, d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Un analyste face à plusieurs patients, puis à sa contrôleuse. On s'y croirait. Étalage de souffrances, affrontements violents, le pauvre psy en prend plein la gueule, et nous aussi. Chacun des trente-cinq épisodes dure moins de trente minutes, soit la durée d'une séance, dont on sort lessivé.
 Frédéric Pierrot, Carole Bouquet |
Et maintenant, comme promis, comme chaque mois, trois portraits-express tirés d'Observations en trois lignes d'Emmanuel Venet (La fosse aux ours).
Patrick Y. attend son Ève, qui doit sortir de sa côte. Comme elle tarde, il bricole un système de palan pour faire tomber sur son torse une pièce de fonte qui libèrera sa belle. On l'en empêche in extremis. Il reste intact, mais affreusement seul.
De sa voix étonnamment douce, Bastien Y. décrit comment il s'est fait embourlinguer le fraxième : on lui avait tout mis dans le méandre, impossible de se désinquiéter. À la fin de la consultation, il demande poliment sa strophe.
Viviane X. n'ira plus à la cafétéria : la dernière fois, elle y a accouché de jumeaux, que le barman a pris pour les donner à sa mère. Depuis, elle accouche dans son lit et mange aussitôt ses bébés pour empêcher qu'on les lui vole.
Au programme d'avril : Mirbeau, Nadeau, Ndiaye, Henein, Tournier (Milène), Le Tellier, Pajak, Sophocle, Carson & Blair, choix varié comme d'hab.
 |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Contrairement aux lois de la physique, on peut s'élever en société à force de bassesses.
Il n'est rien de si bon sur cette terre qui n'ait quelque infamie à sa source première.