
Le poète a grandi au cœur de ces montagnes.
BRÈVES
N°188 juin 2019
«À mon âge, on ne lit plus, on relit !»
Qui a dit ça déjà ? Plaignons le pauvre homme : ne plus goûter les joies de la découverte, quel appauvrissement... Cela dit, les relectures, qui normalement se multiplient avec l'âge, sont une aventure elles aussi. On ne sait pas si l'œuvre admirée jadis ne va pas se dégonfler sous nos yeux, ou si au contraire ce qui nous laissait froid ne va pas prendre des couleurs insoupçonnées.
Les poèmes de Wordsworth, eux, je les retrouve intacts. Ouvrant le volume que Poésie/Gallimard leur consacre, je suis transporté plus d'un demi-siècle en arrière, dans la classe de M. Hibon. On ne peut ignorer William Wordsworth, l'un des grands romantiques avec Shelley et Keats. Nous étudions des passages de son grand œuvre, Le Prélude, qu'il passa des années à rédiger autour de 1800, puis à fignoler jusqu'à sa mort.
Le Prélude, immense autobiographie en vers, décrit l'éveil du poète au monde qui l'entoure et à la poésie ; c'est surtout un hymne à la Nature, qui lui inspire un amour fusionnel. Les paysages de son enfance campagnarde ne cessent de le hanter ; la Nature est pour lui une amie, une amante, une mère, une préceptrice, un modèle. (Elle mérite amplement la majuscule que les Anglais, plus clairvoyants que nous, lui accolent.)
Nous qui sommes poussière, en nous l'âme immortelle
Croît comme l'harmonie en musique ; il se fait
Un travail invisible, obscur, qui met d'accord
Les éléments désaccordés, les associe
En un seul tout. Comme il est étrange que toutes
Les terreurs, les douleurs, la misère précoce,
Les regrets, les tracas, les fatigues, mêlés
Dans mon esprit, aient jamais eu leur part,
L'indispensable part, dans l'édification
De l'existence calme dont je jouis quand
je suis digne de moi ! Louée soit la Nature
Pour cette fin !
Dust as we are, the immortal spirit grows
Like harmony in music ; there is a dark
Inscrutable workmanship that reconciles
Discordant éléments, makes them cling together
In one society...
Lisant ces vers, je les entends déclamés par ce bon M. Hibon, avec son accent raffiné, plus anglais que celui des Anglais, sa voix qui savoure les mots par petites gorgées, ensoleillée par le petit cognac du matin, et je retrouve la ferveur tranquille de ce temps-là, celle des vers du Prélude, celle de l'année studieuse 1965-66.
L'excellente préface du traducteur, François-René Daillie, commence par une citation de Jacques Réda et s'achève par un salut à Gustave Roud, deux de mes poètes préférés. Quant à la traduction, en vers comme il se doit, son ample balancement est un régal. Chapeau l'artiste !
 Le poète a grandi au cœur de ces montagnes. |
Nabokov, lu jadis lui aussi, je le trouve décidément plutôt grandi par le passage du temps.
La vraie vie de Sebastian Knight, de 1940, traduit par Yvonne Davet, en Folio, est son premier roman écrit en anglais.
Deux demi-frères, émigrés de Russie en France — comme l'auteur —, se sont peu fréquentés. L'un d'eux, Sebastian Knight, écrivain réputé, venant de mourir, le survivant nous raconte son enquête auprès des proches du défunt pour tenter de reconstituer sa vie. En d'autres termes, un homme écrit un livre sur un autre qui écrivait des livres.
Là où cela coince un peu, c'est que le narrateur prétend mal écrire, alors que Nabokov himself lui tient la main avec sa maestria coutumière. Mais va-t-on reprocher à la mariée d'être trop belle ? Sans être — à mon avis — le meilleur de son auteur, ce roman nous offre le lot habituel de grands moments (scènes comiques, descriptions étincelantes, métaphores somptueuses).
Plus fréquentes qu'ailleurs chez Nabokov, dans ce roman sur l'écriture, les remarques sur le travail d'écrire et le style, ainsi que les passages où le monde et l'écriture se font métaphores l'un de l'autre, comme si le monde était un livre qui nous parle et le livre tout un monde :
Il me laissait retomber aussi soudainement qu'il m'avait soulevé, aussi soudainement que la prose de Sebastian soulève de terre le lecteur pour, d'une secousse, le précipiter dans la joyeuse dégringolade de l'endiablé paragraphe suivant.
Ou bien :
C'était comme si un voyageur se rendait compte que le pays sauvage sur lequel il promène ses regards n'est pas une réunion fortuite de phénomènes naturels, mais la page d'un livre où ces montagnes et ces forêts, et ces champs, et ces rivières, sont disposés de manière à former une phrase cohérente ; la voyelle d'un lac se soudant à la consonne d'une pente ; une route serpentante écrivant son message en ronde, aussi lisible que celle de nos parents ; des arbres conversant par signes, langage muet compréhensible pour celui qui en a appris les gestes...
Obsession de l'auteur : le monde est d'une richesse infinie, jusque dans le moindre détail, sur quoi il braque sa loupe en des très gros plans vertigineux, attentif
au langage ignoré du silence, à l'effrayante pesanteur d'une goutte de rosée, à la beauté déchirante d'un caillou parmi des millions et des millions de cailloux, tout cela ayant un sens, mais quel sens ?
Telle est la question qui peu à peu se met à hanter le livre, et l'on se croit même au bord de découvrir LE sens caché de toutes choses :
Nous sentons que nous sommes à deux doigts d'une vérité absolue, à la fois belle à éblouir et presque ordinaire par sa complète simplicité. (...) Nous allons apprendre quelque chose qui transformera toutes nos notions, comme si nous avions découvert qu'en remuant nos bras d'une certaine manière, toute simple mais à laquelle jusqu'ici on n'avait jamais encore changé, nous pouvions voler.
Fausse joie, certes, mais au fil des pages le lecteur, frémissant de plaisir, a l'impression — fondée sans doute — qu'elles débordent de sens cachés, de secrets malicieux et de bonheurs à venir. Au point que certains fans voient dans cet opus, me laissé-je dire, le sommet de l'œuvre nabokovienne !
 Le Maître. |
Bruno Schulz, autre vieille connaissance perdue de vue, et que je retrouve encore bonifiée par le temps. Avant de mourir assassiné par un SS en 1942, ce juif polonais, ami de Gombrowicz, a juste eu le temps de publier deux recueils de nouvelles, Les boutiques de cannelle et Le sanatorium au croque mort. C'est ce dernier, publié chez Denoël, que je relis.
Dans la première nouvelle, «Le Livre», un enfant découvre un vieux livre. LE livre.
J'eus l'impression de border dans son lit l'aurore qui éternellement s'embrasait par elle-même, traversait tous les feux et toutes les pourpres et ne voulait jamais s'éteindre.
Nous sommes dans une petite ville de Galice, et dans l'univers.
Dans la plus longue des nouvelles, «Le printemps», la possession d'un album de timbres-poste fait d'un enfant le maître du monde, et l'arrivée de la belle saison prend des proportions cosmiques.
...le parfum du merisier arrive en charges compactes qui explosent doucement, déployant dans l'air leurs traînées indicibles.
Mais lorsque, vers onze heures du matin, la pousse pâle du soleil transperça le grand corps gonflé des nuages, brusquement dans les corbeilles des branches les bourgeons brillèrent tous à la fois et le voile gris du ramage, voilette d'un or pâle, se sépara lentement du visage du jour qui ouvrit les yeux. C'était le printemps.
Et tout est comme ça. Les péripéties — car il y en a, je crois — sont submergées, emportées dans le flot de cette prose d'une profusion orgiaque, allumée, illuminée, hallucinée par moments, comme dans cette chambre qui se transforme en forêt où «juste derrière le lit pousse un mur de broussailles», laquelle forêt, avec le défilement de ses paysages, s'avère être un train de nuit roulant doucement.
Et les yeux des jeunes filles deviennent profonds, des jardins aux mille sentiers y éclosent, des parcs-labyrinthes sombres et bruissants.
Pour Schulz, toute lecture est un embrasement :
Les livres ordinaires sont des météorites. Il y a pour chacun d'eux un instant où il s'envole en criant, Phénix jetant des flammes par toutes ses pages,
mais la prose schulzienne, elle, brûle d'un feu continu, et je comprends soudain pourquoi, il y a tant d'années, j'ai posé le livre au bout de 150 pages, tout comme aujourd'hui : lire ce livre prodigieux est une expérience tellement intense que le lecteur bientôt titube, lui aussi submergé.
 Dessin de Bruno Schulz |
Dans Soixante ans de journalisme littéraire, vol. I (1945-1951), ce mille-cinq cents feuilles que je vais mettre cinq mois à parcourir, Nadeau n'évoque pas Schulz, et pour cause : l'œuvre dudit ne sera connue en France que bien plus tard. Grands moments critiques de cette année 1948 : le roman américain et Artaud encensés, on s'y attendait, un long article très chaleureux et pénétrant sur mon cher Dhôtel, un certain René-Jean Clot dans le rôle du jeune prometteur qui ne tiendra pas ses promesses, et une demie surprise : Nadeau amateur de poésie avec, outre un grand éloge de Prévert, une étude sur Char d'une finesse admirable.
Le dessert, comme toujours : une de ces pages doucement vachardes dont notre homme a le secret. La tête de turc, cette fois, c'est le justement oublié Charles Du Bos, dont on publie cette année-là le deuxième tome du Journal.
Charles Du Bos a oublié de vivre. Nous nous en sommes aperçus dès le début de cette longue introspection commandée par une sorte d'hygiène volontaire et quotidienne de l'esprit. Tapi dans son île Saint-Louis, il n'a fait que se repaître des ombres de sa bibliothèque : Amiel, Benjamin Constant, Baudelaire, Keats, Shelley, Tolstoï, Nietzsche, Tchékov, etc. qui, par un extraordinaire phénomène de vampirisme réciproque, lui ont ravi l'existence pour prendre forme à travers elle. (...) Soucis mineurs que ceux de comprendre et de juger ; Du Bos fait mieux : il investit les enveloppes mortes de ses auteurs et en fait les sujets tyranniques d'un royaume idéal dont il s'arroge le sceptre, parlant avec un naturel parfait de «mon Tchékov, mon Benjamin Constant» qui deviennent autant de répliques de lui-même et des modèles à suivre. Dans cette famille bizarre, Du Bos est à la fois le père unique et le commun fils très obéissant...
Plus loin :
Falaise minée, Du Bos désormais tombe à la mer. (...) La prodigieuse machine de sa pensée aux rouages si complexes et aux activités si souples, après avoir dévoré l'homme et sa vie, ne broie plus que du vide.
Cette longue mise à mort citée non pas pour accabler feu Du Bos, à quoi bon, mais parce qu'elle dessine en creux un anti-portrait de Nadeau lui-même. Lecteur boulimique lui aussi, mais tourné vers le présent et l'avenir, conservant toujours, vis-à-vis de ses auteurs, une distance de sécurité, et jusqu'au bout immensément vivant, comment ne pas voir en lui le parfait contraire de sa victime ?
Avis aux amateurs : les neuf tomes du Journal de Du Bos sont en vente sur la Toile au prix de 140 €...
 Nadeau encore jeune. |
J'ai bien connu Nadeau, et j'ai un peu connu Anne Steiner autrefois. Elle fut mon élève il y a très longtemps, je l'ai retrouvée l'autre jour et elle m'a donné l'un de ses livres, Les en-dehors, aux éditions de l'Échappée.
Les en-dehors ? C'est le nom que se donnèrent les anarchistes français au début du siècle passé, ayant décidé de vivre en marge de la société, qu'elle fût bourgeoise ou même ouvrière. Anne retrace leur histoire mouvementée, finalement peu connue, à part quelques moments forts tels que l'équipée de Bonnot et sa bande. On découvre là, outre Bonnot la star et le passionnant Victor Serge, alors tout jeune, une foule d'autres personnages tombés dans l'oubli, l'un d'eux servant de fils conducteur : Rirette Maîtrejean, sacrée bonne femme qui fut mêlée alors à toutes les aventures du milieu anarchiste.
Ce livre nous offre en même temps la vision précise, ultra-documentée d'une historienne et la vivacité d'un roman palpitant. On y découvre, finement analysées, les tendances qui s'affrontèrent au sein de la mouvance — en fonction du degré d'intransigeance vis-à-vis des modèles sociaux existants —, les diverses expériences communautaires, plus généralement la recherche d'un nouvel art de vivre, et enfin le basculement de certains dans la délinquance qui signa l'arrêt de mort du mouvement : quand on refusait tout travail salarié, comment subsister, sinon en s'alliant à la pègre pour braquer des banques ?
Sans pour autant justifier certains excès, sans abdiquer sa rigueur, l'historienne donne des anars un portrait nuancé mais plein d'empathie. Ces desperados de la société, dont la révolte, pacifique ou non, fut violemment écrasée, nous apparaissent le plus souvent attachants, voire héroïques, avec notamment leur soif de savoir, de justice, et leur courage. Et puis, comme l'écrit alors Victor Serge, «les bandits sont les effets de causes situées au-dessus d'eux» et les vrais coupables ne sont pas ceux qu'on pense.
Décidément, j'ai de la chance avec les livres de mes amis.
 Anarchistes. |
On ne peut pas être veinard tout le temps : Docteur Pasavento, de l'espagnol Enrique Vila-Matas, issu du tirage au sort mensuel, nous raconte en long et en large les déambulations et les états d'âme d'un écrivain, double de l'auteur apparemment, lequel rêve de disparaître et invoque à cette occasion les mânes d'autres auteurs qui s'effacèrent ou tentèrent de, Robert Walser, Agatha Christie, Emmanuel Bove (jolie photo d'icelui en couverture), exposé rehaussé de considérations blanchotesques sur l'écriture ayant pour but l'effacement d'elle-même, le tout d'une redondance propre à certains auteurs de là-bas et d'un ennui général que ma longue phrase macaronique s'efforce de mimer. SOS ! Suis ensuqué à la page 130, quel treuil viendra me désenvilamataser ?
 L'Auteur. |
Une cure de légèreté nous requinquera.
Le ciel était d'un azur cotonneux, l'air était doux comme un sirop et les fleurs s'épanouissaient avec une assurance qu'il jugea vulgaire.
Plus loin :
On croit les malades inertes, séparés du monde, insensibles. Au contraire, ils sont parcourus par ces lames de fond qui n'écument pas. À l'hôpital, tout ce qui tombe sous les sens est dégusté par des connaisseurs. Ce sont des égaux de Michel-Ange qui apprécient le clair-obscur. C'est l'œil de Léonard qui caresse le visage de l'infirmière, c'est le cœur de Rembrandt qui s'émeut quand les chirurgiens s'assemblent autour du lit.
Tout est délicat, ailé, délicieusement vertigineux. Les sons qui viennent de la ville ont effleuré Mozart, les rumeurs qui montent de l'intérieur sont wagnériennes. Le patient, sur son matelas, est un homme enfin libre. Il est là, gisant, mais conscient d'être le lieu géométrique où toutes les forces de l'univers s'équilibrent et se neutralisent. Charles se sentit très heureux.
Charles est un banquier vieillissant, maniaque et desséché, qu'une nièce pulpeuse et fantasque va tirer de son engourdissement. Ils iront jusqu'à vivre une idylle qu'on devine charnelle — suggérée si délicatement qu'on pourrait presque ne se douter de rien. Nous sommes dans un monde protégé, enchanté, dans une prose délicate, ailée en effet, aimablement sarcastique, ouverte aux charmes de l'incongru, une prose où tout pétille et crépite, offrant une menue surprise délicieuse à chaque ligne.
Est-il besoin de le dire ? Nous sommes les invités du genevois Pierre Girard, qui publia ce délicieux Charles dégoûté des beefsteaks en 1944. L'éditeur ? Le très précieux Arbre vengeur, bien sûr. À son catalogue, du même auteur, Othon et les sirènes et Monsieur Stark, recensés naguère ici même. On espère la suite. Vous attendez quoi, les mecs ?
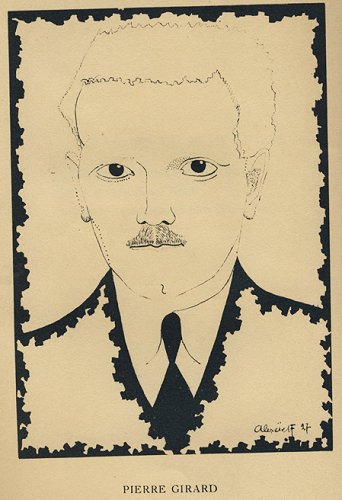 Pierre Girard en 1927. |
Maylis de Kerangal aussi, on la connaît bien sur volkovitch.com. Dans ses romans (Naissance d'un pont, Réparer les vivants), on accompagne un travail complexe, difficile, exécuté par une équipe solidaire. Dans son petit dernier, Un monde à portée de main, les héros sont des apprentis peintres — des peintres d'un genre spécial, des spécialistes du trompe-l'œil, autrement dit des cousins des traducteurs.
Activité subalterne ? Peut-être que
...le trompe-l'œil est bien autre chose qu'un exercice technique, bien autre chose qu'une simple expérience optique, c'est une aventure sensible qui vient agiter la pensée, interroger la nature de l'illusion, et peut-être même — c'est le credo de l'école — l'essence de la peinture.
Au premier plan, trois filles et un garçon, une amitié aussi intense qu'atypique. On les voit étudier à Bruxelles, se séparer, se retrouver ; on suit l'une des filles à Cinecittà et enfin Lascaux, car le voyage s'effectue aussi dans le temps, dans les profondeurs de la terre et du passé, qu'il soit géologique (ils apprennent à connaître les pierres qu'ils doivent imiter), soit préhistorique, lorsque la jeune femme, à la toute fin, recopiant les fresques de Lascaux, s'identifie à ses lointains ancêtres.
Comme toujours chez l'auteure, une précision documentaire d'une minutie fabuleuse, née d'un travail de documentation colossal, fait naître au fil de langues phrases déferlantes une vision d'une force et d'une ampleur quasiment épiques.
On ne sait trop quoi citer, les morceaux de bravoure abondent.
Peut-être ce passage où à une lecture d'Anna Karénine viennent s'agréger, avec une virtuosité toute kerangalienne, le thème de la préhistoire et celui de l'amour naissant :
...un texte dont elle capte immédiatement la nature de palais, l'extérieur solide, l'intérieur immense et minutieux, si parfaitement créé qu'il lui semble être advenu d'un seul bloc, issu d'un puissant sortilège ; elle tourne lentement les pages, perd parfois le fil, remonte le paragraphe à contre-courant jusqu'à l'endroit du texte où elle a lâché la corde, puis replonge et se réinsère, médusée par le façonnage progressif de l'amour, taillé éclat par éclat tel un biface du paléolithique, jusqu'à devenir tranchant comme une lame et capable de fendre un cœur en silence, jusqu'à devenir ce grain de poussière pléochroïque, ce fragment minéral qui change de couleur selon l'angle par lequel on le regarde, à jamais énigmatique, et finit par rendre fou.
 Maylis de Kerangal |
Du côté des Grecs, deux parutions importantes que j'ai eu l'honneur et le bonheur de traduire.
Une réédition d'abord : le formidable Toi au moins, tu es mort avant de Chrònis Mìssios, publié voilà vingt-cinq ans par l'Aube qui avait salopé le travail, et repris aujourd'hui par Cambourakis. (Voir un extrait et le journal du traducteur dans MADE IN GREECE.)
Puis Mauvais anges, l'un des plus grands livres de feu Mènis Koumandarèas, contemporain de La femme du métro et du beau capitaine qu'il rejoint chez Quidam — la plus belle collection française de textes grecs contemporains. Mauvais anges raconte, entre autobiographie et fiction, avec le charme ambigu propre à l'auteur, l'éveil à la sexualité d'un jeune homme dans l'Athènes d'après-guerre.
Attendu trente ans avant de pouvoir le publier.
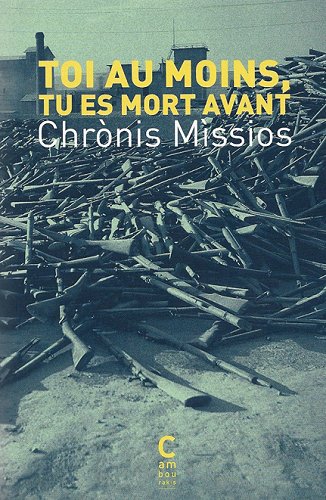 |
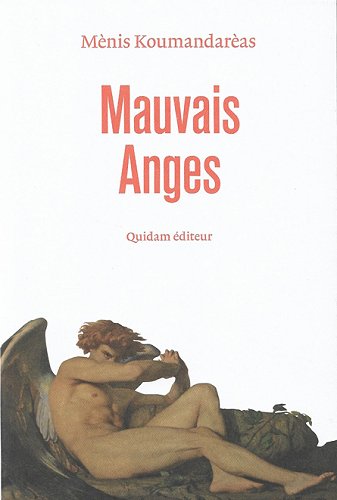 |
| Deux grands bouquins, deux bonheurs de traducteur. | |
Au cinéma aussi, même devise : retours et découvertes.
Ce mois-ci, deux très belles retrouvailles.
D'abord L'amie de mon amie, un Rohmer de 1987 : deux jeunes femmes, deux jeunes hommes, marivaudages subtils et délicieux, chassés-croisés, un vrai ballet, de cela je me souvenais, et de Cergy-Pontoise la ville nouvelle si intelligemment filmée, mais ce que j'avais oublié c'est la splendeur d'une scène amoureuse dans la verdoyante boucle de l'Oise, et l'émotion qui affleure un peu partout, malgré la pudeur du cinéaste. Les quatre acteurs, des quasi-inconnus, parfaits.
 Quel beau quatuor. |
Coïncidence : dans Jour de colère ou Dies irae (1943) de Carl-Theodor Dreyer, il y a une scène similaire, le premier baiser d'un jeune couple dans l'herbe et sous les arbres, enivrante elle aussi comme le foin coupé. C'est le seul moment heureux de ce film austère et douloureux, l'autre consolation, pour le spectateur, étant l'incroyable beauté des cadrages, des lumières, des mouvements. Cette cruelle histoire de sorcières est située au temps de Rembrandt et l'on croit se promener dans ses tableaux.
 Le jeune couple (illégitime). |
Les deux films nouveaux sont plus en demi-teinte.
Après avoir vu El reino, du jeune Rodrigo Sorogoyen, thriller politique haletant, hautement adrénalinogène, une fois l'excitation retombée on se dit que tout cela est un peu tape-à-l'œil et hystérique tout de même, que certaines scènes sont plus spectaculaires que nécessaires et que la thèse du film — les politiques, tous des crapules, tous ! — mériterait quelques nuances. Restent quelques moments forts, où la réalité vire au cauchemar, et une ambiguïté intéressante : le héros auquel on s'identifie est une ordure, et dans la dernière scène les deux personnages vacillent entre le bon et le mauvais rôle, tantôt anges dénonciateurs, tantôt pourris eux-mêmes, sauvant le film de l'extrémisme in extremis.
 L'une des scènes les plus réussies... |
Il y a quatre ans, un film écolo, Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, tour du monde des initiatives écolo pour sauver la planète, remuait les foules avec son message d'espoir : un peu partout des bonnes volontés se mobilisaient contre le désastre annoncé. La suite, Après demain, de Cyril Dion et Laure Noualhat, construit sur le même modèle, fait le point et remonte le moral de l'écolo accablé. Ça bouge un peu partout, haut les cœurs !
Puis, à la maison, lecture d'un article d'un certain Emmanuel Wathelet, sur investigaction.net, qui pilonne le film à coups de boulets rouges. Principal grief : le film omet de critiquer le capitalisme, responsable de tous nos maux.
Il a raison, le camarade Wathelet : Après demain n'est pas une analyse politico-économique. Il ne s'attaque pas frontalement au système, il montre une série d'initiatives diverses qui cherchent à le contourner. Contrairement à ceux qui nous souhaitent une bonne révolution, comme on dit une bonne guerre, la plupart des écolos ne rêvent pas à un grand soir fortement compromis, ils entreprennent d'affaiblir peu à peu le système en multipliant les actes de sabotage doux. Ils croient que boycotter en masse le glyphosate, par exemple, sera plus efficace que de foutre le feu au siège de Bayer-Monsanto. Et pour ce faire, un docu comme Après demain, si mal ficelé soit-il, a un rôle décisif à jouer.
Bref, à mes yeux, la couleur de cette année n'est pas le jaune, mais le vert, avec notamment la poussée écolo des dernières élections — une poussée sensible surtout auprès des jeunes. RN et LRM ont emporté ensemble un match qu'on peut qualifier de nul, et alors ? Tous deux apparaissent plus que jamais ringards.
 Un film plein d'énergies. |
Côté musique, ces vingt dernières années, j'ai fait trois grands voyages, trois intégrales : les chansons de Brassens, les sonates de Scarlatti et les cantates de Bach. Depuis plus d'un mois je parcours à nouveau celles-ci, non pour les entendre toutes systématiquement comme naguère — dix coffrets, soixante CD — mais un peu à l'aventure. Elles ne vieillissent pas, surtout dans ma version préférée, celle de Harnoncourt et Leonhardt, la première sur instruments anciens.
J'aime sa fraîcheur nerveuse, qui a démodé les versions antérieures, leur onction molle et leur mauvaise graisse. J'aime aussi le choix de faire chanter, comme à l'époque, les voix de soprano par des jeunes garçons. On a beaucoup critiqué cette option : ces garçonnets, il est vrai, n'ont ni le coffre, ni la technique de ces dames et leurs prestations sentent plus ou moins l'effort. Mais quelle virtuosité, quelle bravoure, malgré tout ! Et la gêne imperceptible qu'on entend est pour moi un plus : elle donne au chant une dimension héroïque, c'est David affrontant Goliath, c'est l'alpiniste minuscule au flanc de l'immense paroi, en route vers le sommet.
Helmut Wittek, par exemple, dans la cantate 171...
 Le Tölzer knabenchor |
En juillet ?
Nabokov, Noguez, Calet, Gerber & Romero, Ducos, Rollin, Baranger...
 |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Ce n'est pas une preuve de bonne santé que d'être parfaitement à l'aise dans une société malade.
Tu imagines les enfants de familles catholiques réactionnaires vouloir sortir de leur carcan, mais la liberté totale, c'est autant un carcan.