
L'entrée du Purgatoire.
BRÈVES
N°177 juin 2018
Un mince volume chez un éditeur inconnu, Henri Lefèbvre. Un titre curieux : Poèmes involontaires. L'auteur : André Berry.
André qui ?
Combien sommes-nous à le lire encore, André Berry, qui écrivit quelques romans, beaucoup de poésie et mourut très vieux il y a trente ans ? J'ai chroniqué ici même son autogénéalogie, Les aïeux empaillés, savoureusement déconnatoire, et sa longue épopée en vers, Les esprits de la Garonne, découverts jadis dans la bibliothèque de mes parents. Ce n'est pas seulement la piété filiale qui m'a fait acheter ses Poèmes involontaires. J'ai une tendresse pour ce Berry, pour ses vers à l'ancienne si drôlement bien torchés. Ce qu'on appelle de la belle ouvrage — expression désormais vintage, elle aussi.
Ce livre né en 1949, aux pages toutes jaunies mais jamais encore coupées, c'est émouvant comme une septuagénaire encore vierge. Ou comme ces chambres funéraires qu'on découvre après des siècles, intactes.
Involontaires, donc ces poèmes, selon l'auteur : il affirme les avoir «conçus ou composés soit dans le rêve, soit dans la demi-veille, ou sous l'influence immédiate d'un songe». «Autant d'ouvrages dont ma conscience claire n'est point responsable, non plus guère que ma plume visible.»
À un certain degré d'imprégnation, dit-on, les vers vous viennent tout seuls ; mais voir le produit d'une écriture quasi-automatique dans ces sonnets, complaintes, rondeaux et épigrammes si finement travaillés, non, monsieur Berry.
Qu'importe ! Seul compte le résultat. Ces vers impeccables, qui sembleront désuétissimes à beaucoup de gens, sont pour moi un régal. L'arrière-garde a ses charmes, tranquilles et pourtant capiteux, et la mélancolie ses subtiles douceurs. Je ronronne de plaisir en caressant des yeux ces vers de soie et de velours. Il faut que je copie un poème entier pour l'offrir aux volkonautes, mais lequel ? Le «Sonnet de la vivante revenante» ? Le «Sonnet du vieux moi rencontré» ? La «Complainte des villes détruites» ?
Je tire au sort un quatrième :
Attendu pour dîner dans un quartier sauvage
Où d'un ami lointain se mariait la sœur,
Je m'étais rencoigné pour vertical voyage
Dans le mince cachot d'un grinçant ascenseur.
Passé le sept centième et millième étage,
S'enlevait, s'élevait le bachot sans passeur ;
Et je luttais debout dans le droit sarcophage,
Me pinçant pour sortir du cauchemar farceur.
«Il croit encor qu'il rêve et bien en vain s'étire,
Dit alors une Voix, précédant un grand rire
Qui fit sonner d'échos la plus haute des tours.
«Le pauvre ne sait pas que c'est son purgatoire,
Et que pour son rachat, dans la Colonne Noire,
Il doit ainsi monter toujours, toujours, toujours.»
 L'entrée du Purgatoire. |
De Berry à Véry, peu de changement : un petit phonème, et une survie juste un peu moins obscure pour le second, en grande partie grâce au cinéma : Goupi mains rouges et Les disparus de Saint-Agil furent d'abord des romans de Pierre Véry.
Mais qui lit encore Pont-Égaré, son premier livre, datant de 1929, que j'ai déniché dans l'édition revue de 1952, exemplaire piqué à la bibliothèque des Mines de Carmaux ?
Est-ce un roman ? L'auteur fait revivre la campagne de son enfance : un hameau du Périgord au début du siècle passé, quelques personnages — le riche paysan, son ennemi sournois, un couple d'amoureux, une vieille servante simplette, un grabataire qui entend le moindre bruit... L'action dure une journée, puis une nuit de veillée à l'ancienne.
Le jour : la richesse de la terre, l'abondance, l'euphorie des plantes, des humains et des mots qui se mettent au diapason : «Le maïs, de toutes ses dents, rit dans sa barbe. Le jour crève de joie.» «Les pommes de terre, tant elles étaient abondantes et désireuses d'être cueillies, affleuraient le sol, comme des bêtes de velours.»
Mais l'important, c'est la nuit, ses sortilèges, ses diableries, ses terreurs, les bruits inquiétants, les routes hantées par le village volant et la vache fantôme. Les histoires de Véry sont toutes, plus ou moins, visitées par l'ange du fantastique. Il a, dit-il dans sa préface, «le goût du merveilleux». Mais c'est sans doute en ce début qu'il aura le plus forcé la dose.
Les mœurs paysannes du passé, il les décrira mieux encore, sans doute, dans Goupi mains rouges, mais dès cette première approche le tableau est vigoureusement brossé.
«Dans le cadre étroit des villages se développent lentement des intrigues longues comme le serpent de mer. (...) Certains, une vie durant, c'est un lopin convoité qui emplira leur âme, bouchera à leurs yeux ce vaste horizon qui les entoure. D'autres, un arbre à faire déraciner, un mur mitoyen à faire déplacer, voilà qui suffit à justifier les battements de leur cœur.»
 Vache fantôme |
Encore un vieux bouquin : Pierre Nozière, d'Anatole France, dans l'élégante collection Nelson (1910-1940), habitant chez nous depuis près d'un siècle.
Anatole France ! Quelqu'un de bien, assurément, dreyfusard, anticolonialiste, proche de Jaurès et des socialistes. L'écrivain eut l'Académie française, le Nobel et des funérailles quasi nationales, mais c'est peu dire que son étoile a pâli depuis. Les surréalistes, à sa mort en 1924, compissèrent son œuvre avec une hargne insensée qui aujourd'hui donne envie de le lire.
Les dieux ont soif, roman sur la période révolutionnaire, passe pour son meilleur livre ; je m'en souviens vaguement, et ce souvenir est agréable. Pierre Nozière, c'est le nom du héros, masque transparent de l'auteur qui raconte ici sa propre enfance.
Paris sous le Second empire, les quais de la Seine, les bouquinistes, quelques figures pittoresques. Très belles pages sur la perception du monde par l'enfant, celle surtout sur le Jardin des Plantes que l'enfant croit être le jardin d'Éden préservé. Prose agréable, certes, souriante, un peu douceâtre à la longue. On se dit que la désuétude, malgré ses charmes, n'est pas toujours une vertu.
On lit tout de même la seconde partie de ce volume hétéroclite, suite de réflexions elles-mêmes disparates, et là, bonne surprise, l'ironie apparaît, mordante sous la douceur de surface. Plusieurs sommités de l'art, des sciences et de la politique dînent ensemble. «Ces hommes avaient pris avec l'âge des façons assez douces. Les temps les avait polis à la surface. Une pratique savante des idées et aussi l'indifférence qu'inspirait à chacun toute pensée étrangère à la sienne, leur communiquaient les dehors aimables de la tolérance.» Mais en fait ils ne sont d'accord sur rien, et dès que leur quiétude ou leurs intérêts sont menacés, ils deviennent féroces.
Et plus loin :
«Les hommes ne subsistent qu'à la condition de comprendre mal le peu qu'ils comprennent. L'ignorance et l'erreur sont nécessaires à la vie comme le pain et l'eau. L'intelligence doit être, dans les sociétés, excessivement rare et faible pour rester inoffensive. (...) Il faut reconnaître que l'humanité, dans son ensemble, éprouve, d'instinct, la haine de l'intelligence.»
Ringard, le grand homme ? Pas tout le temps. Ces lignes grinçantes éclairent crûment notre monde contemporain, avec ces foules qui élisent les Trump, les Poutine, les Erdogan, ou qui chez nous votent l'état d'urgence et autres conneries sinistres avec un sourire béat...
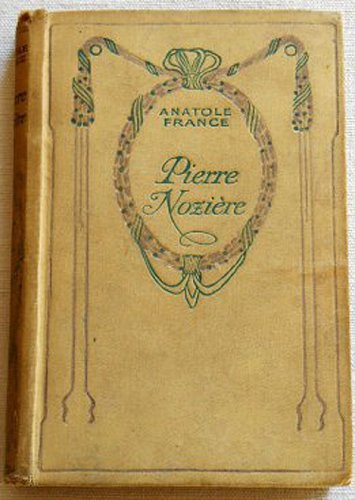 Dans la belle petite collection Nelson. |
Envie de relire Calvino. Le baron perché, c'était chouette, non ? Au fait, son livre le plus admiré, le plus oulipien, Si par une nuit d'hiver un voyageur, l'ai-je lu ? Aucun souvenir, quelle honte. Finalement je vais reprendre Cosmicomics, réédité au Seuil dans une traduction de Jean Thibaudeau, revue (très légèrement) par Mario Fusco, en compagnie de Temps zéro et de plusieurs inédits. Je n'avais pas trop accroché, ça je m'en souviens bien, cette fois tâchons de faire mieux.
Sacré bouquin, Cosmicomics. Il nous emmène jusqu'au fin fond de l'univers et du temps. Calvino y fictionnalise les principales découvertes, ou hypothèses, de la science moderne. On n'était pas là au moment du Big Bang ? Son personnage, le vieux Qfwfq, s'y trouvait ; c'est lui qui nous raconte, sur le mode plaisant et familier, tous ces événements immenses et terrifiants, où une poignée de personnages farfelus se mêlent aux planètes, aux galaxies, aux dinosaures — d'où un effet comique indéniable, qui n'empêche pas l'ampleur, le lyrisme, l'émerveillement. Il y a là des pages superbes, d'une poésie intense.
Une mère prépare des tagliatelles,
...sa poitrine descendant sur le grand tas de farine et d'œufs qui encombreraient le vaste plan de travail, cependant que ses bras la pétriraient toujours et encore, blancs et pommadés d'huile jusqu'au-dessus du coude ; nous pensâmes à l'espace qu'occuperaient la farine, et le blé pour faire la farine, et les champs pour cultiver le blé, et les montagnes d'où descendrait l'eau pour irriguer les champs, et les pâturages pour les troupeaux de veaux qui fourniraient la viande pour la sauce ; à l'espace qu'il faudrait pour que le Soleil arrive à faire mûrir le blé ; à l'espace pour qu'à partir des nuages stellaires, le Soleil se condense et s'enflamme ; à la quantité d'étoiles et de galaxies et d'ensembles galaxiques (sic) en fuite dans l'espace qu'il faudrait pour maintenir à sa place chaque galaxie, chaque nébuleuse, chaque soleil, chaque planète ; et dans le temps même où nous y pensions, cet espace, inépuisablement, se formait...
Et de nouveau ça n'accroche pas. Je reste ensuqué à la p. 140. Que se passe-t-il encore ?
Je n'aime pas les noms des personnages, laborieusement biscornus (Ph(i)Nk0, De XuaeauX, Z'zu, Pbert?Pbert?...), mais la raison est ailleurs : ces espaces infinis m'effraient, me donnent le vertige, j'y respire mal. Le petit Prince de Saint-Ex, tout seul sur son étoile minuscule, me mettait jadis affreusement mal à l'aise. Je hais Le petit Prince.
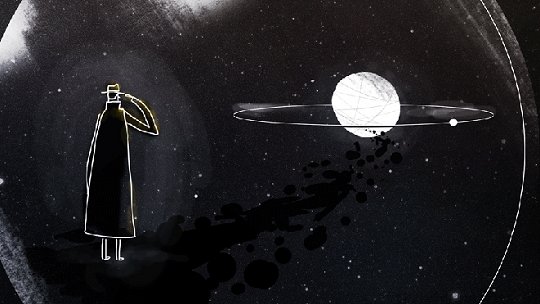 Ambiance Cosmicomics. |
Cosmicomics, c'est de la science-fiction si l'on veut, mais qui plonge dans le passé. Comme Il est difficile d'être un dieu, dans un sens.
Les auteurs, Arkadi et Boris Strougatski, écrivirent entre autres le fameux Stalker, adapté à l'écran par Tarkovski. Ils nous emmènent ici dans le futur, assurément, mais ce futur-là ressemble à notre passé. Nous sommes sur une autre planète où la nôtre, où tout se passe plutôt bien, envoie des observateurs incognito. Une planète arriérée, mélange de bas Moyen-Âge et de Russie stalinienne : misère, crasse, ignorance, ivrognerie, bigoterie, crapulerie, cruauté. Les savants et les artistes sont impitoyablement persécutés, voire exterminés. Un tableau d'une violence incroyable.
Quelque part dans les entrailles du palais, dans des appartements luxueux, où un roi podagre, qui n'avait pas vu le soleil depuis vingt ans dans sa peur du monde extérieur, fils de son propre aïeul, signait avec un ricanement imbécile de sinistres arrêts qui condamnaient à une mort affreuse les plus honnêtes et les plus désintéressés des hommes, quelque part, mûrissait un abcès monstrueux qui allait percer d'un jour à l'autre...
Les enfants, peut-être ?
C'était justement de ces petits garçons aux yeux bleus, identiques dans tous les milieux, que naissaient ensuite la cruauté, l'ignorance, la servilité, et pourtant il n'y avait en eux aucune trace, aucun germe de ces laideurs. Il se disait quelquefois que ce serait magnifique si tous les plus de dix ans disparaissaient de la planète.
On mesure l'étendue du désespoir d'où est sorti ce livre, en 1964, dans une Russie encore traumatisée par Staline.
Cette descente aux enfers donne lieu à une méditation sur l'humain et l'inhumain, où l'on voit des infra-humains incapables d'accéder à l'humanité, et parallèlement des modèles d'humanité qui finissent par perdre la leur. Une méditation d'une extrême lucidité, qui nous donne la clef, entre autres, d'une des grandes énigmes de notre monde : pourquoi les peuples baisent-ils avec adoration le pied qui les écrase ?
...Il y aura toujours un peuple, ignorant, admirant ses oppresseurs et haïssant ses libérateurs. Et cela, parce qu'un esclave comprend bien mieux son maître, si cruel soit-il, que son libérateur, car chaque esclave s'imagine très bien à la place de son maître, mais bien peu s'imaginent à la place d'un libérateur désintéressé.
La traduction de Bernadette du Crest et Viktoriya Lajoye semble bien accordée à la verve robuste de l'écriture. Le titre, lui, est d'une mollassonnerie lamentable : Troùdno bit' bògom, bref, compact, appelait irrésistiblement Dur d'être un dieu. N'est-ce pas la main de l'éditeur, Denoël en l'occurrence, qui a frappé ? Elle est bien lourde parfois...
 Image du film. |
Reposons-nous un peu avec Daniel Mendelsohn. Non, je n'ai pas lu son roman, Les disparus, qui fit un tabac dans nos contrées il y a dix ans, ni Une odyssée, récit autobiographique récemment traduit en français (mais cela ne va pas tarder). J'ai simplement lu et fort apprécié son Cavàfis anglais. Car nous avons tous deux traduit, dans nos langues respectives, l'intégrale des poèmes du vieux d'Alexandrie, ce qui fait de nous des compagnons d'aventure.
Mais si Mendelsohn, brillant professeur par ailleurs, est connu dans son pays, nous dit-on, c'est surtout comme critique. Et voici, en J'ai lu, sur 600 pages, un large échantillon de son travail dans ce domaine. Il y a là de tout, littérature (James, Wilde, Cavàfis bien sûr) mais aussi théâtre (Tennessee Williams) et cinéma (Sofia Coppola, Almodovar...), plus un beau texte autobiographique.
Tout cela est fort savant, mais fort vivant aussi, et l'on se dit tout du long que décidément cet homme-là est un type bien doublé d'un excellent conseiller. Son étude sur Philip Roth, par exemple, est un modèle de lucidité subtile. Il m'explique lumineusement pourquoi je fais bien d'éviter les films de Tarantino comme la peste. Il m'amuse en démontant quelques nanars en péplum. Et tout en tressant des couronnes à Homère (comment faire autrement, grands dieux !), il m'aide à comprendre pourquoi les vaillants guerriers de l'Iliade me sont cruellement étrangers.
 300, de Zack Snyder, nanarissime. |
L'une des rengaines de la critique littéraire, c'est le couplet contre l'autobiographie, le «misérable petit tas de secrets» comme disait l'autre bouffi — couplet qui à la lecture de nombreux livres apparaît cruellement poussif et dérisoire.
Exemple, La mer c'est rien du tout, de Joël Baqué, chez P.O.L. Que fait-il, Baqué, sinon raconter sa petite vie ? La province, une famille de petites gens, non pas miséreux mais «un peu justes», le père détestable, la grande sœur canon, le sport, l'entrée chez les gendarmes puis les CRS... Un ancien CRS qui écrit, d'accord, c'est peu banal, mais vaguement inquiétant tout de même. Et pourtant ce petit livre, fait de petits paragraphes racontant de petits riens, est mon coup de cœur de ce mois.
Le père :
Il aimait dire : «Tout ça c'est que des bouillacades !» Les bouillacades incluaient les Clodettes, les promesses électorales, le peintre Soulages, les minijupes, les vacances, les sentiments, les disques de ma sœur, la joie de vivre.
De nouveaux voisins sont arrivés que mon père a immédiatement détestés parce qu'ils étaient sociables (il aimait ne pas aimer).
Acheter du fromage à la coupe était aussi inimaginable que boire du thé ou sourire à un étranger.
On lui pardonne ses choix professionnels, après une telle enfance.
Son malheur passé fait notre bonheur : tout le récit ou quasiment est de cette eau, d'une densité, d'une intensité, d'une acuité exceptionnelles. Et avec ça, de brèves bouffées de poésie, imprévues, incongrues, d'une profonde justesse. La sœur :
Ses yeux noyaient le ciel dans la mer.
L'été, le ciel brûlait d'ennui.
La tramontane retournait la chaleur comme un gant et faisait claquer les volets comme les pétards qu'on lançait autour du toro de fuego.
Eh bien moi qui n'aime pas la corrida, en lisant Baqué, je dis «oléééé !» à presque toutes les lignes.
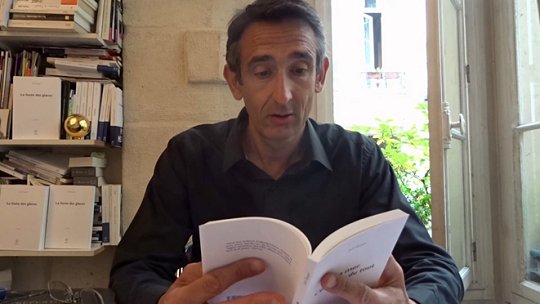 Joël Baqué, ex-CRS |
Et voilà qu'en écoutant l'album 9 de Brassens, je tombe sur «L'épave», chanson peu connue, où un poivrot, ivre-mort dans la rue, est secouru par un bon flic.
Et depuis ce jour-là moi le fier le bravache
Moi dont le cri de guerre fut toujours Mort aux vaches
Plus une seule fois je n'ai pu le brailler
J'essaye bien encore mais ma langue honteuse
Retombe lourdement dans ma bouche pâteuse
Ça n'fait rien Nous vivons un temps bien singulier
Un flic dans le rôle de l'Auvergnat, du bon Samaritain ! Brassens n'a pas tort, il y a de bons flics, même s'ils sont souvent bien cachés.
Les autres chansons de l'album sont un peu éclipsées par la première, la plus longue de Brassens et l'une des plus belles : La «Supplique pour être enterré sur la plage de Sète». Il n'y a pourtant là que des trésors. Archiconnus parfois, eux aussi : «La non-demande en mariage» («J'ai l'honneur de / Ne pas te de- / -mander ta main»), «Le pluriel» («Je suis celui qui passe à côté des fanfares / Et qui chante en sourdine un petit air frondeur») ou «Le bulletin de santé» («Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses / C'est que je baise, que je baise»), chanson chargée de compenser le côté funèbre de la «Supplique».
D'autres chansons mériteraient la gloire elles aussi, comme «Les quatre bacheliers», fort évangéliques, ou «Le moyenâgeux», hommage ému à ce voyou de Villon :
Pardonnez-moi Prince si je
Suis foutrement moyenâgeux
À noter l'abondance de clins d'œil à d'autres poètes, puisqu'outre Villon, Brassens évoque Valéry et son cimetière, et Mallarmé bien sûr, dont le sublime «Je suis hanté. L'azur ! L'azur ! L'azur ! L'azur !» devient
Je suis hanté Le rut le rut le rut le rut
 Hanté, lui aussi... |
Nostalgie (suite). Plus de vingt ans après sa mort, revoilà Doisneau.
Devenu célèbre pour ses photos parisiennes et banlieusardes des années 40, le grand photographe repartit extra muros quarante ans plus tard, en 84-85, dans le cadre d'une mission photographique de la Datar. Ces photos restèrent dans les cartons, mais en voici enfin une partie dans La banlieue en couleurs, à La Découverte. Sont associées aux images nouvelles, en contrepoint, quelques anciennes en noir et blanc, parfois inédites, semble-t-il. Mais ce ne sont pas des fonds de tiroir : «Pavillons à Noisy-le-Sec, 1945» ou «Le nouveau Créteil, 1968», par exemple, qui combinent magiquement noirceur et lumière, ambiance lugubre et enchantement, sont le départ de rêveries infinies.
Auréolé de sa légende, et du même coup englué en elle, condamné à refaire la même chose ou à ne pas être accepté, Doisneau a eu le courage de se renouveler. Qu'il ait choisi la couleur ou qu'on la lui ait imposée, il explore à fond cette nouvelle voie, avec des résultats frappants. Il tire excellemment parti des contrastes spectaculaires entre l'ancien et le nouveau (ah ! «Cité Champagne à Argenteuil» !). Mais ce qui rend ces nouvelles images passionnantes, et attachantes, c'est surtout qu'on y sent le photographe tiraillé entre sa volonté de «ne jamais faire la gueule» à ce qu'il voit, de «chercher toujours des raisons de s'émerveiller», du charme, de l'humanité — et un certain désenchantement. La nature de la commande n'y est sans doute pas pour rien : ce qui domine ici, c'est une certaine solitude, un certain vide. L'être humain est rare, écrasé par les architectures, et les images vues de haut donnent l'impression de s'envoler lentement, quittant des lieux devenus irrespirables.
La chaleureuse préface de Claude Eveno donne un tas de détails précieux ; dommage qu'elle soit rédigée de façon si pesante...
 Gentilly, quartier du Chaperon vert |
Côté BD, deux albums.
D'Etienne Davodeau, Quelques jours avec un menteur (Delcourt), où cinq vieux potes dans les trente ans s'offrent une semaine de vacances entre hommes. Ça vanne sec, on se poile, on se frite par moments, on est ému aussi. Tout cela est bien vu, bien senti, raconté avec tendresse et pudeur, à la Davodeau.
 Les cinq potes. |
Pascal Rabaté, lui, nous donne la seconde partie de sa Déconfiture, chez Futuropolis : 1940, l'exode, des soldats français faits prisonniers par les Allemands, certains s'évadent, l'un d'eux s'en sort, les autres on ne sait pas. Tout cela en noir et blanc, belles scènes de nuit, en ombres chinoises, dessin dépouillé, superbe.
Pourquoi les réunir, ces deux albums ? Parce qu'ils sont cousins. Chacun d'eux décrit un groupe d'hommes, loin des femmes, avec un sens bien affûté du dérisoire, un fin mélange d'ironie et d'attendrissement, d'humour et de mélancolie, à savoir les qualités que le sujet réclame ; parce que Davodeau et Rabaté sont là au sommet de leur talent ; parce qu'à force de les suivre et d'aimer ce qu'ils font, ces deux-là, on en est venu à voir en eux de vieux amis. Merci les gars, et à bientôt !
 Les Allemands l'ont tué, les Français l'enterrent. |
Côté cinéma, ce mois-ci comme les précédents, nous avons vu défiler sur les programmes des palanquées de films passionnants, et nous ? Quatre seulement au compteur, misère !
The servant de Joseph Losey (1964), cinquante ans après, intact, Losey et Bogarde également éblouissants.
Les plages d'Agnès, de Varda (2009), regardé non sans plaisir avant de m'apercevoir, à la dernière bobine, que je l'avais déjà vu à la sortie.
L'un des grands classiques du cinéma, l'un des premiers films parlants, le premier à ne montrer que des Noirs, Hallelujah de King Vidor (1929) avance avec lenteur, beau et noble comme un grand fleuve., baigné de musique et musical jusque dans ses images.
Un film de l'année, un seul : En guerre, de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, récit d'une grève dure et de son échec. Fort, intelligent, combatif sans tomber dans la caricature, cette fiction produit un effet de réel hallucinant — c'est sa grande vertu, et sa petite limite, mais ne chipotons pas : voilà encore un film nécessaire pour qui veut comprendre comment il fonctionne, le grand film dont nous sommes tous les figurants minuscules.
 Vincent Lindon entouré d'acteurs non-professionnels. |
En ces jours politiquement désespérants, que faire ? Applaudir des films engagés, contestataires ? Comme ils ont l'air vieillot eux-mêmes, ces deux mots ! Comme on se sent ringard en rêvant à un peu de justice et d'humanité ! Quels médocs nous ont-ils tous abrutis à ce point ?
En cherchant bien, tout de même, on trouve une consolation. L'évacuation de Notre-Dame-des-Landes et sa violence imbécile, c'est la preuve que les écolos font peur, qu'ils sont ressentis de plus en plus comme une menace pour ceux qui nous gouvernent. La répression brutale, disproportionnée de l'actuelle agitation étudiante, pourtant si timide, c'est le signe que les jeunes aussi sont un danger pour lui et ses maîtres. Si le freluquet montre ses biscotos, c'est que sous ses grands airs il a les jetons.
Il crève de peur, le matamore. Le peuple immense des populistes l'effraie tellement qu'il tape sur les migrants pour l'amadouer. Il voulait bannir le glyphosate, et les industriels de la bouffe lui font avaler son bicorne impérial. Napoléon, lui ? Badinguet plutôt.
 Sur une autre affiche : Macron, pantin de la finance. |
Autre consolation : instaurer l'égalité des salaires entre hommes et femmes, pas question, bien sûr, mais on offre à ces dames une riche compensation : l'égalité par la grammaire ! L'orthographe inclusive, c'est du pipeau sans doute, mais ça occupe le terrain et détourne les gentilles foules naïves des vrais problèmes.
Ceux qui douteraient encore du bien-fondé de cette réforme (j'ai d'abord tapé méforme) doivent méditer ces lignes extraites d'un texte officiel, qui font le tour du Net :
«Le point milieu permet d'affirmer sa fonction singulière d'un point de vue sémiotique et par là d'investir frontalement l'enjeu discursif et social de l'égalité femmes/hommes».
Lumineux ! Comment ne pas être convaincu ?
Décidément, nous sommes dans de bonnes mains.
 Est-iel un femme ou une homme ? |
En juillet, Zamiatine, Sheckley, Makyo, Farina, Toulet, Verhasselt, Pouchet, et en prime, pour ceux qui vont aller en Grèce, Cadenel et Houzoùri. Ça suffira ?
 |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Tout événement est comme une figure qui nous cache de quel fond elle surgit. L'événement est un trait d'écume dansant sur les profondeurs.
La logique n'a d'autre objet que de sanctionner les conquêtes de l'intuition.