
Larry Poons dans ses œuvres.
BRÈVES
N°172 janvier 2018
Montréal, trente ans après. À l'aéroport, policiers et douaniers plutôt bienveillants, parfois même souriants. Impression d'être accueilli par un peuple civilisé, et non d'atterrir, comme à New York, dans un pays malade et méchant, sous la menace d'une statue géante brandissant son gourdin, comme si Carole et moi nous apprêtions à leur dégommer une tour ou deux.
Noël sous la neige, comme dans les vieilles histoires. Le thermomètre descend jusqu'à -16, une température que je n'ai connue dans nos régions qu'une fois en 70 ans. Pas de panique : une bonne doudoune permet de l'affronter sans douleur. Les cyclistes roulent comme si de rien n'était sur le verglas ou la neige, l'un d'eux escalade allègrement le Mont Royal dans la poudreuse.
Femmes emmitouflées réduites à leur visage éclairé par le froid, enchâssé dans leur capuche à fourrure, brillant comme un bijou.
Au musée des Beaux-Arts, dans la petite salle d'art inuit contemporain, toute une série de sculptures étonnantes, créatures fantastiques où parfois l'animal et l'humain se mêlent, où l'imagination déborde, où s'efface la frontière entre art populaire et art savant.
Dans les salles des nouvelles acquisitions, au milieu d'un sympathique bric-à-brac, arrêté soudain par la toile d'un non-figuratif américain dont j'ignorais tout : Larry Poons. Grande, verticale, élégante, elle piège mon regard qui va et vient entre le fouillis exubérant du détail et l'ampleur tranquille du geste d'ensemble. Comment a-t-on pu qualifier d'abstrait cet art qui tout en ne montrant rien de précis peut exprimer parfois une foule de choses, à l'image de cette nouvelle venue d'où émane, sans que je comprenne pourquoi, tant de tendresse, de sérénité, de bonheur ?
 Larry Poons dans ses œuvres. |
Nous racontons à l'ami Vincent, la cinquantaine, qu'à l'aéroport l'un des douaniers nous a dit : Passez Carole, passez Michel. Il répond qu'à son époque, dans les écoles primaires et secondaires québécoises, les élèves appelaient les profs par leurs prénoms et même les tutoyaient. Ce qui, précise-t-il, n'empêchait nullement le respect. Peuple civilisé, vous dis-je. Depuis on est revenu au vouvoiement et à monsieur-madame. Les vieux réacs sont immortels, et le Canada lui-même n'est pas à l'abri.
 Ils tutoient la beauté. |
Les voyages continuent avec l'Atlas des cités perdues, chez Arthaud. Aude de Tocqueville nous y fait découvrir, un peu partout dans le monde, quarante villes fantômes, mortes brûlées, englouties ou simplement abandonnées. Au générique, plusieurs stars : Pompéi, Carthage, Angkor, Teotihuacán... mais aussi beaucoup d'autres cités moins connues, et non moins fascinantes. Certaines très anciennes, et d'autres très récentes, ce qui est presque plus troublant. On ne voyage pas seulement dans les plus lointains passés, mais aussi dans le futur — un futur avorté, avec ces cités de rêve, utopistes, radieuses, que le choc du réel a transformées en enfer, puis en désert. Telle la benjamine du recueil, l'espagnole Seseña, née peu après l'an 2000 et morte en bas âge : «Une chimère, née aux confins de la Castille et de la Manche où Don Quichotte lui aussi divaguait. Une folie architecturale née d'une mégalomanie sans limites et de la spéculation immobilière effrénée» de ces années-là. Ou Prypiat en Ukraine, conçue comme une cité modèle, vitrine du socialisme triomphant... à quelques verstes de Tchernobyl. Ou Kantubek en Ouzbekistan, sur une île de la mer d'Aral, ancien centre de recherches soviétique sur la guerre biologique, interdite elle aussi, contaminée à mort.
Ce qui revient comme un leitmotiv dans ces récits funèbres, c'est l'hubris, la folle ambition de l'espèce humaine. Ses infinies facultés de nuisance. Et son extrême fragilité.
Le défaut de ce livre grand format au prix modique, c'est l'absence d'illustrations correctes. Pas une photo, pas un dessin, rien que des cartes vagues et moches. Heureusement l'étrangeté extrême de ces lieux est bien rendue par des textes sobres, précis, évocateurs, base de départ pour des rêveries infinies.
 Prypiat, cité radieuse... |
On se sent à l'étroit sur notre petite planète ? On n'a qu'à s'offrir la SF et ses immenses voyages dans l'espace et le temps.
Les croisés du cosmos (The high crusade), de Poul Anderson, l'un des classiques du genre, ne nous emmène pas dans le futur comme c'est l'usage, mais au XIVe siècle ! Un vaisseau spatial atterrit dans la campagne anglaise dans le but d'envahir la terre, mais contre toute attente, les villageois écrabouillent cet ennemi infiniment supérieur, s'emparent du vaisseau, s'en vont dans l'espace et après moult abracadabrantes péripéties finissent par conquérir l'univers. (Canevas qui rappelle un film délicieux, La souris qui rugissait, où une minuscule principauté terrasse les Etats-Unis.)
À la jubilation de voir David vaincre Goliath s'ajoute ici l'admiration devant les prouesses de l'auteur : rendre une pareille histoire aussi vraisemblable que possible, faut le faire. Mais si l'on se régale tout du long, c'est aussi qu'Anderson exploite finement le comique de la situation et met en boîte avec une ironie délicieuse, deux sentiments archaïques : le patriotisme et la bigoterie, alors triomphants, et plus bébêtes que jamais.
Mais s'il se moque, c'est gentiment, et de façon nuancée. Remarquable, en particulier, le portrait du héros, le nobliau local, fruste et brutal mais d'une bravoure extrême, et qui va se révéler très malin — à la fois ridicule et admirable.
Dernier sujet de réjouissance : les discrets mais savoureux clins d'œil à la langue médiévale, hélas aplatis par une traduction correcte, mais plate et traînant la patte. Exemple :
«But all stood their ground, being Englishmen, if not simply too terrified to run.»
Ce qui devient :
«Mais personne ne bougea d'un pouce ni ne céda du terrain, c'étaient tous des Anglais — où peut-être étaient-ils simplement trop terrifiés pour s'enfuir.»
Alors qu'il suffisait de suivre le texte :
«Mais nul d'entre eux ne recula d'un pouce, car ils étaient Anglais, ou simplement trop terrifiés pour courir.»
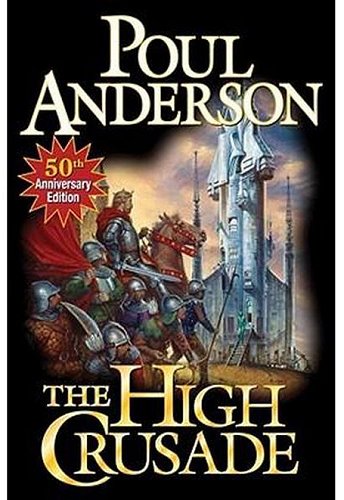 Couverture en v.o. |
George Sanders, acteur bien connu des vieux cinéphiles, qui brilla dans les années 40 et 50 chez Hitchcock (Rebecca), Lewin (Le portrait de Dorian Gray), Mankiewicz (Ève, L'aventure de Mme Muir), Lang (Moonfleet) et plusieurs autres, fut anglais jusqu'au bout des ongles, dans ce que l'Angleterre a de meilleur à offrir au monde : la pudeur cachée par un masque d'excentricité élégante et froide. Ses mémoires, dont on peut croire qu'il les écrivit seul, le montrent tel qu'il apparaît dans la plupart de ses rôles : «une espèce de canaille aristocratique», un type «infect mais jamais grossier». Ces Mémoires d'une fripouille (PUF) sont un festival de drôlerie ravageuse, de cynisme élevé au rang des beaux-arts, d'auto-dérision surtout — et c'est ce dernier point qui rend la misanthropie du monsieur supportable et son humour profondément attachant. D'autant que quelques rares passages, où un homme différent, hypersensible, apparaît par éclairs, laissent penser que la froide rosserie du personnage fut en grande partie un masque.
Étant une personne d'un goût des plus raffinés, j'encours continuellement ma propre désapprobation, puisque mes standards sont trop élevés pour que ma performance puisse jamais s'en montrer digne. J'exige la perfection, mais ne puis que produire la médiocrité.
Des perles pareilles, il y en a presque à chaque page de ce livre si brillant, plein d'une verve légère qui survit même aux lourdeurs de sa traduction. Parmi les morceaux de bravoure, le portrait vachard de Rossellini tournant Voyage en Italie, qui a dû donner des envies de meurtre aux fans du maître...
 George Sanders |
Les plus beaux livres sont souvent écrits en infra-ordinaire — comme si on pouvait se placer en dessous du langage, se frayer un chemin sous les parquets, entre les cloisons, ne restituer que des bribes et exécuter par exemple le plus beau poème américain possible en prélevant quelques minutes d'un procès ordinaire. Ce n'est pas le style qui pose problème, c'est le styliste. On le sent caché derrière, polissant sa syntaxe, devenu son propre secrétaire, se dandinant chez lui au rythme de ses phrases, en veste d'intérieur rouge.
Ces quelques lignes pour tâcher de comprendre pourquoi la superbe Histoire de la littérature récente (tome II) de l'admirable Olivier Cadiot m'agace un peu.
Tout est là : juste remarque sur les vertus du dépouillement, images neuves et fortes, vaste érudition, refus de donner les noms (le poète en question, tant pis pour ceux qui ne savent pas ou ne se rappellent pas son nom), affirmations et injonctions péremptoires, le plus souvent moqueuses. «Jetons les cassettes, tous les supports audio» ! N'écoutons pas les voix du passé ! On croirait Saint-Just.
On a l'impression que du haut de son talent Cadiot se paie la fiole de beaucoup de monde, comme ici les pauvres tâcherons dans mon genre qui soignent leur style. Cela me rappelle Camus, dans La peste, raillant l'un de ses personnages qui travaille longuement ses phrases. Comme si lui-même ne troufignolait pas les siennes ! Et Cadiot, donc, qui nous livre des textes bien écrits, si brefs et serrés qu'ils en deviennent parfois énigmatiques ! De quoi parle-t-il exactement ? et sur qui tape-t-il ? Je ne le comprends pas toujours, j'ai affaire à plus fort que moi, et c'est cela aussi, sûrement, qui m'agace.
Attention, le titre est trompeur : il n'y a rien d'historique dans ces courts chapitres consacrés essentiellement à la lecture et l'écriture. Ce gag du titre décalé, je n'en vois pas bien l'utilité, mais trêve de bougonneries : des gens très bien disent de lui beaucoup de bien, ils ont sûrement raison. J'ai moi-même trouvé au fil des pages un tas de remarques précieuses, du genre :
Le lecteur «doit être à ras de terre et propulsé dans le ciel alternativement».
«On lit des livres pour trouver la bonne distance avec la vie.»
«Il arrive que des choses se répondent dans un livre. La première est élue par la seconde. Elle la salue au passage. Alors ça vibre, ça s'allume, le courant passe. (...) Des choses qui n'ont rien à voir s'organisent un instant en rapprochements brûlants.»
Chouette, non ?
J'y reviendrai quand je serai plus grand.
 Olivier Cadiot himself. |
M'étant offert un gros volume Omnibus des œuvres d'Alphonse Daudet (Romans, contes, récits, plus de mille pages), je comptais m'attaquer à Numa Roumestan ou Sapho, et voilà que je craque pour Le petit Chose.
Je l'avais pourtant déjà lu, combien de fois ? trois ? quatre ? Au début j'étais tout petit, et comme beaucoup d'enfants, j'imagine, j'ai été bouleversé par cette lugubre histoire. Certaines scènes, certains personnages (Banban le gamin qu'on persécute, le bon abbé Germane qui console, la mort de Jacques le grand frère protecteur) et jusqu'à certains noms et phrases entières sont restés gravés en moi.
Ce que je découvre, c'est le commentaire de Daudet sur son roman, qui confirme mes impressions de relecture : la première moitié (l'enfance, le terrible collège cévenol), très autobiographique, n'a rien perdu en force, en émotion, en charme, alors que l'épisode parisien, nettement plus romancé nous dit-on, est un ton au-dessous, plus artificiel, lourdement mélo par moments. Ce qui relie tout de même les deux parties, c'est le personnage principal, faible, naïf, puéril, qui attire à lui tous les malheurs et dont l'abbé a dit qu'il serait toujours un enfant.
De fait, Le petit Chose, dans la partie romancée surtout, suit le même schéma narratif que Pinocchio : un être bon mais immature et irresponsable ne cesse faire des bêtises, de s'en repentir et de recommencer, au grand désespoir de son protecteur.
Parmi les plus beaux passages, ceux où apparaît la jeune fille qui fera fondre le cœur du héros. Il s'agit en fait, l'astuce est là, de deux êtres en un seul :
...d'abord Mlle Pierrotte, une petite bourgeoise à bandeaux plats, bien faite pour trôner dans l'ancienne maison Lalouette ; et puis les yeux noirs, ces grands yeux poétiques qui s'ouvraient comme deux fleurs de velours et n'avaient qu'à paraître pour transfigurer cet intérieur de quincailliers burlesques. Mlle Pierrotte, je n'en aurais pas voulu pour rien au monde ; mais les yeux noirs... oh ! les yeux noirs !...
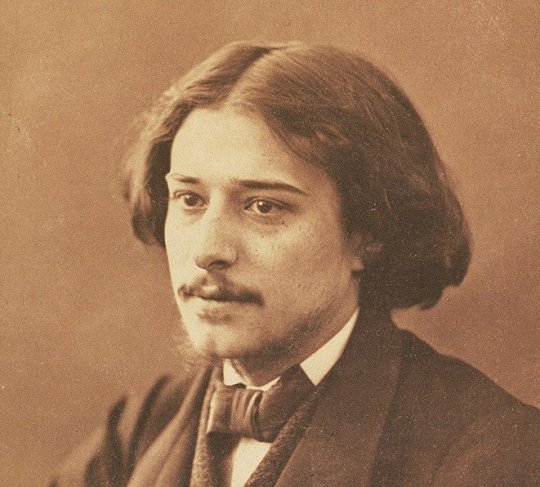 Alphonse Daudet jeune. |
Autre vieille connaissance : Daniel Boulanger, l'un de nos grands nouvellistes. Comment se fait-il que sa novella Connaissez-vous Maronne ? (Gallimard) ait fait antichambre sur mes rayons pendant trente-six ans ?
Dans Maronne, station balnéaire du nord, déserte en mars, une jeune femme est retrouvée morte. Suicide ou crime ? Un commissaire interroge l'unique suspect pendant une centaine de pages, et leur dialogue ne va cesser de nous surprendre jusqu'à la toute fin. L'affrontement tendu alterne avec les échanges amicaux, les rôles s'inversent parfois, la rêverie et la philosophie s'invitent brièvement, l'auteur emporté par son talent pousse un peu trop loin par moments sans doute, mais qu'importe : ses excès lui ressemblent, ils font partie de son charme, de son dédain princier pour la plate vraisemblance.
Ils sont même plus que cela : à l'image de son héros, photographe retoucheur, dans cette histoire comme dans toutes les autres Boulanger retouche la réalité — ce qui ne signifie pas la trafiquer pour l'embellir, mais jouer avec elle à la recherche d'une vérité plus profonde.
Son personnage rêve beaucoup et lit beaucoup — comme l'auteur, on s'en doute. En lisant,
J'ai parfois des éclairs, des ouvertures. Il me semble que je vais enfin comprendre.
— Comprendre quoi ?
— Pourquoi je suis là, je veux dire sur cette terre, et vous, et les choses, avec cette toute petite avance sur la mort.
On ne comprend jamais vraiment, mais quelques bons livres nous amènent tout près du secret. Voilà ce que dans ces quelques pages précieuses Boulanger nous offre, par delà son étourdissant numéro d'enchanteur.
 Daniel Boulanger |
Efim Etkind, traducteur et théoricien de la traduction, a laissé à notre confrérie une sorte de bible : Un art en crise, sur la traduction de la poésie, ouvrage essentiel, apparemment épuisé — encore un scandale. Je retrouve maître Etkind avec un tout petit livre, petit par la taille, La traductrice, où il fait revivre sa consœur Tatiana Gnéditch. Celle-ci, férue de poésie anglaise, persécutée par le régime soviétique — tout comme Etkind lui-même plus tard —, traduisit en prison, dans des conditions épouvantables, le Don Juan de Byron. Elle le savait par cœur. Le résultat, nous dit Etkind, est un chef-d'œuvre.
La passion de traduire, l'amour de la poésie, traduire contre le désespoir et l'oppression : ces quelques pages déchirantes devraient être lues par tous les traducteurs, et par les autres aussi. Elles sont traduites — fort bien, semble-t-il — par Sophie Benech, qui les publie aux éditions qu'elle-même a créées, Interférences, dont notre Miel des anges est une sorte de cousin grec.
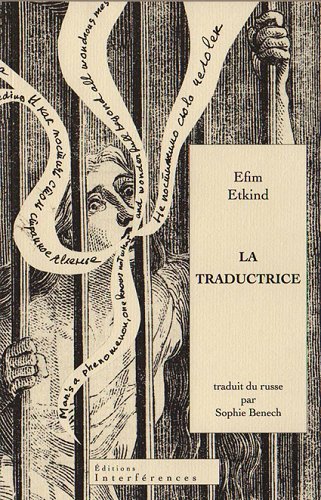 La couverture. |
La poésie, belle étrangère aguicheuse, qui s'offre et se refuse... La poésie contemporaine surtout, dans l'arrogance de sa jeunesse. Toute jeune encore, celle d'Ariane Dreyfus, née en 1858, que j'avais déjà lue il y a sept ans. Son recueil L'inhabitable, à l'époque, je n'avais pas su l'habiter à l'aise. Ai-je progressé depuis ?
Non.
Pourtant les poèmes de La terre voudrait recommencer (Flammarion) sont denses et concrets, pleins de fraîcheur et de sentiment. Ils parlent surtout des corps, corps qui s'aiment, corps des artistes de cirque — souvent ce sont les mêmes. Ces poèmes, je les sens par moments, les pressens, comme on devine un corps nu sous un drap, mais toujours quelque chose m'échappe, je ne suis que visiteur, et je n'ai même pas la ressource de les traduire pour mieux les saisir.
Devant la mer j'ai besoin que tu aies un visage
Pour savoir où je suis.
Tu suffis.
Tu me tiens
Hors de l'éternité inhumaine.
Homme chaud et sûr
J'entrouvre ton aisselle et dans l'angle regarde
Un coin rescapé
D'une mer devenue précieuse et petite.
Moi aussi.
Je suis petite et précieuse.
Celui-là, «Triangle intime», je le tiens presque ; mais certains autres... Il faut se faire une raison : les poètes sont des espèces de mutants, d'extra-terrestres, et moi je ne serai jamais qu'un simple mortel. Ce qui ne m'empêchera pas, Ariane ma sœur, de faire un nouvel essai dans sept ans.
 Ariane Dreyfus |
Brassens, 4e épisode. 1956-57. Dans cet album, une fois de plus, rien que du meilleur. Chansons d'amour («Je me suis fait tout petit», «L'amandier» doux-amer, méconnu hélas), chansons de mort («Oncle Archibald») et d'enterrement («Grand-père»), chanson de copains («Au bois de mon cœur», où défilent mes chers bois de Vincennes, Clamart, Meudon, Saint-Cloud). Les deux plus impressionnantes, peut-être : «Le vin», où l'ivresse est palpable, avec les mots coupés à la rime qui titubent («Quand on est un sa- / ge et qu'on a du sa- / voir boire»), les longues voyelles vacillantes, et «La marche nuptiale», où les parents du poète se marient à un âge avancé, sous l' «œil protubérant» des passants honnêtes.
Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs
Berçant comme un' poupée son gros bouquet de fleurs
Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue
Sur mon harmonica jouant les grandes orgues.
Brassens la chante avec une lenteur impressionnante.
 Brassens en ce temps-là. |
Au cinoche, peu de chose, mais du bon.
Western, film allemand de l'année, scénario et mise en scène de Valeska Grisebach, où les codes du western s'appliquent aux relations tendues entre travailleurs allemands et villageois bulgares. C'est lent, rugueux, mais finalement riche et subtil.
Ressuscité par le DVD, Rue des cascades, de Maurice Delbez (1964) nous emmène à Ménilmontant vers 1960, vu à travers les yeux d'un groupe de gosses. Charmes de la nostalgie, fraîcheur, sensibilité, justesse, ce film oublié méritait de revivre.
Simon du désert de Luis Buñuel (1965), vu à sa sortie jadis. 45 minutes seulement, on aimerait davantage de films dans ce format, mais la brièveté de celui-ci, involontaire (producteur défaillant) le dessert plutôt. Simon le très saint ascète sur sa colonne, est-il sur la bonne voie ou s'égare-t-il ? Que veut dire cette fin en queue de poisson ? Au fond, n'est-ce pas aussi bien de ne pas le savoir ? Restent plusieurs moments forts, dont les réjouissantes interventions du Démon — d'une démone en fait, satanément sexy...
 Le saint et la démone. |
Si j'avais lu les critiques, je ne serais pas allé voir A ghost story, film nouveau de l'Américain David Lowery : plusieurs journaux dignes de foi ont craché sur cette étrange histoire d'un homme qui à sa mort se met à hanter sa maison. Quant à moi, j'ai été séduit peu à peu, profondément, par les longues séquences lentes et intenses, les surprises, les énigmes, la tranquille mélancolie de ce discret bijou.
 Le fantôme et sa compagne. |
Enfin, seule une charmante modestie m'empêche de chanter ici tout le bien que je pense du film d'Henry Colomer, Des voix dans le chœur, dont je suis l'un des trois protagonistes avec Sophie Benech, traductrice de russe, et Danièle Robert, qui vient de traduire en vers L'enfer de Dante. Un film de plus d'une heure sur la traduction de la poésie, un «éloge de la musique qui sommeille dans les mots», comme l'écrit la pochette, qui l'eût cru ? Qui l'eût osé, à part Colomer, ce fou magnifique ?
Des voix dans le chœur sera disponible en DVD dès le début de ce mois.
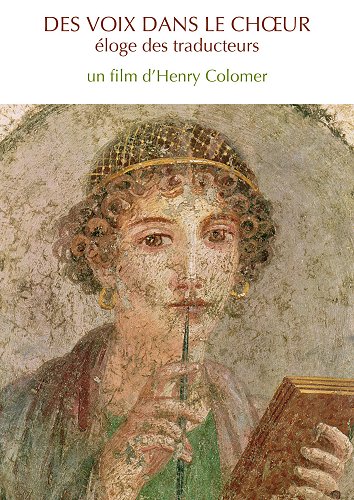 Le DVD ressemble à ça. |
À part ça, quoi de neuf ? Jean et Jean-Philippe défunts se disputant la première page des gazettes : choc de titans, guerre des étoiles !
Cet événement planétaire en a caché d'autres à peine moins tragiques. Le jeune pète-sec qui nous gouverne prend contre les migrants de nouvelles mesures scélérates, qui lui vaudraient d'être jugé un jour s'il existait un bon dieu quelque part. En même temps, il lance contre le réchauffement climatique, à coups de grosse caisse et de pipeau, des appels aussi vertueux qu'inutiles. Comme s'il pouvait changer quelque chose. Comme si quelqu'un pouvait encore freiner la machine emballée. Il nous poudre aux yeux, le petit malin. Ce couillon de Trump, lui au moins, est plus franc.
Nos compatriotes ? Face au danger, la majorité d'entre eux roupillent et roupilleront jusqu'à la mort. Même si devant l'évidence les voix clamant dans le désert se multiplient.
Le journaliste Stéphane Foucart, du Monde, en première ligne, se démène avec une énergie et un talent qui viennent de lui valoir le prix Varenne.
On me signale l'existence de l'institut Momentum, où des chercheurs, des journalistes, des ingénieurs et des acteurs associatifs réfléchissent ensemble aux moyens de sauver ce qui peut l'être encore. Leur site, institutmomentum.org, très pointu, mérite qu'on s'y attarde.
Enfin, pas besoin de croire à une bonne année 2018 pour la souhaiter — comme toujours en pointe dans l'inclusivement correct — aux humain.e.s de bon.ne volonté.e ! (Pourquoi la volonté serait-elle purement féminine, non mais alors ?)
 Ça chauffe pour la planète... |
Au programme de février : Mérimée, Boulgakov, Jourdan, Laget, Linhart, Lambert-Ullmann, Curval, Bilal, Brassens, et des nouvelles du serpent à plumes. Bref, de tout pour tous les goûts !
 |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Il vaut mieux reverdir que d'être toujours vert.
De la modération en toutes choses — y compris la modération elle-même.