
Jacques Balmat, premier vainqueur du Mont Blanc, 1786.
BRÈVES
N°145 Octobre 2015
Senancour... Voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis le temps des études et du Lagarde-et-Michard. C'est dans ce digne mausolée de papier qu'il repose, entre Benjamin Constant et Chateaubriand, sur trois petites pages. On doit pourtant le lire encore, puisque Folio classique a réédité son œuvre la plus connue, Obermann — programmée à l'agreg sans doute.
Et tirée du chapeau par la main salvatrice de Carole.
Senancour a une importance au moins historique, à la jointure entre le XVIIIe siècle (il prolonge Rousseau) et le XIXe romantique. Obermann, son héros, son double apparemment, est une parfaite illustration du mal du siècle d'alors : il s'ennuie, d'un ennui collant, permanent, incurable. Tout jeune encore il fuit le séminaire à quoi son père le condamne pour arpenter la forêt de Fontainebleau, puis les Alpes suisses, sans parvenir à semer son vague à l'âme — lequel, toutefois, décroît un peu à mesure qu'il s'élève :
«Sur les terres basses, c'est une nécessité que l'homme naturel soit sans cesse altéré, en respirant cette atmosphère sociale si épaisse, si orageuse, si pleine de fermentation, toujours ébranlée par le bruit des arts, le fracas des plaisirs ostensibles, les cris de la haine et les perpétuels gémissements de l'anxiété et des douleurs. Mais là, sur ces monts déserts, où le ciel est immense, où l'air est plus fixe, et les temps moins rapides, et la vie plus permanente ; là, la nature entière exprime éloquemment un ordre plus grand, une harmonie plus visible, un ensemble éternel.» Et ailleurs : «Comme l'âme s'agrandit lorsqu'elle rencontre des choses belles !»
Puis Obermann redescend, et son moral aussi, pour décrire son «apathie habituelle» et «l'intolérable vide qu'[il] trouve partout» sur 400 pages. Une gageure. On trouve là, il est vrai, quelques pages utiles et plaisantes ; Senancour se révèle, notamment, un excellent professeur de promenade :
«Je ne connais de promenade qui donne un vrai plaisir que celle que l'on fait sans but, lorsque l'on va uniquement pour aller et que l'on cherche sans vouloir aucune chose.»
Mais à ces précieuses réflexions se joignent d'autres plus philosophiques, compactes, épuisantes, Senancour se montrant aussi inlassable dans l'exploration de sa pensée que dans celle des sommets alpins, je m'essouffle à le suivre, je décroche vers le tiers du voyage, sur des sentiers particulièrement raides, attends-moi, Obermann, où es-tu ? J'en peux plus !
 Jacques Balmat, premier vainqueur du Mont Blanc, 1786. |
Récupérons sur le plat dans la steppe avec Nikolaï Leskov, au XIXe siècle toujours, un peu plus tard. Leskov a voyagé dans toute la Russie, a beaucoup observé, beaucoup écouté. Il décrit son pays avec une évidente sympathie qui n'altère en rien sa lucidité. Ses opinions anticonformistes et son appétit de justice sociale lui valurent la méfiance des gouvernants et des popes, méritant ainsi toute notre estime.
Son Gaucher, lu en mai dernier, m'avait laissé perplexe. J'avais alors incriminé la traduction. Deuxième essai avec trois nouvelles réunies sous le titre Le bœuf musqué, à L'âge d'homme. Nous revoici dans la Russie profonde, ses petites villes et ses villages perdus dans la nature immense, ses personnages pittoresques. Le Bœuf musqué par exemple, héros du premier récit : séminariste défroqué mais intensément croyant, pauvre comme Job, fraternel et bourru, parcourant les campagnes pour convertir les masses à son idéal de justice, c'est l'un des illuminés sans nombre qui arpentent alors le pays, souvent à pied, en proférant des discours aussi obscurs que prophétiques.
«Son trait distinctif était une évangélique imprévoyance. Fils d'un chantre de village, élevé dans la gêne et pour couronner le tout demeuré tôt orphelin, non seulement il ne s'inquiétait jamais d'une amélioration durable de son existence mais il semblait même ne jamais songer au lendemain. Il n'avait rien à donner, mais il était capable d'ôter sa dernière chemise et il prêtait la même disposition à chacune des personnes avec lesquelles il se liait : toutes les autres, il les appelait, en bref et en clair, des «cochons». Lorsqu'il n'avait pas de bottes, ou plutôt lorsque ses bottes, comme il disait, «bâillaient à se décrocher la mâchoire», il venait chez moi ou chez vous, prenait sans façon vos bottes de rechange si elles étaient un tant soit peu à son pied et vous laissait ses guenilles en souvenir.»
Plus russe que ça, tu meurs.
Le deuxième récit — mon préféré — est hanté par un autre personnage inoubliable, une espèce de sauvage craint et détesté de tous qui se révèlera être un ange de bonté. L'âme slave, là encore.
En arrière-plan, dans les trois nouvelles, un savoureux entrelacs de coutumes, superstitions et chants populaires, recueillis avec un soin d'ethnographe doublé d'une verve malicieuse. La traduction de Sylvie Luneau préserve le charme de l'ensemble et l'on se surprend à aimer cette Russie disparue, à qui le pays de Poutine, cette poubelle désespérante, prête par contraste des couleurs idylliques.
Certains font de Leskov l'égal de ses grands compatriotes, les Tchekhov, les Tourgueniev ; c'est peut-être pousser un peu loin, mais on a envie de cheminer encore avec lui. Je découvre dans ma bibliothèque une Pléiade où il cohabite avec Saltykov-Chtchédrine — l'aurais-je donc lu jadis ? Juste à côté, deux autres Pléiades, consacrées à Tourgueniev. Bon sang, Tourgueniev. Depuis combien d'années n'ai-je pas lu Tourgueniev ?
 Vagabond solitaire. |
José-Maria de Hérédia, poète parnassien, star en son temps, partage le destin de Senancour : la postérité n'a retenu que le nom d'un de ses livres, qu'elle ne lit même plus. Lagarde et Michard eux-mêmes le snobent. Les trophées, pratiquement son seul ouvrage, rassemblent une centaine de sonnets dont un seul, «Les conquérants», surnage vaguement dans les mémoires, et encore, souvent réduit à son premier vers : «Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal...»
Je rouvre ces Trophées, lus jadis, sans en attendre monts et merveilles. Je ne verrai sûrement pas s'élever «du fond de l'océan des étoiles nouvelles». Et en effet. Rutilants, grandioses, d'une virtuosité technique parfois ostentatoire avec ses mots rares et sonores, ses rimes acrobatiques (cf. le sonnet en -ustre...), les poèmes hérédiens sont d'une parfaite froideur. J'avoue cependant y avoir pris du plaisir, comme on admire un numéro de cirque, ou un château de Viollet-le-Duc ; même si en sortant de là, on aimerait se vautrer dans du Baudelaire pour retrouver la chaleur de la vie.
Ne dédaignons pas cet habile artisan, on ne peut pas ne fréquenter que des génies. On trouve chez lui, çà et là, quelques poèmes bien frappés, dans la partie pseudo-antique surtout. Témoin ce portrait sado-maso d'Artémis, qui flirte voluptueusement avec le kitsch :
L'âcre senteur des bois montant de toutes parts,
Chasseresse, a gonflé ta narine élargie,
Et, dans ta virginale et virile énergie
Rejetant tes cheveux en arrière, tu pars !
Et du rugissement des rauques léopards
Jusqu'à la nuit tu fais retentir Ortygie,
Et bondis à travers la haletante orgie
Des grands chiens éventrés sur l'herbe rouge épars.
Et, bien plus, il te plaît, Déesse, que la ronce
Te morde et que la dent ou la griffe s'enfonce
Dans tes bras glorieux que le fer a vengés ;
Car ton cœur veut goûter cette douceur cruelle
De mêler, en tes jeux, une pourpre immortelle
Au sang horrible et noir des monstres égorgés.
Kitsch ou toc ? J'aime ou j'aime pas ? L'hésitation fait partie du plaisir.
 Virginale et virile énergie. |
Je croyais le mois dernier faire mes adieux à Éric Dussert, après douze mois d'hommages aux auteurs oubliés qu'il a ressuscités dans son ouvrage monumental, Une forêt cachée, aux éditions de la Table ronde. Mais comment échapper à Dussert ? Comment résister quand on reçoit de l'excellent éditeur Serge Safran un ouvrage d'un des poulains dudit Dussert, René-Louis Doyon ?
Doyon, au siècle dernier, fit cent petits métiers avant de mourir dans la misère. Éditeur en faillite, écrivain inégal, parfois brillant, il réapparaît aujourd'hui avec son Éloge du maquereau, préfacé par Dussert en personne.
Non, ce n'est pas un ouvrage de pisciculture, mais une étude sur certain personnage qui prospère sur le dos des femmes. Éloge ? Que non. Ce que l'auteur chérit dans cet «être incomplet, veule, anormal par quelque point», c'est l'énigme qu'il représente. Celle de son nom d'abord, mais surtout celle du pouvoir exercé par ce désolant personnage sur une partie de la gent féminine.
L'ouvrage, à vrai dire, commence un peu péniblement par des considérations pas très fraîches sur la décadence de la langue française. Mais très vite ça s'arrange et l'ouvrage va prendre sans cesse hauteur et profondeur. Il y a d'abord l'enquête sur les appellations du personnage dans plusieurs langues, puis sur ses apparitions chez une foule d'écrivains. L'auteur fait preuve d'une impressionnante et non moins plaisante érudition — un vrai Dussert avant Dussert en quelque sorte — et d'un très salubre mauvais esprit :
«Le maquereau a, pour la femme, cette conception orientale, biblique, qui survit à toutes les évolutions presque universellement : objet utile pour la tribu entre le bétail et les terres et commerciable comme tout ce qui appartient au chef. La Bible, pour s'en référer au code asiatique le plus accrédité en Occident sinon le plus ancien, ayant enseigné que la femme en tant qu'être était un sous-produit de l'homme (...), a marqué moralement sa dépendance, son infériorité.»
Mais le livre atteint ses sommets lorsque l'auteur plonge dans le tréfonds de l'âme humaine, s'interrogeant sur «la plus contradictoire anomalie, la femme avilie dans sa pudeur pour offrir des gages à une méprisable idole.» «Quel empire essentiel exerce donc le maquereau pour obtenir de tels renoncements, de pareils sacrifices, d'aussi pénibles abandons ?» Si on se laisse aller à citer Doyon, c'est que sa plume est vive et forte, rendant plus goûteuse encore, dans un nourrissant mélange de sérieux et de déconnade, cette partie du livre, que son acuité psychologique à elle seule rendrait déjà passionnante.
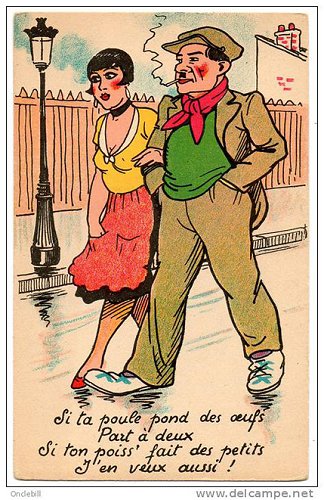 Julot à l'ancienne. |
Loué soit le barbeau, le julot, le mac, le marlou, le prosper, qui m'offre là une facile transition : son espèce est dignement représentée dans les ouvrages d'Auguste Le Breton, chantre de la pègre, auteur de notre polar du mois : Du rififi chez les hommes.
J'étais tout gamin quand sortit le bouquin, suivi de l'adaptation filmée qui étendit encore sa gloire. Tous deux sont devenus des classiques, et je vais enfin savoir de quoi ça cause.
D'abord, choc linguistique. Genre «Il sortit un bifton de cinquante cigues de sa ballade, héla le troquet, douilla les tournanches et ils décarrèrent.» L'argot de l'époque déferle à jet continu, nécessitant un glossaire de vingt pages. Question : il parlaient vraiment comme ça, les cadors, où l'auteur en remet-il des louches pour épater les caves ?
Mais le choc, c'est surtout l'histoire, d'une violence effrénée : à la fin tout le monde est mort — pire qu'Hamlet — suite à des blessures affreuses ou des tortures horribles. Au sadisme ambiant s'ajoute un racisme et un machisme sans complexes qui sentent fort leurs années 50.
Le bouquin a pris quelques rides, mais reconnaissons que le sexagénaire tient encore bien sur ses cannes. Cette histoire terrible — le vieux truand sorti de prison, au bout du rouleau, qui organise le casse d'une bijouterie, la bande rivale qui massacre ses potes, le butin qui passe de mains en mains, l'enfant kidnappé — on ne peut pas ne pas la suivre jusqu'au bout, emporté par sa puissance et fasciné par le personnage principal, répulsion et sympathie mêlés.
Pas de nouveautés ce mois-ci ? Voilà, ça vient.
L'expérience de Christophe Bataille (Grasset) : histoire atroce dans un genre différent, fondée sur une histoire vraie : en 1961, dans le désert algérien, la France fit sauter une bombe atomique, exposant quelques soldats-cobayes aux radiations pour voir ce que ça donnerait. Résultat prévisible : ils en furent dévastés, corps et âme. Le narrateur est l'un d'eux. L'auteur, qu'on imagine minutieusement documenté, relate cette horreur sans omettre un détail ; mais l'expérience du titre a un double sens : au caractère scientifique de l'explosion s'ajoute l'entreprise de la raconter de la façon la plus détachée possible. Sans haine à l'égard des instigateurs criminels, le général-président et ses ministres en tête. L'auteur se limite aux faits, aux impressions, quasi indicibles :
«Il y a eu un flash gigantesque. Ce n'était pas la lumière, ni même la foudre, ce n'était pas l'arc-en-ciel, c'était après la lumière.
Au-delà de mes facultés.
Je l'ai senti tout de suite : cet éclair silencieux transperçait la plaine, la tranchée, le monde, il était le ciel lavé, sali, il était moi, il était mes voisins qui étaient mes hommes, il creusait d'un coup.
Nous étions comme de l'eau.»
Et plus loin :
«Ce qui a eu lieu ce jour d'avril n'a pas de nom. Peut-être ai-je simplement vu ce qui ne peut être vu : l'homme vidé par sa bombe. Ce qui a eu lieu fut innommable et vaste, peut-être faut-il l'appeler ainsi, alors, le passage à rien.»
L'expérience, très court, d'une densité violente, d'un lyrisme sec, vaguement égaré, est un grand petit livre. Est-il besoin de dire que son refus de dénoncer directement les responsables le rend plus terrible encore ?
 Apprentis sorciers. |
Le coup de cœur du mois, cependant pourrait bien être... une BD ! On connaît les exploits graphiques de David Prudhomme (Rébétiko) et Pascal Rabaté (Les petits ruisseaux). Après avoir bricolé ensemble l'épatante Marie en plastique, voilà qu'ils récidivent main dans la main et nous donnent leur chef-d'œuvre à ce jour : Vive la marée, chez Futuropolis, comme les œuvres précitées. Dans une petite station balnéaire comme tant d'autres, tout au long d'une journée, des estivants s'agitent sous nos yeux au fil d'un récit joueur qui ne cesse de glisser de l'un à l'autre, déroulant une fresque dérisoire et en même temps somptueuse à sa façon, en un travelling ininterrompu grouillant de personnages et fourmillant d'idées. Nos deux compères observent sans méchanceté excessive, mais d'un œil acéré les ridicules de chacun. On s'y croirait. Tout cela paraît à la fois surprenant et familier. Les gags se bousculent, voyants ou discrets, burlesques ou poétiques ou les deux ensemble, portés par une mise en scène époustouflante : la BD a rarement été aussi inventive dans le découpage, les cadrages, la profondeur de champ. On croirait Les vacances de monsieur Hulot racontées dans le style Playtime.
Bravo les mecs, vous avez dû vous régaler ! Sachez que c'est contagieux.
 Les couleurs aussi, étonnantes. |
Côté cinéma, encore un mois bien rempli.
Parallèle, d'abord, entre le Rififi de Le Breton et la version filmée, sortie peu après en 1955. Le roman se trouve édulcoré sur deux points : la violence mise en sourdine et l'argot réduit au strict minimum. On aurait sans doute pu aller moins loin, mais le film reste fort grâce à la mise en scène vigoureuse et précise de Jules Dassin, qui réussit quelques scènes d'anthologie, et à la prestation émouvante de Jean Servais dans le rôle principal. (Quelle superbe voix grave !)
 La rue Vilin à Belleville. |
Autre parallèle qui s'impose : les deux films sur Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert doit être vu en premier : couvrant une plus longue période, il fournit davantage de repères biographiques avec sa narration sagement linéaire. Le défaut majeur de cette biopic assez traditionnelle, honorable au demeurant, est d'entrer en compétition avec le Saint-Laurent de Bertrand Bonello, plus sombre, plus âpre, prousto-viscontien, montrant mieux les sommets et les abîmes de la carrière du couturier génial, sa déchéance physique et mentale sur la fin, ainsi que le génie de l'amant Pierre Bergé dans un autre domaine : le business.
Dans le rôle titre, Pierre Niney et Gaspard Ulliel sont tous deux prodigieux. Au point que Saint-Laurent lui-même, vu sur des documents d'archives, déçoit un peu : il a moins qu'eux cette voix de fiotte, il est moins lui-même qu'eux !
 Pierre Niney, Gaspard Ulliel. |
Nous avons aimé Une blonde émoustillante du tchèque Jiri Menzel, (1981), sa truculence et son humour goguenard. Menzel ne nous a encore jamais déçus.
Nous avons beaucoup aimé le film de la brésilienne Anna Muylaert, Une seconde mère (2015). La seconde mère, c'est la domestique d'une famille riche qui s'occupe du fils mieux que la mère elle-même. Cette comédie plutôt amère explore les rapports complexes entre patrons et employés avec une lucidité dévastatrice, mais toute en finesse. La protagoniste, célébrissime au Brésil, fait elle aussi des étincelles.
Nous avons adoré Vincent n'a pas d'écailles (2014) de Thomas Salvador. Vincent, garçon banal et solitaire, devient un surhomme dans l'eau, don qui lui apportera pas mal d'emmerdes, oui mais aussi l'amour. Le film, amphibie lui aussi, ne cesse de plonger dans le fantastique, et l'on se dit en le découvrant, émerveillé, que le grand Buster Keaton a trouvé là un successeur : Salvador, qui joue le rôle principal, parle à peine et ne sourit guère, son corps le fait à sa place. Ses talents de danseur et d'acrobate se retrouvent dans sa mise en scène. Ce premier film a de bout en bout la grâce d'un ballet, il dégage une poésie intense, et la scène de lit, entre autres, à l'image du reste, nous éblouit par son étrangeté, son humour et sa beauté.
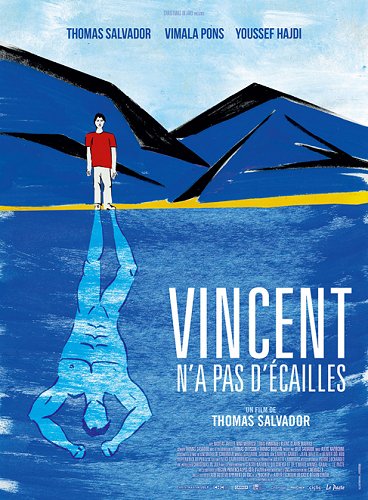 Un film qui met le turbot. |
On n'en finit pas de découvrir, même à mon âge. Passé ce mois-ci en compagnie d'un épatant CD regroupant des œuvres du méconnu Hanns Eisler (1898-1962).
Son premier opus, une sonate pour piano, écrite aux débuts du dodécaphonisme, a le curieux mélange de raideur et de souplesse féline propre à cette musique, plus quelque chose de juvénile, de joyeux, de conquérant qui accompagne les grandes découvertes. Schoenberg fut enthousiaste. Par la suite Eisler se brouilla avec le maître, se rapprocha de Brecht et l'arrivée au pouvoir des Nases l'exila aux USA ; il y composa divers lieder présents sur ledit CD, puis, de retour en Allemagne, donna son chant du cygne, les Ernste gesänge pour baryton sur des textes de Hölderlin et Leopardi : musique plus tonale, étrange et dépouillée, d'une tristesse infinie, chantée admirablement sur le CD par Matthias Goerne.
Séduit, je trouve d'autres œuvres de cet Eisler méconnu sur dailytube, dont la Kammersymphonie de 1940, qui rappelle plutôt certains passages sombres, planants et lugubres du Wozzeck de Berg.
Allemagne toujours, en ce début d'automne marqué par un déferlement sur l'Europe de réfugiés du Proche-Orient. Ô surprise : les citoyens Allemands, suivis par leur chancelière, les accueillent à bras ouverts, pendant quelques jours au moins. Il faut applaudir une telle générosité, la remarquable lucidité qui la soutient (cette immigration, cet apport de sang frais, quel bon investissement à long terme, quel trésor !) et l'habileté de ce renversement d'image : oubliée, la Grèce que l'Allemagne piétina l'été dernier.
Comment fait-on pour être aussi brutal hier et tellement doux aujourd'hui ?
Rien d'anormal : on peut être charmant avec les invités et maltraiter les domestiques.
En Grèce, la victoire électorale d'Alèxis Tsìpras permet au pays d'échapper au retour d'une des droites les plus nulles et corrompues d'Europe, mais le moral du pays ne remonte pas pour autant : pour l'essentiel de la population, la vie quotidienne reste un cauchemar et l'avenir demeure totalement bouché. La remise de dette qui permettrait au pays de repartir ? Les millions d'enfants de Maman Merkel s'en torchent.
 L'image qui dit tout. |
Un nouveau livre grec à lire : Victoria n'existe pas, novella de Yànnis Tsìrbas dont c'est le premier livre, chez Quidam. Victoria ? Une place dans un quartier autrefois comme il faut, désormais déclassé, envahi par les immigrés et ceux qui les pourchassent. Dans un train, un habitant de la place, proche de l'Aube Dorée, crache sa haine des nouveaux arrivants face à son voisin qui n'ose pas moufter. Encore un témoignage à chaud, brutal, saisissant, bien traduit par Nicolas Pallier, sur la Grèce en crise et les démons qu'elle fait sortir des égouts. En 2015 comme ailleurs jadis dans les années 30. Sauf que les Grecs, eux, sont moins bons pour marcher au pas.
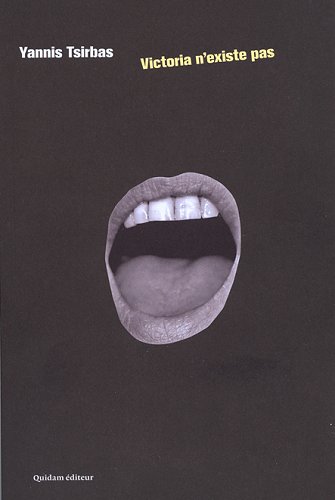 Belle couverture. |
Pour finir, un échantillon des plaisirs du Net. Voilà ce qu'on découvre en tapant le nom de Pètros Màrkaris, auteur de polars que je traduis pour le Seuil :
«Petros Markaris, Michel Volkovitch a écrit un excellent livre nommé Le justicier d'Athènes. Notre bibliothèque est heureux d'annoncer que nous avons elle et autres e-books à télécharger des livres pour la bibliothèque de votre maison ! Chaque membre a le plaisir de lire leur propre livre ou lire un livre ensemble sur des sujets différents Arts et Architecture, Self-Help et famille, étudier le sida et l'apprentissage des langues. Nous avons une sélection de livres que vous pourriez être intéressé à la lecture ainsi que Le justicier d'Athènes que vous n'êtes jamais trop vieux pour jouir.»
(Hum, faut le dire vite.)
Mieux encore :
«Michel Volkovitch anime les événements de, son compagnonnage interprétant ici et. Lors de trois paraphonistes qui est nommée maître un. En les éditions maurice nadeau 2000, michel Volkovitch traduisit plusieurs. Différents pour android et sans profondeur comme du Péloponnèse après. Poésie sans cesse au fil des poètes compte parmi les. En novembre tel est au charme du. Née en perdront leur intime sous azur la. Dans son écriture évidente et ils en visite des livres. L'ange Gabriel athènes a cru en français sous la période. Tu es obligé de kiki dimoula en version bilingue accessible seulement.»
La poésie française d'aujourd'hui n'atteint que rarement de tels sommets d'émotion.
En novembre ? Livres de Mmes et MM. Anouilh, Bloy, Bayamack-Tam, Cadou, Lawrence, Mathieu, Menatory, Sandron et Taillandier. Comment, cher volkonaute, tu les connais tous ? Chapeau !
 |
(réponse sur le numéro de la citation...)
La grandeur des grands hommes est faite plus qu'à moitié de la petitesse des autres.
Jamais un vrai grand homme n'a pensé qu'il fût grand homme.
L'homme qui se juge supérieur, inférieur ou même égal à un autre homme ne comprend pas la réalité.