
Lecteur de Bobin.
BRÈVES
N°127 Avril 2014
"L'aube pâle et frémissante qui ôte sa chemise de brume et secoue sa bonne grosse tête de soleil ébouriffée, la mésange qui distribue la becquée de son chant à toutes les ramilles du lilas croulant, (...) la folle avoine qui danse comme une gitane sans racines..."
Qu'est-ce là ? Du Christian Bobin ? Ça y ressemble furieusement, mais non : le coupable s'appelle éric Chevilllard, lequel entame son feuilleton hebdomadaire du Monde, consacré au nouvel ouvrage de Bobin, par ce pastiche étourdissant. La suite du papier vogue dans les mêmes altitudes. Chevillard, comme beaucoup d'écrivains, ne s'élève jamais aussi haut que dans les descentes en flammes. Ce qui m'enchante, dans ce déluge de vacheries ravageusement joyeux, c'est que Bobin, tel un papillon rare, s'y retrouve épinglé en plein cœur. Entre deux ricanements, entre deux citations croquignolissimes ("Le ciel est un torrent qui se jette dans l'amour de Dieu. Bach compte les étincelles sur ce torrent qui coule dans l'infini ouvert d'un cœur dément etc."), le féroce chroniqueur admet qu'"il y a ponctuellement de belles choses" et "des images justes" chez Bobin, avouant même "un attendrissement passager".
Ce diable de Chevillard met là le doigt sur le mystère, le miracle Bobin. Lequel Bobin a sûrement des admirateurs (et surtout trices ?) extasiés, mais j'imagine qu'une bonne partie de ses lecteurs prend un plaisir pervers à l'alternance qu'il nous inflige, avec une brutale douceur, entre éclairs et court-circuits, bonheurs furtifs et pataquès foireux. Si Dieu, selon frère Christian, est "la fleur du rien, la rose aux pétales d'air, le souffle à marée haute", Bobin lui-même évoque plutôt une chaîne de montagnes russes en goguette, un yoyo en perpétuelle navette entre lumière et ténèbres. Et si je doute de lire un jour La grande vie qu'il vient de pondre chez M. Gallimard (encore que...), j'ai moins que jamais l'intention de manquer, d'un jeudi l'autre, la page de Chevillard dans un journal dont il ferait presque oublier, l'espace d'un instant, le déclin.
 Lecteur de Bobin. |
Les montagnes russes, je les retrouve chez un autre auteur, bien moins connu que le glorieux saint Bobin, totalement oublié en fait : Léonce Bourliaguet.
Bourliaguet (1895-1965), qui fut inspecteur de l'enseignement primaire, écrivit pour la jeunesse une soixantaine de livres, romans ou contes, largement lus à leur époque et vite oubliés après sa mort. L'un d'eux, dans mon jeune temps, m'avait impressionné à cause d'une scène où une fillette se retrouvait toute nue. N'avais-je pas rêvé ?
J'ai donc cherché, et trouvé non sans mal, Pouk et ses loups-garous, aux éditions Magnard, délaissant pour un mois mon hommage nostalgique à la collection Rouge-et-or.
Un village de la province profonde, dans les années 50, "doux pays endormi", voit surgir à son côté un "enfer fumant, rougeoyant, empestant" : une raffinerie de pétrole et sa ville nouvelle. Petits campagnards et enfants d'ouvriers immigrés vont se livrer une féroce petite guerre avant d'apprendre à se connaître. Beau sujet. La petite fille nue ? L'auteur lui avait laissé sa culotte, je m'en doutais. Chose nettement plus embêtante, l'écriture a vieilli. Ce livre des années 50 semble dater d'avant-guerre, il ne saurait plus toucher son public d'origine : les enfants. Le lecteur chenu, lui, peut encore trouver son bonheur dans ces pages désuètes, notamment dans les scènes où l'on visite ce lieu désormais mythique : l'école de campagne, où officie un attachant maître à l'ancienne. Attachante également, la verve bonhomme de l'auteur, sa petite pointe d'humour. Si certaines métaphores fleuries plombent le texte, d'autres ont mieux survécu. On peut trouver cucul certaine évocation du brouillard, "grand fantôme blanc, mou, informe, sans tête, mais dont les mains glacées cherchaient les fentes de ses vêtements, comme pour se réchauffer à la tiédeur de sa peau" ou "L'air était vif et pur, agréable à boire à lèvres serrées, comme un champagne des vignes du Pôle", mais j'avoue une faiblesse, par exemple, pour ceci : "...toute la classe pointa les oreilles. Vous eussiez cru voir se redresser de languissantes salades au premier tambour d'une bonne pluie." Encore une lecture en montagnes russes, moins brutales cependant que celles du casse-cou(-illes) précédent.
"Et ce furent ces jours adorables d'entre été et automne où l'on a le fer chaud du soleil sur une joue et le doux linge mouillé du vent sur l'autre." Si pareille phrase me retient, c'est que je ne sais que penser d'elle, comme de l'ensemble du livre d'ailleurs ; entre j'aime et j'aime pas mon cœur balance et il faut imaginer l'âne de Buridan heureux.
 Illustration de Pierre Rousseau. |
Y a-t-il de mauvaises raisons de lire un bon livre, du moment qu'elles nous font le lire ? J'ai failli plusieurs fois ouvrir à l'insu de la nuit, de Rosetta Loy, traduit de l'italien par Françoise Brun chez Rivages, à cause de sa couverture d'un bleu délicieux. Je m'en veux d'une telle frivolité ; je m'en veux plus encore de n'avoir pas eu le courage d'y céder. Pour finir c'est la main de Carole qui a sorti Loy du chapeau, lors du tirage au sort mensuel.
Merci Carole. Ces dix nouvelles publiées en 1984, proches les unes des autres comme dix facettes d'une même statuette, nous ramènent à la fin de l'été 39, juste avant la catastrophe.
Soleil, vacances, belles maisons, familles riches et cultivées, enfants charmants, jeunes filles, amours, désirs, tout ce beau monde vit ses derniers beaux jours et l'insouciance peu à peu s'effiloche : le ver est dans le fruit, l'ombre de la mort peu à peu s'étend, l'auteure nous dévoile d'avance, en passant, le destin tragique de tel ou tel. On se perd un peu parfois dans tous ces personnages, on peste mais qu'importe, ce brouillage a peut-être un sens, tous ces gens interchangeables ne seront plus bientôt que des fétus dans la tourmente, et la signora Loy en attendant nous séduit par ses portraits en petites touches, son tissage de sensations intenses et fugitives, ses images souvent frappantes ("Les mains remontent dans ses cheveux et prennent sa tête comme le calice du saint Graal"), son écriture sensuelle et berceuse, les instants les plus forts étant ceux où angoisse et félicité alternent ou soudain s'enlacent :
"Et d'un seul coup le désespoir s'était transformé en désir, un désir qui déferlait comme un liquide s'engouffre dans une forme vide. Une marée montante qui soulevait tout ce qu'elle rencontrait, faisait ployer les cimes des arbres, entraînait avec elle des insectes morts et des plumes d'oiseaux, des moineaux tout juste nés aux paupières encore closes. Elle avait fait l'amour comme jamais elle ne l'avait fait, comme jamais elle n'avait même imaginé qu'on pût le faire. Comme jamais plus elle ne le ferait."
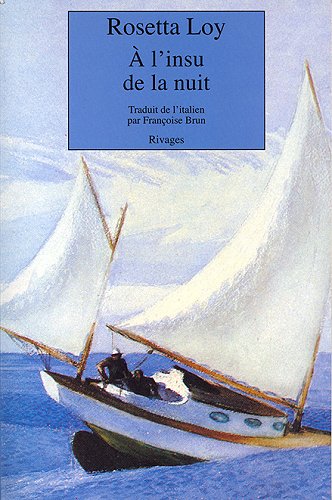 Bleu délicieux. |
Fascinantes, ces années de guerre, pour ceux qui les manquèrent de peu, étant nés juste après. Plus fascinantes encore quand elles sont racontées par François Augiéras.
Augiéras est cet homme étrange au parcours fulgurant, qui voulut changer la vie, voyagea, peignit, écrivit quelques livres incandescents et mourut de vieillesse à quarante-six ans, usé, calciné, clochard. J'avais dévoré son récit grec (Un voyage au mont Athos) et celui de ses dernières années, passées dans une grotte en Dordogne (Domme ou un essai d'occupation), tous deux chez Grasset. Manquait la pièce maîtresse du puzzle, son plus grand livre : Une adolescence au temps du maréchal et de multiples aventures, publié en 1968, trois ans avant sa mort, et réédité par La Différence. Augiéras y raconte son enfance périgourdine, puis la guerre, puis son séjour en Algérie, plus tard. Les années 41 et 42 sont sans doute les plus étranges de ce récit : à seize et dix-sept ans, le jeune homme livré à lui-même va d'aventures en aventures, comédien ambulant, gardien de jeunes délinquants, dans un pays où tout part à vau-l'eau. Plus tard, sa beauté jointe à son culot séduiront le très vieux Gide, et il se fera dépuceler par son oncle en plein Sahara.
Augiéras est l'homme libre par excellence, mystique sans dieu, passionnément attaché au monde naturel ("le beau, noble et vaste monde" qu'il va "adorer comme un dieu"), avec une préférence pour les déserts (les humains le dérangent), aimant le ciel étoilé comme une personne, rêvant à un homme nouveau qu'il pense incarner, et s'exclamant "Ma plus belle œuvre d'art, serait-ce ma vie ?" - lui qui d'un certain point de vue l'a totalement bousillée. Pas trop sympathique, le bonhomme, et pourtant il émeut, il peut même séduire, par sa solitude immense, sa ferveur naïve, ses moments d'ivresse panthéiste, de joie surhumaine. Sa mégalomanie elle-même est attachante : il ne cherche pas à dominer, mais à se libérer. Il y a du Rousseau en lui, mais aussi du Nerval, car on le devine plus d'une fois, entre les lignes, au bord de la folie. "Je suis sensible à des ondes venues de la haute atmosphère, intensément vivantes. L'énergie à l'état pur me traverse..." "J'entends l'appel venu des astres, et c'est en moi d'abord que je soupçonne qu'une nouvelle race est née." Grandiose, non ?
Autre trait nervalien chez cet illuminé : son écriture simple, limpide. La limpidité, c'est plus facile à lire qu'à faire. Augiéras est un très bel écrivain. Exemple ces lignes sans un pouce de graisse, à l'image de l'auteur :
"...il y a une armoire à glace dans ma chambre, je m'y regarde ; je ne me suis pas vu depuis plusieurs mois : je suis beau, j'ai vingt-quatre ans ; je suis très brûlé, tanné par le soleil, amaigri, vêtu presque de loques. Il y a un terrible sourire sur mes lèvres, inquiétant, sauvage, heureux ; j'arrive du sud."
 Augiéras jeune. |
Revoici l'Algérie avec Le premier homme, livre posthume d'Albert Camus, publié longtemps après sa mort, disponible en Folio. étiquetée roman, comme tant de non-romans, cette autobiographie déguisée raconte l'enfance du grand homme dans un quartier pauvre et sinistre de l'Alger des années 20.
Il s'agit d'un travail inachevé, d'un brouillon écrit au courant de la plume, à peine ponctué, au point qu'on se demande, au fil des premières pages, tout en errant dans de longues phrases informes, s'il était judicieux de publier ça. Puis on change d'avis ; la lecture a beau rester un peu chaotique par moments, on oublie cet inconfort devant cette histoire qui tient du conte de fées tout en donnant de la pauvreté une image d'une précision terrible : on y voit un petit garçon travailleur, issu d'une famille aussi démunie intellectuellement que matériellement, qui va échapper à son destin, aidé par son amour des livres et par un instituteur admirable.
Le garçon ne lit pas, il dévore, il en oublie de manger "une nourriture qui, malgré son épaisseur, lui semblait moins réelle et moins solide que celle qu'il trouvait dans les livres". Ayant réussi le concours des bourses qui lui permet d'étudier au lycée jusqu'au bac, il regarde partir "son maître qui le saluait une dernière fois et qui le laissait désormais seul, et, au lieu de la joie du succès, une immense peine d'enfant lui tordait le cœur, comme s'il savait d'avance qu'il venait par ce succès d'être arraché au monde innocent et chaleureux des pauvres, monde refermé sur lui-même comme une île dans la société mais où la misère tient lieu de famille et de solidarité, pour être jeté dans un monde inconnu, qui n'était plus le sien, où il ne pouvait croire que les maîtres fussent plus savants que celui-là dont le cœur savait tout, et il devrait désormais apprendre, comprendre sans aide, devenir un homme enfin sans le secours du seul homme qui lui avait porté secours, grandir et s'élever seul enfin, au prix le plus cher."
N'est-il pas permis de préférer, par moments, ce genre de page spontanée, mal dégrossie sans doute, à celles un peu corsetées parfois des livres officiels du Grand écrivain ?
Pour ceux que la pauvreté emmerde, si l'on faisait un petit tour dans le monde enchanté des riches ? Pour ce faire, il n'est pas de meilleur guide que Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, couple infernal qui depuis quinze ans, sous prétexte de sociologie, ne cesse de harceler la haute bourgeoisie française, perçant à jour ses secrets les plus intimes avec une rare cruauté. Pauvres riches, infortunées victimes de l'envie des médiocres haineux que nous sommes !
J'aurais dû lire d'abord Sociologie de la bourgeoisie, Les ghettos du Gotha ou Le président des riches, mais je commence par le brûlot le plus récent, La violence des riches (Zones), sous-titré Chronique d'une immense casse sociale. Tout ce qu'on nous raconte là est certes connu d'un suiveur attentif de Médiapart, d'Arrêt sur images ou de la moins mauvaise presse papier, mais comment ne pas être soufflé par l'abondance des matériaux, par la précision du démontage ? On contemple d'un seul coup d'œil l'étendue du désastre, de cette casse perpétrée par les gens de la finance et de l'industrie, servis par leurs copains les politiques de tous bords avec un cynisme tranquille ; on admire les prodiges de dissimulation, d'hypocrisie de ceux qui nous entubent ; on comprend mieux pourquoi cette violence feutrée, cette terreur douce est acceptée du plus grand nombre. Il est vrai que partout et toujours, des masses de prolos plus ou moins consciemment asservis votent pour ceux qui les baisent le plus à fond. Droite ou gauche au pouvoir, qu'est-ce désormais que l'état ? Une "société de services pour les dominants". Les prolétaires l'ont dans le cul. La dictature de l'actionnariat s'installe pépère pour mille ans.
Le mot de la fin ? Il appartient ici au président des riches en personne, remettant la breloque rouge en 2006 à Stéphane Richard, ancien directeur des affaires immobilières de Vivendi, ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde qui fut ministre de l'économie. Le petit président déclare :
"Stéphane, t'es riche, t'as une belle maison, t'as fait fortune... Peut-être plus tard y parviendrai-je moi-même... C'est la France que j'aime !"
Stéphane Richard a été gardé à vue et redressé fiscal cette même année. Présents à la cérémonie, d'autres membres du même clan, de la même bande : MM. DSK, Bartolone et Valls.
Cette France-là, aimez-la ou butez-la ! Lire les Pinçon est un devoir civique, en plus d'un acte d'hygiène intellectuelle.
 Dessin de Tignous. |
Autre exploratrice de notre société, autre regard aigu : Ève Charrin, dont j'admirais le mois dernier ici même La voiture du peuple et le sac Vuitton, sous-titré L'imaginaire des objets (Fayard). La course ou la ville (Seuil) nous emmène avec elle dans les camionnettes ou les camions de quelques chauffeurs-livreurs parisiens, le reportage se doublant d'une démarche plus personnelle : l'enquête selon Ève Charrin est l'occasion de réviser ses jugements, de se remettre en cause, et c'est pour cela aussi qu'on l'aime. Au départ, elle l'avoue, ces livreurs qui font du bruit tôt le matin et gênent la circulation l'enquiquinent, et elle se met en route pour mieux les comprendre.
Pari tenu. En soixante pages bien denses, on fait le tour d'un métier difficile qui reflète l'évolution de notre société : fragmentation du travail, contrôles omniprésents par GPS, scans et autres machines espionnes, flux tendus à se rompre, contraintes en hausse, salaires en baisse, la solidarité qui fout le camp. Face à la déshumanisation générale, cinq ou six beaux portraits d'hommes étonnamment zen (mais il le faut pour ne pas craquer), la palme revenant à Mohamed Zghonda le chaleureux, qui fait de la résistance, prenant son temps au lieu de courir "comme un poulet sans tête", souriant et blaguant, tâchant de préserver autant que possible civisme et sociabilité. Sans son CDI et son statut de délégué syndical, il ne pourrait pas se le permettre.
Bref, ce que l'auteure nous offre une fois de plus, c'est le meilleur du journalisme : bien vu, bien pensé, bien écrit, ni trop subjectif, ni désincarné. Je m'en régale autant que des belles chroniques de Florence Aubenas dans Le Monde - sacré compliment.
Et voici ma dernière lecture du mois, précieuse entre toutes. Une Pléiade parue ce mois-ci, 1600 pages, que j'ouvre un peu intimidé. Je tiens dans mes mains presque toute l'œuvre d'un écrivain que je vénère, aujourd'hui très vieux : Philippe Jaccottet. Un pavé si imposant, s'agissant d'un homme qui pratique si bien l'art de s'effacer, quel paradoxe !
Par quoi commencer ? Relire ou découvrir ?
Je reprends pour la nième fois le poème initial, "L'effraie".
La nuit est une grande cité endormie
où le vent souffle... Il est venu de loin jusqu'à
l'asile de ce lit. C'est la minuit de juin.
Tu dors, on m'a mené sur ces bords infinis,
le vent secoue le noisetier. Vient cet appel
qui se rapproche et se retire...
Lueur ? Ombres des enfers ? Non, c'est le cri d'un oiseau de nuit
qui nous appelle au fond
de ces bois de banlieue. Et déjà notre odeur
est celle de la pourriture au petit jour,
déjà sous notre peau si chaude perce l'os,
tandis que sombrent les étoiles au coin des rues.
Tout est déjà là dans un sens, vers 1950, en moins d'une page, dans l'un des poèmes les plus miraculeux qui soient, merveilleusement cadencé, en alexandrins brisés avec douceur, hésitants. Un poème qui retient son souffle. L'a-t-il écrit dans ma petite ville où il habitait ces années-là, sur le coteau d'en face ?
Avec Jaccottet, il faut aller doucement. Je reviendrai à lui le mois prochain. Pour l'instant je me promène dans les premiers poèmes, j'écoute, dans Observations I, la méditation sur Hölderlin ; sur le rôle de la poésie, "concentration, accomplissement (ou plutôt, bien entendu, effort dans ce sens)", "acheminement toujours recommencé vers l'intérieur de soi" ; sur sa démarche : "La justesse... Je voudrais ne rien chercher d'autre ; c'est-à-dire, ni possession, ni gloire. (...) Il y faut, plutôt que de l'attention (toujours trop volontaire), un état d'"accueillement", quelque chose de tranquille et de détendu que favoriseraient peut-être des métiers manuels, ou même des activités très humbles..." - et là, il cite en exemple les romans de Dhôtel, qu'il fut l'un des premiers à reconnaître et aimer.
Je saute alors, tout à la fin, vers Truinas, le 21 avril 2001, récit en prose de l'enterrement d'un autre poète, André du Bouchet, plein de chagrin, de souvenirs d'êtres humains et de leurs paroles dites ou écrites, et aussi de l'"espèce de joie" qu'apporte, dans cet "avril hivernal", le printemps qui vient. "Alors, ayant frôlé du plus intime de soi, si fragile qu'on puisse être, si débile qu'on puisse devenir, quelque chose qui ressemble tant au plus intime du mystère de l'être, comment l'oublier, comment le taire ?"
 Chouette effraie des clochers. |
Jaccottet a bientôt nonante ans ; Alain Resnais, son aîné de trois ans, vient de mourir, quoi de plus naturel ? Et pourtant cette mort m'a pris au dépourvu violemment, peut-être à cause de Manoel de Oliveira, qui tourne encore à cent-cinq ans, nous laissant croire que le cinéma vous rend immortel. En apprenant la nouvelle, je me suis mis à pleurer comme un con. Il est vrai que cet homme, que je n'ai jamais rencontré, a été comme un père pour moi.
Alain Resnais est mort... Alain Resnais est mort... Rien à faire, je ne m'habitue pas.
Dans quelques jours, au SEL, nous verrons l'opus ultime, Aimer, boire et chanter.
 Alain Resnais, 2002. |
Quatre films seulement ce mois-ci, mais rien que du premier choix.
à propos de Tonnerre, de Guillaume Brac, on a évoqué Rozier, Rohmer et Pialat, et de fait ce presque premier film, histoire d'une amourette foirée, séduit à la fois par son naturel et sa maîtrise, ses passages de l'humour à l'émotion, du réalisme à un onirisme discret, de la comédie au quasi thriller. Du beau boulot.
Même remarque à propos de A Swedish love story, titre idiot dont le réalisateur, Roy Andersson, n'est pas responsable. C'était là, en 1970, son premier film, il n'était pas encore l'un des maîtres du bizarroïde, et l'on garde de cette idylle adolescente un souvenir ému d'été ensoleillé, de jeunes et beaux visages et de regards en douce. Les deux héros, là aussi, sont d'un naturel confondant.
Hitchcock divisait les films en deux catégories : les tranches de vie et les tranches de gâteau. Philomena, de Stephen Frears nous offre les deux. Cette histoire d'une vieille femme cherchant le fils dont on l'a séparée cinquante ans plus tôt a beau s'inspirer d'événements réels, elle se déroule de façon spectaculaire à souhait. Judi Dench et Steve Coogan, le journaliste qui l'accompagne dans sa quête (également auteur du scénario virtuose) forment un couple délicieusement disparate, l'église catholique d'Irlande en prend plein la gueule, elle le mérite mais l'essentiel n'est pas là : rien de manichéen dans ce film subtil et humain, où la vieille dame ignorante, en pardonnant aux bonnes sœurs mauvaises, donne à son acolyte et à nous tous la plus belle des leçons.
 Judi Dench et la vraie Philomena Lee. |
L'homme au crâne rasé, premier film d'André Delvaux, 1965. Un petit prof banal vit un amour fou, inavoué, pour l'une de ses belles étudiantes. Souvenir ébloui de mes dix-huit ans.
Cinquante ans plus tard l'enchantement est intact. Chacune des scènes commence dans la grisaille quotidienne avant que le réel peu à peu vire au fantastique, avec une admirable douceur. Le petit homme est-il fou ? Quand se met-il à dérailler ? Je me rappelais avec précision la scène d'anthologie chez le coiffeur, mais n'avais gardé (comme c'est bizarre) aucun souvenir de la scène des aveux entre elle et lui, scène pourtant prodigieuse.
Le film est parlé flamand, ce qui ajoute encore à l'étrangeté. Il est en noir et blanc, et je me fais pour la première fois cette remarque évidente : à présent que la couleur est devenue la norme, les films en noir et blanc sont plus beaux encore qu'avant, ou du moins plus mystérieux : l'absence de couleurs change la réalité en rêve et les humains en fantômes.
 La scène de la chambre d'hôtel. |
Avant la page voyages, pause musicale, un peu de repos.
Repos, tu parles ! La Symphonie n°3 de George Enescu (pudiquement rebaptisé Enesco chez nous) est une débauche sonore, un déluge, un maelström. Dans une symphonie, d'habitude, les thèmes sont méthodiquement variés, longuement mâchés comme un chewing-gum ; ici, ça nous tombe dessus en masses tourbillonnantes, en vagues successives, ça grouille, ça pète, ça fuse dans tous les coins, cordes chauffées à blanc, cuivres apoplectiques, percussions ivres de coups. Composer ça dut être un travail d'Hercule. Et l'écouter donc.
Non, je ne dis pas que je n'aime pas. Dans des cas pareils, aimer, ne pas aimer, sont des notions dépassées, un peu vaines.
Quelqu'un pourrait me raconter les deux derniers mouvements ?
Voyages, donc. En trois semaines, Athènes, Bruxelles, Lyon... Le traducteur pantouflard n'arrête pas de voyager, devenu VRP du livre, traînant vers d'hypothétiques acheteurs sa grosse valise pleine des bouquins du Miel des anges.
Côté publications, le mois fut chargé. Sont parus en même temps :
- Pain, éducation, liberté, de Petros Markaris, dernier tome de la Trilogie de la crise après Liquidations à la grecque et Le justicier d'Athènes. Celui-là, au moins, son éditeur (le Seuil) se charge de le vendre et le vend bien.
- Le voleur de baisers, recueil de délicieux chants populaires sur le thème de l'amour (échantillon dans MADE IN GREECE -> Chants d'amour), chez Alidades, dans la même collection que Le frère mort et Médecines crétoises.
- Poètes grecs du 21e siècle, vol. 2, au Miel des anges. Dix poètes ultra-contemporains, de tous âges et de toutes sortes, publiés avec l'appui de l'Institut français de Grèce et de la Fondation Stavros Niarchos. Un immense merci à Olivier Descotes, directeur de l'Institut, hyperactif agitateur culturel, qui se décarcasse pour aider les Grecs et ceux qui les aident.
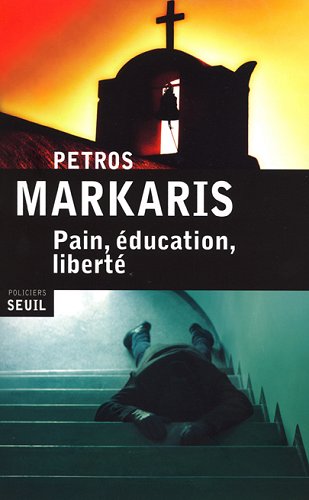 |
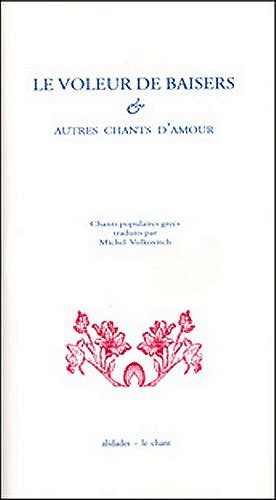 |
 |
| Une bonne façon... | d'aider les Grecs : | acheter leurs livres ! |
Huit jours en Grèce, logés comme des princes à l'école française d'Athènes, havre de paix au cœur de la ville. Beaucoup de belles rencontres, comme toujours, et beaucoup de travail aussi ; guère de temps pour les balades, à part la tournée des musées antiques (impressionnant musée de l'Acropole, œuvre d'art en lui-même) et une escapade de quelques heures à Hydra, l'île des riches. La crise ? Dissimulée à peu près dans les beaux quartiers, elle continue de s'étaler ailleurs : mendiants et fouilleurs de poubelles se côtoient, tandis que les tags envahissent les murs en un débordement de colère assourdissant. La culture bouillonne elle aussi, représentations théâtrales et soirées poétiques se multiplient, et si certaines grandes librairies ferment, d'autres plus petites sont en train d'ouvrir. Les artistes se battent avec l'énergie du désespoir - presque toujours pour des clopinettes. Une amie, l'une des grandes voix du théâtre grec, vient de jouer Pirandello pendant un mois pour un cachet à peine au-dessus du SMIC.
Dimanche, huit heures du matin. Monté en trottinant au sommet du Lycabette où je pensais me retrouver seul, eh bien non : une femme est là, dans la position du lotus, immobile comme une statue de Bouddha. Il paraît que depuis l'arrivée de la crise, les seuls livres qui se vendent encore sont ceux d'économie (pour comprendre) et les manuels de yoga (pour supporter).
Le meilleur souvenir de ces journées ? Peut-être le dîner du dernier soir, joyeux malgré tout, avec huit poètes parmi mes préférés. Allez les gars, allez les filles, on continue, on se bat.
 Exàrkia, mars 2014. |
Le temps est parfois frais en Grèce au mois de mars. Un soir pas bien chaud, nous croisons le pape de la traductologie française, invité d'honneur du colloque auquel je viens de participer. Vous avez vu ce temps ? ricane-t-il. Réchauffement climatique, tu parles ! Ces abrutis du GIEC nous empoisonnent avec leurs salades !
Notre grand homme s'envolera le lendemain matin pour sa patrie, juste avant l'arrivée de la chaleur. On m'avait prévenu que c'était un vieux con réac. Je ne m'attendais guère à une confirmation aussi éclatante.
Changement climatique (suite). Le récent pic de pollution à Paris, que j'évoque dans le JOURNAL INFIME, connaît-on ses vraies causes ? Non, bien sûr, le lobby écologiste ayant muselé la presse nationale. Seul le Figaro ose dire la vérité avec son indépendance et son courage coutumiers. Non, les coupables ne sont pas les véhicules au diesel ou les industries polluantes. Quelle idée ! Alors qui ? Ces maudits Allemands, assoiffés de vengeance, qui envoient vers nous, poussées par des ventilateurs géants, les fumées mortelles de leurs centrales au charbon ? Sans doute. Mais la pollution, c'est avant tout la faute à ces salauds d'écolos sur leurs vélos : chaque fois qu'ils freinent, leurs tambours de freins libèrent un flot de particules fines qui à la longue nous empoisonnent. Si la pollution augmente, c'est qu'il y a davantage de vélos, CQFD.
 écolo polluant criminellement la planète. |
Nous ne changeons pas de sujet en évoquant les élections municipales françaises, où les seuls à se poser les vraies questions, à s'inquiéter des menaces les plus graves, récoltent à peine 10% des voix ; où les plus démunis ont voté pour ceux qui les méprisent et les écrasent le plus ; où la peste brune contamine peu à peu les cerveaux. Je ne m'attarderai pas sur cette puanteur, ayant du mal à pianoter en me bouchant le nez.
Au programme de mai, Kerangal, Quemener, Martet, Jaccottet encore, Levi, et deux Cohen pour le prix d'un seul !
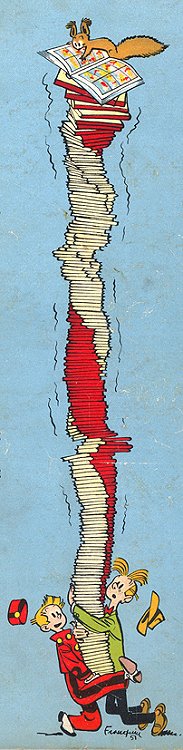 Mon rêve d'enfance : en avoir autant... |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Voyante : personne du sexe féminin capable de voir ce qui est invisible pour son client, à savoir qu'il est un imbécile.
Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question.
Les hommes qui disent que les femmes sont frigides sont de mauvaises langues.