
Feu le grand Bouddha de Bâmiyân.
BRÈVES
N°126 Mars 2014
«Il y a longtemps que je démêle dans un geste de branche son élan vers l'inexprimé, longtemps que j'écoute le murmure des ardoises, le chœur antique des fourmis, le message précis des forêts, des dunes, et ces sortes d'hypothèses chuchotées qui montent d'une famille de pierres. Et quand je longeais mon canal Saint-Martin, triste et bleu comme une femme qui s'en irait vers les grottes du remords, j'entendais se révéler des cœurs gros à la surface de l'eau, je surprenais le coup d'œil désespéré de la maison qui se noie, je m'abandonnais au sifflement de la lune, et parfois je me plongeais aussi dans la lecture de ce journal chanté que les oiseaux impriment comme avec des gouttes d'eau dans le vaste atelier des arbres.»
De qui est-ce ? De Léon-Paul Fargue, poète de la première moitié du XXe siècle, grand flâneur, grand rêveur, connu surtout pour son recueil Le piéton de Paris. Le passage cité sort d'un recueil de proses, Méandres, paru en 1946 peu avant sa mort, réédité chez Gallimard (L'imaginaire). De quoi ça parle ? Difficile à dire : l'auteur, apparemment parti pour raconter Paris après la Libération, glisse de sujet en sujet au fil de la plume, de souvenir en souvenir, d'image en image, en d'infinis méandres. Ce que j'en pense ? Là encore, je ne sais pas trop. Voilà une prose chiadée, aucun doute, le vieux bonhomme a du talent et du bagou, mais son fleuve charrie (à mes yeux du moins) le pire avec le meilleur, passant avec aisance du brillant à l'affecté, de la trouvaille superbe aux facilités creuses. Je préfère son «vaste atelier des arbres» à ses oiseaux imprimeurs ; j'aime les «Champs-Élysées, sorte de train de plaisir bloqué dans les icebergs de l'industrie de luxe», et nettement moins cet éloge de la littérature américaine : «C'est le vérisme intégral d'un Faulkner, la révélation de l'inquiétude américaine chez Eugene O'Neill, et le triomphe absolu de l'originalité chez Walt Disney.»
Non seulement Fargue s'écoute écrire, mais il étale ses relations dans d'éprouvants accès de name-dropping. Car il les a tous connus, les artistes des années folles qui remplissaient les cafés de Montparnasse et les salons des riches mécènes, les Debussy, Ravel, Valéry, Claudel et tant d'autres... Les œuvres de ceux-là n'ont pas gardé trace de ces parlotes et de ces mondanités ; peut-on en dire autant des livres de ce poseur, de ce phraseur ?
Serons-nous plus heureux avec Nadeem Aslam, Pakistanais exilé en Angleterre ? Son roman La vaine attente, publié en 2008, traduit l'année suivante au Seuil, nous emmène en Afghanistan il y a une dizaine d'années. Le pays, ravagé par la guerre, continue de vivre dans la terreur. Les Russes et les talibans font assaut de cruauté tout au long du livre, dans une débauche de détails horribles, les époques se mêlant au fil d'une narration chaotique aux flash-backs accumulés, et pour tout avouer je garde de ce concentré d'horreur un souvenir assez confus. Chacun recherche une personne aimée disparue, si bien qu'une armée de fantômes hante cette histoire, d'autant que les survivants eux-mêmes, leur âme détruite, sont désormais à peine plus que des zombies.
Là encore, que dire ? Il arrive qu'on échoue à entrer dans un livre, sans penser pour autant qu'il soit mauvais. Ce déchaînement de violence, même s'il correspond à la réalité historique, me semble trop systématique pour nous toucher (quelques moments de répit suffiraient), mais je reconnais la beauté, l'intense poésie de certaines scènes. À preuve ce passage où l'horreur s'insinue subtilement, et d'autant plus affreusement, au cœur même de la beauté tranquille des choses :
«On peut extraire du cyanure des abricots, Casa le sait pour en avoir distillé un jour dans un camp d'entraînement du djihad, avant de l'injecter à diverses créatures. Le souvenir lui revient au moment où il passe devant un arbre en fleur dans une rue du centre de Jalalabad ; c'est la fin de l'après-midi, mais les fleurs ne se sont pas encore complètement vidées de leur parfum. Une fourmi remonte le tronc à la vitesse d'une étincelle courant le long d'une mèche.
Crayons. Citrons. Sirop de maïs. Teinture. Il sait qu'il pourrait fabriquer des explosifs à partir de plusieurs des produits qu'il voit sur les charrettes et dans les boutiques autour de lui. Sucre. Café. Peinture. Il serait même capable de fabriquer une bombe avec son urine.»
La traduction de Claude Demanuelli est un régal.
 Feu le grand Bouddha de Bâmiyân. |
Le souci de varier mes lectures me pousse parfois vers d'audacieux extrêmes ; la certitude de ne jamais lire un livre m'entraîne parfois à m'y plonger, rien que pour le plaisir de me contredire. Voilà pourquoi je m'attaque l'autre jour, me surprenant moi-même, aux Nouvelles méditations poétiques, d'Alphonse de Lamartine !
Son œuvre, jadis largement lue, admirée, aimée, a sombré tout doucement dans l'oubli, seuls surnagent quelques bribes de poèmes, objets inanimés, temps qui suspend son vol. Et son nom vaguement ridicule.
C'était un type bien, ce Lamartine, une âme noble pour parler comme lui. «Nations, mot pompeux pour dire barbarie», «Mon pays, c'est la vérité» : voilà des phrases de lui plus que jamais salubres.
Ces Nouvelles méditations ne contiennent pas ses poèmes les plus connus, et n'eurent pas, à l'époque, le succès attendu. Je commence la lecture avec un léger trac, dans quoi me lancé-je donc ? De fait, ça balance agréablement, comme prévu, c'est joli mais un peu convenu, un peu mou, bientôt je m'ennuie et cale au bout de quelques pages.
Aujourd'hui, avant d'enterrer le malheureux, je reprends le livre, par la fin cette fois, et tombe sur la Méditation vingt-sixième, «Adieux à la poésie».
Il est un âge où de la lyre
L'âme aussi semble s'endormir,
Où du poétique délire
Le souffle harmonieux expire
Dans le sein qu'il faisait frémir.
Et là, je suis ému enfin, malgré le vocabulaire désuet. Ému par l'aveu du poète qui sent l'inspiration décliner ; par la musique du vers, ces [i] plaintifs qui lancinent à toutes les rimes — enfin excessif, Lamartine ! — et par cette rime redoublée aux vers 3 et 4, belle trouvaille qui produit comme un gonflement d'émotion, un suspens prolongé avant la retombée du vers final. Et tant pis si le poème est longuet et la fin pas terrible. J'ai presque envie de retourner dans le bouquin chercher au hasard d'autres scintillements, d'autres petits bonheurs.
 |
 |
| Avant et après ses Nouvelles méditations. | |
Restons dans le rétro avec la collection Rouge-et-or qui berça mon enfance, en ce temps lointain où les jeunes lisaient, faute de jeux vidéo. J'étais un lecteur compulsif alors ; j'ai dû dévorer plusieurs fois La rose d'argent et L'escalier bleu de Renée Aurembou, l'un des piliers de la collec, mais c'est son Xavier Bas-Rouges que je m'en vais retrouver.
Nous sommes sous le Second empire, dans le Bourbonnais, au fond de la France profonde. Xavier, dix ans, né dans une famille pauvre, quitte l'école pour travailler dans une mine de charbon, puis chez un curé de village, puis, après une fugue, dans une ferme loin de chez lui. Une bohémienne lui a prédit qu'il trouvera un trésor, il y croit, le petit sot, et la prédiction se réalise à la fin. On se passerait de ce dénouement un peu fade, mais le reste de l'histoire tient la route. L'auteure, sérieusement documentée, décrit la vie des paysans de l'époque de façon convaincante, et comment ne pas s'attacher son jeune héros, petit Poucet perdu dans un monde qui l'effraie. J'aime aussi le français de Mme Aurembou, cérémonieux et familier en même temps, discrètement rehaussé de mots locaux («viron» pour «promenade», «berlot» pour «bêta», «grenouillat» pour «flaque d'eau», «patouilloux» pour «boueux»). Une écriture de maîtresse d'école, au meilleur sens du terme — c'est selon moi un compliment.
Quant aux illustrations de Pierre Dehay, que je trouvais moches il y a plus d'un demi-siècle, elles ont étonnamment bien vieilli, parfaitement accordées au livre avec leur charme naïf, leur tendresse un peu rude.
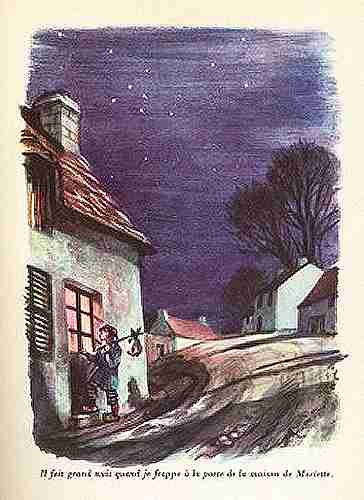 Petit Poucet Xavier parti seul sur les chemins. |
Philippe Curval aussi, je l'ai lu autrefois, plus tard. Le dormeur s'éveillera-t-il ? (Denoël, Présence du futur) m'avait beaucoup frappé vers 1980, et je me demande pourquoi je ne suis jamais revenu à ce maître du genre. Pourtant les occasions ne manquent pas : ce géant de la SF française a publié une foultitude de romans et de nouvelles aux confins de l'anticipation et du fantastique, et il continue, à 80 ans passés, dans un perpétuel bouillonnement d'imaginaire.
Le testament d'un enfant mort, publié en 1978, que réédite judicieusement le Passager clandestin dans sa collection Dyschroniques, est une petite chose de 60 pages, mais qui donne une juste idée du travail de Curval. Ici, pas de voyages dans l'espace, pas de grandes scènes spectaculaires : l'aventure est intérieure. L'humanité est frappée d'un nouveau mal : de nombreux nouveau-nés dépérissent et meurent bientôt, pourquoi ? L'auteur donne la parole à l'un d'eux, ce qui nous vaut une description saisissante de la vie utérine, de l'accouchement et des premiers jours. Voici la naissance :
«J'ai quitté la créature qui me portait, poussé par un reflux géant. J'ai été expulsé dans un tumulte de sang et de cris et j'ai jailli dans l'atroce lumière, dans l'abominable sécheresse de l'au-dehors. Le corps n'est plus lubrifié. Les yeux reçoivent la décharge de mille soleils.»
Suivent, notamment, des pages étonnantes à la gloire du pouce, tandis que le bébé, non content d'exposer ses sensations, entreprend d'expliquer le monde qui l'entoure avec un mélange d'intuition presque inquiétante et d'incompréhension désolante, mais poétique :
«Plus tard, les arbres grandissent et les feuilles poussent ; quand les feuilles remuent, cela fait naître le vent, le vent vivant qui fait à son tour bouger les arbres. Comme toutes les choses vivantes, les plantes sont fermées avec des boutons. (...) Avec le vert des forêts on peut faire des bouteilles.»
Du monde, le bébé n'a saisi que le mauvais côté, voilà pourquoi (on s'en doutait) il refuse de vivre. On le comprend à moitié seulement : il se prive ainsi, entre autres, de lire Curval et la SF en général, que cette nouvelle donne envie de fréquenter, avec son irréalité souvent violente, qui confine plus ou moins à la folie, mais qui sert en même temps de loupe nous aidant à mieux voir notre réel.
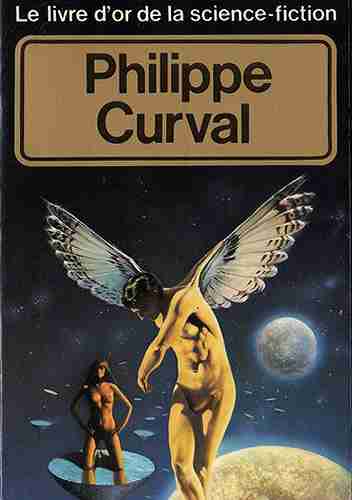 |
 |
| Pour tous les goûts... | |
Le réel ? Le voici ! Le plus contemporain, le plus quotidien, avec Ève Charrin et son essai La voiture du peuple et le sac Vuitton, sous-titré L'imaginaire des objets, chez Fayard). L'auteure s'est souvenue des Mythologiques de Roland Barthes, dont elle reprend le dispositif : un portrait de notre monde d'aujourd'hui en plusieurs textes brefs, chacun d'eux associant un objet usuel savamment radiographié (un sac à main, une pomme, des sushis, un ordinateur, du lait...) et, je cite, «un phénomène social, économique, politique bien connu et identifié (par exemple, la crise des classes moyennes, le creusement des inégalités...)».
Ève Charrin a l'œil du journaliste et la plume de l'écrivain. Comme son illustre aîné, elle déploie avec la même largesse, la même finesse, bonheurs de pensée et d'écriture. Son livre nettoie le regard, aiguise l'œil, réjouit le cœur. Un régal d'un bout à l'autre. On voudrait citer des dizaines de pages. Ceci, par exemple :
«...La fluidité paisible et prospère que nous aimons dans le lait, nous l'attendons aussi de l'Union européenne. (...) Cette onctuosité tranquille, cette abondance sûre, c'est ce que nous espérons de l'Europe, neutralité nourricière, ennemie des heurts et des conflits, sécurisante et douce. Historiquement, l'Europe s'est construite autour du charbon et de l'acier du traité CECA, mais symboliquement, l'Europe, c'est le lait.»
Mais Charrin va plus loin que Barthes : elle ne s'enferme pas dans le rôle de l'observateur narquois et, disons-le, un rien condescendant ; elle s'implique, se met en scène et en question, ses trésors d'ironie virent par moments à l'auto-ironie, comme dans cette page étourdissante sur les bobos et la télévision, au point d'atteindre parfois cette apothéose de l'ironie, quand on ne sait plus si c'en est encore. C'est dans ces pages-là que cet ouvrage brillantissime est le plus attachant, et pour tout dire, émouvant.
Barthes eût été un peu jaloux. Et je parie que l'immense Perec, auquel on pense ici plus d'une fois, se serait régalé.
Ah, voilà Chevillard. Sacré Chevillard. J'aime son nom qui lui va si bien, pas sérieux, goguenard, on dirait un pseudo, on se demande si Chevillard existe, on l'imagine écrivant, écrivant tout le temps, une vingtaine de romans, un tas d'autres textes inclassables, ses aphorismes quotidiens, une prolificité qui fait un peu peur, quelle imagination ! quelle verve ! Sa chronique hebdomadaire dans Le Monde des livres est pour moi une oasis au milieu des pages qui l'entourent. Mais avec ses romans j'ai du mal. Chevillard semble fait pour les courtes distances, les sprints fulgurants. Et là, sur la longueur, pour la première fois, je suis emballé, conquis.
Avec Le désordre Azerty (titre musicalement superbe), publié chez Minuit, il a trouvé la bonne formule : un juste équilibre entre discontinu et continu, ordre et désordre. Le livre est construit sous forme d'abécédaire, les lettres se suivant dans l'ordre du clavier français. L'aspect fourre-tout, coq-à-l'âne, s'en trouve légitimé. On retrouve le Chevillard qu'on connaît, ses parodies, ses digressions, ses apartés, ses métaphores filées, somptueusement boiteuses ou carrément absurdes, un festival.
«C'est un fait : les plus grandes femmes, tout en majesté, en ondoiements, ces lianes interminables, sveltes comme fumées de cigarette, infiniment troublantes, ont aussi les plus longs pieds. Il faut soutenir cette superstructure admirable, cette construction vertigineuse, il faut bien qu'elle tienne debout. Et nous comprenons soudain pourquoi les marins ne peuvent résister à l'appel des sirènes. Oui, plutôt une queue de poisson que ces palmes inaptes à la natation qui laissent sur le sable des empreintes démesurées, risibles, abolissant la magie de nos étreintes quand deux corps aimantées courent au ralenti l'un vers l'autre sur les plages blondes, dans l'incendie du crépuscule.»
C'est très fort, mine de rien : on a là en même temps fascination et ironie. En tous cas, c'est drôle (moi je trouve). Ce garçon a l'humour chevillardé au corps et la dérision pour religion — une religion sympathique, vu sa forte teneur en auto-dérision. Chevillard se fout de lui-même comme il se fout du monde, c'est ce qui donne à ses pages leur légèreté délicieuse, et puisque le monde se fout de nous, la vision qu'en donne Chevillard s'avère tout à fait lucide et juste. Sous ses dehors rigolards, il touche à l'essentiel plus souvent qu'à son tour :
«Le zoo annonce peut-être le devenir de toutes les créatures vivantes. Les barreaux poussent plus dur que le blé sur cette terre ; certaines ne savent déjà plus si elles sont dedans ou dehors.»
Et ce qui pourrait passer pour un dessert savoureux et rien de plus, à bien regarder, se révèle un nourrissant plat de résistance.
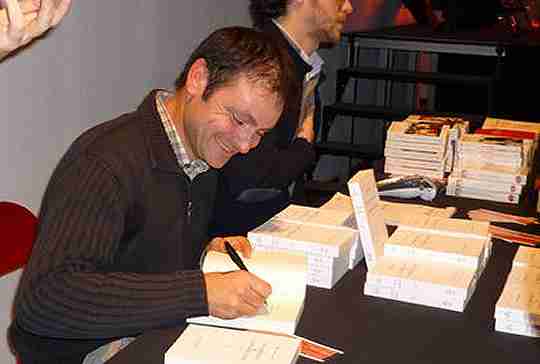 Non, sans blague, c'est lui ? Alors il existe ? |
Me frotter à Bernanos, quelle idée ! Je me sens si proche d'un Chevillard, et si loin de ce catho frénétique ! Il croit au diable, cet homme-là, il en fait même l'un de ses personnages (Monsieur Ouine, dans le roman homonyme, c'est lui), alors qu'à mon avis personnifier le Mal est une illusion faite pour s'en consoler à peu de frais : n'est-ce pas plus terrible s'il n'existe pas, si le Mal se fait tout seul ? Il y a dans Sous le soleil de Satan, son premier roman, publié en 1926 à trente-huit ans, quelques tunnels, des pages de discussions entre curés dont les trois-quarts m'échappent, et son héros, l'abbé Donissan, jeune prêtre bizarre, affreusement tourmenté, qui va devenir un saint (on reconnaît les saints à ce qu'ils sont sûrs d'aller droit en enfer), se livre à des auto-flagellations dans quelques pages épouvantables, à vous faire fuir ce livre terrible. Quelle horreur qu'une foi si dévoyée, si malsaine ! Bernanos est une brute, un forcené, sans rien qui puisse plaire aux mécréants, aux progressistes, aux petites natures dans mon genre, et pourtant son roman ne me lâche pas, il m'emporte comme une vague géante. C'est sinistre, violent, parfois sordide, à l'image du prologue où Mouchette, seize ans, enceinte du nobliau local, le tue avant de se faire sauter par un autre notable, en fait de soleil on est plongé dans la nuit la plus épaisse — nuit de l'espoir, nuit de la connaissance : «Les sentiments les plus simples naissent et croissent dans une nuit jamais pénétrée, s'y confondent ou s'y repoussent selon de secrètes affinités, pareils à des nuages électriques, et nous ne saisissons à la surface des ténèbres que les brèves lueurs de l'orage inaccessible.» Mais ce roman si noir est tout de même lumineux dans un sens, par la force incroyable de la pensée, de l'imagination, de l'écriture. Une scène en particulier, celle où Donissan, égaré en rase campagne dans la nuit noire, fait la rencontre d'un petit homme qui s'avère être le diable, cette scène qui n'en finit pas, on est fasciné, on voudrait qu'elle continue encore. On songe tout au long du livre, devant ces sentiments confus, contradictoires, changeants, extrêmes, devant ces mystères et ces vertiges, à Dostoïevski l'incomparable. Ce Bernanos, quel diable d'homme !
 Depardieu, de par le diable. |
Du salut des âmes au salut de la planète. Notre tirage au sort mensuel me met dans les mains Rendre possible un autre monde, de Jean-François Draperi. Une soixantaine de pages très denses pour présenter l'économie sociale, à savoir de nouvelles structures économiques alternatives — associations, mutuelles, coopératives — à même de lutter, si c'est possible encore, contre le régime capitaliste dominant, dont on connaît les effets. (Pas toujours désastreux, ces effets, puisqu'ils profitent à 1% de l'humanité.) Opposée au modèle néo-libéral, qui «détruit l'essentiel pour accéder au superflu», mais aussi au modèle marxiste dont elle refuse le recours à la violence (l'analyse marxiste elle-même n'étant pas récusée), la voie que l'auteur préconise et décrit s'inspire de diverses initiatives du proche passé, en Inde avec Gandhi, en Amérique Latine, voire en Europe. Nous ne sommes pas dans l'utopie, mais dans un possible qui dépend de chacun de nous, fondé sur le volontariat, la solidarité (certains d'entre nous en restent capables), la patience. «Doutant de l'efficacité du grand soir, l'économie sociale travaille à la petite semaine.» Ce petit livre n'est pas avares en formules bien tapées de ce genre, et j'en retiens une autre, à méditer : «La violence est ce qui reste de réactionnaire, de ''non humain'' (...) dans les pratiques sociales.»
Ce qui peut se discuter, j'en conviens. À ce propos, voici ce qu'on trouve dans un article sur l'album de photos signé Didier Ben Loulou, Athènes (La Table ronde), dont j'ai déjà dit le plus grand bien ici :
«Les deux auteurs de ce beau livre nous donnent à voir ce à quoi nombre d'entre nous essaient d'échapper au quotidien, et c'est peut-être heureux : l'extrême violence induite par cette situation contemporaine qui veut que 1 % de nos «frères» humains aient décidé d'asphyxier les 99 autres. Car telle est la réalité : une masse d'hommes victimes d'un crime contre l'humanité. Le temps viendra d'un nouveau Nuremberg où ces quelques individus seront jugés et, je l'espère vivement, pendus.»
Je ne connais pas Marie Stolz, auteure de ces lignes dans l'intéressante revue poétique en ligne Recours au poème. Certains, choqués par cette idée de pendaison, diront qu'elle exagère. Sans doute. Juste un peu, afin que les criminels concernés entendent et comprennent. Mais ne sont-ils pas aveugles et sourds, cuirassés dans leur égoïsme, depuis toujours et à jamais ?
Si la violence finit par les engloutir, ils en seront les seuls responsables. Je n'irai pas les tuer, mais on ne me verra pas non plus pleurnicher sur leurs tombes. Quant à Marie Stolz, je lui souhaite longue vie.
Côté films, ce mois-ci, fin de la série Top of the lake de Jane Campion, avec un avant-dernier épisode spécialement haletant et une conclusion un peu décevante, car trop riche en coups de théâtre. Mais ne chipotons pas : l'ensemble est admirable, les personnages fouillés, attachants — même certaines crapules —, les acteurs vaillants, la nature superbe, et ceux qui aiment les femmes seront comblés par celles qui mènent ici la danse, à commencer par l'enquêtrice, si fragile, si forte. La série tout entière est l'un des plus beaux hymnes à la femme qui soient.
 Ainsi donc, la petite n'est pas morte ! |
À voir peu de films, on devient difficile. L'amour est un crime parfait des frères Larrieu a pourtant bien des atouts : qu'ils sont beaux, les paysages et les décors, qu'elles sont affolantes, et généreusement dénudées pour notre bonheur, toutes ces dames qui harcèlent ce malheureux Amalric. Karin Viard ! Maïwenn ! Sara Forestier ! De quoi le rendre fou... Certains ont qualifié ce film d'hitchcockien ; d'où vient qu'il ne m'a pas un instant donné le même frisson qu'Hitchcock, et que tout cela m'a paru agréable, mais vain ?
 Mathieu Amalric, Sara Forestier. |
Dans la famille Scandinaves déjantés, voici le norvégien Bent Hamer, découvert grâce à l'ami Lucien. Kitchen stories (2003) met en scène le moins sexy des duos : un paysan solitaire et taiseux et un comportementologue chargé de l'observer dans sa cuisine. Après avoir joué les chiens de faïence, ils vont peu à peu quitter leur mutisme et devenir presque potes. Pas de sexe, pas d'amour dans cet OCNI, mais une ambiance bizarre entre Tati, Keaton et Beckett, un burlesque lent, pince-sans-rire, cachant une gravité secrète, et un jeu épatant sur les couleurs, à base de gris et de verdâtre. Cher Bent Hamer, à bientôt !
 Tout le film est là. |
Dernier bonheur du mois : revoir Les enfants terribles (1949), scénar de Cocteau, mis en scène par l'impeccable Jean-Pierre Melville. Cette histoire vaguement incestueuse entre frère et sœur n'a rien perdu de son charme ambigu. Edouard Dhermitte et Nicole Stéphane se ressemblent, on les croirait frère et sœur pour de bon ; lui, joli garçon plutôt féminin, elle et son charme vaguement viril ; lui pas très bon acteur (imposé par Cocteau), écrasé par elle, ce qui va dans le sens de l'histoire ; elle est brûlante, indomptable, inoubliable.
 Frère et sœur. |
L'autre soir, au SEL en bas de chez nous, retransmission en direct du Don Giovanni de Mozart depuis la Royal Opera House de Londres. Musique sublime, chanteurs excellents et même beaux, mise en scène intéressante, image et son sans reproche, trois heures de bonheur pour une quinzaine d'euros. J'imaginais que la salle serait pleine, eh bien non. Que font-ils donc le soir, les chévriens ? Sont-ils plutôt France 2 ou TF1 ?
Mars, mois chargé pour le traducteur. Je causerai le 7 et le 11 à l'Institut français d'Athènes, le 15 à Bruxelles, puis le 22 à Lyon où je présenterai le poète Alèxandros Ìssaris.
Au programme sur ce même site, le 1er avril, Jaccottet, Camus, Augiéras, Charrin encore, Pinçon-Charlot, Stefansson, Loy, et à la demande expresse de ses nombreux admirateurs, l'immortel Léonce Bourliaguet.
 La lecture éclaire nos nuits... |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Dieu est plein de bonté tant qu'on ne lui demande rien.
Le jour où la merde vaudra de l'or, les pauvres naîtront sans trou du cul.
Si tout le monde te déteste parce que tu es paranoïaque, tu ne l'es plus.