
Le célèbre Héraklès (1909)
BRÈVES
N°115 Avril 2013
Quand on s'est habitué à regarder les tableaux sur le papier glacé d'un livre ou la vitre d'un écran d'ordinateur, rencontrer les originaux vous fait le même effet que le vent du large au citadin qui vit entre quatre murs. Carole et moi découvrons le musée des Beaux-Arts de Lyon et sa collection enchanteresse d'œuvres du XXe siècle : Braque et sa «Femme au chevalet», Matisse, Bonnard, quelques autres encore, mais ce qui me frappe le plus peut-être, ce sont les grands contemporains d'il y a cinquante ans, un peu moins fêtés aujourd'hui semble-t-il, dont je n'avais jamais vu les œuvres pour de vrai : Viera da Silva, Roger Bissière, Hans Hartung. Leur présence est d'une intensité magique.
Ne pas rater les sculptures, somptueusement installées dans une ancienne chapelle. Il y a là des artistes dont j'ignorais tout (Joseph Bernard, Rik Wouters et son extraordinaire «Folle danseuse»), et aussi les grandes stars : Rodin et son «Paolo et Francesca», Barye et son lion, Bourdelle et son célébrissime «Héraklès archer», d'une force hallucinante.
 Le célèbre Héraklès (1909) |
Si j'ai délaissé mon Mac et mes dicos pour une journée à Lyon, c'est que le devoir m'appelle. Un devoir doublé d'un plaisir. Je vais retrouver l'association Dekfalion, ses adorables organisatrices, son public en or et l'héroïne de la soirée, mon amie Athina Papadàki, l'une des voix les plus fortes de la poésie grecque actuelle, venue spécialement d'Athènes.
Après la séance, au dîner, Athina se penche vers sa voisine qui réside en France et lui dit : Vous avez une bien jolie bague. Nous autres ne pouvons plus porter de bijoux dans la rue, souvent on nous les arrache, même les boucles d'oreille.
La Grèce fut longtemps l'un des pays les plus sûrs du monde. Là aussi, la crise est en train de tout saccager. Il y a comme ça des petits détails qui résument tout, et font froid dans le dos.
Le 29 mars, à Lyon, au festival Quais du polar, Liquidations à la grecque, de Pètros Màrkaris, publié au Seuil, a reçu le Prix du polar européen. C'est le premier volume d'un ensemble intitulé Trilogie de la crise. Les deux suivants paraîtront sous peu. Un grand merci à Anne Freyer, Marie-Anne Esquivié et Marie-Claire Chalvet : elles se sont démenées pour défendre ce superbe polar, qui dit tant de choses sur la Grèce actuelle.
Sur mon agenda, en ce mois d'avril, actualité grecque fournie : petit tour à Thionville le 6 avec Ersi Sotiropoulos et un atelier de traduction, puis le 20 avril à Bordeaux où je présenterai des poèmes grecs en vers, traduits en vers, de Cavàfis à Vayenas en passant par Kavvadìas et Ganas.
Avril verra également — si tout se passe bien — deux parutions qui me tiennent très à cœur.
D'abord, après un an de galères diverses, le premier volume de mon anthologie permanente Poètes grecs du 21e siècle, présentant dix poètes chaque année pendant six ans au moins — j'espère. Pour commencer, un choix très varié, avec Liondàkis, Vayenas, Kyparìssis, Papadàki, Markòpoulos, Papalexàndrou, Roùvalis, Alexopoùlou, Rakòpoulos et Aïnalis. Les éditions publie.net de François Bon proposeront l'ouvrage sous forme électronique mais aussi sur papier, et dans les prochains mois c'est toute ma Collection grecque, soit treize titres, qui sera papiérisée en POD (édition à la demande).
Seconde publication : le Toi au moins, tu es mort avant de Chrònis Mìssios, adapté en BD par Sylvain Ricard et Myrto Reiss au scénario et Daniel Casanave au dessin chez Futuropolis. Ce témoignage sur les prisons grecques dans les années terribles, de la Guerre civile à la Dictature, est un livre essentiel par la richesse humaine de la vision et la force de l'écriture. Le travail des trois adaptateurs, à la fois fidèle et inventif, plein de vigueur et de finesse, aurait sûrement ravi l'auteur, hélas mort juste avant. Parallèlement, publie.net réédite le texte intégral en deux versions, électronique et papier ! Internetophobes, n'ayez plus peur de publie.net !
 Bravo, Daniel Casanave ! |
Actualité grecque (suite). Chrìstos Chryssòpoulos, jeune auteur dont on a déjà pu lire, chez Actes Sud, trois romans (Le manucure, Monde clos et La destruction du Parthénon), récidive chez le même éditeur avec Une lampe entre les dents, longue marche dans les rues d'Athènes aujourd'hui. L'auteur rapporte ce qu'il y voit et entend, assorti de réflexions diverses. Celles-ci ne sont sans doute pas la partie la plus passionnante de l'ouvrage, au demeurant plutôt bref, mais les pages de simple récit n'en paraissent que plus frappantes. Le portrait qu'elles dessinent d'une ville à la dérive est saisissant. Chryssòpoulos a le coup d'œil aigu, il décrit avec autant de lucidité que d'empathie la cour des miracles qu'Athènes devient peu à peu, l'espèce de folie qui rôde, les SDF naufragés de la crise, ombres, spectres, morts-vivants, les petits trucs pour survivre, à commencer par cette règle d'or : se rendre invisible.
«On rencontre partout des gens qui vont et viennent, sans but, désorientés, sans intention particulière. Souvent, ils font quelques pas dans un sens, puis subitement ils s'arrêtent, retournent là d'où ils étaient partis, puis repartent l'instant d'après, dans une oscillation dépourvue de sens qui ressemble au bercement d'un autiste.»
«On dirait que la ville s'est retournée sur elle-même. Comme on retourne une chaussette. Tout ce qui autrefois avait sa place à l'abri des regards, tout ce qui restait caché — ou plus exactement privé — entre les quatre murs des habitations est aujourd'hui livré en pâture au beau milieu de la rue, au vu et au su de tous. Le corps dont on doit s'occuper, les fonctions élémentaires comme manger ou dormir, les disputes, les gestes amoureux, tout cela se déverse à présent autour de nous, avec désespoir, impudeur, sans même la délectation de la transgression — en un spasme nerveux.»
La traduction d'Anne-Laure Brisac rend pleinement justice au livre.
 La Grèce au pilon... |
La Grèce, toujours la Grèce ! Dans ce fichu site, on ne quitte l'hexagone que pour aller se faire voir en Grèce !
C'est moi-même qui m'adresse de loin en loin ces reproches. Et qui les trouve, ma foi, justifiés. Eh bien secouons-nous, changeons d'horizons, cap sur le Mozambique, patrie de Mia Couto. Dix de ses romans ont déjà été publiés chez nous, chez Albin Michel et Chandeigne, et ce sont les éditions Métailié qui publient aujourd'hui Poisons de Dieu, remèdes du diable, traduit du portugais.
...
Aïe. Rien à dire. C'est sans doute un très bon livre et même les chefs-d'œuvre ne peuvent plaire à tout le monde, c'est sûrement ma faute si je n'ai pas vibré à cette histoire qui réunit, dans une petite ville paumée du Mozambique, un vieil homme impotent et un jeune médecin follement amoureux de la fille dudit. Qu'est-ce qui a pu charmer tant de lecteurs, à quoi je reste sourd ? L'ouvrage deviendrait-il génial à partir de la p.113 où j'ai calé ?
Ce que j'ai noté : quelques savoureux néologismes (kangourouer, se démulâtrer, illucidité, contamineux...) et plusieurs problèmes de traduction — pas assez drôles pour divertir le volkonaute. Signalons simplement que «se souvenir» et «se rappeler» se construisent, l'un avec «de», l'autre sans, comme on l'apprend au CM2.
Ne défaisons pas nos valises, essayons la Russie, grâce à Carole qui a tiré le bouquin au sort dans ma bibliothèque des oubliés.
Une bourgade là aussi, plus perdue encore, une ligne de chemin de fer où ne passe qu'un seul mystérieux train, quelques personnages cabossés qui végètent là en attendant le train chaque nuit et la mort au bout d'une existence vide. La force de ce bref récit, Le train zéro de Iouri Bouïda (1997 en v.o., 1998 chez Gallimard), tient à l'alliance réussie entre un réalisme intense et une dimension fantastico-symbolique à la Kafka : d'un côté le froid, la boue, les odeurs de chou, la vodka, la misère, le désespoir ; de l'autre ce train incroyablement long et rapide, qui régit tout, dont on ne sait rien, manifestation d'un pouvoir invisible qu'il faut craindre et servir sans comprendre :
«Tu n'existes pas, moi non plus, il n'y a personne, nous ne sommes tous que l'ombre de la Ligne, l'ombre d'un ordre, si tu veux — l'ombre de l'avenir.»
On croit encore aux lendemains qui chantent, là-bas, en ce temps-là, ou on fait semblant, alors que tout barre en couille sous nos yeux et que certains ont deviné le secret : ce train qui seul existe, en fait n'existe pas lui non plus :
«...le train zéro est un mirage. Ouvre les yeux, Don. Allez, Don, regarde bien, fais un effort, mon vieux, c'est juste le vent qui court à travers la plaine sans fin, juste un vent qui souffle de la Russie, le pays des mirages, des enfants perdus, des mères et des pères égarés, le pays des amants morts, des traîtres et des fous, un vent qui vient de la Patrie, celle qui dévore ses propres enfants...»
Ce monde ? Un cauchemar peuplé d'ombres et de morts-vivants, l'auteur nous le martèle avec une force qui gifle comme un vent glacé, et que la traductrice, Sophie Benech, n'affaiblit pas — autant que je puisse juger, ayant pratiquement oublié (tchort vazmi !) la langue de mes ancêtres.
 Russie, désert blanc |
C'est parti, on ne s'arrête plus. Cap sur l'Orient ! Cette fois le guide s'appelle Patrick Deville, on l'a déjà rencontré ici même et on n'a sûrement pas fini de le revoir. Son Kampuchea nous avait emmenés au Cambodge et cette fois nous repartons avec lui en Indochine, comme cela s'appelait avant. Peste & choléra, publié au Seuil, est la biographie d'un homme remarquable, Alexandre Yersin. Médecin bactériologiste disciple de Pasteur, il découvrit le bacille de la peste et le vaccin assorti, mais fut en même temps l'un des derniers touche-à-tout de la science, aujourd'hui étroitement spécialisée ; curieux de tout et inventeur inépuisable, il explora l'Indochine, s'y installa et mit en valeur un domaine immense grâce à toutes sortes d'innovations agronomiques. Devenu riche, il resta cependant toujours proche des petites gens, qu'il soigna autant qu'il put. Aujourd'hui encore, au Viet-Nam décolonisé, il fait l'objet d'un culte.
Deville, grand voyageur, ne pouvait qu'être séduit par ce Yersin atteint comme lui d'une vadrouillite aiguë contre quoi il ne chercha jamais de vaccin ; par cet homme libre, «rétif à toute contrainte sociale, (...), un ours, un sauvage, un génial original, un bel hurluberlu» ; par sa croyance au progrès et au bonheur futurs, aujourd'hui désuète et attendrissante ; par sa destinée hors du commun, qui dans un roman serait jugée invraisemblable. L'éditeur a cependant collé, à cette bio solidement documentée, apparemment très fidèle, l'étiquette «roman» — laquelle, il est vrai, ne veut plus rien dire.
Peste & choléra a reçu, paraît-il, deux prix, mais c'est tout de même un excellent livre, vif et nerveux, plein de ces ellipses où l'on reconnaît les bons auteurs :
«Yersin n'est pas un homme de Plutarque. Il n'a jamais voulu agir dans l'Histoire. À la différence des Vies que celui-ci met en parallèle, celles des traîtres et des héros, celle-là de Yersin n'offre aucun exemple à fuir ou à reproduire, aucune conduite à suivre : un homme essaie de mener son embarcation en solitaire et la mène plutôt bien. Derrière lui la mer efface son sillage. Le soir on l'aide à gagner son bureau. Il reprend l'étude du grec et du latin.»
(Il est alors très vieux.)
J'en redemande ! En souhaitant malgré tout que le succès de ses bios n'incite pas l'auteur, épatant romancier par ailleurs, à négliger la fiction.
 Alexandre Yersin à 30 ans. |
Allons plus loin encore : le bout du monde se trouve en Ecosse, sur une petite île totalement isolée où Eric Blair, dit George Orwell, à la fin de sa courte vie, s'installe en 1946 pour écrire 1984.
Encore une bio de personnage extraordinaire, sauvage et original génial ; encore un épisode réel digne d'un roman ; encore un écrivain de première force, fasciné par son sujet : Jean-Pierre Martin.
Pour écrire L'autre vie d'Orwell (Gallimard, collection L'un et l'autre), le biographe aurait pu se contenter de recracher sa documentation, comme font tant d'autres. Orwell, malade, s'exilant loin de tout, vivant en quasi autarcie, dans un confort plus que spartiate, travaillant comme une bête, bricolant, jardinant, c'est l'une des histoires les plus étranges qui soient. Une énigme aussi. Que va-t-il chercher si loin, ou que fuit-il ? Espère-t-il que Big Brother ne le retrouvera pas là-bas ?
Mais il n'y a pas qu'Orwell dans ce livre : il y a Jean-Pierre Martin, qui pendant un temps se retira du monde lui aussi, qui comprend Orwell de l'intérieur et le dépeint avec autant de lucidité que de tendresse, éclairant le mystère de cette retraite orwellienne avec sa perspicacité, sa sensibilité, son humour, son éblouissant talent d'écriture, toutes qualités dont j'ai déjà parlé ici même. L'autre vie d'Orwell est plus qu'un régal : un de ces livres qui vous remplissent d'air pur et vous donnent envie de changer la vie.
Car l'odyssée d'Orwell commentée ainsi est aussi une invitation à réfléchir. Il ne s'agit pas pour nous, bigbrotherisés que nous sommes, de nous réfugier sur une île déserte — y en a-t-il encore ? Mais de chercher les moyens d'éviter, par on sait trop quelles stratégies sans doute moins radicales, quelles esquives intérieures, d'être totalement dévoré corps et âme par le monstre.
Un seul reproche : trop de passages à citer... J'aime Orwell qui «saisit le mot juste comme une truite qui frétille sous la main». J'aime le pénétrant parallèle, p.92, entre Rousseau, Bernanos, Orwell et Thoreau, «héroïques Alceste», avec «leur figure un peu raide de chevalier blanc et de don Quichotte ascétique», leur manque d'insouciance, mais aussi leur «hédonisme paradoxal». Mais c'est une autre page qui s'impose, que j'aime trop pour me résoudre à la couper :
«Si l'on ne sait pas trouver dans la survie une forme de vie par excellence, si l'on est trop attaché à la routine d'un confort sans accroc ou à la recherche sans intermédiaire d'un plaisir de l'instant, on pointera dans la décision d'Orwell l'effet de quelque masochisme. Son activisme, son jusqu'au-boutisme, sa ferveur agricole, comment comprendre tout cela si l'on n'a jamais éprouvé soi-même l'épuisement volontaire de soi comme une ivresse ? Seuls ceux qui connaissent intimement l'étrange satisfaction du corps fourbu à la fin d'une journée de paysan peuvent comprendre combien une fatigue bienfaisante stimule l'imagination, comment certaines constitutions n'accèdent à un relatif apaisement que lorsque toute l'énergie dont elles débordent a été mobilisée. Avec cet effet étonnant, tournoyant, hallucinogène : une sorte d'abrutissement qui libère l'esprit.»
 Eric Blair et son fils adoptif. |
Non, nous n'allons pas en Pologne ! Le moulin de Pologne, dans le roman homonyme de Jean Giono, se trouve aux portes de sa Manosque natale. J'ai lu ce Moulin de Pologne il y a un demi-siècle, et si j'avais tout oublié de l'histoire je me souviens très bien de mon ravissement d'alors. Je rouvre aujourd'hui le livre, vaguement inquiet, comme avant de retrouver un copain de jeunesse.
Eh bien le vieux copain pète la forme. Ce roman, sans doute le plus allègrement cruel de son auteur, dépeint avec une verve méchante la vie d'une petite ville, ses préjugés, ses haines, ses peurs idiotes, ses cancans, ses manigances — un «grouillement de cancrelats», dit un commentateur. Giono, à l'époque, rendu amer par ses mésaventures d'après-guerre, note dans un carnet, reprenant Hobbes : «L'homme est naturellement mauvais». Son narrateur anonyme, habitant de la petite ville, déclare au nom de ses concitoyens : «Il nous faut manger avant d'être vertueux. Neuf fois sur dix nous constatons que pour nous emplir la bouche, il faut vider celle du voisin. À ce régime, celui qui porterait en lui les éléments de la grandeur crèverait, la bouche vide, comme doivent mourir les plus faibles. (...) C'est pourquoi, en nous comme autour de nous, tout est petit. Et je vous garantis que, de cette façon, le monde va. (...) Celui qui a la chance de pouvoir aimer, qui peut saigner et souffrir sans regret, n'a pas le droit de nous reprocher la joie que nous éprouvons à haïr quand c'est la seule qui soit (ou qui reste) à la portée de notre cœur.»
Giono aime fouiller les âmes dans leurs plus sombres recoins, sachant qu'on n'atteint jamais le fond. (Il se plaît aussi à lancer des allusions obscures, trop subtiles pour son pauvre lecteur.) Mais pour lui, le monde ne se limite jamais aux cancrelats : il adore les êtres mystérieux et les beaux monstres, et cette épopée de la petitesse est traversée, comme tous ses livres, par quelques âmes fortes qui sauvent la mise à l'humanité.
J'avais tout oublié ? Non, c'est faux. Un détail m'était resté, fulgurant : une page avant la fin, le petit narrateur méchant nous glisse, enveloppé dans une parenthèse, cet aveu qui éclaire tout : «Ai-je dit que je suis bossu ?»
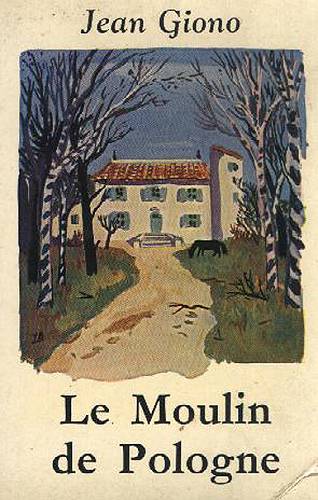 Édition du Livre de Poche, 1962. |
Et l'on se retrouve à Paris — même si dans le dernier roman de Patrick Modiano, L'herbe des nuits (Gallimard), Paris prend à tout bout de champ des airs de ville provinciale. C'est pour l'auteur une façon parmi d'autres de dissoudre la réalité, dans cette histoire pleine de fantômes, de personnages louches et fuyants, de mystères et d'actes inachevés. C'est habituel chez Modiano, dira-t-on, mais plus encore ici, dans ce roman extrême où il ne se passe quasiment rien, comme dans l'extraordinaire Dora Bruder : le jeune narrateur côtoie une petite bande fort suspecte, a une brève liaison avec une jeune femme fuyante dont il apprendra plus tard, bien après l'avoir perdue, le passé criminel. Le temps vacille et parfois se dissout lui aussi, au point que le narrateur déclare : «Il n'y a jamais eu pour moi ni présent ni passé». Il flotte perpétuellement dans une sorte de manque d'être : «Je n'avais à cette époque aucun droit ni aucune légitimité. Pas de famille ni de milieu social bien défini. Je flottais dans l'air de Paris.» Flottement agréable ou malaise, on ne sait pas toujours — autre flottement. Ce narrateur, c'est Modiano jeune et ce n'est pas lui, d'où flottement là encore, entre mémoire et fiction, comme dans la plupart des romans sans doute, mais Modiano joue de cette ambiguïté plus que tout autre.
Qu'est-ce qui garde matière, épaisseur, existence, chez Modiano ? Les mots. Les noms des mauvais garçons : Chastagnier, Aghamouri, Duwels, Marciano, amoureusement choisis, revenant comme un leitmotiv, un refrain. «La Barberie. Le Moulin d'Etrelles. La Framboisière. Les mots resurgissent, intacts, comme les corps de ces deux fiancés que l'on avait retrouvés en montagne, pris dans la glace, et qui n'avaient pas vieilli depuis des centaines d'années.»
L'un des plus beaux Modiano ? Le plus beau, c'est toujours le dernier que je viens de lire. Et les plus pauvres en matière ne sont-ils pas les plus modianesques, les plus hardis, les plus sournoisement émouvants ?
Paris toujours. Nous partons en bus avec Jacques Roubaud et son Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, long poème épico-comique. La description des lieux et des péripéties du voyage, de Saint-Lazare à Montempoivre, est enrichie d'une prolifération de digressions elles-mêmes ponctuées d'incises qui elles-mêmes etc., les degrés de digression étant indiqués par des retraits et des couleurs. Ce qui donne :
Sitôt le boulevard atteint tonitruant
Venant de république et vers bastill' se ruant
Admirez comment jeu par synérèse marque
La précipitation
Ne suis-je gymnasiarque
Et très audaci-eux virtuose du vers ?
Autos, motos, camions tous font un bruit d'enfers
Notre machiniste a vec ardeur accélère
À peine avons-nous lai sé le pasteur wagnère
Derrière nous que de beaumarchais le tronçon
Qui nous échoit est par couru hé le friçon
De la vitesse fût tel que nous n'eûmes guère
Loisir de regarder, prendre note. que fère
Pour rendre compte ?
Alexandrins, certes, mais les règles classiques y sont violées de diverses façons, la règle étant qu'elles le soient presque à chaque vers. Le poème avance donc à une allure à la fois pépère et sautillante, lent mais cahotant comme un bus, on pense très fort à Queneau et Perec, on savoure une foule de jolies trouvailles, on sourit souvent, les éditions Attila ont fait un travail d'édition exemplaire et l'on souhaite le succès à ce beau livre. Et si l'on trouve l'exercice un peu long, un peu forcé, un peu littéraire, un peu vain par moments, on se dit qu'on a sûrement tort, qu'on est un vilain pisse-froid et qu'on changera peut-être d'avis en remontant plus tard dans ce bus roubaldien.
 Le 29 en 1966. |
Des vers encore, mais plus classiques, avec la Petite anthologie imaginaire de la Poésie française, signée Henri Bellaunay, aux éditions de Fallois. Ils sont presque tous là, nos grands poètes, de Rutebeuf à Supervielle et Queneau. Mais attention : ces poèmes sont des pastiches ! On pourrait parfois s'y tromper, tant Bellaunay est un virtuose du vers. Son Psaume XXVI paraphrasé par Corneille puis Racine est un prodigieux tour de force. Exemple la dernière strophe.
Corneille :
Ne permets point, Seigneur, que ma fragilité
Sur les pas du méchant en ces chemins souillés
Se puisse pervertir.
De mon timide pied anime les lenteurs
Et donne-moi d'avoir le souverain bonheur
De toujours t'obéir.
Et Racine :
Fais en sorte, mon Dieu, que ma frêle nature
Suive ta droite voie et des sentiers impurs
Ignore les détours.
Vers tes limpides eaux consens à m'emmener
Et que je sache enfin la sainte volupté
De t'obéir toujours.
On s'y croirait (presque). Parfois, le pasticheur montre le bout de son nez, comme dans ce du Bellay :
Très excellent Ronsard
Et Belleau, et Tyard,
Et toi, gentil Baïf,
Donnez-nous de vos sources
Les bondissantes courses
Dans le matin natif,
Et donnez à nos âmes
De vos dansantes flammes
Les rieuses clartés,
Cependant que s'apprête
Greimas et/ou Genette
À les enténébrer.
Les puristes seront sans doute un peu chagrinés par certaines libertés prises à la rime... N'ergotons pas. Ce petit volume est un trésor, un viatique essentiel pour tous les amateurs de poésie et de rigolade, en compagnie de la Nouvelle anthologie imaginaire... que Bellaunay publia ensuite. C'est pour qualifier le travail de cet homme-là que fut inventé le mot «délicieux».
Il fallait bien ce court intermède, cette oasis de calme et de beauté, avant de replonger. Le 8 février 1962, une manifestation pacifique fut réprimée par la police française avec la sauvagerie que l'on sait. Résultat : huit morts au métro Charonne. Maryse Douek, alors élève du lycée de Chèvres, avait dix-sept ans ; ce jour-là elle faillit mourir. Cinquante ans plus tard elle s'est décidée à témoigner. Désirée et Alain Frappier — elle écrivant, lui dessinant — ont tiré de ce drame un récit graphique sérieusement documenté qui ne fait pas seulement revivre la tuerie elle-même, mais l'atmosphère de cette époque, les conversations entre jeunes et au sein des familles. L'ensemble est d'une extrême justesse. On en ressort bouillonnant d'une saine colère. Il faut lire Dans l'ombre de Charonne, aux nouvelles éditions Mauconduit, pour ne pas oublier de quoi les hommes au pouvoir sont capables.
Une page du livre aligne les noms des officiers de police ayant dirigé la charge en excitant leurs fauves : Jean Soreau, André Yser, François Defrance, Ernest Arnaud-Jules, Jean Ravinet, Elie Bisserbes, Louis Courtois, Jean Pascault, Marcel Goureau, Louis Armand, André Collin, André Drouin, André Gauthey, Georges Dauvergne. Sur la page d'à côté, ceux qui les ont couverts, voire encouragés : Maurice Papon, préfet de police ; Roger Frey, ministre de l'Intérieur. Puissent leurs descendants aller gerber sur leurs tombes.
J'oublie quelqu'un ? Le président de la République ? Allons donc. Pour Charles de Gaulle, trônant dans les hauteurs, que pouvaient bien représenter quelques morts de plus, fourmis de rien du tout ? Il savait que son appel du 18 juin le plaçait à jamais au-dessus des lois, et qu'on lui pardonnerait ses infamies — y compris, trois ans plus tard, le meurtre de Ben Barka. Comme quoi un grand homme peut en même temps se conduire comme un salaud.
 Lycéens devant le lycée de Chèvres, 1962. |
Vers la même époque, sortait un film qui fit alors beaucoup de bruit : Les tricheurs, de Marcel Carné. Si le crime de Charonne est resté une plaie ouverte, le pensum de Carné a tout du cadavre. Les jeunes qu'il met en scène ont des rôles faux qu'ils jouent faux. La bande son crache du jazz à jet continu pour faire moderne. Seul intérêt du film : le déjà grand Laurent Terzieff se démenant pour s'arracher à cette glu, tel un oiseau pris dans la marée noire. Jacques Prévert, scénariste attitré de Carné, n'a pas travaillé à ces Tricheurs qui sont, du même coup, l'une des plus belles preuves de son talent.
Lady Oscar de Jacques Demy ? Une œuvre de commande, d'après un manga racontant aux Japonais la France de Louis XVI. Ç'aurait pu être comique, eh bien même pas. On ne trouve pas là le nanar que décrivent certains, la chose est tournée avec soin par un bon professionnel, mais quand on pense à Lola, à Une chambre en ville, on a du chagrin.
Victor, Victoria, de Blake Edwards ? Bizarre. Je l'ai vu à sa sortie, je viens de le revoir, c'était très bien, brillant, drôle, et je ne me souviens de rien.
Au bout du conte, d'Agnès Jaoui ? Voilà quelqu'un que j'adore, dont je me sens proche, que je serais heureux d'avoir pour amie, dont j'apprécie fort les films. Ils sont intelligents, fins, sensibles, ils m'émeuvent et me font rire... Et plus tard, j'ai du mal à me rappeler de quoi ça parle. Mais celui-là, variation sur l'usure des couples et sur la part d'irrationnel dans nos pensées, je crois que je m'en souviendrai : c'est le plus inventif, le plus libre sur tous les plans, le plus riche.
N'empêche, le sommet du mois, côté cinéma, c'est Syngué Sabour, pierre de patience, d'Atiq Rahimi, qui adapte là son propre roman. Dans une ville (Kaboul ?) ravagée par la guerre, livrée à la violence des hommes, les femmes s'organisent pour survivre. L'une d'elles parle à son mari plongé dans le coma et peu à peu lui avoue ses secrets les plus intimes, les plus terribles. Ce film à la gloire des femmes, venant d'un pays ultra-macho, ô divine surprise ! Le scénario est virtuose (Jean-Claude Carrière y a mis la main), les images splendides, et que dire de l'héroïne, Golshifteh Farahani, de sa beauté lumineuse ?
 La femme et le mari inconscient — à moins que... ? |
L'accompagnement musical du mois est confié à Nikolaï Rimsky-Korsakov, dont nous entendons souvent certaines pièces brillantes et bien plus rarement ses grandes œuvres : les opéras. Il n'a pas eu de chance, Rimsky. Si talentueux pourtant, il pâlit à côté de deux génies : son ami Moussorgsky, dont il récrivit certaines œuvres de façon un peu trop académique, et son élève Stravinsky. Son opéra La fiancée du tsar, qui me tient compagnie ces jours-ci, trrès rrusse et rutilamment orchestré comme tous les autres, se laisse écouter avec beaucoup de plaisir de bout en bout, mais c'est dans ses opéras à dimension fantastique ou féérique, Sadko, Le coq d'or ou Kitège, qu'il atteint par moments les sommets. Quelques notes suffisent et l'on est emporté.
En mai ? Un bon vieux Simenon. Giono et Gailly, Page et Pellerin, Emaz et Zeimert, Freud et Fred, Edwards et Demy... Il y en aura pour tous les goûts.
 Fantasy Fest. |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Un bon mot vaut mieux qu'un mauvais livre.
L'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive.
Quand un livre de deux cents pages en contient dix d'instructives, nous devrions remercier l'auteur, et faire comme si le reste n'avait pas été écrit.