
La Presse Française et ses fins limiers courant après le Chef-d'œuvre.
BRÈVES
N°111 Décembre 2012
C'était la saison des prix, me dit-on. Il paraît que cette année les divers jurys n'ont pas trop déconné. Les critiques semblent contents. Une de Télérama regrette qu'Angot et Djian n'aient pas reçu de breloque, mais c'est sûrement de l'humour au xème degré.
Pour ma part, très envie de lire La peste et le choléra de Patrick Deville qui a décroché je ne sais plus laquelle, de breloque, tant j'ai goûté naguère son Kampuchéa, mais quel intérêt de causer des livres dont tout le monde cause ? J'attendrai que la meute, galopant frénétiquement aux trousses de l'actualité, soit passée aux nouvelles nouveautés.
Bizarre, cette obsession du neuf. Ce besoin qu'ont nos critiques de courir sans un seul coup d'œil en arrière, en peloton compact. Les livres grecs en sont souvent victimes, eux qu'on découvre quasiment toujours — quand on les découvre — avec un ou deux temps de retard. C'est arrivé deux fois l'an dernier : deux journalistes s'éprennent, l'un du Beau capitaine de Koumandarèas (Quidam), l'autre de Qu'a-t-elle vu, la femme de Loth ? de Bourazopoùlou (Ginkgo), deux grands romans, en effet. Seulement voilà, on ne peut pas en parler, ils sont sortis trois mois plus tôt — autant dire un siècle.
Je rêve d'une presse moins pressée. J'imagine une revue qui s'occuperait uniquement de livres oubliés, voire jamais remarqués. Nadeau raconte dans Grâces leur soient rendues, son autobiographie — bouquin délicieux, inusable —, qu'il accueillit dans sa Quinzaine, pendant un temps, une chroniqueuse pseudonymée Tante Ursule qui recensait les titres négligés de tous. Il s'agissait de nouveautés, certes, mais il y avait là un louable début. Où es-tu donc passée, Tante Ursule ?
 La Presse Française et ses fins limiers courant après le Chef-d'œuvre. |
N'exagérons pas non plus. Je ne veux pas m'empêcher d'évoquer ici des quasi-nouveautés réjouissantes.
D'abord, dans notre série romans d'entreprise, après le Journal ambigu d'un cadre supérieur d'Etienne Deslaumes, voici Ils désertent, de Thierry Beinstingel, chez Fayard, meilleur encore à mon sens. Deux personnages principaux : un vieux VRP qui travaille à l'ancienne, que sa hiérarchie veut virer (stupidement, car il demeure très efficace), et la jeune collègue chargée de le pousser dehors. Tout devrait les opposer, ces deux-là, seulement voilà...
Ne racontons pas tout. Le roman séduit dès son titre à double fond (ils désertent / île déserte), puis par son regard attentif, tantôt discrètement chaleureux (sur ses deux héros, sur les humbles en général), tantôt calmement féroce (sur l'entreprise actuelle, monde cruel et vulgaire), par son attention à l'infra-ordinaire et ses détails minuscules, mais ô combien signifiants.
Portrait d'une femme anonyme, seule dans une rue d'un lotissement neuf et sans âme :
«Tu repenses à cette femme appuyée sur ce vieux break, sa lassitude, son attitude d'abandon, d'abdication, de résignation, sa cigarette lentement consumée en regardant ce logement qu'elle quittait, l'espoir d'une vie qui partait en fumée, une cartouche de plus grillée. La vie est dure, se découpe en tranches nettes et brutales comme les murs de ces quartiers, la rectitude violente des avenues qui ne mènent nulle part. Ombre des arbres rachitiques furieusement jetées à terre, trottoirs de pierre pour délimiter du vide, et le vent de chaleur recouvre déjà les rues neuves d'une poussière de désert.»
L'auteur installe un dispositif tout simple, mais efficace : des chapitres alternés, où il s'adresse tantôt à lui (qu'il vouvoie), tantôt à elle (qu'il tutoie). En plus des deux héros, sans cesse plus attachants à mesure qu'on les découvre, s'ajoute un troisième personnage : un certain Arthur Rimbaud, qui fut voyageur de commerce lui aussi, et qui déambule dans l'histoire comme un fantôme.
À la fin, miracle ! David abat Goliath, la petite bonne femme dit merde à sa hiérarchie, comme on le souhaitait sans l'espérer. Raison de plus pour que les tenants du Progrès, les dévots du Marketing triomphant et du Fric à tout prix, n'ouvrent pas ce livre. Il les agacera. Ils le jugeront naïf et passéiste — lui attribuant leurs propres défauts.
Mais que dis-je ? Comme s'ils avaient le temps de lire, ces gens-là.
Le roman de Beinstingel a fait un peu parler de lui, plus en tous cas que celui de Tierno Monénembo, Le terroriste noir, au Seuil. Un grand merci aux amis qui m'ont signalé ce beau moment de lecture. L'histoire, à elle seule, vaut le détour : pendant la Deuxième guerre mondiale, un soldat noir, prisonnier des Allemands, s'évade et se réfugie dans un village des Vosges où il crée un maquis tout en séduisant plusieurs femmes avant d'être repris, torturé, exécuté.
On n'y croit pas, à cette histoire. On a tort. Ce personnage a existé, l'auteur a juste un peu brodé. Addi Bâ, héros de la Résistance, qui résista des semaines à la torture sans parler, fut ensuite oublié des autorités pour cause de peau trop sombre. Nos soldats noirs étaient là pour se faire tuer en première ligne, pas pour cueillir des lauriers, fussent-ils posthumes.
Monénembo, Guinéen installé en France, a de notre pays une connaissance intime : son tableau de la campagne vosgienne, sinistre bout du monde, avec ses petites communautés villageoises racornies, ses collabos, ses mouchards et ses quelques héros discrets, a une présence hallucinante, et ce qui rend si attachant ce récit assez terrible, c'est qu'il est raconté, dans un chaud et froid délicieux, avec la verve et l'humour léger d'un conteur africain. Une fois de plus, vive le métissage ! Ce roman traditionnel, écrit de façon toute simple, a le même charme que son étonnant héros :
«Et bientôt, les enfants cessèrent de pleurnicher en se cachant les yeux, les hommes de hâter le pas, les vieilles femmes de se camoufler derrière les rideaux quand ils le voyaient passer. Il devint en quelques mois, et l'on ne savait trop par quel tour de magie, un élément familier du décor au même titre que le fronton de l'église ou les piliers de la buanderie. Même les cheûlards de Chez Marie qui passaient leurs journées à faire des blagues salaces sur tout ce qui n'était pas d'ici, en vidant leurs godets de gnole, changèrent leurs propos et leur attitude.»
 Addi Bâ (1913-1943), assassiné par les Allemands. |
Le terroriste noir nous montre la guerre après la bataille, diluée dabs le quotidien de l'Occupation et de la Résistance. Giono, lui, nous entraîne en première ligne, dans les tranchées où il passa plusieurs années de sa vie pour en ressortir écœuré, pacifiste à jamais. De sa guerre il a fait un roman, Le grand troupeau, qu'il ne pouvait pas ne pas écrire mais qui lui donna un mal fou. Il avait trop de matière, et situer un livre si loin de chez lui était pour lui un acte contre nature. «Je l'ai fait parce que c'était quelque chose que je ne savais pas faire», dit-il. Et il ne fut jamais content de son Grand troupeau.
Il a grand tort. Voilà un livre d'une force inouïe, puissamment et subtilement composé dans son va-et-vient entre montées au front et retours au pays. Les scènes du front, privées de précisions géographiques ou temporelles, nous plongent dans un brouillard genre Fabrice à Waterloo ; on est sans cesse au bord de l'incohérence, du cauchemar, de l'hallucination ; la folie rôde, l'horreur monte peu à peu, culminant dans des moments affreux comme la lutte à mort d'un soldat et d'une truie qui dévorait un enfant. Et l'on retrouve, comme toujours chez Giono, la puissance tellurique, panthéiste des images, qui montrent la terre en être vivant géant :
«Elle palpitait comme un lait qui va bouillir. Le monde, trop engraissé de chair et de sang, haletait dans sa grande force. Au milieu des grosses vagues du bouleversement, une vague vivante se gonflait ; puis l'apostume se fendait comme une croûte de pain. Cela venait de ces poches où tant d'hommes étaient enfouis. La pâte de chair, de drap, de cuir, de sang et d'os levait. La force de la pourriture faisait éclater l'écorce. Et les mères corbeaux claquaient du bec avec inquiétude dans les nids de draps verts et bleus, et les rats dressaient les oreilles dans leurs trous achaudis de cheveux et de barbes d'hommes. De grosses boules de vers gras et blancs roulaient dans l'éboulement des talus.»
 Celle de 14-18. |
Avant cette année consacrée à la (re)lecture de Giono, il y eut ici même une rétrospective Sarraute. S'en souvient-on ? «Il ne reste rien de Sarraute», déclare dans la presse un jeune plumitif à la mode, nommé... attendez que je retrouve son nom sur gougueule... Aurélien Bellanger. Lequel dézingue au passage MM. Beckett et Simon. (Il préfère Houellebecq.)
Un candidat sérieux pour la prochaine Andouille.
Or voilà qu'en feuilletant, dans une maison amie, la Pléiade Sarraute que je ne possède pas, je tombe sur la présentation de l'avant-dernier livre de la disparue, Ici. Un long dithyrambe signé Viviane Forrester, que je défie quiconque de lire sans aller lire Ici sur le champ.
Publié en 1995, cet ensemble de vingt brefs tableaux (peut-on encore parler de roman ?), rappelle fort le premier livre de l'auteure, Tropismes, venu au monde cinquante-sept ans plus tôt. Ici est un nouveau pas en avant, qui supprime carrément les personnages —les personnages désormais, ce sont les mots. Les mots plus vivants, plus grouillants que jamais, surtout ceux qu'on ne prononce pas, ceux de la sous-conversation :
«Mais tandis que la conversation poursuit en toute sécurité tranquillement normalement son cours, ici par derrière il y a une agitation de plus en plus forte, c'est un véritable tumulte... des mots surgissent, se bousculent, ils poussent, appuient, des mots impatients qui n'ont pas le temps de s'assembler en phrases...»
Des mots qui fuient aussi : les premières pages montrent la mémoire cherchant obstinément un mot perdu. Plus que jamais Sarraute cherche, explore, et on suit fasciné cette vieille dame qui avance encore et encore, à la faible lueur d'une bougie, alors que sa recherche, elle le sait, n'aboutira jamais :
«Quelle parole ici pourrait s'élancer... d'où ? pour aborder où ? de quel autre côté ? sur quelle autre rive ? Il n'y a pas d'autre côté, pas de rives, aucun espace à traverser, rien vers quoi se diriger, rien à atteindre, rien à rejoindre...»
On se retrouve toujours au point de départ, ici, «le même ici parcouru en tous sens de courants, ouvert à tous les vents, sans contours, sans forme...»
On a l'impression, cette fois, qu'on ne peut aller plus loin. Ce qui nous reste : les mots eux-mêmes, dont Sarraute recueille et analyse la beauté avec une oreille plus fine que jamais. Comme dans ce commentaire de la phrase pascalienne : «Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie» :
«Et tout ici porté par ces mots, adhérant entièrement à eux, se dilate, s'étire, s'étend, s'élève... jusqu'où ?... on n'en peut plus, le cœur vous manque...
Et puis quand emporté jusque là où il n'est plus possible d'avancer... «m'effraie» tombe... «m'effraie»... la palpitation d'un oiselet abattu en plein vol, gisant à terre... «m'effraie»... le frémissement de ses ailes encore tièdes, vivantes...»
Livre prodigieux en effet. (Le petit Bellanger l'a-t-il lu ?) Livre sombre, mais dont la maîtrise engendre un sentiment de plénitude. Je trouve là le chaînon qui m'a manqué pour entrer dans Ouvrez, le dernier livre. Il faudrait y revenir maintenant, mais moi aussi je galope, léger, superficiel, me retournant à peine moins que les salariés de la critique...
Points communs entre Mmes Sarraute et Dickinson : une solitude créatrice quasi totale (elles n'ont ni ancêtres, ni compagnons de route, ni descendants) et une force effrayante. S'il m'arrive de me sentir chez moi en lisant Nathalie, j'admire de beaucoup plus loin Emily, dont la parole si dense et abrupte me reste souvent obscure. Il a fallu le tirage au sort mensuel pour que je m'y mette. Ce choix de poèmes, Escarmouches (Orphée / La différence), est traduit par Charlotte Melançon.
Édition bilingue, heureusement : si quelqu'un est intraduisible, c'est bien la terrible Dickinson, avec ses vers ultra-courts, ses rimes et son idiome encore plus concis, plus tendu que l'anglais. La traductrice fait de son mieux, mais le français traîne fatalement la patte, et je ne suis pas convaincu par certains écarts inutiles, certaines fidélités pesantes — que côtoient, il est vrai, quelques belles réussites.
J'aime certains quatrains, comme le fulgurant
Had I not seen the Sun
I could have borne the shade
But Light a newer Wilderness
My Wilderness has made
Je ne sais que penser de la traduction :
Si je n'avais vu le Soleil
j'aurais pu porter l'ombre
Mais la Lumière autre Mort
M'a fait Mourir encore —
Wilderness, ce n'est pas la Mort, mais le Désert... Là, elle y va fort, la consœur... Mais je ne regrette pas ma nouvelle approche de l'immense poétesse : il me semble que je les ténèbres s'éclairent un peu à chaque fois. D'ici dix ans, vingt ans, qui sait, j'y verrai presque clair !
 Emily Dickinson (1830-1886) |
Encore des poèmes, avec un gros petit volume de chez Poésie/Gallimard intitulé Éros émerveillé. Ce n'est pas la première anthologie de poésie érotique, ni la dernière ; on y retrouve sur 600 pages les classiques du genre, déjà bien connus, mais aussi pas mal de raretés. Rien que des Français. On se demande, pour une fois patriote, si les autres pays disposent d'une telle foison. Si la quantité impressionne, la qualité, elle, varie ; la fesse est vite ennuyeuse et le genre périlleux, mais ce livre, moins fait pour être lu d'une main que pour susciter nos sourires joyeux, réserve une foule d'excellents moments et d'amusantes surprises. On s'étonne, par exemple, des cochoncetés pondues par Péret ou Radiguet. Et en retrouvant dans ce lupanar, lutinant langoureusement une autre dame, cette Lucie Delarue-Mardrus au nom si beau, dont je lus de tout autres poèmes en CM2, dans la classe de Mme Clocheau, je suis troublé comme un enfant qui surprend une amie de ses parents bien comme il faut en train de se faire tringler...
Les volkonautes apprécieront-ils ce quatrain de Pierre Motin ?
Votre beauté sans seconde
Vous fait ici appeler
La perle unique du monde :
Il vous faut donc enfiler.
Je pourrais leur proposer, à la place, tel sonnet du très cher Théophile de Viau... Mais gardons-en pour les prochains mois : l'ouvrage est meilleur savouré à petites gorgées, comme je viens de le faire moi-même.
 Eros et Psyché. |
Et puisqu'on parle de sexe, je viens de trouver des allusions coquines jusque dans L'école des femmes de Molière, relu pour la première fois depuis le lycée. Timides, bien sûr, mais audacieuses pour l'époque.
Plutôt sinistre, cette époque — comme tout ce qui touche à Versailles. Pudibonde et misogyne, entre autres. La pièce a évidemment perdu un peu de son actualité, la cause des femmes ayant tout de même progressé, en Europe du moins, mais les machos sont éternels, les tyrans domestiques aussi, et L'école des femmes continue de frapper fort et juste.
Ce qui étonne à présent, c'est le côté sombre de cette comédie. Cette Agnès toute jeune séquestrée par ce barbon qui s'apprête à l'épouser, ce vieil homme découvrant qu'on ne veut pas de lui, pas franchement joyeux tout ça. Certains grands comédiens et metteurs en scène ont pu laisser aller la pièce vers le tragique ; Molière, lui, qui jouait le vieux salaud, la tirait vers la farce, dit-on. On regrette fort de n'avoir pas l'avoir vu dans ses œuvres : ce tiraillement entre texte et jeu devait faire des étincelles.
 Louis Jouvet, Madeleine Ozeray. |
Dernière lecture du mois : Allegro appassionato, à savoir les mémoires de Jean Wiéner, chez Fayard. Je ne voulais les manquer pour rien au monde : Cet homme-là me fait rêver depuis un demi-siècle, quand Mme Pecqueux me racontait les fabuleux concerts à deux pianos de Wiéner et Doucet dans les années 20 et 30, qu'elle avait vus de ses yeux vus. C'était du jazz ou du classique délicieusement jazzéifié, le public se bousculait et certains morceaux sont toujours vivants sur CD. Concertiste, découvreur, organisateur de concerts, compositeur, Wiéner a marqué la vie musicale de tout un siècle avec sa vivacité, sa curiosité, son audace, qualités qu'on retrouve dans son livre et qui font qu'on le dévore d'un trait.
Enfin, cet homme ouvert et généreux fut très tôt un homme de gauche — non par atavisme familial ou professionnel, mais contre son milieu grand bourgeois d'origine —, ce qui rend son engagement communiste, si naïf soit-il, méritoire et même, oui, sympathique.
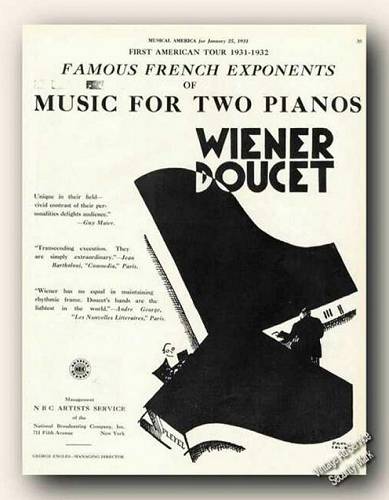 La gloire en Amérique. |
Musique partout, dans les livres, au cinéma. Quand j'apprends la sortie d'un film de Philippe Béziat, je me précipite. Béziat, c'est deux grands moments déjà : les répétitions de Pelléas et Mélisande à Moscou, puis celle des Noces de Stravinsky sur les bords du Léman. À chaque fois on suit le travail des musiciens autour d'une grande œuvre ; on est embarqué, fasciné, conquis. Cette fois nous sommes à Aix-en-Provence pour une production de la célébrissime Traviata. En excellente compagnie : Louis Langrée au pupitre (on aimerait le voir davantage encore), Jean-François Sivadier metteur en scène et Nathalie Dessay en Violetta. Béziat a tout filmé, depuis les premières répétitions jusqu'aux représentations, et tout mêlé si habilement qu'on a là en même temps, comme dans les précédents films, les joies du travail en cours et ceux du travail achevé. La diva chante et joue admirablement, elle a une pêche incroyable y compris hors-chant, et il se confirme que rien n'est plus exquisément pédagogique et sérieusement jouissif que les films de Béziat.
Après ce régal, tout de même, on a envie de voir tout l'opéra. Sont disponibles actuellement une bonne demi-douzaine de captations DVD. Choisi celle de la Scala de Milan, avec Angela Gheorghiu et Ramon Vargas, mise en scène de Liliana Cavani, Lorin Maazel à la baguette. Une Traviata classique, spectaculaire et somptueuse — en opposition à la version dépouillée de Sivadier. Chanteurs parfaits, mise en scène rutilante. Le dîner du premier acte, notamment, vous laisse bouche bée.
Résultat : traviatisé, le mec ! Les airs de l'opéra me trottent dans la tête jour et nuit depuis plus d'un mois.
Je me souviens d'avoir, dans ma raide jeunesse, dédaigné Verdi, trouvé lourds et vulgaires ses ploum-ploum, ses oumpah-oumpah, ses tagadac-tagadac. Il est vrai que je ne le connaissais que par le disque. Et aujourd'hui me voilà vaincu, pieds et poings liés. Alfredo est un rien rondouillard et Violetta un chouya trop mûre, l'agonisante aligne les acrobaties vocales avec un brio et une santé de championne olympique, mais moi je gobe tout et j'en redemande. C'est tout de même bizarre, la vieillesse.
 Violetta Dessay |
Musique et cinéma (suite). Après la tubarde, visite à deux jeunes femmes en pleine forme, deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux...
C'est comme de dire Sésame ouvre-toi : tout le monde a compris, nous entrons chez Demy l'enchanteur.
Les demoiselles de Rochefort (1966), c'est plus qu'un film. C'est une ville entière transformée par un tournage et qui vit encore dans les échos de celui-ci ; c'est un pays tout entier qui fredonne certains airs, et pour qui ce film-là fait désormais partie de la famille. S'il avait mal vieilli, on ne saurait même pas lui en vouloir, mais on le dirait doté d'une jeunesse éternelle. La musique n'a pas pris une ride, la mise en scène ravit toujours par son élégance fluide, les sœurs Deneuve et Dorléac sont plus que jamais admirables de professionnalisme et de naturel. Un seul bémol : la chorégraphie des groupes, bonne sans plus. On se trouve là un ton au-dessous de Broadway. Chakiris est impeccable, mais dès que Gene Kelly apparaît, aussitôt tout le reste pâlit. Le moindre de ses gestes est magique.
 Les sœurs Dorléac : Françoise et Catherine. |
Côté actualité, deux belles réussites :
Dans la maison de François Ozon, histoire d'une réjouissante perversité, genre Théorème de Pasolini : un adolescent s'introduit dans la famille d'un de ses camarades dont il séduit la mère, avant de faire craquer la femme du prof, lui même fasciné par le jeune homme. Film trouble, ambigu à souhait, où les invraisemblances du scénario ajoutent plutôt qu'elles ne retranchent à l'intensité de l'histoire, et où Luchini en fait juste assez trop. Détail secondaire sans doute, mais qui touche le retraité : l'univers du lycée (côté profs aussi bien qu'élèves) est reconstitué sans caricature, avec une grande justesse — chose rare au cinéma.
 Mathilde Seigner, Ernst Umhauer. |
Sur Amour de Michael Haneke, que dire ? On admire tout : le choix du sujet (la fin de vie d'un vieux couple), l'intelligence du scénario, l'intelligence de la mise en scène, le jeu sublime de deux très grands acteurs qu'on adore : Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva. On peut difficilement faire mieux. Alors comment se fait-il que dès le lendemain, l'émotion de la veille soit quasiment évaporée, déjà ?
Le spectacle, en cet automne, se donne aussi hors des salles. Quel scénariste fou aurait osé inventer la série tragi-comique jouée par l'UMP élisant son chef ? Chaque jour on pense toucher le fond, et chaque jour on s'enfonce encore dans la vase du ridicule et de l'odieux.
Celui qui observe le désastre depuis l'autre bord est bizarrement partagé. À la jubilation de voir l'ennemi se saborder méthodiquement (d'autant que l'élu officiel est l'homme idéal pour couler son parti) se mêle peu à peu la consternation. On a beau avoir perdu toute illusion quant aux hommes politiques, on essaie encore de croire un peu en eux : ils sont, comme la police, un mal nécessaire. Le naufrage de la droite non-fascisante n'est une bonne nouvelle que pour les fachos.
Quel bonheur ce serait d'être consolé par les hauts faits de la gauche au pouvoir. Mais ce qui se passe vers Nantes ces jours-ci nous accable davantage encore. On voit un gouvernement officiellement socialiste perdre son âme, et ses ministres écolos se trahir pour un lambeau de pouvoir. Ce qui est en jeu à Notre-Dame d'Hollande, ce n'est pas seulement quelques hectares de bocage, mais toute une vision de l'avenir. Croire que nous aurons toujours plus de pétrole, d'avions et de voyages, quand on est informé comme ces gens-là, c'est tragique. Ils n'ont donc rien compris ? Non, ils savent confusément, mais ils refusent d'ouvrir les yeux, tous autant qu'ils sont, les Hollande, les Zayrault, les Montebourg, les Valls, gamins irresponsables, pantins aveugles et sourds.
 La manif décolle. |
Et pour pousser notre chagrin à son comble, on apprend que les riches dépriment !
Je l'ai toujours dit : heureux les pauvres, qui n'ont rien à perdre. Mais là, outre les soucis écrasants qu'amène l'abondance, voilà que ces pauvres riches ploient sous le poids d'impôts qui vont les mettre sur la paille. Et ce n'est pas tout : on dit que la société française, mesquinement jalouse, ne les aime pas !
C'est un spécialiste, le milliardaire Pierre Kosciusko-Morizet, qui résume le mieux la situation : «À un moment on a cherché les juifs, maintenant on cherche les riches.» On imagine les wagons plombés emmenant les malheureux (sans classe affaires !) vers de lointains crématoires, et malgré nos rancœurs hideusement envieuses, notre cœur se serre douloureusement.
Heureusement, Marie-Christine Roisne-Coquette, grande patronne de haut vol, nous rassure : «C'est dans l'air de dire que les Français n'aiment pas leurs riches, mais moi, je ne le sens pas. Ni dans l'entreprise ni quand je vais chez le coiffeur.»
Loués soient les dirigeants lucides ! Loués soient les coiffeurs des beaux quartiers ! Ouf, on respire.
N'allons pas gâcher notre joie de vivre retrouvée en parlant de la Grèce, où tout ne va pas pour le mieux, où l'on se serre toujours plus la ceinture sous l'œil dédaigneux des bien nourris rotant leur bière.
Je n'en suis que plus heureux lorsque je peux amener certains Grecs à quitter l'enfer pour quelques jours. À Paris, ce mois-ci, le Festival des Balkans accueillait deux auteurs que j'ai le bonheur de traduire : Pètros Màrkaris et Ioànna Bourazopoùlou.
Màrkaris, scénariste d'Angelòpoulos et auteur de polars, est l'un des plus lucides témoins de la crise qui détruit peu à peu son pays. Il a eu les honneurs du Monde et du Nouvel Obs, et son polar paru le mois dernier au Seuil, Liquidations à la grecque, vaut le détour. Quant au roman de Bourazopoùlou, Qu'a-t-elle vu, la femme de Loth ? (Ginkgo), si la Grèce en est absente, il dit sur son pays et notre civilisation à tous, indirectement, une foule de choses profondes.
Ce roman sidérant, ignoré par la presse, encensé chez Babelio sur Internet, se vend peu à peu et de mieux en mieux, plus d'un an après sa sortie, par le seul bouche à oreille. Comme quoi il ne faut jamais désespérer.
Rappel pour ceux que la Grèce intéresse : deux sites combattants nous aident à comprendre ce qui se passe là-bas. Un grand merci à www.jesuisgrec.blogspot.com et www.okeanews.fr.
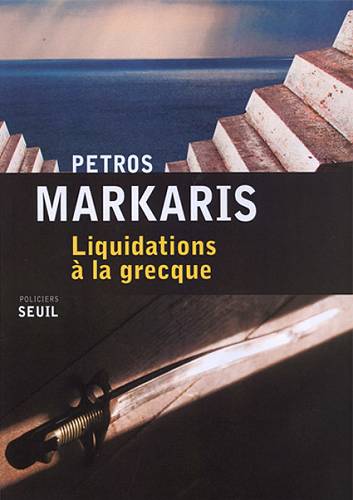 |
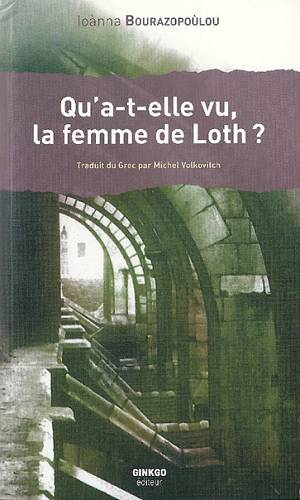 |
|
| Un polar... | ...et un roman de SF |
Dernières bonnes nouvelles, pour ceux que la traduction intéresse :
Pierre Assouline, grand ami des traducteurs, les accueille sur son nouveau blog (www.larepubliquedeslivres.com) dans une rubrique spéciale, La version du traducteur. Dominique Nédellec est le premier invité avec un article étincelant sur sa traduction d'Un voyage en Inde, de Gonçalo M. Tavares, chez Viviane Hamy.
Quant à notre revue TransLittérature, faite par les traducteurs pour les traducteurs et leurs lecteurs, elle dispose désormais d'un site (www.traduction-litteraire.fr) où les anciens numéros sont tous disponibles en ligne, gratos ! (Comme quoi notre confrérie n'est décidément pas douée pour se faire du blé.)
Le mois prochain ? Giono toujours ! Tchekhov ! Hardy ! Mauriac ! Lafon ! Rosset ! Rocher ! Côté cinoche, Demy, Franju, Miller ! Côté zizique, Barber et Vaughan Williams !
 Fantasy Fest, Key West (Floride) |
(réponse sur le numéro de la citation...)
La vieillesse est faite de ces humbles victoires sur la désobéissance croissante du corps.
Comment meurt un héros hardi, volontaire, alliant l'intelligence à la sincérité, et qui apporte à ses congénères un message difficile, exigeant, bouleversant l'ordre reçu et les coutumes admises ? Dans son lit, entouré de ses disciples, de ses enfants et de ses petits-enfants ? Allons donc.
Un lion mort ne vaut pas un moucheron qui respire.