
La fille de Neanderthal
BRÈVES
N°108 Septembre 2012
On m'a longtemps bourré le crâne. On m'a présenté mon ancêtre, Neanderthal, comme une brute épaisse, un singe à peine amélioré, même pas foutu de graffiter les grottes, et qu'un nouveau venu plus malin, Homo Sapiens, a logiquement éradiqué.
Sapiens ? Cause toujours. À voir ce que ledit Sapiens est devenu, je lui voue une sympathie modérée, tandis que feu son rival m'a toujours inspiré de la tendresse, comme les perdants et les disparus. Or voilà que les scientifiques, depuis quelque temps, travaillent à ressusciter le vieux loser ! Et l'image qu'ils en donnent justifie ma sympathie instinctive !
Un livre, Neanderthal, Une autre humanité (Perrin), nous dit tout sur la question — en attendant de prochaines découvertes. L'auteure, Marylène Patou-Mathis, est l'un de nos neanderthalologues les plus pointus. On est émerveillé en la lisant. On admire les prouesses techniques des spécialistes, qui en analysant quelques bouts d'os vous reconstituent avec précision le régime alimentaire du bonhomme, ou vous démontrent qu'il possédait un langage articulé. Certains soutiennent qu'ils ne pouvait pas prononcer les [i], les [u], les [a], les [k] et les [g], et tout le monde pense qu'il parlait du nez. Bientôt ils vont nous rapporter un enregistrement de sa voix. Toute sa vie quotidienne est ainsi restituée avec précision, comme si on y était.
Et on l'admire, lui aussi. C'était un chasseur habile et courageux. On dit surtout que ce tueur d'animaux était un non-violent qui ne trucidait pas ses semblables, contrairement au sanguinaire Sapiens. En tous cas c'est en lui que je me plais à voir mon ancêtre, puisque c'est désormais prouvé : ses femmes ont fricoté avec le jeune tueur et l'on retrouve à l'occasion ses gènes chez les humains d'aujourd'hui.
Il a vécu, ou plutôt survécu dans des conditions souvent très rudes, pendant 300 000 ans ; pour nous les petits péteux, qui détruisons notre planète, combien d'années encore avant la fin ? Neanderthal me fait infiniment rêver. J'ai beau savoir que la machine à remonter le temps, c'est du pipeau, je ne peux m'empêcher d'y croire, je me vois projeté au milieu d'une tribu, recueilli avec la compassion due aux handicapés — je cours tellement moins vite qu'eux. J'apprendrais leur langue, écrirais des poèmes en néanderthalien, leur enseignerais le jeu des rimes et des allitérations. Seul problème : la bouffe. Bidoche à tous les repas, dur pour le végétarien... Je vais réfléchir.
 La fille de Neanderthal |
Un petit reproche à l'ouvrage de Mme Patou-Mathis, par ailleurs passionnant : j'aurais souhaité une écriture moins neutre, une petite dose de lyrisme... Est-ce vraiment incompatible avec la rigueur scientifique ?
Une autre de mes lectures semble indiquer que non : la célèbre Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck. L'écrivain bien connu se doublant d'un véritable spécialiste, qui a lu aussi bien qu'observé, son livre paraît tout à fait solide scientifiquement. Est-il besoin de dire qu'on est fasciné ? En observant chez moi, là-haut sur la terrasse, la nouvelle ruche et les ouvrières qui entrent et sortent sans m'accorder un regard, je ne soupçonne rien de ce qui se passe à l'intérieur. L'organisation y est d'une complexité prodigieuse, et aberrante parfois pour nous qui la comprenons si peu.
La fécondation de la reine, par exemple : pourquoi tant de prétendants, pourquoi si haut dans le ciel ?
«Chaque jour, (...) lorsque midi déploie jusqu'aux confins du ciel ses grandes ailes bleues pour attiser les flammes du soleil, leur horde empanachée se précipite à la recherche de l'épouse plus royale et plus inespérée qu'en aucune légende de princesse inaccessible, puisque vingt ou trente tribus l'environnent, accourues de toutes les cités d'alentour, pour lui faire un cortège de plus de dix mille prétendants, et que, parmi ces mille, un seul sera choisi, pour un baiser unique d'une seule minute qui le mariera à la mort en même temps qu'au bonheur, tandis que tous les autres voleront inutiles autour du couple enlacé, et périront bientôt sans revoir l'apparition prestigieuse et fatale.»
On peut trouver le style du maître un peu melliflue par moments, mais n'est-il pas accordé au sujet ? Les abeilles, ces forçates, sont tout sauf douces et poétiques, mais l'inhumaine étrangeté de leur monde et l'émerveillement mêlé d'horreur qu'il nous inspire sont bien rendus par l'emphase de Maeterlinck, inhabituelle aujourd'hui, et l'imagination du lecteur s'envole, fécondée à son tour, sur les ailes de cette prose fleurie qui l'aiguillonne.
(Bon sang, c'est contagieux.)
La vie des abeilles, ce classique, est actuellement épuisé ! Alors que les abeilles ont plus que jamais besoin qu'on les connaisse, qu'on parle d'elles, qu'on les aide à survivre ! Éditeurs, réveillez-vous, dare-dare !
 Juillet 2012. Arrivée de l'essaim. |
L'an dernier j'ai relu Nathalie Sarraute qui bouleversa mes dix-sept ans ; cette année, je retourne à Giono dont mes quinze ans furent éblouis. Un demi-siècle plus tard, j'ai un peu le trac en reprenant son premier livre publié, Colline, le premier que je lus alors, qui fit de moi un gionolâtre fervent. Tout oublié de l'histoire, mais je sais encore presque par cœur quelques lignes de la première page, qui pour moi résument le reste :
«C'est entre les collines, là où la chair de la terre se plie en bourrelets gras.
Le sainfoin fleuri saigne dessous les oliviers. Les avettes dansent autour des bouleaux gluants de sève douce.»
Cette fois je suis sensible à quelques menus couacs, à un certain tiraillement entre le côté simple, élémentaire (les héros sont de rudes paysans) et une tendance à l'affèterie (l'auteur est un fin lettré), mais qu'importe, je n'ai rien dit : Colline est une splendeur.
Je retrouve, je m'y attendais, la nature décrite avec une extraordinaire sensualité, la force et la fraîcheur prodigieuses des images, le grand souffle animiste, panthéiste, qui brasse et mélange perpétuellement les règnes animal, végétal et minéral ; et à côté de ces grandes orgues, le flutiau du «petit chemin qui saute comme un chevreau sous la lune». Ce que j'avais oublié, c'est le portrait frappant, cruel, d'une société humaine primitive, qui affronte les forces maléfiques de la nature, avec rituels divers (comme l'abattage du sanglier à la fin pour remplacer le meurtre avorté), avec jeteurs de sorts et puissance magique de la parole :
«Et c'est là qu'il s'est mis à parler, comme s'il avait été la fontaine du mystère. Ça s'est tout construit : un monde né de ses paroles. Avec ces mots il soulevait des pays, des collines, des fleuves, des arbres et des bêtes ; ses mots, en marchant, soulevaient toute la poussière du monde. Ça dansait comme une roue qui tourne ; j'en étais tout ébloui. Tout par un coup, j'ai vu, net, l'ensemble des terres et des ciels, de la terre où nous sommes, mais transformé, tout verni, tout huilé, tout glissant de méchanceté et de mal. Là, où avant, je voyais un arbre, une colline, enfin des choses qu'on voit d'habitude, il y avait toujours un arbre, une colline, mais je voyais, au travers, leur âme terrible.»
Pas trop vraisemblable, sans doute, cette tirade littéraire d'un simple paysan, mais Giono fait souffler là un vent de délire qui balaie les objections du plus pisse-froid des lecteurs. Colline est plus beau encore qu'il y a cinquante ans.
Non, ce n'était pas son opus 1. L'avait précédé Naissance de l'Odyssée, une variation sur l'histoire d'Ulysse, un peu vaine, où l'écrivain se cherche encore, qui me tombe des mains, et dont le grand mérite est de rendre l'apparition du vrai Giono plus somptueuse encore.
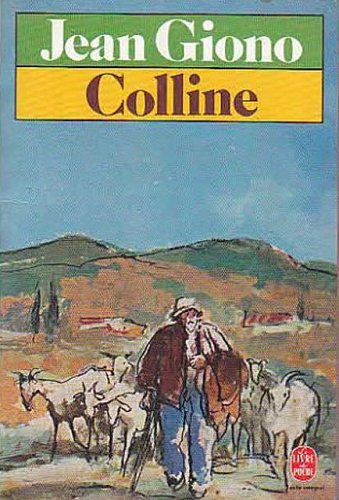 Colline, années 60. |
Les vacances ? Pour certains, c'est la transhumance jusqu'à des lieux de préférence lointains, avec mer et soleil à gogo, et au fond, pourquoi pas ? Je peux les comprendre. Quant à moi, dans ma verdure banlieusarde, un Giono vaut un grand voyage, alors que dire d'un Dhôtel ? Un été sans Dhôtel est un été pourri.
Voici donc Dans la vallée du chemin de fer, roman datant de 1958 (Horay). Peu connu, et surprenant, comme la plupart des romans dhôteliens, quoi qu'on dise. Non que l'auteur s'éloigne de ses décors familiers : il y a là une petite ville de province, des forêts, des campagnes, des personnages un peu lunaires et des hurluberlus, des errances perpétuelles, des coïncidences, des amours contrariées, des ciels bleus déchirants et le bonheur final. La surprise vient de ce que cette fois le héros est marié, de ce que sa femme le trompe, thématique rarissime chez l'auteur ; surprise également, cet espèce d'emballement de la machine : le héros, doté comme toujours chez Dhôtel d'un sympathique manque d'ambition, pousse plus loin que jamais le désir d'échouer, de tout gâcher, de disparaître ; les hurluberlus se multiplient et se déchaînent ; les rebondissements, les ébauches d'idylles s'accumulent, dans un tourbillon insensé. Le tragique affleure plus d'une fois, un meurtre est à deux doigts d'être commis (par le héros !), mais il y a aussi comme toujours ces moments de bonheur indicible, faits de presque rien, et ce sont eux qui comptent :
«Puis ils s'étendirent sur la grève, près du plongeoir. Viviane laissait tous les faits se dérouler dans n'importe quel sens. Le soleil était tranquille. Jamais ni elle ni Blaise n'avaient imaginé une paix aussi grande. Le mauvais parc des Sarts leur apparaissait comme un lieu magnifique. Si rien ne se passait après ce jour, cela n'aurait même plus d'importance, puisqu'on aurait vu ce jour.»
Une paix de ce genre, voilà ce que cela apporte, parfois, au lecteur de Dhôtel.
Il ne faut pas non plus se limiter aux auteurs familiers. D'où l'institution du tirage au sort mensuel, qui extrait de ma bibliothèque d'attente, ce mois-ci, La scène américaine de Henry James, récit du voyage que fit l'auteur devenu anglais dans sa patrie d'origine en 1904 après vingt ans d'absence.
Henry James, pour moi, c'est le génial auteur du Tour d'écrou et de quelques autres nouvelles. Lorsque j'ai tenté de lire tel ou tel de ses longs romans, je me suis toujours enlisé dans leurs méandres et contre-méandres, alors que nageant dans ceux de Proust je me sens constamment porté.
Shall I make it this time ?
Eh bien non, c'est pire encore. Au lieu de décrire simplement ce qu'il voit, l'auteur se regarde voir et il s'écoute se regardant, entortillant — et son lecteur du même coup —, tout au long de ce fleuve de plus de 600 pages, des fragments de vision, lesquels pourraient nous toucher, sans doute, une fois extraits de cette gangue, dans des commentaires et des accumulations de détails à perte de vue («Elle était fort drôle, par exemple, cette quantité de vision qui se mit à s'accumuler durant un arrêt en chemin dans une maison à l'hospitalité cordiale mais pointilleuse qui ouvrit ses portes à l'endroit même où la corde du violon des associations pouvait vibrer le plus intensément, à l'endroit même où le sens du «vieux New York», des premiers états du tableau à présent surpeint d'une façon si violente, trouva la plupart de ses occasions — les trouva, jusqu'à l'extravagance, à l'intérieur et à l'extérieur.»), dont l'abstraction à la fois pointilleuse et vague finit par noyer le poisson de la sensation vive dans le marécage de phrases interminables d'où je me suis extrait, menacé de noyade, au plus vite.
Quelques jours plus tôt, un ami cher me parlait de ces livres dont tout le monde parle avec vénération mais au bout desquels nul n'est jamais allé, citant Berlin Alexanderplatz et L'homme sans qualités. Et La scène américaine de James ? Qui l'a traversée en entier, à part son héroïque traducteur, Jean Pavans, dont la copieuse préface le montre caméléonnement coulé dans la peau du maître ? Relisant pour la nième fois sans la comprendre la phrase citée ci-dessus, on admire Pavans plus encore qu'on ne le plaint. Et on se sent bien peu de chose.
(Dire du mal d'Henry James ! What a dreadful faux pas !)
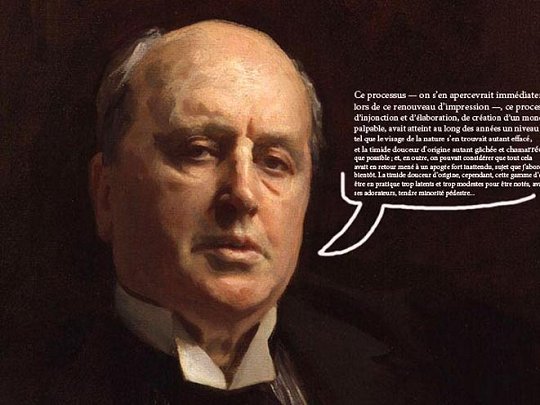 H.R. vu par John Singer Sargent. |
Voyage transatlantique raté, partons dans l'autre sens. Nous débarquons dans une principauté minuscule et imaginaire (encore que...) quelque part en Europe de l'Est, où règnent un petit roi débonnaire et un grand calme. Nous sommes en 1939 et par conséquent le voisin allemand se doit d'envahir le dérangeant confetti. Il le fait sans délicatesse excessive.
Voilà, c'est tout. Cela s'appelle L'heure du roi. L'auteur, Boris Khazanov, ayant le malheur d'être russe, a connu le Goulag pour cause d'écrits subversifs avant de passer en Allemagne. (On se demande par quel miracle il y a encore des Russes en Russie.) Cette fois c'est le national-socialisme que le rescapé dézingue, en cent pages courtes et d'une clarté délicieuse pour qui sort de James. L'autopsie du nazisme est une activité répandue et facile, mais Khozanov, médecin de profession, manie le scalpel avec une sûreté sans défaillance, assimilant ce qui frappa l'Allemagne d'alors à une gigantesque maladie mentale collective.
«À l'époque, [le Reich] apparaissait comme une mystification grandiose. Ses citoyens, du plus privilégié au plus démuni, des hauts fonctionnaires du parti aux moindres cireurs de bottes, semblaient participer à une conspiration universelle visant ce qu'il fallait dire ou ne pas dire ; tous donnaient l'impression d'être d'accord pour n'énoncer jamais que le mensonge, le Mensonge, le MENSONGE. Persuadés qu'ils étaient de la nécessité de cacher la vérité, convaincus qu'il ne fallait pas même tenter de la saisir, comme il faut éviter d'ouvrir le boîtier d'une montre pour découvrir son mécanisme, ils finirent par ignorer tout de cette vérité.»
Résultat : «La majorité de la population du Reich n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait dans le pays.» Tous, obéissant aveuglément à des ordres venus d'en haut, «assumaient la même responsabilité ou — ce qui revient au même — nul n'était responsable de rien».
Diagnostic : «Le mythe du Reich — comme celui de tout état analogue — manifestait un caractère délirant. Cela lui conférait un attrait incomparable.» (C'est moi qui souligne.)
Cette fiction si profondément vraie se déroule avec une fausse douceur, un humour léger en surface malgré sa désolation profonde, dans une langue élégante à force de simplicité ; il faut croire que la traduction est excellente, louée soit Elena Balzamo.
 Cavalerie polonaise contre panzers allemands, 1939. |
Pour se remonter le moral, on ira plus loin encore, dans une contrée imaginaire, c'est plus sûr. Notre guide : Nicholson Baker.
Ce cher homme est surtout connu chez nous pour ses romans érotiques. Vox et Le point d'orgue (The fermata en v.o) exhibaient déjà une imagination joyeusement débridée, mais dans son nouvel opus, House of holes (La belle échappée, chez Bourgois), le gaillard se surpasse. Cette fois nous décollons tout à fait du réel pour suivre les divers personnages (est-ce un roman ou une suite de nouvelles ?) dans une maison mystérieuse totalement vouée à l'amour où se déroule une suite de scènes voluptueuses. Les inventions de l'ami Nick, obsédé superbe, n'ont jamais été aussi décoiffantes. Elles ont en commun l'art de présenter l'improbable et l'incongru comme tout naturels. Tout ici est drôle et souriant, tout baigne dans une euphorie lumineuse, une bienheureuse apesanteur ; tout le monde est poli et gentil, la vie est simple, rien de mal ne peut arriver ; l'écriture elle-même est jouissive, avec la richesse et la fraîcheur de son vocabulaire et ses cocasses accouplements de mots.
J'entends crier : Un extrait ! Un extrait ! Le voici, dans la belle traduction d'Eric Chedaille :
«Cardell s'agenouilla sur la sable pour examiner l'empreinte de pas. Dans l'air flottait une odeur pénétrante d'océan, d'algues et de choses intemporelles qui ne possèdent pas de nom.
L'empreinte était petite et légère — celle d'une femme. Y appliquant le pied, il tâcha de se représenter la solide ossature de l'inconnue. Puis il entreprit de la suivre en marchant autant que faire se pouvait dans les traces. (...)
Au détour de la courbe, Cardell aperçut une lointaine silhouette coiffée d'un chapeau. Sans cesser de calquer son pas sur les empreintes, il se mit à marcher plus vite. À chaque enjambée, il en apprenait un peu plus sur la voûte plantaire de cette femme, son talon, ses vigoureux petits orteils. Il trottinait presque à présent.
Il finit par la rattraper. (...) Sous le couvre-chef, fait d'une paille fine et pâle, son visage rayonnait comme une mandarine de grand luxe. Il la reconnut. (...)
— J'ai marché dans vos empreintes de pas. Ce fut une expérience des plus intimes. Avez-vous senti la pression de mes pieds contre les vôtres ?
— Je n'en suis pas certaine. Je vais marcher dans vos empreintes et vous me direz ce que ça vous fait.»
Le fantastique et la sensualité qui flamboient dans le reste du livre, on les retrouve ici ténus, subtils et non moins charmeurs. À toute personne que le sexe répugne ou ennuie, cette ode à la volupté, en même temps hard et soft, fera l'effet d'un baume salutaire, en apportant aussi d'autres nobles jouissances, à commencer, mais oui ! par l'émotion poétique.
 Portrait plausible de l'auteur. |
À mon menu cinéma ce mois-ci, aucun fessetin de ce genre. Ne parlons pas de ces petites vidéos cochonnes d'Internet, que d'ailleurs je ne regarde pas. Pratiquement pas. Elles sont d'une éprouvante nullité presque toujours, avec leurs mâles genre marteau-piqueur, même si l'on y trouve de rares pépites lorsque les dames sont seules entre elles. Certaines embrassent divinement, et je leur dois une découverte : quoi de plus excitant à voir qu'une pelle bien roulée, au fond ?
 Quand le bonheur vient du bassin. |
Les films normaux ? Il en arrive sans arrêt des tas, des bons, nouveaux ou anciens, mais notre SEL chévrien ferme en été, et Paris est de plus en plus loin. Reste le DVD sur canapé.
Pot-bouille, l'un des romans de Zola les plus excitants, nous introduit dans un immeuble bourgeois dont les habitants ne pensent qu'au sexe et au fric. C'est un ballet vaudevillesque et cruel mené à grande allure, où Zola se montre, qui l'eût cru ? presque léger.
Je ne sais si adaptant Pot-bouille en 1957 Duvivier a respecté l'intrigue, mais l'esprit est là, aucun doute. Gérard Philipe joue avec brio le petit arriviste séducteur, attachant autant qu'odieux, Danielle Darrieux est parfaite comme toujours, toute la troupe se surpasse et Duvivier dirige les opérations avec la vigueur et la souplesse du grand pro qu'il est. Ça galope, c'est drôle et méchant à souhait.
 Gérard Philipe, Danielle Darrieux, Dany Carrel. |
Notre second invité de la saison : Terence Davies. Retour à sa veine autobiographique avec The long day closes (1992). Quand on a vu Distant voices et Still life, on retrouve tout : une rue pauvre de Liverpool, une maison pauvre, la famille, les amis, la bande son pleine de musique et surtout de chansons d'époque, les couleurs sombres, les cadrages étonnants, les longs plans fixes, l'émotion à la fois retenue et concentrée, et c'est splendide. Seuls changements : le héros a grandi, l'adolescence approche, l'amour du cinéma se déclare, l'école autoritaire est une torture. Et surtout le père est mort. Dommage pour nous spectateurs : cet alcoolo violent donnait à Distant voices une intensité déchirante.
 Dans la caverne magique. |
Nous y sommes allés tout de même, à Paris ! Deux fois. Double bonheur.
Comme antidote à leur fast food hollywoodien, le plus souvent fade à gerber, les Américains nous envoient de temps à autre un petit film épatant, preuve qu'il y a encore de l'espoir là-bas.
The color wheel (2011), d'Alex Ross Perry, est ce qu'on peut trouver de plus fauché : noir et blanc graillonneux, rôles principaux tenus par le réalisateur et la co-scénariste. Mais petit film deviendra grand : sur un canevas qui a beaucoup servi — elle et lui se détestent, un voyage ensemble va les rapprocher —, le jeune réalisateur brode ses variations comme un chef. Ses personnages sont tous plus ou moins nuls et ratés, ils n'arrêtent pas de se bouffer le nez, y compris le couple principal, mais cette glauquerie est rachetée, transfigurée par les dialogues et leur verve vacharde. Voilà un film à la gloire de la parole : c'est elle qui rend si drôles un bon nombre de scènes, c'est elle qui fait du frère et de la sœur ennemis des virtuoses de l'invective, leur conférant une certaine grandeur, leur évitant notre mépris — jusqu'à la fin, à la fois sidérante et logique, au bout d'un très long plan admirable où s'épanouit toute la richesse humaine de l'histoire. Come back soon, Mr Alex.
 Alex Ross Perry, Carlen Altman. |
Second bonheur, Lola de Jacques Demy. Combien de fois ai-je vu Lola ? Elle a cinquante ans, pas une ride et une foule de soupirants transis, dont je suis. À chaque fois elle m'arrache des larmes.
D'où vient-elle, cette magie de Lola ? Le jeune Demy, qui tourne là son premier film, est d'emblée un maître de la lumière, qui compense l'absence de couleur par un noir et blanc qu'on dirait coloré, aux blancs éblouissants, aux éclairages audacieux (les visages souvent laissés dans l'ombre) ; c'est aussi un maître du mouvement qui fait de la musique et de la danse avec les évolutions de la caméra, celles des acteurs et le montage. Le film est porté par la musique de Michel Legrand. Anouk Aimée en Lola est craquante, même si m'émeut plus encore son amoureux transi, joué par le fragile et douloureux Marc Michel. Il n'a plus fait grand-chose ensuite, comme si ce rôle l'avait à jamais consumé.
Il y a quelque chose de fou dans cette histoire, comme dans toutes celles de Demy d'ailleurs : dans ce romantisme forcené, ce culte du premier amour, ces échos perpétuels entre situations passées et présentes et entre personnages. La scène où le marin américain et la très jeune fille vont à la fête foraine est peut-être ce qu'on a filmé de plus beau sur la naissance d'un premier amour, avec ce ralenti soudain — effet pourtant cheap, mais qui, là, devient sublime, on ne sait comment. Scène vertigineuse, touchée par la grâce — comme le film tout entier.
Lola de Nantes, version restaurée à Los Angeles par les Ricains. Que deviendrait-on sans eux !
 Marc Michel, Anouk Aimée, Nantes. |
Et voici déjà la fin de ce mois, qui pour les Franciliens fut si doux dans sa fraîcheur ensoleillée. Adieu, douillet refuge ! Je m'apprête à rejoindre Carole chez les Grecs. J'appréhende ce que je vais trouver là-bas, ce malheur et cette détresse contre lesquels je ne peux rien, tandis que les maîtres de l'Europe savourent leur bière en détournant les yeux et que les financiers qui nous gouvernent, modernes Diafoirus, ignares et pontifiants comme les médecins de Molière, continuent d'imposer purge et saignée au malade épuisé par leurs soins. Qui nous délivrera des crétins arrogants du FMI et autres BCE, des requins et des vautours de l'internationale des banques, tous tragiquement coupés du réel ?
Et voilà qu'à l'instant de partir, je lis dans le journal que notre ministre de l'Intérieur aurait invités ses cons patriotes à «être fiers d'être français, fiers du drapeau tricolore, de l'hymne national».
Il doit s'agir d'un mauvais canular. Je ne peux imaginer qu'un homme de gauche — si, si, tout de même un peu — pense de façon si arriérée, ou alors fasse la pute si grossièrement. Pour séduire qui, grands dieux ?
C'est pour entendre ça que j'ai voté ?
Non, il n'y a là qu'un vilain cauchemar dont je vais me réveiller bien vite.
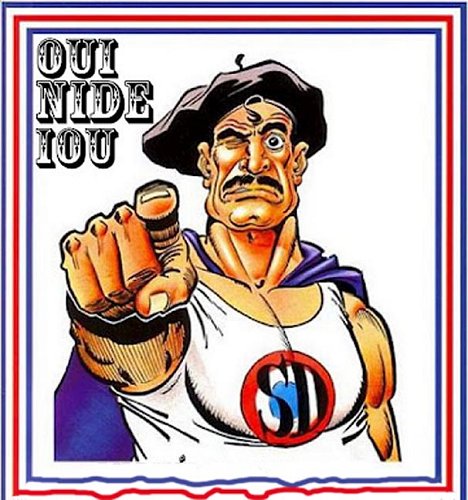 Superdupont raille deux à gaine ! |
Courage. Il nous reste nos anti-dépresseurs, notre baume au cœur : lecture, cinéma, musique. En octobre, Giono, Deville (Patrick), Deslaumes, Simenon sans doute, la poésie québécoise avec les éditions l'Oie de Cravan, plus une ou deux surprises j'espère, et côté cinéma, des films de MM. Duvivier et Davies et d'autres encore.
 Fantasy Fest, Key West (Floride) |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Car, même quand tous les artistes l'auront oublié, les tyrans sauront encore quel est le pouvoir inégalable de l'art.
Nous pensions être fidèles à Anouher en conservant ses mots, mais c'est lui être plus fidèle que de changer ses mots pour garder sa pensée.
On fait rarement ce qu'on veut, et si l'œuvre est vivante, elle vous échappe, sans qu'on y songe, et même vous contredit.