
Bande d'hypocrites.
BRÈVES
N°105 Juin 2012
«La grande littérature est morte : c'est là un fait qui n'a pas besoin d'être prouvé.»
Voilà ce que décrétait hardiment, vers 1830, un certain Auguste Chaho, et ce lisant mon cœur a bondi de joie. Comment ne pas pressentir, dans ces quelques mots, la présence d'une andouille géante, que je vais pouvoir assaisonner ce mois-ci ? Je cherche aussitôt fébrilement d'autres perles charcutières du même auteur. Chou blanc, hélas : maître Chaho et son œuvre ont totalement sombré dans l'oubli.
Enfin, oui et non. Chaho le magnifique n'est pas mort ! Il ressuscite à chaque génération ! Ses réincarnations du moment, MM. Camus, Millet et Todorov en tête, ne cessent d'ululer lugubrement son message funèbre. Pour préserver leur foi, ils se sont héroïquement interdit, cela va de soi, la lecture du moindre texte écrit dans le dernier demi-siècle — à part leurs propres œuvres, sans doute.
Mais faut-il se moquer ? À un tel degré de flamboyance, le déni du réel devient admirable. Faut-il argumenter ? Ce serait vain. Laissons ces messieurs à leurs lamentations, dont on devine qu'au fond d'eux-mêmes ils se délectent, et plongeons-nous vivement dans les trésors de notre temps.
 Bande d'hypocrites. |
Tu ne t'aimes pas, de Nathalie Sarraute, publié en 1989, c'est encore du contemporain, et ça décoiffe ! L'auteure bientôt nonagénaire continue d'explorer, d'avancer. Peut-on encore parler de roman ? On est face à un immense dialogue, aux voix anonymes : plus de personnages ici, ou plutôt un personnage unique, aussi peu différencié que possible, fait d'une multiplicité infinie de voix, «vous tous qui êtes moi», dont on suit la conversation incessante. L'éternelle confrontation entre le moi et les autres, qui fait la matière des livres de l'auteure, se redouble donc ici en s'intériorisant de façon vertigineuse.
Combien de moi ? Comment savoir ? «Oh oui, il y en a tant... comme des étoiles dans le ciel... toujours d'autres apparaissent dont on ne soupçonnait pas l'existence... Alors vous voyez, j'ai renoncé, je suis l'univers entier, toutes les virtualités, tous les possibles... l'œil ne le perçoit pas, ça s'étend à l'infini...»
Vertige, vous dis-je. De la «grande littérature», comme disait l'autre, assurément. Un peu trop grande pour moi sans doute. Malgré l'accumulation habituelle d'images et de scènes, malgré la vivacité du dialogue et la force de bien des pages, Tu ne t'aimes pas exige beaucoup de son lecteur, confronté à l'absence d'intrigue et de progression dramatique, jointe à un certain ressassement — même si ce mouvement obsessionnel de reprise a ses raisons, étant celui-là même du psychisme humain selon Sarraute. J'avoue que ce chef-d'œuvre quasi-ultime m'inspire, à la relecture, plus d'admiration que de véritable amour.
Curieux de savoir ce que nos trois papys ci-dessus penseraient de Patrick Bouvet, s'ils avaient la curiosité de lire. Encore jeune (né en 1962), il m'a emballé dès son début, In situ (1999), suivi de Shot, Direct, Chaos boy et Canons, qui prennent respectivement pour thème la vidéo, la photographie de presse, la télévision, le jeu vidéo et la photographie de mode. Et voici, toujours aux éditions de l'Olivier, le dernier venu, Pulsion lumière, qui met en scène le cinéma. Encore un portrait du monde contemporain — et du monde des images, logiquement, puisqu'elles nous entourent, nous gouvernent, devenues plus réelles que le réel.
Ce qu'on voit au cinéma sur les images
comment certains fabriquent ces images
comment d'autres voient ces images
tout cela mélangé brassé se décompose et se recompose, en kaléidoscopie, en stroboscopie, à la fois fluide et saccadé, tourbillonnant, immobile
dans un film-trip
où les morts-vivants des rizières
côtoient des soldats
défoncés
aux drogues hallucinogènes
qui remontent le long
des tripes
en passant par le cœur
pour atteindre
le cerveau
search and destroy
des dizaines de milliers de
cartouches
tirées
dans le crâne
«un logiciel nous permet
d'ajouter
de la fumée ou de la brume
Bouvet est qualifié de «plasticien de l'écriture», ce qui n'est pas faux, à condition de voir qu'il n'est pas moins musicien. Ses rythmes, ses constructions, ses progressions rappellent un Steve Reich, par exemple. Cette écriture d'une force visuelle et sonore extrême, est-ce de la prose ou de la poésie ? Ni l'un ni l'autre. Appelons ça du Bouvet, et ne voyons pas dans cette jonglerie formelle un étalage de virtuosité gratuite : derrière la distance apparente et l'absence de commentaire, la description violente, hallucinée, fait voir la vanité, la vacuité de ce monde de faux-semblants, sous une lumière à la fois glaciale et brûlante.
Je l'ai déjà écrit plusieurs fois ici même, mais en l'occurrence on se doit d'être répétitif : je range les textes de Bouvet parmi ce qui s'écrit de plus juste et de plus fort aujourd'hui.
 Patrick Bouvet live |
Stéphane Padovani (né en 1966), était pour moi un inconnu avant que son éditeur, Pascal Arnaud (M. Quidam), me donne à lire son dernier livre, L'autre vie de Valérie Straub. Une toute petite chose, quarante pages.
Le tout début :
«Elle n'aspire plus qu'à la tranquillité des pierres.»
Une phrase qui n'a l'air de rien, mais qui m'arrête. Je me la relis plusieurs fois, pour m'en pénétrer, tenter de comprendre son pouvoir. Je le sens confusément: elle a exactement le rythme, la densité sonore qu'il faut. Ce type-là sait où il va. Et la suite le confirme.
Une femme sort de prison. Ex-terroriste. Elle doit maintenant se refaire une vie :
— Tu vois, Isa, on a tant désiré la Révolution. Un idéal de justice et de bonheur pour tous. J'étais prête à tuer et à mourir pour cela. Et je l'ai fait. J'ai tué, et je suis morte aussi... Mais les gens continuent de payer leurs impôts, ceux qui peuvent, ceux qui ne trichent pas avec le fisc, et de continuer à vivre, à s'acheter des gadgets informatiques, à s'inquiéter pour l'avenir de leurs gamins, à tomber malades ou amoureux, à regarder le match à la télé. Et moi je suis de retour. Je pensais avoir programmé ma sortie mais je n'ai envie de rien. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de moi ?
Des amis lui trouvent un boulot manuel dans un coin de campagne où elle pourrait se faire oublier, jusqu'au jour où son destin la rattrape. La fin, terrible, nous prend à contrepied — et pourtant, quand on y réfléchit, c'est d'une certaine façon la seule fin possible. D'ailleurs, en fin de compte, malgré ce virage in extremis, le livre avance droit jusqu'au bout.
Je n'en dis pas assez ? Je n'aime pas raconter les livres, et surtout celui-ci n'incite pas au bavardage. Il réussit à suggérer le maximum de choses avec un minimum de mots, à trouver la bonne distance vis-à-vis de son sujet et de son héroïne, entre émotion et retenue, révolte et acceptation, avec une absolue justesse. Si l'on veut partager un rare bonheur de lecture, on ne doit pas non plus parler plus haut que cette parole proche du silence — et en même temps si pleine.
 La Santé, à Paris. |
Autre livre court, dont les auteurs, Micha König et Catherine Korenbaum, sont moins connus encore. Micha, aujourd'hui rabbin en Touraine, est un miraculé : entre 42 et 44, aux Pays-Bas, l'enfant juif qu'il était aurait dû dix fois mourir. Dans La diagonale du rosier (Studio graph), au soir de sa vie, il raconte ces années d'épouvante à Catherine Korenbaum qui rédige : les persécutions, l'étau qui se resserre, la vie traquée de cachette en cachette, ceux qui aiment et protègent, ceux (nombreux) qui dénoncent. Tout cela qu'il faut sans cesse rappeler, contre l'oubli et sa force d'inertie géante.
Au-delà de la tragédie collective, le récit s'attarde aussi sur le drame personnel des deux mères de l'enfant : la vraie, qui dut s'en séparer pour lui sauver la vie, et l'adoptive, qui souffrit affreusement de devoir le rendre après la guerre.
La suite de son existence, pleine de péripéties douloureuses, le vieil homme l'évoque à demi-mot avec une réticence marquée : il ne raconte pas pour se mettre en vedette, mais pour saluer ceux qui l'ont aimé au point de risquer leur vie pour le sauver ; c'est la gratitude et l'amour qui ont déclenché cette «hémorragie de souvenirs», comme s'auto-décrit, dans une jolie formule, ce récit sans prétention littéraire apparente, mais si efficace dans sa simplicité.
La gratitude... Ce noble sentiment a aussi des effets pervers.
Il est un certain Jean-Baptiste Para qui m'inspire la plus vive reconnaissance : poète et traducteur, il porte à bout de bras une revue exemplaire, Europe — tâche écrasante. Il est d'une gentillesse peu commune. Il a signé des critiques bienveillantes sur mon travail et fréquente même ce site ! Bien que je le connaisse à peine, je le considère comme un ami. Mais au-delà de ce que je lui dois personnellement, je lui tiens gré de tout ce qu'il fait, de ce qu'il est. Sentiment partagé, sûrement, par des centaines d'autres personnes du métier.
Eh bien c'est terrible. Car au moment de lire un de ses livres, j'hésite : si ça me déplaît, je n'oserai pas l'écrire, et si j'aime et je l'écris, je passerai pour un hypocrite, un renvoyeur d'ascenseur.
Heureusement que j'ai de la chance en amitié : il est rare que les écrits d'amis me déçoivent. J'ouvre La faim des ombres de Para (Obsidiane, 2006), et suis d'emblée désorienté, comme par la plupart des poètes contemporains, alors pourquoi ce sentiment d'aisance, d'évidence ? Les images défilent et ne cessent de surprendre, mais sans rien de forcé, de tape-à-l'œil, dans la fraîcheur et la douceur, portées par une musique où la simplicité s'allie au raffinement.
...une pierre jetée dans le puits disperse mon visage...
La barque échouée deviendra mangeoire,
le mufle humide de la nuit posé sur mon sommeil...
Des bonheurs de ce genre, j'en coche par dizaines. Je ne saisis pas bien le fil mais j'écoute ardemment, comme un enfant la conversation mystérieuse des adultes. Qu'est-ce que ça raconte ? Allusions évasives à des événements, à la Russie, au monde arabe, visions fugitives. Des échos, des ombres d'événements. Des obsessions : le manque, l'absence, jusque dans le titre, La faim des ombres.
Entre les douilles vides, les clous rouillés,
Une ombre aussi peut avoir faim.
Mais derrière le deuil et la douleur, on devine des consolations, des embellies possibles ; parfois le poème oscille entre l'ombre et la lumière :
La neige fond sous leurs genoux
Et là où tombent les larmes
Tu aperçois l'herbe le lendemain
Comme si le manque était un chemin — le chemin ? — vers la plénitude :
Goutte d'eau, renonce à être perle, tu deviendras océan.
Et si le poète étouffe sa voix, c'est qu'il faut apprendre le silence, pour entendre toujours plus finement :
Toujours elle dort et son sommeil est un jardin.
Son silence est tout ce qui me parle.
En refermant des livres comme celui-là, on se sent comme lavé. L'esprit plus tranquille et plus alerte à la fois. Au fond c'est très simple : la poésie n'est pas obligée de raconter ou de décrire, il suffit qu'elle nettoie l'esprit, aiguise l'ouïe et le regard, nous apprenne à nous émerveiller des choses les plus humbles, puisque, nous dit le poète,
Il y a des ailes d'ange dans le bruit du papier.
N'ayant pas connu sir James Marie Barrie (mort en 1936), rien ne me retient de chroniquer son Peter Pan, qui a éclipsé le restant de son œuvre, avant d'être éclipsé à son tour par son propre succès : quand on a vu le film de Disney, par exemple, on s'imagine avoir tout vu.
Il m'a marqué moi aussi, ce film. C'est le premier que j'ai vu dans une salle. Nous sommes entrés en retard, au moment où le capitaine des pirates, géant sur l'écran immense, joue du clavecin dans sa cabine, son crochet orné d'une bague étincelante.
C'est de traduire ce mois-ci une pièce grecque inspirée de Peter Pan qui m'a décidé à lire enfin l'original. Eh bien il le mérite. Et j'ai bien fait d'attendre : on peut lire Peter Pan à tout âge, mais l'adulte y trouve son compte plus que l'enfant.
Oublions la version Disney, qui a tout enguimauvé. Ce qui frappe dans le vrai Peter Pan, c'est la face d'ombre : L'omniprésence de la mort, la mélancolie et le chagrin diffus dans l'histoire de cet enfant que sa mère a renié et de ces autres enfants qui abandonnent longuement leurs parents. Peter lui-même est un héros bien ambigu, aussi inquiétant que charmant. Il représente l'enfance à l'état pur, ce garçon qui refuse de grandir, «joyeux, innocent et sans cœur», et sa façon d'oublier tout a quelque chose de monstrueux. Troublante aussi, l'étrange parenté entre lui et son ennemi, le capitaine Hook, comme lui fort et solitaire. Bizarres et quasi surréalistes, ce crocodile avaleur de pendules, ces enfants qui ont un chien pour gouvernante, le père qui élit domicile dans la niche du chien — car les scènes les plus folles ne se déroulent pas sur l'île de Neverland, mais au cœur d'une famille londonienne. Le livre entier, jusque dans les recoins du récit, est ainsi saupoudré d'un excentrisme nonsensique délicieusement british.
 Peter et le pirate. |
Bon, finie la récré. Voici un ouvrage trèèès sérieux : La musique, anthologie littéraire et philosophique, de Vincent Vivès, chez Buchet-Chastel. Un générique de rêve, avec notamment Homère, Platon, Ovide, Saint Augustin, Shakespeare, Rousseau, Diderot, tous les romantiques, Debussy, Proust, Blanchot, Boulez ...
Ce long défilé de 350 pages se recommande par l'extrême variété des points de vue, allant du plus cérébral au plus sensuellement poétique, de la musique selon Plutarque, qui guérit de la peste, à la musique au service de la peste brune dans une page de Quignard sur les camps nazis. Au fil des textes, quelques découvertes et des retrouvailles bienvenues nous attendent — ce qui n'empêche pas, à la longue, un certain accablement. Les philosophes, en effet, ont la part belle ici, or le discours philosophique, s'efforçant de saisir la chose la plus impalpable et fugitive qui soit, paraît d'une lourdeur et d'une froideur accrues. Les écrivains s'en sortent évidemment mieux, et l'on apprécie plus que jamais des oasis nommées Nerval, Mallarmé ou Leiris. On regrette un grand nombre d'absences : Echenoz, Gailly, Butor, Huxley, Rolland, Gide...
Je termine cette lecture dans l'ennui et la déception. D'autant que le compilateur a choisi des traductions poussiéreuses et que ses présentations n'évitent ni jargon ni bavardage. Après ça, courons écouter de la musique ! Ce sera bon comme une douche après un crapahut dans des nuages de poussière.
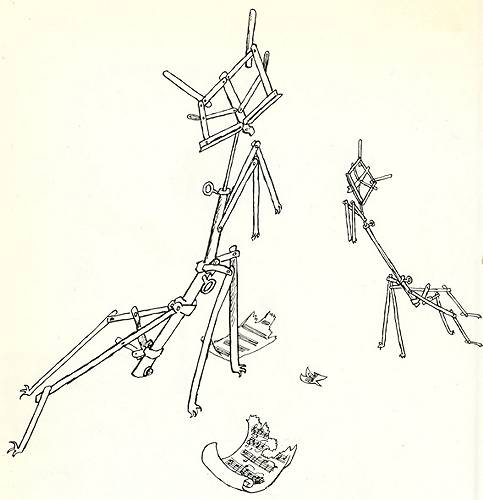 Dessin de Gerard Hoffnung. |
Autre lecture sérieuse : Loki, de Georges Dumézil, grand spécialiste des langues et des mythologies. Paru en 1948, Loki fut réédité en 2010 dans la collection Les livres qui ont changé le monde, proposée par Le Monde. Collection très riche, à prix réduit, ce qui permet d'acheter une foule de textes indispensables qu'on n'aura jamais le temps de lire.
Sauf que voici le tirage au sort mensuel, merci Carole, qui tire Loki des ténèbres !
Loki est un dieu de la mythologie scandinave, dieu étrange à la personnalité insaisissable et contradictoire, malin, filou, ami des autres dieux qu'il sert à l'occasion et en même temps leur pire ennemi. Dumézil nous explique brillamment ces contradictions tout en rapprochant Loki d'un personnage mythologique du Caucase. Ainsi commence un va-et-vient fabuleux entre Islande et Ossétie. L'auteur est un monstre d'érudition qui parle des dizaines de langues, dont la cervelle est aussi souple que bien remplie ; il dénoue les fils les plus embrouillés avec la puissance du bulldozer jointe à la grâce du prestidigitateur. Je ne dis pas qu'il soit facile de le suivre dans les méandres des vieilles légendes, parfois savoureuses, souvent d'une complication indigeste, et l'on peut ne pas se passionner pour la mythologie comparée, mais le travail d'un tel cerveau offre un spectacle stimulant. Même si l'on a oublié dès le lendemain toutes les aventures de Loki, Syrdon et leurs comparses, on garde l'impression somme toute agréable d'avoir l'esprit plus net et les cellules grises aérées, en éveil.
Il faudrait lire bien davantage, voir plein de films, soit en salle, soit en DVD au coin du feu, Carole et moi — car il nous est arrivé de faire du feu en ce début de mai frisquet. Cinq ou six livres et films par mois, non, cela ne suffit pas pour calmer la fringale.
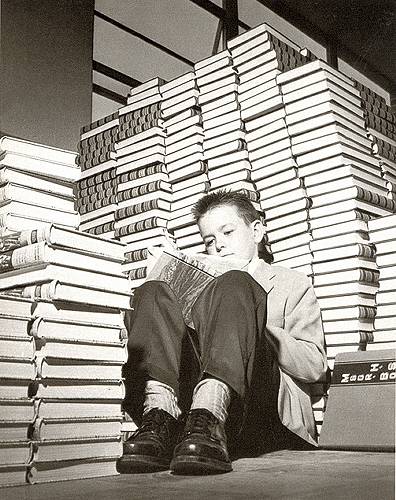 Easy reader. |
Côté films de l'année, ce mois-ci, deux très bons moments.
D'abord, Chercher le garçon, de Dorothée Sebbagh, où une femme de trente-cinq ans part à la recherche de l'âme sœur sur Internet. Cette comédie sans gros budget, mais pleine d'allant et de jolies trouvailles, marie avec finesse observation du réel et grain de folie. Amusante galerie de portraits masculins, héroïne (Sophie Cattani) craquante, et tout cela est impeccablement filmé.
 Dorothée et Sophie. |
Second bonheur, Young adult, film américain de Jason Reitman. Une jeune femme installée à Cleveland a une idée fixe : reconquérir son ex, marié et père de famille dans leur cambrousse natale. Elle y retourne, et là...
Sacrés Ricains, capables du pire mais aussi du meilleur, comme le prouve ce film subtil, délicieusement inconfortable car sans bons ni méchants : grande ville et trou provincial, l'une avec ses bobos, l'autre avec ses ploucs, se retrouvent dos à dos, tous deux baignant dans le vide et l'ennui ; l'héroïne (Charlize Theron, séduisante à faire bander un gay) et d'autres personnages apparaissent à la fois détestables et attachants : du beau boulot d'équilibriste !
 Jason et Charlize. |
Côté classiques sur DVD, Gigi de Vincente Minnelli (1958), avec Leslie Caron et Maurice Chevalier. Le maître y recrée le Paris de 1900, d'après une nouvelle de Colette, avec une splendeur décorative indéniable et une délectation à quoi ses compatriotes sont sans doute plus sensibles que nous autres Gaulois, cette vision exotique de Paree risquant de nous faire un peu ricaner.
 Leslie Caron adolescente. |
Le pied, pour Carole et moi, ce mois-ci, vient plutôt d'un film sans doute moins somptueux, mais aussi plus imprévisible : Allô Berlin ? Ici Paris ! de Julien Duvivier. Le nom de ce cinéaste évoque aujourd'hui une qualité française académique et des ambiances noires. Or ce film des débuts, tourné en 1932, au langage encore très proche du muet et de ses audaces, respire la jeunesse et la fantaisie avec ses embardées perpétuelles et son humour souvent grinçant. La visite guidée de Paris en car, par exemple, n'a rien à envier à celle, plus connue, du Zazie dans le métro de Louis Malle.
Dans Carnet de bal de 1939, du même réalisateur, une femme retrouve après des années ses anciens prétendants, MM. Jouvet, Raimu, Baur, Fernandel, sacrée affiche. Ils sont soit décevants, soit inaccessibles, et l'on retrouve cette fois le climat sombre et amer de la Duvivier touch. Un peu longuet sans doute, le film est riche en scènes brillantes qui laissent globalement un excellent souvenir.
 La scène coquine... |
Alterner œuvres connues et découvertes, cela vaut également pour la musique. Ce mois-ci, après avoir vérifié que les grands opéras de jeunesse de Richard Strauss, Salomé et Elektra, paroxystiques et rutilants, me faisaient toujours de l'effet, je passe à leur contraire absolu : la musique discrète et oubliée de Maurice Delage. Cet ami de Ravel, dont il est musicalement le petit cousin, ne survit actuellement que par deux CD confidentiels, dont l'intégrale des mélodies que possède la médiathèque de Chèvres. J'entre donc, la tête encore bourdonnante des fracas et déluges straussiens, dans un salon douillet d'autrefois où Sandrine Piau, Jean-Paul Fouchécourt et Jean-François Gardeil égrènent ces petits bijoux subtils avec le raffinement qu'on leur connaît. Musique à mi-voix, qui semble s'adresser à quelques amis chers, qu'on écoute et réécoute sans en épuiser les délicates beautés. Sur l'autre CD, les Quatre poèmes hindous et les Sept haï-kaï, en version orchestrale, déploient leurs splendeurs ; quant au monumental Quatuor, très développé mais en même temps très concis, presque trop compact, il ne se décante qu'après plusieurs auditions.
Delagie, lieu protégé hors du temps... Mais comment oublier les orages du dehors ? Les malheurs de la Grèce par exemple ? Et comment ne pas désespérer ? Les experts eux-mêmes y perdent leur latin, et personne ne voit le bout du tunnel.
Un ami traducteur a la bonté de m'envoyer ce poème que Günter Grass vient d'écrire :
La honte de l'Europe
N'ayant craint le marché et proche du chaos,
Qu'il est loin, ce pays qui te fut un berceau !
Ce que la force d'âme te donnait comme un dû,
Le voilà relégué comme un simple rebut.
Débiteur dénudé cloué au pilori,
Qu'il souffre ce pays que l'on disait chéri
Et que l'on dit si pauvre alors que ses trésors
ornent tous tes musées comme un butin en or.
Sur cette île bénie, portent la carabine
Ceux qui si fiers d'eux-mêmes arboraient Hölderlin.
Pays qu'à peine encore on tolère en silence
Tandis qu'aux colonels on proposait alliance
Et de ses droits privés, il subit, des puissants,
Le joug et l'infamie, oppressé jusqu'au sang
Antigone au défi pourtant porte le noir
De ce peuple qui fut berceau de tes espoirs
Mais loin de ce pays, du Crésus les sbires
Ont pris ce qui pouvait briller et resplendir.
Nous sommes saufs, enfin ! s'écrient les commissaires
Mais, furieux, Socrate leur rend la coupe amère.
Ils maudiront les tiens, en chœur, oui, tous ces dieux
Que tu voudrais chasser de l'Olympe et des cieux
Ce pays, ô Europe, son esprit t'inventa !
Et sans lui c'est le tien qui se desséchera.
Une lueur d'espoir tout de même : l'idée que la solution miracle, pour enrichir un pays, consiste à paupériser sa population — à l'exception d'une minorité de nantis —, cette idée-là n'est plus considérée comme raisonnable par tout le monde. Si les Allemands écoutent Günter Grass, et s'ils se souviennent de leurs cours d'histoire à l'école, ils comprendront peut-être qu'il n'est pas bon d'imposer à d'autres ce qu'on leur imposa dans les années 20, avec dans les années 30 les résultats que l'on sait.
Un parti d'extrême gauche gouvernant la Grèce ? Il ne ferait sûrement pas pire que les deux grands partis traditionnels, tous deux pourris jusqu'à l'os. De toute façon, pourrait-il rester longtemps fidèle à ses projets les plus extrêmes ? L'essentiel pour moi, je l'avoue, c'est que ces gars-là ne souhaitent pas quitter l'euro — j'y vois un signe de maturité politique.
La Grèce hors de l'euro ? Rien que d'y penser, je frémis. L'Europe, désolé, plus ça va plus je l'aime, plus je l'attends. Une Europe différente, cela va sans dire, de celle d'aujourd'hui, abandonnée par ceux dont elle avait le plus besoin, livrée aux mains de la mafia de la finance.
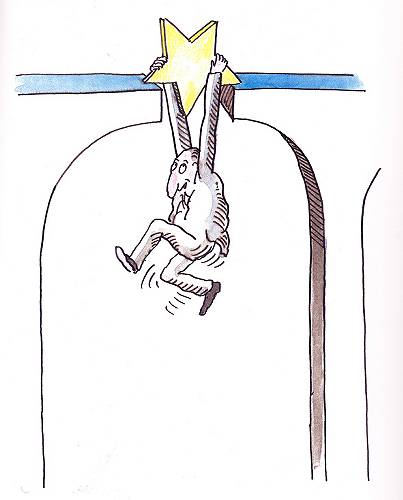 Mal barrée... |
À propos d'extrême gauche, acheté le premier numéro d'une nouvelle revue, L'impossible, dirigée par Michel Butel. Des contributions de qualité au confluent du politique et du littéraire, Jean-Christophe Bailly, Cécile Wasjbrot et Delfeil de Ton au sommaire, des entretiens avec divers personnages plus ou moins connus (dont un de Francis Marmande avec un homme extraordinaire, le musicien Diego Masson), et un ton généralement très combatif. Qu'on soit tout à fait, plutôt, ou juste un peu d'accord, il y a dans cette hargne quelque chose de nécessaire, de salutaire. Pour aiguillonner les mous qui nous gouvernent, il conviendra d'être parfois un peu dur.
En juin, parution aux Éditions des Vanneaux du premier tome d'une nouvelle anthologie, Poètes grecs du 21e siècle. Dix poètes, dont certains inédits en français. On en reparlera.
Sur volkovitch.com en juillet, menu varié comme de coutume : des contemporains (Oster, Goux), des déjà classiques (Sarraute, Simenon), des visites à Claude Mauriac et Lou Andréas-Salomé, la poésie de Bachelin, les films de Duvivier et quelques autres, un peu de zizique classique.
Pas franchement in, tout ça ?
Sur volkovitch.com, «démodé» n'est pas une injure.
 Mario Mariotti, Animains (Dessain et Tolra) |
(réponse sur le numéro de la citation...)
On ne peut pas vivre dans un monde où l'on croit que l'élégance exquise du plumage de la pintade est inutile.
L'homme sait assez souvent ce qu'il fait, il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait.
L'amour, c'est comme du mercure dans la main. Garde-la ouverte, il restera dans ta paume ; resserre ton étreinte, il te filera entre les doigts.