
Jean Renoir, La règle du jeu.
PAGES D'ÉCRITURE
N°60 Septembre 2008
Trois jours de vélo en Sologne : la petite route file tout droit dans l'immense forêt, qui veut bien laisser voir, de temps à autre, une maison basse ou un étang derrière des clôtures. Le reste se cache. La Sologne joue les mystérieuses. Pas de grands paysages puisque tout est plat. Des panneaux Propriété privée partout. Derrière ces arbres, au cœur des grands domaines, des centaines de châteaux invisibles. Ce n'est pas un vélo qu'il faudrait pour les voir, mais une machine volante ; on se contentera d'un livre somptueux, La Sologne à tire d'aile, tout en photos aériennes où le photographe Michel Berger, qui s'édite lui-même, s'envoie en l'air et nous avec.
En plein mois d'août, personne ou presque dans les bois, les bourgs et même les villes. Romorantin estive comme d'autres hibernent. Dans la forêt à deux pas de Vierzon, les biches se baladent en famille sur les chemins. Profitez du répit, mes chéries : le mois d'août en Sologne est le paradis pour vous. Dans quelques jours et jusqu'au printemps, pan ! pan ! pan ! ce sera l'enfer.
 Jean Renoir, La règle du jeu. |
J'ai l'air de la débiner, cette Sologne, mais elle me fait rêver. Envie de revoir La règle du jeu de Renoir, de refourrer le nez (peut-être), cinquante ans après, dans Raboliot de Maurice Genevoix, et (sûrement) de rendre une nouvelle visite au plus glorieux des Solognots, le Grand Meaulnes.
Il est toujours dangereux, dit-on, de retrouver un copain d'adolescence, mais toute cette brume de discours contradictoires qui entoure celui-là, tantôt extasiés, tantôt dédaigneux, finit par intriguer. On a envie de juger par soi-même. Et dans l'émouvant château de La Chapelle d'Angillon, village natal d'Alain-Fournier, le soi-disant musée qu'on lui consacre, à la limite de l'arnaque, ne fait qu'attiser mon désir de revenir à son livre, comme sur les traces d'anciennes amours.
J'ouvre l'exemplaire de mes parents, imprimé en 1944, dont le papier jauni s'effrite. Le roman, même chose. Les scènes célèbres du début, à commencer par la fête étrange, ont des couleurs pâlies, le charme ancien se maintient tout juste, l'histoire peine à décoller comme les aéroplanes de ce temps-là, plombée par une sentimentalité un peu molle — ah ! ces points de suspension à tout bout de paragraphe... Non, ce n'est pas nul, loin de là, on a là un document ethnographique précieux, la vie dans ces campagnes a bien changé en cent ans etc., on se laisser bercer tout de même, envoûter par ce charme à l'ancienne, cette simplicité, cette limpidité naïve, même si en plus on attendait autre chose...
Qui finit par venir. Meaulnes s'enfuit, revient, repart, revient enfin à la dernière page pour repartir aussitôt — tiens, il avait fini par épouser Yvonne de Galais ? Et elle est morte en mettant leur fille au monde ? Comment avais-je pu oublier tout cela, et cette scène terrible : le narrateur, le petit instituteur, témoin bien sage, prenant dans ses bras pour lui faire descendre l'escalier l'épouse morte de son ami ?
L'enchantement, dans ce roman lent et patient, finit par s'installer par couches de nostalgie superposées (le narrateur ayant la nostalgie du temps où Meaulnes à ses côtés avait la nostalgie de la fête étrange), et par la répétition obsessionnelle des mêmes motifs : le besoin de fuir, le refus désespérant du bonheur tout simple qui s'offre. On accuse parfois Le grand Meaulnes de mièvrerie ; dans certains passages peut-être, mais le roman pris dans son ensemble dégage une sombre mélancolie. Voilà une histoire terrible dont les personnages sont maudits. Un traité sur l'impossibilité du bonheur, sur l'art de le gâcher.
Et je m'aperçois en refermant le livre que les jolies scènes du début, un peu éventées, vues à travers tout le malheur qui les suit, devenues paradis perdu pour de bon, retrouvent leur parfum d'autrefois, ou presque. Et j'ai la gorge serrée.
Allons bon, je me suis laissé avoir ! Je relis le début de mon texte avec indignation ! La lecture est une aventure.
Michel Ossorguine, lui, j'ignorais jusqu'à son nom. Né en Russie à la fin du XIXe siècle, il est mort exilé en France pendant la dernière guerre et je doute qu'il ait jamais été connu ici, même vivant. On me recommande son roman Une rue à Moscou (L'âge d'homme), je commence par un autre plus court, L'histoire de ma sœur (Éditions des Syrtes). Roman ? En 1931, déjà, on abuse de l'étiquette : ici tout est vrai, sauf les noms. Kostia, alias Michel, raconte la triste vie d'une sœur aînée morte à trente-sept ans, femme aux dons éclatants mais tout aussi douée pour le malheur, mal-aimée par son mari autant que bien-aimée par le petit frère, et dont la vie fut gâchée par elle-même, sans doute, autant que par les règles sociales de l'époque. L'autre sœur — aubaine pour le romancier —dépourvue de tout talent, et qu'une vie encore plus étriquée rend totalement heureuse, offre une antithèse parfaite.
Ossorguine n'est sans doute pas un aigle. Tout en appréciant sa délicatesse de touche, on peut trouver ses demi-teintes un peu ternes, son aquarelle un peu aqueuse. Il y a pourtant des pages épatantes, comme celle où frère et sœur passent des nuits à jouer aux cartes, de façon frénétique et idiote, et plus généralement toutes celles où l'auteur s'abandonne à sa vénération éblouie. «Si nous n'avions pas été frère et sœur, ose-t-il même écrire, il est probable que nous aurions été des amants passionnés.» Sans aller jusqu'à les faire passer à l'acte, il aurait dû sans doute se lâcher un peu, décrire avec encore plus d'élan cette rare passion fraternelle. Quel beau sujet. Pourquoi n'ai-je pas eu de sœur ? Je t'aurais adorée, ma grande.
Mais ne chipotons pas. Ce portrait de femme discrètement déchirant, ces scènes enveloppées de mélancolie, ce voyage sur la rivière à travers l'immensité russe, ces paysages entrevus qu'on a soudain envie de retrouver chez Tourgueniev ou Pasternak, tout cela dégage un charme slave assez fort pour survivre à une traduction plutôt pataude, et puis ça fait du bien de ne pas lire que des chefs-d'œuvre.
Alors continuons.
Une vraie boucherie, de Bernard Jannin, chez Champ Vallon, premier roman d'un inconnu, coup de maître ? Sans doute que non. Mais ma B.A. — je l'ai lu pour faire plaisir à une amie — est récompensée : j'ai savouré, quoique végétarien, cette tranche de vie bien saignante.
Cela commence en description naturaliste d'une boucherie de province dans les années 50. Une vraie boucherie, en effet : on s'y croirait. C'est très finement observé — et remémoré, plaisamment rendu, avec un sens de la dérision très affûté.
Ensuite, peu à peu, tout va déraper, ou décoller, vers le fantastique, il y aura une homérique bataille entre commerçants sur un marché, puis un chapelet de cadavres, une vraie boucherie là encore (bravo pour le titre à tiroirs) et là j'avoue que l'auteur y allant un peu plus au hachoir j'ai un peu moins accroché, mais qu'importe : il a un sacré sens de la formule, et certaines phrases du début sont de purs délices. Le boucher : «De la pensée comme du geste, il regardait où il mettait les pieds.» La bouchère : «D'une année sur l'autre, elle était un peu plus maquillée de couperose bouchère ; en effet, le flux d'air, qui balayait depuis la porte les présentoirs tel un glissando, soufflait sur elle l'incarnat des viandes.» Pour se défouler, pour conjurer le vide quotidien, cette Bouchère écrit en secret : «Elle se vidait et s'emplissait à la fois en racontant le tout de rien.» Phrase dont je suis jaloux — d'autant plus que je pourrais me l'appliquer. L'homme qui écrit de telles choses mérite qu'on suive son parcours.
Trois superbes phrases, dira-t-on, très bien, mais cela justifie-t-il qu'on se tape tout un bouquin ?
Sans doute que oui. Combien en ont autant ?
 Beau port de tête. |
Un autre qui ne fait pas dans la demi-teinte, c'est Xavier Bazot, que les volkonautes connaissent bien. Grâce aux éditions en ligne publie.net, son quatrième livre, Stabat Mater, apparu en 1999, disparu depuis, vient de ressusciter.
Bazot dit quelque part que tous ses romans sont autobiographiques, et quand comme moi on les a tous lus, il y a de quoi être soufflé. Cet homme a donc eu déjà plusieurs vies, et celle-là ne fut pas la moins terrible. Le narrateur, nommé Xavier, perd ses deux enfants, l'un tout petit, l'autre pas encore né, ce qui l'amène au fond de la souffrance. Une souffrance et une horreur qui deviendraient insoutenables pour le lecteur comme pour l'auteur, si le livre n'était pas tout entier un travail de deuil, à la fois plongée et mise à distance, éclatant le récit, brouillant le temps, mêlant réel, fantasmes, idées folles et espoirs déments, chaud brûlant et froid glacial, dans un récit traversé de personnages hurluberlus et d'un très étrange humour noir, tandis qu'on se demande, au fil des phrases labyrinthiques de l'auteur, si elles sont là pour diluer, disperser la douleur, ou la tendre et la rendre encore plus lancinante. Et ces subjonctifs imparfaits extravagants : sourire ou grimace, dérision ou noblesse exacerbée de la langue ? On ne sait plus, et ce qu'il y a pour moi de plus beau dans ce livre, c'est cette perpétuelle incertitude, cette palpitation, ce tremblé par quoi Bazot se confirme comme l'un des auteurs présents qui comptent pour moi le plus.
Autre grand moment de lecture ce mois-ci, grâce à un certain Guy Dupré dont j'ignorais tout. C'est pourtant quelqu'un, ce Dupré, salué à ses débuts par Breton et Gracq, aujourd'hui octogénaire après avoir écrit peu de livres, dont trois romans dont on dit le plus grand bien.
Les manœuvres d'automne (éditions de Rocher) n'en sont pas un, mais que sont-elles ? Des mémoires, un essai ? Dupré, qui a travaillé dans l'édition, a côtoyé bien des personnages étonnants, célébrités littéraires ou descendants d'iceux, des femmes extraordinaires surtout, dont le dernier amour d'Alain-Fournier, la redoutable Mme Simone. Il fut l'amant de la belle Sunsiaré de Larcôme, qui très probablement causa la mort de Nimier en bousillant sa belle voiture en plus. Ce livre éparpillé en apparence, mais souplement construit, est une galerie de portraits à quoi s'entrelacent des réflexions sur l'amour, l'Histoire et quelques thèmes récurrents : métissage, bâtardise, transmission héréditaire, vie du couple franco-allemand... L'auteur a du sang asiatique dans les veines, cela l'obsède, les sang-mêlés sont tous ses frères. On a, en le lisant, l'impression rare de rencontrer un homme radicalement différent. Un côté fana-mili joint à une tendresse pour les métèques et les sans-grade. Un mélange de fidélité rigide et de liberté souveraine.
Quel dépaysement de rencontrer ainsi Barrès extrait du purgatoire, le fils de Barrès, le petit-fils de Barrès, drôles de pistolets tous les trois, ou d'entendre philosopher le général Bigeard... On se sent agacé — en même temps qu'heureux — d'être amené dans ces pages, par moments, à voir le monde sous un autre angle.
On peut être agacé aussi par la tendance dupréenne au name-dropping et au Moi-je-sais, mais l'agacement après tout fait partie du personnage et de son charme un peu cassant. Sa prose est hautaine comme lui-même, parfois cinglante, mais si ample, maîtrisée, somptueuse, à la Chateaubriand, qu'elle fait l'effet d'une gifle de velours. De quoi donner l'envie d'y revenir.
Ses trois romans, Les fiancées sont froides, Le grand coucher et Les mamantes, ont été réédités en un volume par le Rocher.
Un auquel je reviens toujours : Flaubert. Septembre étant le mois des bonnes résolutions, décidé de relire Bouvard et Pécuchet à raison d'un chapitre par mois, ce qui me prendra toute l'année scolaire. Après tout, Flaubert a bien passé plusieurs années à l'écrire... Je ne veux pas seulement faire durer le plaisir, mais retrouver, avec la lenteur, une certaine intensité de lecture.
Chapitre I : les deux hommes se rencontrent, coup de foudre d'amitié. Bouvard devient riche par héritage, ils s'achètent une ferme et s'y installent.
Héroïsme de l'entreprise flaubertienne : construire tout un roman sur deux personnages aussi ternes et nuls au départ. L'auteur se moque d'eux, c'est évident, mais moi je guette les indices du contraire, les traces de sympathie voilée qui rendront le livre ambigu, riche, mystérieux. Sinon, à quoi bon ?
«À la grande bibliothèque, ils auraient voulu connaître le nombre exact des volumes», ces pauvres couillons. Oui mais «ils s'informaient des découvertes, lisaient des prospectus, et, par cette curiosité, leur intelligence se développa. Au fond d'un horizon plus lointain chaque jour, ils apercevaient des choses à la fois confuses et merveilleuses.» Moquerie et bienveillance finement dosées.
J'adore aussi la fin de ce chapitre inaugural, où ils s'endorment heureux le soir de leur arrivée. «...et tous les deux ronflaient sous le clair de lune, qui entrait par les fenêtres.» Ridicules les deux ronfleurs, certes, cons comme la lune, sans doute, mais Flaubert a beau ne pas surligner, n'est-elle pas douce, protectrice, approbatrice, la lueur qui veille sur leur sommeil ?
Autre bonne résolution : lire de la poésie tous les mois. C'est bien la moindre des choses pour un type qui se pique d'en traduire. Et attention ! Du neuf ! du costaud ! Prêts ? Je cite :
«Crade et sec et dur et bref et rude épitrochastique quand ça le veut, ça me chante, et par toquade pas pour accumuler des idées fortes sous une forme concise où rien ne brille pas plus que tout ni moins que rien, mais mon nombre et ma règle et vous autres, c'est votre pulsation vilaine entendue et un sale remuement du monde, ça peut te muer —»
Je laisse un petit moment pour que ça décante. Le volkonaute en profite pour relire en douce, angoissé. Ça manque un peu de contexte, avoue-t-il. Qu'il se rassure : le contexte ne l'aiderait guère. Tout est comme ça. Je suis aussi perdu que lui. Je ne sais ce que ça me raconte, je me raccroche aux branches qui passent, visions de campagne, souvenirs d'enfance, allusions fugitives au Moyen-âge... Syntaxe tordue, brouillée, mots rares, mots forgés, drelins-drelins de consonnes, contrepets, maraboudficelles, on joue avec moi, je pourrais refuser, balayer tout ça, attribuer le tout aux effets de l'alcool comme le poète m'y invite («Et dès que j'entends parler de vous, je bois double»), mais résistons à cette paresse : on veut nous égarer sans doute, mais parions que c'est pour nous mener quelque part. J'ai décidé d'y croire, je vais sans effort jusqu'au bout des 80 pages, c'est vif, c'est drôle, c'est dru, c'est, comment dire : fermenté, comme une grande marmite de langage et de sentiments qu'on touille et retouille, «âpre et douce besogne» et doucement ça fermente, le goût un peu âpre réveille et «si vous n'y comprenez rien, vous aurez entendu quelque chose —»
Je persifle un peu, mais ces Vers à vif de Jean-Pascal Dubost, chez Obsidiane, au bout du compte, se laissent entendre, ils donnent un sentiment de plénitude et l'envie d'y revenir. Pourquoi diable ? Je le saurai peut-être un jour si je fais encore des progrès.
J'aime cette définition du poète : un type qui passe son temps sous l'orage avec l'espoir d'être, quatre ou cinq fois dans sa vie, frappé par la foudre. Il en va de même pour le lecteur de poésie. Le courant continu est rare ; pour recharger les batteries il suffit, comme ici, d'être touché par éclairs.
Sentant le volkonaute un peu groggy, je lui sers en guise de remontant deux coupes de champagne : les deux premiers films de Michel Deville.
On n'en parle pas assez, de celui-là, qui a fignolé en près de cinquante ans une œuvre à la fois étonnante et discrète, propre à réconcilier esthètes et grand public. Viennent de sortir en DVD les deux premiers volumes d'une quasi-intégrale, soit onze films. D'où ma troisième bonne résolution : les voir (ou revoir) toute cette année à raison de deux par mois.
Deville a débuté dans les années 60 par une série de comédies écrites avec Nina Companeez. Prototype : Ce soir ou jamais (1960). Les vêtements et les coiffures de cette bande de jeunes ont pas mal vieilli, et l'on regrette que ce soit tourné en noir et blanc, mais il y a tant de jeunesse et tant de couleur dans le jeu et la mise en scène ! Claude Rich est délicieux déjà, Anna Karina éblouissante, Françoise Dorléac n'a qu'une scène mais du feu de Dieu, et si l'histoire semble un peu sage en surface on sent ici ou là le Deville voluptueux, libertin qui piaffe et attend son heure.
Adorable menteuse (1962) tourne autour de deux femmes : Marina Vlady et Macha Méril dans la gloire de leurs vingt ans, belles à couper le souffle. Leurs prétendants qu'elles font tourner en bourrique, non moins subjugués que nous, dansent autour d'elles un ballet tourbillonnant, échevelé, presque une comédie musicale — mais chez Deville tout est musique. Fêtes galantes à la Watteau, insouciance, légèreté, raffinement, à la moitié du film on est déjà K.O. de bonheur et c'est alors, démonstration faite, que le jeune réalisateur montre un autre visage : l'une des deux belles tombe amoureuse, telle éprise qui croyait prendre, le tempo ralentit, une sourde gravité s'installe, une élégante mélancolie, comme si, dès l'opus 2, l'auteur voulait résumer d'avance tout son parcours ultérieur.
Pressé pour une fois de vieillir d'un an — car impatient d'avoir vu toute la suite.
 Adorable menteuse. |
Rien de tel que de voir les films par séries. Eldorado du Belge Bouli Lanners, dont les images roulent toujours dans ma tête, m'a donné envie de continuer dans le road movie avec l'un de ses classiques, Macadam à deux voies de Monte Hellman.
Je me souviens du choc produit, il y a quarante ans, par les deux westerns du monsieur, The shooting et L'ouragan de la vengeance. On y galope dans l'insolite. Quelques années plus tard, en 1971, Hellman nous fait traverser le continent américain en bagnole. On s'attend à un truc vroumvroum, un Easy rider sur quatre roues, mais non, ce diable d'homme décidément ne fait rien comme les autres. Question intrigue, le strict minimum, la course entre deux voitures qui en tient lieu tourne court ; les deux jeunes héros sont quasi mutiques et leur adversaire, un mythomane, cause dans le vide ; il n'y a pas de fin, la pellicule se met à brûler. On dirait l'enfant des amours de Hawks et Antonioni, Godard tenant la chandelle.
Ce disant, je ne veux effaroucher personne : logiquement on devrait s'ennuyer, on ne s'ennuie jamais. On est surpris à tout bout de champ par les finesses du scénario et de la mise en scène, envoûté on ne sait comment par l'intensité du regard de Hellman. Il pourrait nous tenir en haleine en filmant n'importe quoi ; ses films, désertiques au premier abord, s'avèrent infiniment plus riches et plus denses que les grandes machines creuses où ça bouge tout le temps.
Le public aurait peut-être aimé, qui sait ; les producteurs de Hollywood, non, trop fort pour eux. La sortie fut massacrée, la carrière de Hellman aussi et son Macadam devint un film-culte, dont quelques allumés parlaient pleins d'émotion sans qu'il fût possible de le voir. Le voici dans une réédition princière, de celle qu'on réserve aux Grands Classiques, avec d'excellents bonus plus longs que le film, yeepee !
Et les nouveautés ?
Le SEL de Chèvres ferme en juillet-août et voir un film à Montparnasse est une épreuve : après une demi-heure de trajet, on passe une autre demi-heure dans le Gaumont avant que le film commence, à encaisser les coups de poing de la pub, puis les rafales de kalachnikov des bandes annonces. Cette violence visuelle terrifiante, comment mes congénères font-ils pour la supporter ? Une exposition régulière apporte-t-elle au moins un abrutissement salvateur ?
Heureusement, quand le film est bon, les gens oublient de crunchouiller leur putain de pop-corn. C'était le cas l'autre soir, bel exploit du réalisateur Safy Nebbou et de ses actrices, Catherine Frot et Sandrine Bonnaire. L'empreinte de l'ange, titre obscur, cache un film d'une sacrée maîtrise. Autour de deux mères se disputant un enfant, le jeune réalisateur construit un film où l'on oublie tout ce qui paraît faux dans l'histoire, tant les émotions sonnent vrai. Et ce grâce à un scénario subtil où les éléments (le feu et l'eau) jouent un rôle crucial, d'une mise en scène au cordeau à la Hitchcock et d'une direction d'acteurs qui donne aux gestes une sensualité, une animalité presque, intenses. Nebbou dit avoir étudié le comportement des lionnes avant de diriger ses deux tigresses ; elles sont toutes les deux à rugir d'admiration. La fillette qu'elles s'arrachent, en petit rat, craquante elle aussi.
 Sandrine prête à bondir. |
Côté musique, je continue d'écouter Honegger sans arriver à savoir si j'aime ça ou pas, et ô surprise, ma nième tentative pour m'habituer à Tchaïkovski semble un succès !
Attention : je continue de trouver ses symphonies grandiloquentes et larmoyantes, et pompier son concerto de piano, mais en réécoutant l'opéra Eugène Onéguine — qui pour les Russes, dit-on, est une espèce d'hymne national, je sens le charme qui agit, je m'abandonne peu à peu à ces douceurs faciles, à ces enveloppantes caresses un peu putes.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Grandis-je ou vieillis-je ?
On ne sait pas toujours si l'on doit être fier de soi. J'avais fait vœu de ne pas regarder les Jeux à la télé, j'ai tenu bon, tu parles d'un exploit, trop fastoche. Mais les Chinois n'ont pas semblé souffrir de mon boycott, et j'ai ajouté le ridicule au dérisoire, je l'avoue mort de honte, en consultant tous les jours le tableau des médailles, comme un curé qui croque du chocolat en douce. Les médailles ! Âge mental, douze ans.
Mais enfin, dira-t-on, pourquoi se priver de ce qui fut un grand spectacle ? Question mise en scène, paraît-il, c'était aussi grandiose qu'à Berlin en 36 ! Décidément les démocraties ne font pas le poids... Il y avait aussi, en prime, la beauté du geste sportif — il suffit de couper le son pour échapper aux commentateurs.
Eh bien non, pas envie. Cette beauté-là commence à me faire peur. À force de surpasser, l'athlète de haut niveau, ce mutant de moins en moins humain, arrive si haut qu'on en a le vertige, d'où l'angoisse (la sienne, la nôtre) et de plus en plus souvent, la chute.
Un milliard de Chinois pleurant parce que Liu Xiang, leur idole, a bobo à la cheville, on peut trouver ça rigolo. Et en même temps, sinistre.
«Je continuerai à te soutenir, Liu Xiang. Quelle que soit la marque que tu représentes, je l'achèterai.» Voilà ce qu'écrit un blogueur de là-bas.
À la bonne heure. Gardons le moral. Le business, le métal jaune, n'est-ce pas là, en l'occurrence, l'essentiel ?
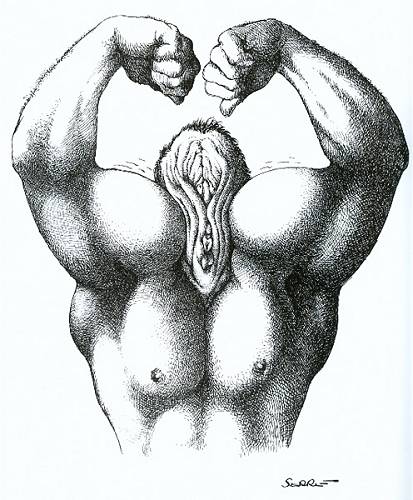 Dessin de Serre. |
Malgré certains faux-pas de nos athlètes, l'éditorialiste du Monde pavoise. Les Françaises pondent plus souvent que leurs voisines ! Deux enfants par tête de pipe ! «Cette performance, cocorique le monsieur, nous donne la médaille d'or en Europe.» Champions d'Europe de l'oubli de pilule. Allons enfants, le jour de gloire est arrivé. «Ce pragmatisme (sic) du peuple français, poursuit notre homme, constitue son meilleur atout pour préparer son avenir. Il n'est de puissance que démographique.» Alfred Sauvy le disait déjà, c'est donc sûrement vrai. Les économistes savent mieux que nous. J'imagine cette course à la procréation, partout sur la planète, cette multiplication, cette pullulation infinie, et d'un seul coup, pardonnez-moi messieurs si savants, j'ai les boules.
Comment ? Rien ce mois-ci sur notre politique intérieure ? Non, pourquoi ? Rien de neuf. Tout va bien. Le gouvernement est content. Il a «gagné la bataille de l'idéologie», annonce-t-il. M. Hortefeux se frotte les mains, sa politique de nettoyage national rafle tous les suffrages, une poignée de sales gauchistes mise à part. Le président voyage beaucoup. Son épouse vend des disques.
Laissons-les jouir de leur bonheur tranquille avant l'automne.
En ce début septembre, pour la première fois depuis 1951, je ne vais pas faire ma rentrée à l'école. Vacances perpétuelles pour le nouveau retraité, mais pas pour les volkonautes ! On continue de bosser, qu'est-ce qu'on croyait ? En octobre, on retournera au collège, on étudiera Flaubert et Saint-Simon, on dissèquera les phrases de nos auteurs et l'imaginaire de la droite française, puis il faudra se taper un marathon.
Besoin d'un peu de repos ? Des films, un peu de piano, Muriel Robin et d'autres comiques, ça ira ? Un petit voyage en Islande ?
(réponse sur le numéro de la citation...)
Si on est capable de rire de soi, on est assuré de vivre longtemps.
L'ennui me rend heureux en ce qu'il annule l'obligation, très civilisée, que l'homme s'impose d'être heureux.
Pour que la lumière soit, il faut que quelque chose brûle.
Les Balances, êtres instables, veilleront à préserver l'équilibre entre les diverses tendances de leur moi. Ils éviteront les promenades nocturnes, la fréquentation d'inconnus et l'ingestion de breuvages non contrôlés. Aucun danger en revanche, et beaucoup de frissons heureux en perspective, à la lecture d'un classique indémodable : Docteur Jekyll et Mister Hyde, palpitant et profond comme tout ce qui sort de la plume du génial Robert-Louis Stevenson.
 Spencer Tracy dans Dr Jekyll et Mr Hyde de Victor Fleming. |