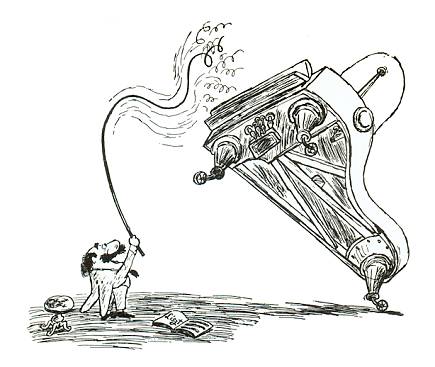
Gerard Hoffnung, Acoustics
PAGES D'ÉCRITURE
N°35 Août 2006
«Or jamais la musique n'a débouché sur des idées, sur une pensée, sur un rapport au monde en particulier. Au mieux, elle n'est qu'un amplificateur des sentiments de celui qui l'écoute...»
Ce qu'un journaliste écrit là semble procéder du bon sens, alors pourquoi cette affirmation banale me fait-elle bondir ? Est-ce là réaction primaire de mélomane dévot dont on insulte l'idole ? Sans doute, mais pas seulement : ce qui me choque dans ce jugement, c'est sa courte vue. Il contredit une expérience intime — laquelle j'ai le plus grand mal à ordonner, à formuler. Et pour cause : la musique, cet homme a raison, ne manie pas les concepts et les mots. Mais elle ne se borne pas non plus à chatouiller les sens. La musique nourrit l'esprit, pour peu qu'on sache l'écouter. Comme la pensée, elle est une forme et un mouvement. Écouter une musique inventive, qui bouge, se déploie, s'organise de façon neuve, ne peut qu'inciter l'esprit, par mimétisme, à sortir de ses routines, à penser de façon plus libre, plus ample. Les surprises et les chocs d'une pièce de Gesualdo, les envolées d'un Beethoven, les glissements et virages imprévus d'un Debussy, autant de stimulants subtils. La musique est l'un des supports de la pensée, l'eau où elle baigne. Car la pensée, que les philosophes me pardonnent, n'est pas selon moi un grand fleuve puissant, mais seulement le frêle esquif porté par lui.
La musique, je ne sais si je saurai bien l'écouter un jour. Trop distrait, trop flemmard, je reste à mi-chemin, mais la fameuse forme sonate classique, avec toutes ses règles, toutes ses répétitions — exposition (thème A, thème B), reprise, développement, réexposition —, qu'est-ce donc, sinon l'expression d'un rapport au monde, le miroir d'une époque où tout est codifié, où l'innovation n'est pas exclue, mais sous surveillance, par avancées mesurées encadrées par de tranquilles retours au connu ? Écouter une symphonie de Haydn, n'est-ce pas retrouver ce bonheur d'un balancement, d'un équilibre entre discipline et liberté, tradition et nouveauté, prudence et audace ?
L'intello français est souvent sourd. Question d'éducation, mais pas seulement. La musique est chose mentale, sans doute, mais elle est surtout liée au corps. Ce corps qui fait si peur à certains de nos travailleurs du cerveau...
(Journal infime, 2002)
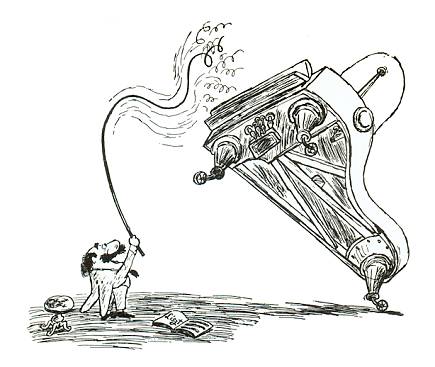 Gerard Hoffnung, Acoustics |
Suite du périple à travers les traductions de l'Odyssée (cf. Pages d'écriture N°34).
Et voici la version Mugler :
«Dis-moi, ô Muse, l'homme aux mille tours, qui tant erra,
Lorsqu'il eut renversé les murs de la sainte Ilion,
Qui visita bien des cités, connut bien des usages
Et eut à endurer bien des angoisses sur les mers...»
Le nouveau prétendant a choisi le vers de 14 syllabes, dont la coupe inégale (8+6 ou 6+8) doit permettre d'éviter la monotonie de l'alexandrin. Ample, mais facilement pesant, ce n'est pas un mètre commode. Un Jacques Réda en a tiré des merveilles — sur de plus courtes distances, il est vrai ; chez Mugler, on est moins convaincu. Alors que Bérard et Jaccottet maintiennent la plupart du temps une cadence à la fois régulière et variée, l'un par des coupes ternaires (6+6+6), l'autre avec ses changements de mètre discrets, ici, dès la première page, on patauge. Ce qui manque surtout dans cette version en vers, c'est le rythme. La meilleure Odyssée, dit-on, est la plus facile à apprendre par cœur. Essayez donc avec celle-ci. Faute de rigueur dans le choix des coupes, on bute sans arrêt sur des vers mous, informes — tels les deux premiers. D'où une impression diffuse de malaise et d'ennui. D'autant que l'on sent plus d'une fois le traducteur engoncé, contraint au remplissage, à de pénibles contorsions, comme ces diérèses désuètes : chari-ot, radi-euse, Ethiopi-ens...
Plus grave encore : ce manque de vigueur atteint aussi l'expression. La parole est ici moins dense, l'éclat moins vif que chez Bérard ou Jaccottet ; on est gêné par un vocabulaire parfois poussiéreux : «périr» au lieu de «mourir», «altiers», «courroux», «les tourments que j'endure», «la fureur des vents»... Les susnommés non plus ne sont pas toujours parfaits (et Homère, donc !), mais on oublie vite leurs défaillances, tant les trouvailles qui les suivent illuminent tout. «Les autres ne sont que fantômes», écrit simplement Mugler (X, 495) ; «Les autres ne sont qu'un vol d'ombres», dit Jaccottet, et soudain la poésie est là. Dans la nouvelle version, en revanche, les éclairs sont plus rares que les court-circuits... Comment peut-on écrire, par exemple, «Quand ils voient entrer dans la danse un rejet si superbe» (VI, 157), ou ce «Vieillard ! ce que tu viens de dire est vraiment magnifique !» (XIV, 508), d'une rare platitude ?
Non que cette énième mouture soit totalement mauvaise ; elle a surtout le tort de s'attaquer à plus fort qu'elle, et d'être au fond moins neuve, moins hardie, plus terne que ses deux grandes devancières. Un coup pour rien. Homère n'a pas trouvé (pas encore ?) son Klossowski, qui traduisit l'Enéide avec une belle violence, ou son Meschonnic, décapeur de Bible. L'essentiel est qu'il ait son Bérard et son Jaccottet, dont les Odyssées lumineuses nous tiendront compagnie, quoi qu'il advienne, encore très longtemps.
(Article paru dans la Quinzaine littéraire du 15.11.1991)
Pour vous je ferai un meilleur prix.
Ma voix est inconnue
des grands drames de la planète :
disparitions du droit, faims qui mangent
leur survie pour vivre,
contrebande sauvage d'inégalités,
intérêts nucléaires,
guerres touristes,
décisions qui circulent
incognito en lunettes noires
dans leur gilet d'arbitraire pare-balles.
Et tout cela sous l'autorité
du très ancien, tout-puissant C'est ainsi.
Ma voix n'est pas entendue
dans les horribles drames de la planète.
Jamais elle n'est montée jusqu'au cri
pour maudire en cadence
les divisions du monde,
engrais par moitié
pour que l'autre moitié s'épanouisse.
Ma voix faible et lointaine
comme un savoir, une peur
a la voix du silence.
Et s'arrosant d'humble réalité
chaque jour elle s'immole par le feu.
C'est là son cri intérieur,
son frisson de colère
sa malédiction cadencée contre le chaos
sa vigilance
à côté des grands drames, de leurs gémissements,
sa bourrade chétive et sournoise
au très ancien, tout-puissant C'est ainsi.
Les hasards hurlent
leur succession est sourde
à la voix de stentor, antique et vénérable
de la Nécessité.
Jamais elle n'a pu faire écho.
Des décisions incognito en lunettes noires
le bâillonnent en route.
Pourquoi ferait-elle écho, ma voix
volant les lauriers de la puissance
à la voix du Monde ?
Ma voix est respectueuse
de la voix vaincue du Monde.
Les hasards hurlent
leur succession est sourde.
La parole qui crie, un Narcisse.
En se penchant sur les malheurs
c'est d'abord des miroirs qu'elle s'assure.
Non, ma voix ne se reflète pas
dans de noirs malheurs.
Aux démarches bruyantes
elle ne se mêle pas, ne co-hurle pas
pour que les montagnes se changent en collines
ou les collines en montagnes.
Elle reste basse comme une colline.
Ma voix, non, ce n'est pas
la liberté ou la mort.
C'est une prison pour voix
et leur euthanasie,
cible patiente
des caprices du nucléaire fou, son prochain.
Ma voix est un escabeau
pour paroles fatiguées,
pour conclusions qui reviennent vaincues.
Ma voix est la marche sans bruit
d'une écriture solitaire
dans des rues vides sous la pluie.
Pour vous je ferai un meilleur prix
disait Rien à Quelque chose
et cet idiot l'a cru.
(réponse sur le numéro de la citation...)
Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est : infinie.
Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie.
Il y a dans toute entreprise une part de supercherie qui, une fois le résultat atteint, se transforme en réalité.
Vivre : meubler une maison vide. L'entreprise à peine terminée, vient l'huissier qui saisit tout.
Plus sûrement que l'aigle n'échappe à la flèche, l'infusoire échappe à l'écrasement.
Déménageant d'une partie de la maison à l'autre, passé des semaines à porter mes livres sur mon dos et dans mes bras. Pour accueillir ces milliers de bouquins, monté je ne sais plus combien de bibliothèques, fidèle au modèle Billy d'Ikéa, basique, pas cher et facile d'assemblage, même pour les gourds dans mon genre.
De soir en soir, trop épuisé pour lire...
Ah le veinard : pour la première fois depuis des années, j'ai tous mes livres autour de moi, au même étage ou presque. Évidemment, il a fallu exiler au sous-sol ceux de mes parents : les œuvres quasi complètes de Marcel Aymé, dans les éditions des années 40 au papier pulvérulent ; presque tout Sagan (j'en repêcherai un de temps à autre) ; l'essentiel de Montherlant (celui-là restera au frais) ; les vingt-sept volumes des Hommes de bonne volonté de Jules Romains, dont la masse m'impressionnait tant jadis, aujourd'hui dormants dans ces fonds de purgatoire que sont les rayons d'altitude — il faudra tout de même aller y voir un jour.
Dans la chambre d'amis du bas, vieux projet enfin réalisé à l'intention de nos hôtes insomniaques : regrouper et classer les polars parentaux. Il y a là notamment 107 Simenon, faible partie de l'œuvre, masse imposante malgré tout. De les voir ainsi ensemble le désir de lire me reprend, irrésistible, et c'est avec Lettre à mon juge, l'un des vingt titres retenus dans la Pléiade, que je repique à la lecture. J'avais lu jusqu'ici une douzaine des romans de Simenon, toujours avec plaisir, mais le plaisir avec lui, plus qu'avec tout autre sans doute, par delà le livre lui-même, tient à la présence autour de lui d'un ensemble immense, dont on sait qu'on ne fera jamais le tour, présence que le retour du personnage Maigret, des situations et des thèmes rend obsédante au point de peu à peu vous coller à la peau. On se dit ouais, pas mal, pas extraordinaire non plus, on est au bord de s'ennuyer un peu et sans savoir quand ni comment, on se retrouve englué.
Tout jeune, je feuilletais en douce En cas de malheur à la recherche des passages de sexe ; un avocat célèbre se laisse vamper par une jeunesse, il finit par la sauter, ou plutôt se faire sauter — je cite de mémoire : «...et doucement, avec des haltes, comme pour ne pas m'effaroucher, elle prenait possession de moi.» Ce que Simenon décrit là, n'est-ce pas aussi la façon dont ses histoires s'emparent sournoisement de nous ?
(Près de cinquante ans plus tard, le vieux volume des Presses de la Cité s'ouvre tout seul à cette même page : «...petit à petit, avec des hésitations, des haltes, comme pour ne pas m'effrayer...»)
Que dire de la saisissante Lettre à mon juge, hors les banalités d'usage sur Simenon profond connaisseur des âmes, la force des passions, la faiblesse des êtres humains, qu'ils soient criminels ou représentants de la Loi ? Le narrateur, un médecin jugé pour avoir tué sa femme, apostrophe son juge : Hypocrite procureur, mon semblable, mon frère, cela pourrait bien être le thème central de toute l'œuvre.
L'histoire se passe en province voilà plus d'un demi-siècle et je me rends compte soudain que toutes les histoires de Simenon ont depuis longtemps basculé dans le passé, mais cela ne fait qu'ajouter au charme, et la force massive du romancier nous oblige à voir dans ces années-là — n'est-ce qu'une illusion ? — non seulement une autre époque, mais un autre monde où tout est plus lent, plus épais, plus dense.
 La couverture d'origine.... |
Autre provincial, contemporain du précédent, un peu moins prolifique mais plus noir encore dans sa vision du genre humain : Jean Anouilh. Comme Simenon, je l'ai trop peu lu et me plairais à le fréquenter davantage. En mai dernier, au SEL (Sèvres Espace Loisirs, notre belle salle municipale), une représentation de son Alouette par une troupe locale valeureuse a réveillé ce désir.
Lire Anouilh, c'est comme rendre visite à un vieil oncle de province, réac mais brillant causeur, bougon mais marrant : on a beau connaître ses tirades par cœur, se promettre que c'est la dernière fois, on y revient toujours. Quel talent, mon salaud ! Avec son Rendez-vous de Senlis je ne pouvais pas mieux tomber. L'auteur le rangeait dans ses Pièces roses ; les Pièces noires doivent être gratinées... On retrouve là son amertume infinie, les blessures d'enfance inguérissables, mais un équilibre vacillant s'installe entre sinistre et cocasse, entre les sombres agitations d'une humanité sordide et la pure lumière du regard de la jeune héroïne, par quoi tout est racheté. On a rarement vu pièce plus théâtrale, au meilleur sens du terme : le sujet — un homme organise un faux dîner de famille, en embauchant des acteurs, pour épater la jeune femme qu'il aime — entraîne des effets de théâtre dans le théâtre où l'enchantement se trouve multiplié. La pièce entière est si bien écrite pour la scène, par un amoureux fou des planches, qu'on croit la voir jouée sous nos yeux.
Pas mal traîné cette année, sur le boulevard du Montparnasse, devant les bacs des soldeurs. Moissons plutôt maigres, mais les rares découvertes ont la saveur de l'imprévu. Tombé l'autre jour sur les débris d'une anthologie de la poésie française en seize volumes publiée par France-Loisirs dans les années 90. Parmi les invendus, le tome du Parnasse.
Les souvenirs d'école remontent. Heredia... Leconte de Lisle... En sixième, au tableau, Xavier Normand déclame, Le sable rouge est comme une mer SAAAAANS limite, geste large vers l'infini, puis trou de mémoire au vers suivant : Et qui flambe, muette... muette... Allons bon, moi aussi.
Pauvres Parnassiens, qui a encore envie de se les farcir ? Après Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et Mallarmé, le déluge. Il nous faut le meilleur ou rien. Nous sommes terrifiants. J'ai eu pitié, j'ai emporté les pauvres vieux ringards dans mon sac.
Le bienfait n'a pas été perdu. Je me régale. Rien de génial ici, d'accord, tout cela est souvent grandiloquent, froid et raide et les effets téléphonés, mais comment ne pas admirer l'habileté, le soin, la belle ouvrage ?
Revoici l'impeccable Gautier, son fameux «Oui, l'œuvre sort plus belle / D'une forme au travail / Rebelle, / Vers, marbre, onyx, émail.» Mes profs m'avaient-ils expliqué jadis la belle trouvaille rythmique, 6, 6, 2, 6, ce vers court, ce resserrement qui dit si bien la contrainte, la concision ?
Dans le tas, plusieurs déceptions, des tubes du Lagarde-et-Michard devenus longs tunnels, mais que de bonnes surprises ! On peut trouver Heredia cliquetant et clinquant, mais comment nier que dans son registre il atteint perfection et splendeur ? Leconte de Lisle, diva aujourd'hui déchue, s'avère plus d'une fois ronflant, académique, tape-à-l'œil, chromo, sa philosophie à 4.95 nous assomme, son «Sommeil du condor» m'endort, mais que de grâce légère dans les contrerimes du «Manchy», où passe un écho anticipé du charmeur entre les charmeurs, Paul-Jean Toulet... Noté de fort belles choses aussi, plus ou moins isolées, chez Louis Bouilhet, grand copain de Flaubert, chez le total inconnu Ernest d'Hervilly, chez le pâle André Theuriet, mais oui («Sainfoin, frissonnantes avoines...») et même, en cherchant bien, chez François Coppée ! Chez Sully Prudhomme !
«La mer pousse une vaste plainte,
Se tord et se roule avec bruit,
Ainsi qu'une géante enceinte
Qui, des grandes douleurs atteinte,
Ne pourrait pas donner son fruit...»
Grandiose ou ridicule, je ne sais. Et c'est cela qui me ravit.
Ô joies de la brocante littéraire...
 Le fruit de la mer.... |
Beaucoup d'ancien dans mes lectures ce mois-ci, mais aussi du nouveau : Bardadrac de Gérard Genette, au Seuil. Objet aussi étrange que son titre, et d'autant plus étonnant que l'auteur, jusqu'ici, n'était connu que pour des ouvrages textologiques d'une grande rigueur. Or voilà notre homme qui se lâche soudain, nous offrant dans une joyeuse pagaille souvenirs d'enfance et de jeunesse, portraits, pensées sur les sujets les plus divers, jeux verbaux, y compris toutes les vannes classiques de l'humour potache, genre «Et le désir s'accroît quand l'effet se recule», plus un copieux recueil de mots-valises. Le titre annonce la couleur : un bardadrac, c'est le fouillis d'un grand sac : tout un barda en vrac, d'où n'importe quoi peut choir (patatras) ou (abracadabra) jaillir.
On peut déguster ces zakouski dans l'ordre qu'on veut, mais j'ai préféré, pour ne rien manquer, les savourer de A jusqu'à Z, même si ce classement alphabétique des matières ne me convainc pas tout à fait : c'est un truc à la mode, une facilité — à moins d'installer un ordre caché dans ce rangement arbitraire, ce que Genette semble avoir tenté, mais sans totalement réussir. Pas très emballé non plus par gros morceaux qui s'intègrent malaisément à l'ensemble : le dictionnaire des idées reçues à la Flaubert et le Je me souviens façon Perec appelaient une publication séparée. J'aurais souhaité aussi que l'auteur nous en dise davantage, sinon sur sa vie privée, du moins sur ses aventures de lecteur et d'écrivain. Tout cela est évoqué avec tant de retenue, de délicate pudeur que pas une seule fois, en 450 pages, on ne sent affleurer la passion.
Mais je critique, je critique, alors que j'ai dévoré ce bouquin ! On y apprend une foule de choses avec le sourire en compagnie d'un homme délicieux, modeste et drôle, en tous points attachant. «Me manquent effectivement, et, je le crains, définitivement, le sens du sacré, celui du sublime, et peut-être même celui du sérieux.» Voilà qui nous console de certains maîtres à penser poncifiants...
Pierre Strobel a-t-il apprécié Bardadrac ? Il a en tous cas plusieurs points communs avec Genette, et pas seulement le communisme déçu : ce que j'ai dit de l'homme Genette à l'instant s'applique à Strobel mot pour mot.
La politique mise à part (quand nous nous connûmes, j'étais de l'autre bord), le parcours de Pierre est remarquablement parallèle au mien. Au lycée Claude-Bernard, dans les années 60, il avait le premier prix de français et moi le premier accessit — cf. MES ÉCOLES, Lycée 58-65. Puis chacun a très longtemps attendu avant de publier — lui surtout. C'est fait, enfin ! J'ai dans les mains son À la Santé qui vient de paraître à l'Escampette et cet opus 1 me rappelle un peu le mien : dans nos deux livres, l'auteur-promeneur explore le lieu où il vit, en trace le portrait et le sien propre en filigrane du même coup. À cette différence que le territoire strobélien n'est pas l'immense banlieue de Paris, mais quelques rues intra muros autour de la célèbre prison. Pas vraiment touristique, ce coin, et même plutôt aride par endroits, on y passerait qu'on n'y verrait que du gris, mais notre homme a un œil qui traîne, un œil en même temps ultra-vif, il voit tout, son humour n'a d'égal que sa tendresse et sa plume souple et légère fait le reste : Strobel fait apparaître la beauté cachée des choses, il nous amuse et nous émeut d'un bout à l'autre, à partir de trois fois rien parfois (à preuve le texte sur le socle vide de la statue d'Arago), et pas besoin d'être cycliste pour vibrer a son ascension de la Butte aux Cailles à vélo, qui prend des allures d'épopée. Allez Pierre !
 On refait le mur.... |
Rangements et travaux — nous en avons pour tout l'été, Carole et moi — m'ont empêché de suivre l'actualité comme elle le mérite. Il paraît que la France a presque gagné au championnat de foot, qu'un joueur nommé Vidane, je crois, a donné un coup de boule à un Rital qui mettait en doute la vertu de sa mère et qu'à cause de ça il s'est fait renvoyer du match ! Ô décadence... En d'autres temps, quand les hommes étaient encore des hommes, dans toute la Méditerranée, une insulte pareille et c'était le coup de couteau, salué par les hourrah de la foule. Andalous, Albanais, Corses, Siciliens, Grecs, Turcs, Maltais, Maghrébins, où sont passées vos grosses couilles d'antan ?
Commode, le foot. Les clameurs accompagnant les buts ont à peu près couvert les cris indésirables, comme ceux de certains jeunes basanés chassés de leurs écoles françaises pour aller se faire éduquer ailleurs, dans des pays dont ils ignorent parfois jusqu'à la langue.
N'accablons pas trop l'auteur de ce nettoyage ethnique : les jeunes immigrés, personnellement il n'a rien pour ni contre. La seule chose qui compte, c'est Lui-Même. Le petit excité, en fait, est un calculateur au sang froid. Face aux protestations des âmes sensibles — il y en a beaucoup tout de même, y compris à droite —, il prévoit d'épargner un tiers de ses victimes, soit, selon lui je suppose, le pourcentage de population qui le désapprouve, et de virer sauvagement les deux tiers restants aux applaudissements du nombre correspondant de français lepénistes ou lepénoïdes. Bien vu, mon petit monsieur. Permettez-moi seulement de recommander à vos partisans (vous-même n'avez pas le temps de lire) un bref ouvrage commandité par la Cimade et publié par La Fabrique : Votre voisin n'a pas de papiers, sous-titré Paroles d'étrangers. Précis, implacable, riche en témoignages de victimes, ce livre sur l'accueil des étrangers en France amènerait peut-être nos gardiens de frontières à réfléchir, s'ils le souhaitaient vraiment...
Début juillet, inscrit sur la liste du RESF (Réseau éducation sans frontières), recevant par Internet des appels au secours, j'envoie chaque jour des messages à l'un ou l'autre préfet pour l'inviter à ne pas expulser tel ou telle jeune bronzé(e).
Plaisir d'invectiver les valets du petit mégalo.
Le 11, suite au transfert de notre ligne téléphonique d'un côté de la maison à l'autre, l'accès à Internet est coupé. Il paraît que c'est normal et que cela va durer quatre ou cinq jours : le temps, pour les techniciens, de presser un simple bouton. Pour finir, malgré nos protestations quotidiennes, nous allons rester deux semaines sans Internet. Deux semaines qui nous auront montré, derrière les beaux discours publicitaires, le vrai visage de France-Télécom : système d'intervention rigide et inefficace, indifférence aux souffrances du client. Pour tout dire, France-Télécom a été franchement nul.
Couper l'Internet à tous ceux qui râlent contre tes agissements, ce serait une bonne idée, hein, petit Sarkozy ?
Le 1er septembre, sur volkovitch.com, il y aura.... On ne sait pas. Dans les grandes lignes, la formule ne devrait guère changer. On en discutera début août avec le cousin Marc, on réfléchira plus en détail vers le 15, après la fin des plus gros travaux de la grande maison.
En juillet 56, à Chèvres, au bas de l'avenue de Bellevue, ma mère et moi regardions passer le Tour avec Roger Walkowiak en jaune. Cette année, cinquante ans plus tard, le Tour nous rendant visite à nouveau, Carole et moi y sommes presque allés ! Je sais, la plus grande épopée pharmaceutique des temps modernes a perdu pratiquement tout intérêt sportif, mais qu'importe : le Tour est désormais une fête mouvante, une retombée en enfance collective, un précieux rituel où le pays consolide son identité en communiant dans la nostalgie du passé. Se retrouver au passage de cette procession, c'est quasiment un devoir civique. Yvette Horner n'est plus là avec son accordéon à pédales, mais il nous reste la caravane publicitaire, les motards, les klaxons, le peloton joyeusement bigarré, les cuisses bronzées des coureurs ! Vu les progrès de la chimie, elles sont sûrement plus grosses encore aujourd'hui qu'en 56 ! Amies volkonautes, j'espère que vous êtes allées vous rincer l'œil.
Lecture assortie : Secret défonce, chez JC Lattès, signé par un ancien coureur professionnel, Erwann Menthéour. Il nous dit tout sur les médications cachées des chevaliers de la seringue. Pire encore que ce qu'on imagine. Publié en 1999, ce témoignage devenu un classique semble n'avoir rien perdu, hélas, de son actualité...

|