
Chef d'œuvre de technique.
PAGES D'ÉCRITURE
N°33 Juin 2006
J'ai deux vélos : un pour les bois, un pour la ville, chacun remplaçant l'autre en cas de pépin. Une voiture me coûterait bien plus cher, mais avec mes deux fois deux roues — luxe rare, quasi indécent — je me fais l'effet d'un nabab. La grande vie, à mon âge, enfin !
Je parle à mes vélos. Ils ont des noms. Le vieux gris, prolo de chez Décathlon, c'est Dédé ; le Giant flambant jaune, diva fragile (les caprices de ses freins à disque me coûtent une fortune), je l'ai baptisé Gilbert. Pas de quoi passionner la foule de mes lecteurs, j'en suis conscient, et pourtant notre manège à trois m'intéresse. L'idée de les nommer, par exemple, m'est venue très tard, après quelques années — déclenchée par quoi ?
(Cette question dérisoire, quelqu'un de plus futé que moi en dégagerait peut-être une loi psychologique importante. Les scientifiques, eux, le savent : la clef des mystères se trouve dans l'infiniment petit.)
Je parle à mes deux vélos en arrivant sous l'appentis, pour les saluer, annoncer lequel j'ai choisi, puis au retour, quand je suis content de nous, ou pour prendre sur moi d'éventuelles défaillances, mais sur la route, pas un mot, pourquoi ? La faute, sans doute, à leurs solides vertus : docilité, discrétion. Ils se font oublier au point de laisser croire que je suis seul à me défoncer ! Ils font alors presque partie de moi-même, et c'est pourquoi sans doute mes vélos (attention ! ce ne sont pas de banales bicyclettes) portent des prénoms masculins.
J'ai peu de reproches à leur faire. Pas très malins, sans doute. Leurs emballements puérils dans les descentes m'amusent plutôt ; ils le paient plus tard dans les côtes, je les sens souffrir, je dois les traîner, mais ils s'accrochent, ils font presque toujours ce qu'ils peuvent, humbles et honnêtes. Les freins fragiles de Gilbert, c'est de naissance, et quant au reste ils sont tous deux d'une robustesse incroyable. Quand je pense à ce qu'ils subissent, l'hiver surtout, dans le genre secousses et bain de boue ! Le moindre vélo d'aujourd'hui est un chef-d'œuvre de technique. On devrait s'émerveiller. On ne sait plus.
Ce que je n'aime pas trop, tout de même, c'est leurs façons hypocrites quand ils crèvent ou cassent la chaîne : d'un seul coup plus personne, on joue les tas de ferraille sans vie, Je suis mort, je peux pas t'aider... Avant de repartir tout frais, comme un zèbre, sur un pneu neuf, quand je me relève les mains pleines de cambouis. Quelle aptitude à changer d'organes ! Moi et ma clavicule, à côté, nous avons l'air préhistorique...
Que je parle à Gilbert et Dédé, j'espère bien que ça ne fait rire personne. Après tout, il nous arrive à tous, ou presque, un jour ou l'autre, de faire bien pire ! de parler à un absent, à un mort ! Sans compter ceux qui adressent à Dieu des discours compliqués, persuadés qu'Il n'a que ça à faire, les écouter, eux, et non les milliards d'autres microbes. Tous ces monologues apparemment absurdes ont un sens, évidemment, c'est par là qu'il faudrait chercher maintenant, mais je suis pris au dépourvu, mes petits vélos m'ont trop vite mené à ces questions immenses, je ne suis pas prêt, stop mon gars, pied à terre.
(Journal infime, 2003)
 Chef d'œuvre de technique. |
En va-t-il ainsi dans toutes les langues ? Un certain nombre de textes grecs modernes sont traduits en français plusieurs fois, soit qu'une traduction officielle contestée suscite une ou plusieurs versions alternatives, appelées à rester inédites, soit qu'en l'absence de traduction officielle quelques courageux pondent leur texte chacun dans son coin pour le proposer aux éditeurs.
Cavàfis, depuis longtemps dans le domaine public, peut être actuellement lu dans trois traductions françaises, et il en existe au moins une autre, non publiée — sûrement pas la pire des quatre. Elỳtis, lui, pas encore libre de droits, attire moins les retraducteurs pour l'instant, malgré le caractère problématique, parfois, de ce qui nous est donné à lire.
L'un des recueils majeurs d'Elỳtis, Axion esti (1951), fut traduit en 1987 chez Gallimard par un poète français dont je tairai le nom, qui ne parlait pas grec. Je serais moins cruel avec cet homme si ce prince des prétentieux n'avait, du temps de sa gloire il y a vingt ans, cherché à monopoliser son idole Elỳtis aux dépens de ses concurrents. Aujourd'hui, nul ne l'ignore : le pensum de X. est un massacre. Les traducteurs se rendent en pèlerinage sur ce lieu d'horreur, comme d'autres vont méditer à Waterloo ; les grands désastres font rêver.
J'exagère ? Voici un mot-à-mot du début :
Au commencement la lumière Et l'heure la première
où les lèvres encore dans la glaise
essaient les choses du monde
Sang vert et bulbes d'or dans la terre
Superbe dans son sommeil la mer étala
des voiles écrus d'éther
sous les caroubiers et les grands palmiers dressés
Là seul j'aperçus
le monde
en pleurant à chaudes larmes
Mon âme cherchait un Guide et un Héraut
Je vis alors je me souviens
les trois Femmes Noires
levant les bras vers l'Orient
Le dos doré et le nuage qu'elles avaient laissé
peu à peu s'effaçant etc.
Et voici le chef-d'œuvre autoproclamé de X :
Ores la lumière Et telle heure la première
qu'en l'argile encor
les lèvres modulent
à l'épreuve des choses de l'univers
Sang émeraude et bulbes en terre dorés
Charme suprême en son sommeil déferle aussi la mer immense,
gazes de l'éther, ces voiles écrus
dessous les frondaisons des caroubiers et les grands jets des palmiers drus
Là-bas tout seul j'ai rencontré
l'univers
sanglotant sans arrêt
Mon âme désemparée cherchait Héraut et Timonnier
Lors j'ai vu je m'en souviens
les trois grandes Femmes Noires
en train de lever les bras en face de l'Orient
Leurs échines festonnées d'or et la nuée qu'elles laissaient
peu à peu se ternissant etc.
Le pire, dans ce fatras, c'est pour moi le bourrage permanent à coups de noms et surtout d'adjectifs inutiles («immense», «frondaisons», «désemparée», «grandes»), causé par la décision de reproduire dans la V.F., vers par vers, le nombre de syllabes du poème original. Tragique erreur, contresens musical absolu, puisque d'une langue à l'autre les rythmes ne sont pas les mêmes : certains vers grecs impairs sont équilibrés, et leur calque français informe ou boiteux. Voilà pourquoi la version X. est flasque d'un bout à l'autre.
D'autre part, ignorant le grec, X. ne sent pas la langue d'Elỳtis ; on lui a dit que le poète a recours à tous les registres du grec, ce qui n'est pas faux ; mais il ne voit pas que le fond de la langue du poète est fait de mots très simples ; sinon, rendrait-il «vert» par «émeraude», «doré» par «festonné d'or» ou, dans un autre passage, «plage» par «syrte» ? À moins que pour lui la poésie soit avant tout affaire de beau langage ? Que la beauté, selon lui, soit affaire de fards et de fanfreluches ?
Il a fait très fort, X., dès le premier mot : ce «Ores» médiéval, qui traduit avec bravoure «au commencement» par «maintenant» — accord d'entrée fortissimo plaqué triomphalement à côté ! X. l'a fait exprès, on s'en doute, et il consacre une page entière de son intarissable préface à s'autogloser, tout fier : «...la lumière est l'épiphanie à un instant donné (celui de la prise de parole) de ce qui avait de toujours été. La lumière/parole produit l'effet d'entrée (annonce) dans l'existence, elle ente le monde existant dans un moment absolu, toujours-déjà-là : le poème ne commence pas vraiment, il commence seulement d'être aperçu, et concomitamment autour du pivot (la Balance) du ET le temps paraît avec la lumière, dans la dimension de l'annonce et son «futur antérieur» creusant d'imaginaire le néant présent etc. etc.».
C'est si beau que le poème devient superflu...
La seconde traduction complète d'Axion esti, clandestine par nécessité, est l'œuvre de deux inconnus : Jean-Marie Velleine et Dèspina Saltourìdou.
Au commencement la lumière Et la toute première heure
où les lèvres encore dans la glaise
explorent les choses du monde
Sang verdoyant et dans la terre des bulbes d'or
Resplendissante dans son sommeil la mer étalait
un voile écru d'éther
sous le feuillage des caroubiers et sous les palmiers élancés
Là seul je rencontrai
le monde
en sanglotant
Mon âme cherchait un Guide et un Héraut
Je vis alors il m'en souvient
les trois Femmes Noires
lever les bras vers l'Orient
leur dos chamarré d'or et la nuée qu'elles laissaient derrière elles
peu à peu se dissipait etc.
Sans doute pourrait-on aller plus loin encore dans le dépouillement : j'aurais pour ma part, suivant le grec, viré ce «feuillage» adventice, mis «vert» au lieu de «verdoyant» et peut-être même osé un «toute belle» au lieu de l'encombrant «resplendissante». Mais cette version simple, sans esbroufe, a gagné ma sympathie : elle nous donne l'essentiel et rendrait mille fois mieux justice au poème grec, si toutefois nos lois permettaient qu'elle fût diffusée...
L'aiguille doit être au-delà du douze.
Non, je n'ai pas d'horloge allégorique
parlant de douzième heure qui sonne
et de tout ce qui résonne comme elle.
C'est l'heure usine,
le soleil déjeune
et ses rayons
sont tantôt cure-dents épars
tantôt cireurs astiquant
les avions qui passent.
Le soleil a déjeuné
il se sent lourd
exorbité comme la curiosité
qui s'écrie qui suis-je qui suis-je
quand toute réponse est muette et s'en fiche.
Mais qui donc l'a fait naître soleil,
grain rouge sur la joue des millénaires ?
Pourquoi pas plutôt un baiser,
un cireur faisant reluire les lèvres,
pourquoi pas une pièce de monnaie
pour voyager sans cesse,
connaître des mains inconnues, exotiques.
Il a déjeuné, le soleil,
il se sent lourd,
comme s'il avait peine à digérer
les heures si régulières.
Alors ce soir il a bien envie
de laisser tomber le couchant,
de faire marche arrière et s'éteindre
là d'où il vient,
de suivre en somme
le parcours des humains
ce parcours de poupée,
sans saveur
sans les sirops orange.
Bon Dieu, quel vicieux que l'ennui,
dont les désirs s'allument à la mortalité.
J'écris je déchire
j'écris je déchire
pas de cireur qui fasse reluire
toutes les idées passées par la tête et le papier.
J'écris je déchire
je me sens lourde,
j'ai fini je crois de déjeuner
exorbitée
comme la curiosité qui s'écrie
qui suis-je qui suis-je
et toute réponse est muette et s'en fiche.
Je déchire en mille et douze morceaux
ce que j'ai pensé,
je déchire des douzièmes heures,
des montres
en petits morceaux
et les étrangle par dessus le marché
de ma main fantôme
de peur que mes écrits déchirés
ne se recollent tout seuls en secret
ne se lisent et ne découvrent
qu'ils étaient bons à jeter.
(réponse sur le numéro de la citation...)
La rigueur pour tout ce qui touche aux choses de la chair donnait en quelque sorte carte blanche pour cette passion de la propriété que la conscience bourgeoise avait déguisée en vertu.
Elle avait conservé cette force incroyable que donne l'absence totale d'intérêt envers les autres.
Il n'existe sans doute rien de plus difficile que d'avoir l'air sincère quand on a le cœur brisé.
On n'a jamais perdu le paradis ; seulement on ne sait plus s'y reconnaître. On croit tout très difficile, et tout alors le devient.
Qui ne peut l'éviter il doit aimer sa peine.
Cinq ans sans aller en Grèce !
Aéroport d'Athènes. Pas un seul uniforme en vue, pas une barrière. Pour qui a fréquenté le JFK de New-York, ses flics arrogants, ses contrôles hargneux, sa paranoïa de forteresse envahie par la peur et la haine, l'entrée en Grèce est une merveille de douceur.
Pauvre Amérique, comme je te plains.
Je t'aime, petite Europe.
Patras. Au cœur de la ville, une librairie, Polyedro — un véritable centre culturel en fait, animé par un couple de passionnés, avec galerie d'art et manifestations littéraires incessantes. Elles se tiennent derrière, dans un grand jardin. Ce soir, sous les figuiers, dix traducteurs de poésie grecque contemporaine, venus de toute l'Europe, évoquent la réception de la poésie grecque dans leur pays ; demain, chacun lira dans sa langue les traductions commandées par la librairie pour un hommage aux poètes de la ville. Dans cette anthologie multilingue prévue, une vingtaine de poètes dont plusieurs d'envergure. Beaucoup d'entre eux se retrouvent dans une autre anthologie, celle-là bilingue, que la municipalité m'a commandée, Patras étant cette année la capitale culturelle de l'Europe. L'argent vient de Bruxelles, on s'en doute : le ministère de la Culture local, toujours riche en promesses, n'a pas un radis à distribuer. Le mépris de l'État grec pour la culture est l'un des plus flamboyants d'Europe.
Le premier soir, j'ai le plaisir d'annoncer que notre Anthologie de la poésie grecque contemporaine, en Poésie/Gallimard, parue en 2000, s'est déjà vendue à 5000 exemplaires. (Souvenir ému d'une collaboration idéale avec André Velter et son assistante, Catherine Fotiadi.)
Le lendemain, lectures de poésie pendant plus de cinq heures, en deux séances. L'organisation pagailleuse du matin n'entame pas la bonne humeur d'un public nombreux et endurant. Tout s'arrange l'après-midi. Les comédiens qui lisent en grec, irréprochables. Dans l'assistance, je reconnais la chauffeuse de taxi qui m'a amené depuis Athènes. Plus tard elle me tapote gentiment l'épaule : Evharisto, kyrie Micel... Je serais un peu moins vieux, elle me tutoierait. Je lui fais la bise.
Si j'ai dit aux Grecs en passant un peu de mal du paysage poétique français contemporain, c'est que j'émerge assez abattu de Pièces détachées, anthologie de la poésie française d'aujourd'hui, signée Jean-Michel Espitallier (Pocket). On aimerait saluer par des hourrahs la parution d'un tel ouvrage en poche ; mais que tout cela — presque tout cela — est froid, cérébral, fabriqué ! Surtout quand on sort de lire les poètes grecs d'aujourd'hui, tellement plus charnels, plus proches du réel et par conséquent du lecteur !
Je sens chez la plupart de ces poètes hexagonaux une peur panique de la simplicité. (Ils ont raison dans un sens : la simplicité, quoi de plus difficile ?) Alors ils font les malins. Ils se donnent un mal fou pour avoir l'air moderne, c'est-à-dire, selon eux, sec et abscons. Les notices où chacun d'eux se présente sont d'un amphigourisme et parfois d'une prétention désolants, à moins que comiques. Je ne sauverais, pour ma part, que la poésie orale de Bernard Heidsieck, un beau poème de Paul Louis Rossi, les acrobaties vertigineuses de Ghérasim Luca, et Emmanuel Hocquard bien sûr, si libre et imprévisible, dont j'avais fort goûté jadis Le commanditaire (P.O.L) où il emmène la poésie dans d'étonnantes aventures.
Tiens, Réda n'est pas là... Réda, de la bibine, un has been... Et Jean-Pierre Lemaire... Hou le blaireau, on comprend tout ce qu'il dit...
Oui, mon humour pèse des tonnes. Ce que je raconte là, ça se pense à la rigueur, ça ne se dit pas ! J'ai conscience d'être vachement plouc. Mais c'est sans doute un privilège de l'âge que d'avoir l'audace d'avouer sa plouquerie. Je pense avec tendresse au vieux Lope de Vega, lequel, apprenant qu'il allait mourir, s'écria : Bon, je peux l'avouer maintenant, Dante m'a toujours fait chier.
 Après une lecture de Dante. |
Allez, vieux connard, encore un effort.
Absent de l'anthologie, le poète Jean-Pierre Verheggen. Ridiculum vitae précédé de Artaud Rimbur (Poésie/Gallimard). Voilà un tempérament totalement opposé au mien. Quelle démesure ! quel coffre ! quel souffle ! On est submergé par cette avalanche verbale, ce grand largage d'amarres où les mots se cognent et vous pètent à la figure ou s'accouplent en giclées de calembours. Mes métaphores ne sont pas fortuites : le héros de tout cela, c'est le corps, vu avant tout dans ses fonctions reproductrices ou excrétatoires. Le corps dans tous ses états, le langage déchaîné, on n'est pas très loin de certains poètes-Pocket, comme Savitzkaya — même si Verheggen n'a pas d'égal en truculence et tonitruance. Plus encore que Rimbaud ou Artaud, ce forcené évoque un Rabelais sous fumette, un Joyce amphétaminé.
Écoutons-le :
«C'est le corps d'Artaud, d'Artaud coupé ! Artaud mi méat-culpé et mi-mimé enculé ! Et qui, tout à coup, s'met à grouiller de mots larvaires invertébrés ! À peine articulés ou semblant tomber des nues ! Et qui le font paraître cet Artaud sans Maître ou cet Artaud dont on abuse, cet Artaud, crado de sa Méduse !»
Tout cela est fait pour être dit, vociféré, bramé, sans laisser à l'auditeur le temps de se ressaisir, de se demander où tout cela nous mène et si la machine emballée, par moments, ne tournerait pas un petit peu à vide... Ce qui vaut sûrement aussi pour une partie de l'anthologie Pocket, dont le papier n'est sans doute pas le support idéal : c'est un CD qu'il faudrait.
Ce qui me fait douter qu'on tienne en Verheggen l'Artaud de notre temps ? Notre Mot-mot annonce d'entrée naïvement vouloir écrire «un texte fulgurant comme la foudre et le foutre homonymique», une sorte d'«art poétique violent», «un hard poétique !» Artaud, lui, n'avait pas pour but premier d'écrire un beau poème ; ça venait de bien plus profond...
Dans l'avion, lu Libé. Pourquoi cet honorable journal m'agace-t-il vaguement certains jours ? Lui et moi devrions nous entendre : on se donne des allures décontract' et on se prétend de gauche.
Une raison ponctuelle, très mesquine : le commentaire sur ma première tradale, dans Libé en 84, faisait deux lignes, le plumitif n'ayant lu que la première page. Je ne savais pas encore que deux lignes, c'est déjà inespéré...
Chouette, une chronique signée Aziz Chouaki. J'avais aimé sa pièce Une virée. Chouaki raconte ici sa semaine au quotidien. Tout cela bien vu, sympa, écrit dans un idiome qui m'est familier, mélange de langue savante et de langue de la rue, intello-populo, niveau de langue sismographique, phrases sans verbes, ellipses, mots raccourcis, argot, un tour plus recherché ici ou là, une allusion pour hapifiou. J'ai conscience d'écrire un peu comme ça ; je ne comprends pas la raison de mon malaise. Le texte oscille sous mes yeux : le même passage, tantôt vif, efficace, tantôt sombrant dans le procédé, se vautrant dans un maniérisme canaille.
«Boulevard extérieur, gros chantier, le tram, les Parisiens râlent, bordel de circul'. Midi, petite dalle, tiens se faire un Grec, petit fast, cinq, six tables. Aux murs, poster, plantureuse bimbo turque, grande chanteuse, semble-t-il, là-bas. Puis, sur la gauche, ça s'esthétise islam-glam, breloquante déco, guirlandes fluo...»
C'est trop haché, ça ne respire pas. Il suffirait de peu de chose en moins... de frôler l'invisible ligne jaune sans la mordre... Pas facile, mais tout l'art est là.
Un régal en perspective : le petit livre d'Eric Hazan, LQR, la propagande du quotidien (Raisons d'agir). La LQR, ou Lingua Quintae Respublicae, c'est la Langue de la Ve république, la langue où nous baignons, celle de nos décideurs, économistes, publicitaires, politiciens, celle des médias. Un idiome par essence discret : pour atteindre son but — endormir le citoyen —, il lui faut agir sans qu'on le remarque. C'est, nous dit Hazan, «une arme postmoderne, bien adaptée aux conditions «démocratiques» où il ne s'agit plus de l'emporter dans la guerre civile mais d'escamoter le conflit, de le rendre invisible et inaudible. Et comme un prestidigitateur qui conclurait son numéro en disparaissant dans son propre chapeau, la LQR réussit à se répandre sans que personne ou presque ne semble en remarquer les progrès...»
Belle image ! Bravo l'artiste.
Tremble, LQR maudite : Hazan est là pour tirer de l'ombre tes vocables les plus sournois, faire défiler un par un ces salopards au grand jour puis les achever d'une balle dans la tête. On approuve, on se dit qu'en effet la langue est bien polluée, que voilà un bon coup de balai, qu'il y a de quoi se réjouir, alors pourquoi n'est-on pas tout à fait réjoui ?
D'une part, on s'inquiète. Devant l'hécatombe verbale, on se demande quels mots nous restent et si l'on va encore oser ouvrir la bouche. Les immigrés venus de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple, comment les appeler, puisque selon l'auteur arabo-musulman est quasiment une infamie et maghrébin un terme raciste ?
Au fait, à côté de tous ces mauvais mots, en est-il de bons ? Est-il au monde une langue propre, vraie, dont l'existence au moins virtuelle légitimerait le combat de notre auteur ? Aurait-il découvert, lui dont on devine les positions politiques très à gauche, une langue de ce côté-là qui ne serait pas faite du bois le plus dur ? De quoi susciter notre curiosité la plus vive... Hélas, pas une ligne là-dessus. Secret défense.
Surtout, on s'interroge sur l'efficacité de la satire, de ce combat frontal face à un tel ennemi, oblique, insaisissable. Plutôt que ces charges d'une raideur puritaine, ne vaudrait-il pas mieux un peu d'humour, d'ironie, de fausse connivence avant de mieux frapper ? Moins de boxe et plus de judo ? Quand l'ennemi est mou, camarade, fais-toi souple, tu as l'air nunuche comme ça, raide comme un piquet...
Commencé Le vent, de Claude Simon, dans l'édition toute fraîche de la Pléiade, avec un rien de trac : le bonhomme exige beaucoup de son lecteur. Allais-je caler en route, comme avec La bataille de Pharsale ? Eh bien me voilà au bout, sain et sauf !
Le vent, écrit à 40 ans, premier de ses livres qu'il n'ait pas renié ensuite, n'est sans doute pas l'un de ses chefs-d'œuvre, mais presque : frénétiquement dostoïevskien (le personnage principal) et proustien (les très longues phrases, les trois adjectifs...) tout en affirmant de façon forcenée une écriture hautement personnelle, même si Faulkner lui non plus n'est pas loin (l'accumulation, le désordre...), Simon, dans plus d'une page, atteint déjà ses sommets. Témoin entre cent, ce simple paysage de campagne vu du train, p. 55, où l'on sent soudain de façon prodigieusement intense le poids, la présence des choses, la «matière gluante et malaisée» du réel et l'épaisseur du temps. On trouve là déjà l'évidence impérieuse et tranquille des grandes pages simonesques, si nombreuses plus tard dans L'acacia et Le jardin des plantes.
Ce qui me frappe aussi, dans ce roman d'un homme aussi hostile à l'analyse psychologique que Sarraute à la même époque, c'est certains passages de ce point de vue éblouissants. Elle et lui, tout compte fait, qui prétendaient tuer «la psychologie», l'auront portée à son point culminant...
Et maintenant que j'ai terminé ce Vent, ne suis-je pas prêt à me mesurer aux Géorgiques en personne — avant, qui sait, de me lancer à l'assaut de Pharsale une nouvelle fois ?
L'âge venant, on n'a plus peur de rien.
Récompense méritée : récré cinoche au SEL en bas de chez moi. Quatre étoiles, comédie galopante, pétillante, emmenée par un trio d'acteurs en état de grâce (Isabelle Carré, José Garcia, François Cluzet) et un metteur en scène virtuose — à sa façon, toujours discrète —, Christian Vincent. On ne cesse de rire ou de sourire, tout cela est parfaitement léger — une légèreté voulue, frisant parfois la provocation, et par conséquent moins lisse qu'elle n'en a l'air. Tout comme ce personnage de champion automobile crétin, joué par Cluzet, dont le ridicule atteint peu à peu au grandiose, au sublime, au point que l'émotion affleure mais chut, circulez, ce n'est qu'une comédie, tournée chez nous en plus alors que seul le temps, comme chacun sait (compter au moins vingt ans) et l'espace (un océan s'impose) ont attiré vers les joyaux de Lubitsch, Hawkes ou Capra des nuées d'exégètes fervents...
Au SEL toujours, la semaine dernière, on donnait Volver d'Almodovar, que j'ai raté, quel con. Pas loupé cette semaine le dernier Nanni Moretti, Le caïman. Moretti non plus ne m'a jamais déçu. Au contraire. Cette fois il nous offre deux histoires : un producteur minable essaie de monter un film sur Berlusconi, il se fait plaquer par sa femme. Film éclaté, scènes entrechoquées, violence et saugrenu en alternance ou mieux encore mêlés, rire et larmes aussi, ça bouge, ça bouillonne. Moretti nous explique l'impossibilité de faire un film sur Berlusconi et son film prouve le contraire — au prix de trésors d'astuce et d'invention. Un thème obsessionnel unifie ce puzzle : l'image (la télé, le cinéma surtout), ses mensonges et ses vérités. Non content d'apparaître, Berlusconi s'incarne en trois acteurs, mais en se divisant il s'élargit : son portrait, peu à peu, devient celui de l'Italie entière. Comment les Italiens ont-ils fait pour choisir, et failli élire une fois encore, cet escroc avéré, ce concentré de vulgarité brutale ? La question trouve là un début de réponse : Berlusconi serait caché au fond de chaque Italien. Démission de la pensée, du sens moral, il serait en eux la part la plus moche, la plus vile. Mais valons-nous mieux, nous Français, même si nos escrocs à nous sont un peu moins voyants ?
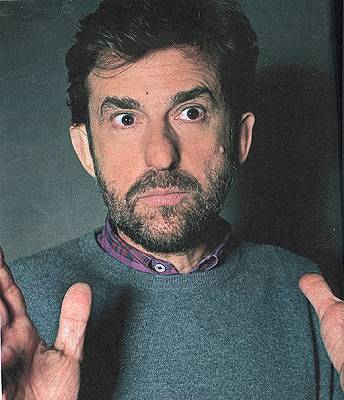 J'ai le même pull que lui. |
29 mai. Il y a juste un an, la France disait NON à l'Europe, ça s'arrose. De Villiers, Besancenot et quelques potes ont fêté ça l'autre soir en charentaises et béret devant un verre de gros qui tache. On l'a drôlement baisée, la salope, a dit Le Pen. T'as vu, elle peut plus arquer, a rigolé Fabius. Ils sont rentrés chez eux, titubants et joyeux.
Pleure pas, petite Europe, moi je t'aime, et je ne suis pas le seul. Un jour ils seront morts, ces minables, et toi plus vivante et belle que jamais.
En juillet, ceux qui en ont marre de Dhôtel et Modiano iront voir ailleurs, et les indifférents à l'Odyssée, dont nous scruterons les traductions, pourront se coller devant TF1. Ceux qui n'éprouvent pas de tendresse pour l'école éviteront les portraits de profs gentils au lycée de Brimeil. Les allergiques à la poésie contemporaine fuiront les poèmes de Christòphoros Liondàkis, et vous, ricanants contempteurs du «petit tas de secrets», vous sauterez mes nouveaux souvenirs d'école primaire avec dédain ...
CANCER du 22 juin au 22 juillet
Le mois dernier, ici même, ami cycliste, un abruti qui devait être moi t'a recommandé de rouler en groupe. Conseil de Sagittaire, à oublier dare-dare. Chacun a sa propre vitesse de croisière idéale, liée au rythme cardiaque, et qui seule garantit les progrès. Suivre les autres, c'est aller soit trop vite, soit trop lentement ; tantôt on s'asphyxie, tantôt on pédale dans le vide.
D'accord, bavarder avec ses potes, pourquoi pas, mais le rouleur solitaire a mieux à faire : à l'écoute de son corps et de la nature qui l'entoure, tous les sens en éveil, il parle aux arbres, au vent, à la pluie, aux absents bien-aimés, il écoute, il apprend à chaque instant.
Pour que vos acolytes vous pardonnent vos absences, offrez-leur l'anthologie À bicyclette, chez Sortilèges. On y trouve, on s'en serait douté, des textes d'Allais, Aymé, Jarry, Leblanc, Perret, Blondin, mais aussi de Hemingway, Cortazar, Gracq, Beckett, Barthes et San Antonio. J'y note cette précieuse remarque, signée Saroyan : «Grâce au vélo, j'ai beaucoup découvert sur le style — le style dans l'écriture ; le style dans tout.»
 Armstrong, Cancer célèbre |