
Jean Echenoz, 2005.
PAGES D'ÉCRITURE
N°25 Septembre 2005
Le nouvel Echenoz, Au piano, m'a emballé en douceur, comme les précédents. On a beau trouver dans chaque phrase une leçon de regard et d'écriture, et admirer notamment cet art de la précision dans le flou, l'impression finale — plus encore que dans d'autres grands livres — dépasse nettement la somme des sensations isolées. On arrive sans trop de mal à isoler tel ou tel procédé, mais pour l'essentiel, mystère.
J'ai beau savoir qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde, que seuls les tièdes et incolores n'ont pas d'ennemis, c'est plus fort que moi : je me demande comment on peut ne pas aimer Echenoz, ou du moins ne pas saluer son talent. Le jour où dans le RER qui nous ramenait du lycée de Brimeil le jeune Machin (c'était quoi son nom ?), devant qui j'encensais les bouquins d'Echenoz, a lâché sur eux un jet de bave méprisante, le brillant jeune homme s'est d'un seul coup changé en petit morveux.
Et Au piano ? Il pisserait dessus aussi ? Accordons-lui le bénéfice du doute. Je trouve dans ce nouveau bouquin quelque chose de plus. Faisant déraper son récit, tuant son héros après cinquante pages, nous contant ses aventures post mortem avant de le ramener dans ce monde avec un irréalisme qui pourrait choquer, sembler gratuit, futilement ludique, l'auteur invente une sorte de mythe moderne qui me rappelle, oui, Platon, et pas seulement pour cause de descente aux Enfers. D'après ce mythe-là, nous autres vivants sommes déjà plus ou moins morts, nous ne sommes plus parfois que des ombres, la petite flamme en nous éteinte, ou prisonnière. Et voilà comment l'aspect le plus léger du livre nous mène à ce qu'il a de plus grave et d'essentiel.
Autre éblouissement ces jours-ci, Virginia Woolf, Mrs Dalloway, en anglais pour la première fois. Je l'avais lue en khâgne dans la traduction ancienne, un peu molle. Je me souviens, à la même époque, d'un devoir de philo de mon copain Bourgeois où il comparait de façon obscure la contemplation esthétique au plaisir de la vitesse. Pauvre extase... avait noté maître Grondan avec dédain dans la marge. Et voilà que trente-cinq ans plus tard, reprenant Woolf, grisé, frappé à jet continu, dans certaines pages, d'impressions multiples comme par des gifles de vent, j'ai enfin compris Edmond Bourgeois.
Il y a vingt ans, je confiais à l'un de mes profs de grec aux Langues-O mon enthousiasme pour un roman fraîchement paru. Il m'a répondu, À mon âge, vous savez, il m'en faut beaucoup pour qu'un roman m'accroche... Ils me tombent des mains... À mon âge ! Il avait à peine cinquante ans. Ce qui m'a chagriné, c'est moins la remarque elle-même, somme toute lucide, sur l'usure des facultés d'émerveillement, que le ton de l'aveu : non pas contrit, mais satisfait ! Comme s'il fallait voir une marque de progrès dans la déchéance. À d'autres, le coup du vieux sage, mon petit père ! Le détachement, non, désolé, je n'y vois qu'un cache-misère. Une infirmité.
Tant que les livres nous donnent le vertige, alleluia, nous sommes vivants. J'aime mieux perdre la force d'écrire que celle d'admirer, de m'émouvoir. De même que je préfère, à tout prendre, ne plus séduire les femmes, plutôt que cesser de les désirer.
(Journal infime, 2002)
 Jean Echenoz, 2005. |
Je fus longtemps un traducteur prétentieux, qui ne daignait se pencher que sur de grandes œuvres. Les largesses de l'Éducation nationale me dispensaient de travaux purement alimentaires. Puis, l'âge venant, le nombre de bouches à nourrir croissant, je commence à transiger. Et ce n'est pas une mauvaise école.
Je traduis pour la première fois un polar, genre série noire, excellent, émouvant, original à sa façon, qui transcende son genre mais lui reste fidèle pour une large part. Ce qui me pose des problèmes nouveaux.
Les livres dont je m'occupais naguère inventaient plus ou moins leur propre langue ; ici, je me sens appelé à tenir compte d'une certaine tradition : mon auteur a partiellement transposé dans sa langue les modèles classiques, ma version française doit donc, en écho, pas complètement bien sûr, mais un peu tout de même, sonner comme du polar. Mais quel polar ? Les américains ou leurs adaptations françaises ? On sait qu'aux temps héroïques, les originaux U.S. furent passablement déformés en arrivant chez nous, siliconés à coup d'argot et de métaphores gouailleuses, et je me demande si cette tendance a totalement disparu. Je me sens donc invité à traduire avec un œil sur le grec, un œil sur les standards américains et un troisième œil sur le français-de-polar-hexagonal. D'autant que la prose de mon auteur (il semble avoir lu ses modèles en américain mais aussi en français) louvoie volontiers entre un dépouillement hard-boiled et une verve plus française.
What ! what ! s'écriera le puriste indigné. Le traducteur doit traduire ce qu'il a sous les yeux, point final !
Sorry, ce n'est pas si simple. L'argot notamment pose problème. Le grec est par rapport au français une langue sous-argotisée. Si j'applique aveuglément mes grands principes fidélitaires habituels, je me retrouve avec un texte pauvre et plat — ce que l'original n'est pas —, et même, dans certains dialogues, à la limite de l'invraisemblance. Alors j'en rajoute une petite louche ici ou là, je verdis la langue un chouya — beaucoup moins, tout de même, que les joyeux drilles du père Duhamel dans la Série noire de jadis. J'espère bien ne choquer personne, par exemple, si les «amis» de l'original grec deviennent chez moi, parfois, des «potes»...
Autre avantage de traduire ce genre de prose tendue, nerveuse : l'exercice de concision. Travail fondamental quel que soit le texte, à mon avis, mais plus encore peut-être dans un récit d'action. Ce qui m'amène à pratiquer une activité sans doute illégale, mais souvent nécessaire : l'élagage en douce. Tous les auteurs ne s'y prêtent pas, certains n'ont pas laissé un mot de trop ; ici, de temps à autre, je coupe. Un «lui» dans «lui dis-je», par exemple — sauf s'il y a doute sur la personne. Ces pronoms personnels avec «dire», en fait, je les vire pratiquement toujours, polar ou pas.
«Il ôta son alliance de son doigt». D'où pourrait-il donc l'ôter ? Allez, je coupe le doigt — sauf si le doigt joue un rôle particulier dans le texte.
Ce petit verbe pas vraiment essentiel ? Hop, à la trappe. Une phrase nominale par-ci, par-là, ça change, ça donne du punch.
«Je m'étais merveilleusement débrouillé pour mon âge», écrit mon auteur. Et quelques pages plus loin : «On se serait cru dans un polar de quatre sous, mais cela me plaisait.»
Sans réfléchir, je transpose : «Je ne m'étais pas trop mal débrouillé...» «...mais cela ne me déplaisait pas».
Différence de mentalité : un Grec s'exprime de façon plus directe et s'autocongratule plus facilement qu'un Occidental.
N'est-ce pas très mal, ce que je fais là ? Refus d'accueil de l'étranger ! Anglo-saxonisation sournoise ! Si Berman vivait toujours, je prendrais un coup de règle sur les doigts... (Mais Berman lisait-il des polars ?)
Désolé, je persiste. Ce genre d'understatement, de litote, me semble un composant essentiel de l'esprit polar, en même temps que la concision. On se doit d'être dur, sec, de ne pas trop en dire. (Il y a là, au fond, une sympathique pudeur...) J'ai l'impression, en infléchissant ici très légèrement le texte, de ne pas aller à contresens du texte.
Et surtout, ô puristes éventuels, je vous emmerde. Le texte à traduire que l'on me confie appartient pour 99% à l'auteur. L'infime 1% qui reste m'appartient. Il est pareil au sel dans la soupe, sans quoi elle serait sans goût. Privé de mon 1% je serais malheureux, je m'ennuierais. Mon lecteur aussi.
Qu'est-ce qui se passe ?
Et quelle hostilité séculaire le sépare
de ce qui ne se passe pas ?
La salle vide à en étouffer. Qui va répondre, personne ?
Je prépare un grand voyage.
Avec les mêmes gestes que l'on fait
quand on reste.
Dans mon profond, lointain changement j'avance.
Qu'est-ce qui se passe ?
Quelle peur vient pleurer ainsi
rendant si glissant ce qui change ?
J'avais tant de paires d'yeux
pour de loin pour de près
pour dedans pour dehors
pour ceci pour cela
pour en haut pour en bas
pour ainsi pour autrement
pour les disparitions d'êtres chers
et tous les va-et-vient des phénomènes
tant de paires d'yeux
mais quelle maturité kleptomane les a prises
ne me laissant qu'une paire
pour voir ce qui m'est volé.
Les cendres se préparent une grande amphore.
Je prépare un grand voyage.
Avec les mêmes gestes que l'on fait
quand on reste.
Dans mon profond, lointain changement j'avance.
Qu'est-ce qui se passe ?
Quel choix de vie défunt honorent-elles
toutes ces salves de silences ?
Quels yeux de que Fait Accompli ont pleuré
rendant si glissant ce qui change ?
Quelle Fin a eu l'audace
de saluer le Début d'un je ne te connais pas ?
Les cendres se préparent une grande amphore.
Je prépare un grand voyage.
Avec les mêmes gestes que l'on fait
quand on reste,
de même que l'on reste avec les mêmes gestes
que l'on fait quand on part.
Dans mon profond, lointain changement j'avance.
Qu'est-ce qui se passe ?
Un retard est amoureux de l'Heure juste,
elle le repousse : fiche-moi la paix vieux salaud.
L'Heure juste, petite garce. Le Temps, enfant gâté.
Arriver à l'heure
à mon profond, lointain changement
y arriverai-je ?
Quelle peur vient pleurer ainsi
pour que C'est encore loin et Où vais-je
soient trempés jusqu'aux os ?
Et quand j'arriverai
combien de choses encore devront-elles mourir,
quelles salves honorifiques de silences
et quoi d'autre entendrai-je
combien de temps passerai-je encore
à commencer
ce voyage sans fin
plus profond, plus lointain toujours
dans mon changement ?
J'ai fini. J'ôte ma paire d'yeux
et je salue.
La salle vide à en étouffer pleure.
Ah les pleurs unanimes !
(Mon dernier corps)
La poésie de Kiki Dimoula ne ressemble à rien de connu. Qui d'autre qu'elle oserait écrire, par exemple, un long poème sur la lutte entre la ménagère et la poussière ?
Ses sujets sont parfois infimes — on a même soutenu qu'il n'y a pas de sujet, sinon le néant. «L'unique thème de Dimoula, écrit Nìkos Dìmou, c'est le passage — progressif ou soudain — de l'être au non-être. Ce passage qui s'appelle temps, usure ou mort.» Avec aussi, en sens inverse, ce retour provisoire et frappé d'impuissance qu'est le souvenir.
On est d'abord frappé, en lisant Dimoula, par sa pensée fine et méandreuse, par la présence massive d'entités abstraites personnifiées ; on peut la juger spéculative, cérébrale — avant de sentir qu'elle est l'une des plus concrètes et incarnées qui soient. Le poème ne perd jamais de vue la réalité la plus tangible : les objets y acquièrent une vie intense, presque angoissante, regardés ainsi à travers les verres grossissants des métaphores, qui se chassent l'une l'autre, souvent, à une allure vertigineuse.
On peut tout de même trouver une famille à Dimoula : les Metaphysical poets du XVIIe siècle anglais (Donne, Herbert, Marvell) ou, plus près de nous, Emily Dickinson, chez qui spéculation et sensation, tout naturellement, ne font qu'un. Autre point commun entre elle et eux : la dimension tragique. À cela près sans doute qu'il y a chez Dimoula — comme chez les poètes précités — trop de lucidité, d'humilité, de pudeur pour laisser la tragédie s'installer en grande pompe. Le tragique, ici, est sans cesse accompagné, miné par un humour étrange, teinté de dérision, qu'il sabote à son tour : tous deux avancent bras-dessus, bras-dessous, dans une débauche de crocs-en-jambe sournois.
Ultime paradoxe : ce poète de l'angoisse, du repli, est aussi l'un des plus audacieux dans l'expression, bousculant allègrement, s'il le faut, vocabulaire et syntaxe — ce qui ne fait que renforcer l'impression qu'on a toujours, chez Dimoula, d'avancer sur des sables mouvants.
Kiki Dimoula, née en 1931, a publié neuf recueils, dont Le peu du monde (1971), Mon dernier corps (1981), Je te salue Jamais (1988) et L'adolescence de l'oubli (1994). Elle a reçu deux fois le Prix d'État de poésie. Je donnerai ici en douze mois douze poèmes tirés de Mon dernier corps, que j'avais publiés il y a dix ans dans mes Cahiers grecs première formule — pratiquement hors commerce — pour une poignée de lecteurs.
 Kiki Dimoula. |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles.
Pour que les fleurs sentent bon, il faut sans doute que le jardinier sente mauvais.
Dans cet immense piège où succombent les éléphants, les souris vivraient fort à l'aise.
Ce n'est pas celui qui tient la lampe qui voit le mieux le chemin qu'il éclaire.
Pour moi, il n'y a que des miracles.
On rêvait d'un mois d'août à l'ancienne, vautré dans les bouquins. On avait oublié la tradale en retard, quelques pages qui supplient qu'on les écrive, cent mille paperasses à classer avant la rentrée, ce putain de site à alimenter... Résultat : un été presque sans lecture !
Tout de même, on ne peut pas sauter l'étape rituelle en Dhôtelland.
Dans la bibliothèque d'attente, dix volumes de Dhôtel, de quoi voir venir. Je les contemple comme d'autres dans leur cave bien remplie les vins ou les bûches pour le feu.
Choisi cette fois un opus rare : Les voyages fantastiques de Julien Grainebis, fraîchement réédité chez Horay. Qui a dit que notre homme écrivait toujours le même livre ? Celui-ci, quoique dhôtellissime, est très étonnant par l'extravagance tranquille de l'histoire (avec incursions, pour une fois, dans le merveilleux déclaré), le tempo allègre comme jamais, le sourire malicieux, toute une joyeuse folie diffuse. Juste après son fameux Pays où l'on n'arrive jamais — son livre sans doute le plus facile et qu'il aimait le moins —, Dhôtel s'est offert cette récréation, cette divagation, explorant des sentiers plus secrets.
Le public, évidemment, n'a pas marché.
Dans l'avant-propos, l'une des pages les plus dhôtelliennes de toute l'œuvre, je pêche cette phrase toute simple qui la résume si bien :
«...Il lui semblait qu'à chaque instant une fissure allait se produire et faire éclater une lumière qui transformerait tout sans que rien soit touché à l'ensemble des choses de la vie et des travaux auxquels il participait modestement.»
(Notez bien, pas une seule virgule !)
Honte à moi, je n'ai pas encore lu Cabinet portrait de Jean-Luc Benoziglio (Points-Seuil), qu'on dit si drôle. Je n'avais même rien de lu de ce recommandable auteur avant son dernier roman, Louis Capet, suite et fin (Seuil aussi). L'auteur nous y révèle que Louis XVI n'a pas été guillotiné, mais exilé incognito dans un village des bords du Léman. Nous assistons aux relations difficiles entre le roi déchu et les villageois. L'infortuné souverain subit tout un chapelet d'avanies, de quoi fendre le cœur des républicains les plus rudes, et pourtant Benoziglio nous fait sourire en coin d'un bout à l'autre. C'est qu'il est Suisse, le bougre, ou plus précisément Vaudois, et ça se voit. Je sais de quoi je parle, j'ai des racines là-bas, et je retrouve dans le petit bijou que voici tout l'humour aussi délicieux que discret de ma famille des bords du lac — un humour trop fin, souvent, pour bien des lourdauds hexagonaux...
 Louis Capet à Saint-Saph' |
Chouette ! Je suis invité à Genève, le 24 septembre, par la librairie du Rameau d'or (17 boulevard Georges-Favon) pour parler des jardins en compagnie de deux auteures suisses, Catherine Safonoff et Corinne Desarzens, dont je viens de recevoir les livres et que je me réjouis de découvrir : ce que j'ai feuilleté en ouvrant le paquet m'a paru très alléchant.
À propos de jardins, un souvenir magique : Le jardin des Finzi-Contini (Folio) de Giorgio Bassani, lu dans ma jeunesse. Les lunettes d'or (Folio), recueil de nouvelles du même, en est le prolongement. Même lieu, même époque : Ferrare à l'époque fasciste, avant et pendant la guerre. Vie de province étriquée, lâchetés petites et grandes, haine, intolérance, le fascisme tel un cancer. Victimes diverses : juifs, homosexuels, gens de gauche... L'éternelle histoire de types ordinaires qui deviennent des salauds, ou (moins souvent) des héros. La mélancolie colle à la peau et le charme bassanien, tout en phrases longues et sinueuses, résiste vaillamment à une version française en semelles de plomb.
Toutes les trois lignes j'ai envie d'intervenir, de couper, redistribuer, polir ce brouillon de traduction. Je me console en pensant qu'à l'époque j'avais lu le travail du même traducteur sans broncher. Mon oreille se serait donc affinée en trente ans ?
Les années troubles, encore, avec Les lauriers du lac de Constance de Marie Chaix (Points-Seuil). L'auteure, née au début de la guerre, était la fille d'un collabo notoire, bras droit de Doriot, dont l'ascension et la chute forment l'épine dorsale du récit.
En fait, je n'ai pas ouvert ce livre pour un voyage de plus au temps de l'Occupation, mais par curiosité verbière, souhaitant découvrir une écriture dont on m'avait dit le plus grand bien. De ce côté-là je ne suis pas déçu, j'ai fort goûté la maîtrise et l'invention de cette prose, mais j'avoue que l'histoire, fascinante, m'a plus d'une fois fait oublier (bel exploit !) la petite cuisine du style.
Piliers de ce livre, quelques portraits saisissants : Doriot lui-même, force de la nature, géant terrifiant et charmeur ; le grand-père, tyran traditionnel, admirable et odieux ; le père fourvoyé, un peu embelli sans doute. La grande force de l'auteure est dans sa faiblesse — l'impossibilité, pour cette femme de gauche née à droite, de condamner ou d'absoudre. C'est cet équilibre oscillant de bout en bout, ce frémissement contenu, qui s'imprime dans la mémoire, apportant à la fois douleur et apaisement.
Si nous restons hantés par ces temps lointains, c'est sans doute moins par complaisance malsaine que pour nous regarder en face, dans un miroir où apparaît mieux que jamais l'être humain dans son ambiguïté, sa fragilité, son vacillement entre chien et loup.
J'avais lu (cf. PE 22) Les décombres de Rebatet, collabo parmi les plus immondes, avec une tenace envie de gerber. Je suis entré dans la bio du salopard pour essayer de comprendre à défaut d'excuser. Lucien Rebatet, un itinéraire fasciste, de Robert Belot (Seuil) est une étude précise, lucide, sans hargne inutile, mais accablante : Belot n'a rien trouvé qui rachète la petite ordure. Le salaud intégral. Loup hurlant tant que ses potes ont le pouvoir ; queue entre les jambes dès que le vent a tourné. Je scrute sa photo, sa petite gueule de bouledogue prêt à mordre, comme si ce faciès allait me donner la clef... Tout est pourtant analysé, démonté, on suit pas à pas le processus qui mène au monstre, et malgré tout l'énigme subsiste : comment un être pareil a-t-il pu exister ?
D'Olivier Assayas, je connaissais surtout deux de ses films les plus récents : Les destinées sentimentales, d'après un roman de Chardonne, très belle adaptation, très beau bal genre Guépard, presque digne de Visconti ; et Clean, excellent travail aussi, images superbes évoquant Bergman, Antonioni, presque dignes d'eux... Sans doute suis-je affreusement injuste : pourquoi ces deux films d'un de nos meilleurs metteurs en scène, dont la cinéphilie me va droit au cœur, me laissent-ils vaguement insatisfait ?
Un peu trop clean ?
Puis je vais voir Irma Vep, l'histoire d'un réalisateur d'aujourd'hui qui doit tourner un remake des Vampires de Feuillade. Film sur un tournage raté, sur l'impossibilité de filmer, très amer, très violent — quoique sans un seul coup de poing. Un bouillonnement de fébrilité, de colère, qui vient glisser sur le sublime visage lisse de la star chinoise (Maggie Cheung) débarquée dans cette nef des fous. Film réalisé avec trois sous, dit-on, dans des conditions acrobatiques, mais d'une habileté, d'une richesse étourdissante, à la fois nécrophilique (défilé de fantômes, Musidora, Léaud, Lou Castel ...) et animé de ce tremblement mystérieux qui manque aux deux autres.
Le seul ennui, c'est que ce film de 1996 leur est antérieur...
Bonheur de voir Irma Vep à la Vidéothèque des Halles, lieu magique à l'écart des foules, sans pub et sans popcorn.
Les vampires de Feuillade, tournés quatre-vingts ans plus tôt, c'est là aussi que je les avais vus, en quatre séances (dix heures de film !), dans une salle minuscule. Nous n'étions pas plus d'une dizaine. Au fond, un clodo ronflait. On sortait de là comme d'un sommeil agité, hanté de rêves délirants. Une de mes plus fortes aventures de cinéma. Drôle, tout de même, que ce bricolage primitif puisse tenir tête à l'œuvre raffinée d'Assayas. Et chapeau encore à celui-ci, d'avoir réussi à inclure dans son film une scène de Feuillade sans que ce matériau radioactif le fasse tomber aussitôt en cendres...
 Irma Vep échappera-t-elle au journaliste Guérande ? |
Chaque été, la Quinzaine littéraire consacre un numéro entier à un thème. Cette année : L'envie de lire. Ensemble d'une richesse exceptionnelle, d'où j'extrais, entre autres splendeurs, une lecture mot par mot du «Cantique de saint Jean» de Mallarmé par Lucette Finas, une charge réjouissante par Maurice Mourier sur l'enseignement actuel du français et de fort sympathiques souvenirs d'enfance de Gilles Lapouge.
Autre lecture accélératrice de neurones : une série d'articles du Monde sur ce que sera notre vie dans trente ans.
Prudence : je me souviens nettement d'un article d'anticipation paru en 1955 dans un magazine pour les jeunes : en 2000 les voitures se déplaçaient toutes seules, mais les ordinateurs n'existaient pas... N'empêche, les prédictions du Monde font frissonner — d'impatience ou de peur, selon.
Ils n'ont oublié qu'une chose : les pannes. Dans tous ces futurs imaginaires, tout est neuf et fonctionne au poil. Qu'est-ce qu'on parie : la panne est éternelle. Nos machines de plus en plus complexes portent en elles des milliards de gaffouillages potentiels. À preuve mon expérience personnelle, celle d'un homme qui vient de quitter son PC pour un Mac tout en gardant son abonnement à Internet. Je viens de passer quelques journées de pur cauchemar à tenter de communiquer avec le service d'assistance Wanadoo. In Wanadoo did Kubla Khan a torture dome decree... Si vous faites des enfants, chers volkonautes, n'oubliez pas : plus une famille ne peut survivre sans un informaticien et un plombier...
Cet été, il y eut tout de même de très bons moments. Certaines rencontres, par exemple, avec des revenants. Carole et moi avons revu ce cher Samuel Bryght (cf. «I love Jesus» dans MES ÉCOLES), disparu pendant trente-trois ans. D'autres encore ont refait surface, et ce n'est pas fini...
Jamais déçu par ces rencontres, au contraire — mais quelles surprises parfois !
Oui, la vie est un roman.
Et voici la rentrée des classes, juste avant qu'on commence à s'ennuyer.
Rentrée politique aussi.
Enhardis par leur triomphe de mai, certains casseurs d'Europe — pardon : certains altereuropéens — s'en prennent à ce symbole maudit de l'horreur néo-libérale : l'euro. Je leur dis, fort bien, mais ne vous arrêtez pas là ! N'oubliez pas que les nouveaux francs sont une pernicieuse invention gaulliste ! Encore un effort, camarades, virez-les, afin qu'Arlette puisse de nouveau, comme à la grande époque, faire son marché en anciens francs !
En octobre, sur volkovitch.com, on ira du côté de chez Proust ; on jouera avec les pronoms relatifs ; on aura une tendre pensée pour ces dames qui enseignèrent au lycée Claude-Bernard jadis ; on verra l'auteur de ces pages pratiquer l'automutilation (sans douleur, au contraire !) ; on lira des pages du prosateur grec Mènis Koumandarèas ; les pubs seront plus que jamais d'une révoltante nullité.
BALANCE. Du 24 septembre au 23 octobre.
Que les planètes soient favorables ou non, dites-leur merde et partez rouler.
Au retour, lisez, relisez Besoin de vélo de Paul Fournel (Seuil).
«Le vélo est un coup de génie.» «Le vélo commence toujours par un miracle.» «Dès que j'ai su pédaler j'ai eu l'idée d'un monde plus grand. Lorsque je partais faire un tour, tout ce qui était à l'intérieur du tour était chez moi.» etc. Des régals pareils sur plus de 200 pages, c'est ce que vous offre cet ouvrage de chevet. S'il vous a plu, sautez sur «Le crack», texte bref tiré d'un autre délice : Les athlètes dans leur tête, du même Fournel (Points/Seuil).
Et puis méditez bien, surtout avant d'aller pédaler en ville, cette profonde maxime fournellienne :
«Chaque cycliste, même débutant, sait qu'à un moment ou un autre de sa vie il aura rendez-vous avec une portière de voiture.»
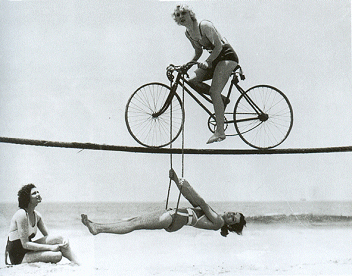
|