
La tour au trésor.
PAGES D'ÉCRITURE
N°24 Août 2005
Agathe et Zoé, dix-sept ans, deux anciennes élèves de la section arts plastiques, m'avaient invité à leur expo de peinture. Elle se termine ce soir. J'ai promis, j'irai, malgré le boulot qui déborde.
C'est au fond d'Issy-les-Moulineaux. Vélo en panne, j'irai à pied. Dimanche matin, bord de Seine en ruines, chantiers, palissades, rien que du moche et c'est bien ainsi : marcher, dans des lieux ingrats surtout, sans les séductions de la vitesse et de la beauté, c'est se frotter humblement à la terre, se replier sur l'essentiel, ce plaisir élémentaire de bouger. Le dénuement rend léger lui aussi, me dis-je en attaquant le mauvais raidillon sans voitures, entre un mur et un talus d'herbes folles, qui monte vers le plateau.
Lieux inconnus. Là-haut, derrière un fouillis banal de maisons et de petits immeubles, une immense tour blanche — celle qu'on voit de partout sans savoir d'où elle sort. C'est là mon but : au rez-de-chaussée, un local minimal, prêté aux deux filles pour le week-end. Elles attendent sagement, seules au milieu de leurs toiles. Que je sois venu sans voiture les étonne. Comme si les sommets n'étaient pas plus beaux d'être atteints à pied. Il faudrait toujours aller ainsi, en pèlerin, s'élever lentement, recevoir en arrivant fourbu l'aumône des belles images, comme d'autres le pain et l'eau fraîche.
Un peu intimidé, comme elles. Je crains de ne pas aimer, d'être obligé de blesser ou de mentir, mais dès le premier coup d'œil, tandis que dehors la pluie qui m'avait épargné reprend, j'oublie mon inquiétude. J'aime leurs tableaux. Je m'y sens bien. Je serai incapable de les décrire une fois parti, je garderai d'eux un souvenir aussi flou que l'impression fut forte, mais c'est sans doute, mystérieusement, bon signe. Comme s'ils s'étaient dissous en moi, telles les images de certains rêves, pour mieux m'imprégner. Je crois me souvenir des matériaux, bouts de photos, papiers, clous, boutons, découpages, collages, coloriages, toute une petite cuisine souriante, avec en même temps l'enfance et la science, l'art et la fraîcheur. Je ne suis pas fort en hiérarchies, je sais de moins en moins ce que c'est, un Chef-d'Œuvre, un Grand Artiste ; je sais que ces travaux d'apprenties m'auront davantage parlé, stimulé, enrichi que certaines toiles célèbres.
Elles n'ont invité à part moi qu'un autre prof, qui ne viendra pas. Je les complimente en me freinant un peu, trop louer peut faire du mal. En leur disant le plaisir qu'elles m'ont donné, je lis dans leurs yeux celui que j'apporte. Nous nous sommes fait mutuellement un cadeau. Nous avons joué une petite Épiphanie bancroche : un roi mage esseulé, deux enfants lumineux au lieu d'un.
Reste à redescendre dans les odeurs d'après-pluie, laissant derrière moi la tour que j'appellerai désormais le château d'Agathe et Zoé, et qui pendant deux jours, à son pied, comme l'arbre des contes, a caché la marmite aux pièces d'or.
(Journal infime, 2001)
 La tour au trésor. |
L'été dernier, À travers le miroir. Cet été, Persona. Tous deux tournés par Bergman sur son île de Farö dans les années 60. Deux de ses films les plus tendus, les plus sombres, deux de mes plus lumineux souvenirs de cinéma. Jamais revus.
Abordé sur l'île avec le trac. Eh bien non seulement les deux films tiennent le choc, mais ils m'apparaissent encore plus beaux, plus jeunes. Je suis sans doute moins bluffé qu'à l'époque par le bric-à-brac du prologue dans Persona, où j'ai l'impression que le metteur en scène, de façon géniale, fait tout de même un peu son malin. Le reste : prodigieux. La scène de nuit dans Persona, entre extase et horreur, où Liv Ullmann s'approche du lit de Bibi Andersson endormie, est d'une beauté non terrestre. Le noir et blanc, aujourd'hui rare, étrange, qui change les personnages des vieux films en fantômes, rend la scène encore plus troublante qu'alors.
Ce que je n'avais pas bien vu à l'époque, c'est la fidélité de ce cinéma — éternellement d'avant-garde par ailleurs — aux racines de son art, à l'époque fabuleuse du muet. Le côté bricolage : on peut faire le plus beau des films en décors naturels, avec une équipe réduite et deux ou trois acteurs. Une caméra tranquille, des plans longs et simples, des gros plans à l'ancienne. Le noir et blanc juste avant l'invasion de la couleur, dans sa splendeur ultime, incandescent. Pureté, dépouillement absolus. Tout droit vers l'essentiel. Combien de nos gentils films récents soutiendraient la comparaison ? Si anodins, pour la plupart — même et surtout les plus gesticulants, caméra excitée, montage hystérique.
Je suis sévère sans doute. Il existe sûrement, aujourd'hui encore, un cinéma audacieux, inventif. C'est moi qui ne sais plus le voir, atteint que je suis de presbytie intellectuelle, comme tous les esprits déclinants.
(Journal infime, 2002)
 Alma : Je voudrais être comme toi... |
Au mois de mai dernier, la Société des gens de lettres organisait à Paris un forum sur le thème : Existe-t-il un français des traducteurs ? La question surprendra seulement ceux qui n'ont jamais traduit, ou jamais lu de traduction...
Nous étions ce jour-là, je pense, tous d'accord : oui, la langue d'un livre traduit est différente, plus ou moins, de celle d'une version originale ; quant à savoir si cette langue de traduction est plus pauvre ou plus riche ou simplement autre, nos cinq heures de débats n'ont pas suffi pour apporter une réponse.
Plus pauvre ! gémissent nombre d'entre nous. Le traducteur pratique un français rétréci, pour deux raisons au moins. D'abord, il tend à n'utiliser, dans la langue cible, que les formes correspondant à celles de la langue source, si bien que des pans entiers de sa langue à lui restent inexploités. Ensuite et surtout, il se sent surveillé par l'éditeur, vu comme un défenseur du «beau langage». Les vétérans racontent qu'autrefois les directeurs de collection censuraient pudiquement, dans les traductions, toutes les tournures trop familières, ou inhabituelles, au point que la grande majorité des traductions se retrouvaient rédigées dans le même idiome allégé, dit français d'éditeur, ou français de Saint-Germain-des-Prés, en tous points correct et fade à proportion. Sans doute agissaient-ils de même, à vrai dire, avec les auteurs français peu connus, mais les Céline ou les Queneau, eux, étaient respectés. Un auteur violant la syntaxe passait alors pour inventif, et un traducteur faisant de même pour un ignorant. Aujourd'hui, s'il existe encore dans l'édition quelques mammouths rescapés de cette ère glacière, la corporation a fait, dans l'ensemble, de sympathiques progrès ; pour ma part, si j'ai parfois surpris mes relecteurs, j'ai réussi presque toujours à les convaincre. L'ennemi, désormais, est plutôt en nous-même, dans notre touchante humilité, notre admirable discrétion qui nous incitent à l'autocensure.
Et même, parfois, dans notre propre savoir-faire !
Le traducteur, en effet, est amené naturellement, dans ses débuts du moins — par désir de s'exercer, de bien faire, de démontrer son adresse, ou simplement emporté par son élan — à tout transposer, même ce qui pourrait ne pas l'être, dans un accès de ciblisme exacerbé. Le second stade de l'apprentissage consiste à lutter contre sa propre habileté, à laisser parler davantage la langue étrangère dans la nôtre — et c'est là que notre français a des chances de s'enrichir.
Le traducteur peut ainsi élargir sa langue de deux façons. Par erreur d'abord, en calquant maladroitement une tournure étrangère ; le résultat a de fortes chances d'être moche, mais on connaît des exceptions, j'ai même rencontré des pataquès heureux ! On peut aussi, et c'est préférable, agir en toute lucidité, en important un mot, une tournure inusitée chez nous. Reste à savoir dans quelle mesure.
La stratégie, pour moi, varie selon les textes. Une page écrite dans un grec très pur, très sage, appellera un français classique. Un texte hardi, violent, demandera une traduction plus sourcière, plus aventureuse. Mais je crois que nous devons veiller, en traduisant, à toujours écrire notre langue avec un léger accent, une claudication infime. Ma traduction doit proposer un français légèrement décalé, pour cette simple raison : l'original lui aussi, pour peu qu'il vienne d'un véritable écrivain, fait entendre une langue inouïe.
«On ne m'a pas élevée dans l'eau de rose», dit le grec. «Dans du coton» ? Ce serait l'équivalent exact, mais la version littérale, tout aussi explicite, a plus de fraîcheur.
«Traînant de lourdes pensées...» Tournure banale en grec, assez insolite en français. Je transpose d'abord : «accablé par ses pensées», puis je retourne au mot-à-mot : plus concret, plus visuel. J'ajoute là un relief inexistant dans l'original ? J'ai si souvent aplati ailleurs, cela compense...
Désormais, chaque fois que je peux, je n'adapte pas les proverbes. «Ventre affamé n'a pas d'oreilles», bien usé, cède la place à «Têtes fâchées, panses rabibochées.» «Feu vu de loin ne brûle pas», disent les Grecs. Je bricole simplement pour donner à la chose, par le rythme et l'assonance, le claquant d'une formule : «Feu vu de loin ne brûle pas les mains».
La ponctuation étrangère déteint aussi sur moi. Le tiret me fascine, le tiret m'enchante, l'usage que l'anglais en fait (en simple ou en double) me donne des idées, et tant pis pour les puristes qu'il incommode : je m'arroge le droit d'enrichir ainsi ma trousse à outils.
L'antéposition du verbe ou de l'adjectif, plutôt rares chez nous, semblent gagner du terrain. Est-ce dû à des traducteurs (paresseux ou conscients ?), ou à des auteurs imprégnés par des lectures anglaises ? Peu importe, c'est de toute façon une bonne nouvelle : le français s'assouplit, nous pouvons jouer avec l'ordre des mots, ce paramètre si important, de façon plus variée, plus expressive.
Lors de la table ronde, j'ai cité ce bout de phrase d'un confrère : «un joyeux, nerveux langage». Il y a dans cette inversion, ai-je plaidé, quelque chose de nerveux, justement, de joyeusement insolite, ça prend à rebrousse-poil, ça réveille. J'ai entendu quelques dents grincer. Moi-même, par moments, suis encore un peu effarouché. Mais qu'est-ce qu'on parie ? Dans vingt ans cela passera tout seul !
Des soldats sont encore de retour
après des batailles perdues
des soldats sont encore de retour
après des batailles gagnées
ils retournent et ils tournent
comme un disque
ils ramassent les rêves au coin des rues
y mettent le feu
des cheveux pendent encore et des soleils blanchis
l'un après l'autre tombent en craquant
des lunes soudain sont trouées de l'intérieur...
(des lunes — ai-je dit — pas des cadavres)
...et il en sort des têtes
voici une tête, mon amour, c'est la tienne
depuis combien d'années je ne l'avais vue
voici une lune, mon amour, c'est la tienne
depuis combien d'années je n'ai pas tenu sa main
maintenant les lunes n'ont pas deux
n'ont pas cinq ou cent
ou mille mains
mon amour a disparu
avec les soldats fatigués
les soleils
les lunes
un cœur-aiguille
comment peut-il courir sur un disque
brisé
brisé
brisé
depuis des milliers d'années
Dans mon tombeau
je marche angoissé
de long en large
de large en long
j'entends hurler
les choses qui m'entourent
idées-voitures
voitures-idées
des gens passent
ils parlent, rient
de moi
ils disent des vérités
ils disent des mensonges
sur moi, sur moi !
Je leur crie Non
ne parlez pas
de mes amours mortes
elles se réveilleront
elles vous crèveront les yeux !
(Blessures de couleurs)
Ils sont pleins de courage, mais ils pleurent
et croient comme les petits enfants
ils portent des haillons
des costumes de prix
ils vivent dans des villas ou des jardins
ou dans une pièce obscure
les uns errent dans des rues de terreur
d'autres pendus aux barbelés flottent au vent
d'autres enfermés en prison
tous ils peinent et transpirent
ils ratent, ils réussissent ou
pensent qu'ils ratent ou
pensent qu'ils réussissent
le démon toujours les assiste
il soulève le canon de son fusil
et les vise
en plein cœur
(Ectoplasmes)
(réponse sur le numéro de la citation...)
Le mal est sans doute un bien dont les résultats ne se manifestent pas immédiatement.
Le malheur, ma fille, n'est pas d'être méprisée, mais seulement de se mépriser soi-même.
Il faut tout un village pour élever un enfant.
Si l'univers a quelque chose à nous dire, il attend que nous soyons seuls.
Qu'importe notre lâcheté, s'il y a sur la terre / un seul brave, / qu'importe la tristesse s'il y a eu dans le temps / quelqu'un qui s'est dit heureux...
Corvée de l'été : les voyages.
Ouf ! Cette année encore, dispensé. Bonheur de rester chez soi, dans une banlieue tranquille, en compagnie d'une grosse pile de bouquins et d'un nouvel ordi qu'on apprivoise peu à peu.
Si l'on bouge, c'est à vélo, en solitaire ou à deux, dans la fraîcheur des forêts d'Île-de-France.
Petit voyage tout de même, dans le temps, pour dire adieu à Claude Simon.
Novembre 85. Les traducteurs ont invité l'écrivain à leurs Assises d'Arles, sans savoir que juste avant on lui collerait le Nobel — cette épreuve terrifiante. L'impétrant est un petit homme hagard, muet, harassé par quinze jours d'interviews non-stop, qui paraît plus fluet, plus accablé encore entre les solides gaillards qui le traduisent, aux discours non moins costauds. Dans les vingt années qui suivront, nous verrons peu de tables rondes aussi denses que celle-ci.
(Tu peux le vérifier, volkonaute, en parcourant les très riches Actes des Assises, publiés chaque année par Actes Sud.)
Les romans de Claude Simon, j'avoue que parfois ils me donnent du mal. Pas encore prêt pour affronter, entre autres, le redoutable Géorgiques... Mais La route des Flandres, mais L'acacia, mais Le jardin des plantes, quels grands et splendides moments ! La réalité décrite, analysée avec une minutie extrême, et en même temps saisie dans toute son épaisseur. Miracle d'un corps qui serait à la fois découpé en fines rondelles et totalement vivant. D'un monde qu'on aurait mis à distance pour mieux le voir et qui en même temps nous colle à la peau. Nous submerge.
À mes apprentis traducteurs de Charles V je lis chaque année un passage de La route des Flandres : une phrase, une seule, celle qui raconte une course de chevaux d'une seule traite, sur huit pages, à la fois galopante et immobile, temps débridé, temps arrêté — moment d'une intensité prodigieuse, entre des dizaines d'autres.
Lire des histoires d'école, en pleines vacances ? Pourquoi pas, quand pour vous l'école est un lieu aimé, et quand le bouquin est signé Catherine Henri. J'avais fort goûté Un professeur sentimental (Pages d'écriture n°21). Avec De Marivaux au Loft (P.O.L), publié précédemment, même formule, même réussite. Pas de grands discours, de théories rutilantes, mais des chroniques toutes simples au fil des jours, racontant comment une enseignante passionnée se démène pour faire aimer Apollinaire ou ne serait-ce que Dumas à des jeunes qui parfois n'en ont que faire, croient-ils.
J'ai déjà dit tant de bien de ses livres que je m'en vais cette fois l'égratigner gentiment sur des broutilles.
«Comme je conserve cette navrante propension chrétienne à l'examen de conscience et à la culpabilité...»
Chrétienne ou pas, chère amie, je vous supplie de la conserver, cette «navrante propension», qui a fait de vous l'admirable prof que vous êtes. (Curieux, cette pudeur qui nous retient d'avouer que nous avons une morale — comme si l'exigence morale, chez tout être pleinement humain, ne naissait pas en même temps que la pensée !) (Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit une connerie ?)
«Je ne pense plus, comme tout khâgneux, que la vie est faite pour aboutir à un beau livre...»
Est-ce vraiment là un idéal puéril ? Heureusement la fin du paragraphe me va droit au cœur, évoquant «l'intrication serrée, la contagion réciproque de la vie, des images et des livres» qui est la raison d'être du présent site.
Cette Catherine Henri dont la lecture fait tant de bien, pas beaucoup entendu parler d'elle dans la presse...
Je ne connaissais le peintre Albert Marquet que par une vue de Paris grise et lourde attristant la couverture du Lagarde & Michard XXe siècle. Pas de quoi inciter à fréquenter le monsieur. Cet hiver j'ouvre le catalogue d'une expo récente (Marquet, vues de Paris et de l'Île-de-France, Paris Musées) et là, sous mes yeux, les masses deviennent vaporeuses, la grisaille se met à vibrer, ça vacille entre Cézanne et Monet... Me voilà conquis, mais quand je rouvre l'album après quelques semaines, plus rien. Depuis, selon le moment, les toiles de Marquet, reprenant sans fin les mêmes motifs parisiens (ressassement poussif ou héroïque acharnement ?), me chuchotent des choses ou restent muettes, passent du mastoc au raffiné, de l'anodin à l'intense avec une prestesse dont je la croyais incapable.
Comme j'envie ceux qui savent toujours ce qu'ils aiment !
Comme je les plains !
C'est un infime détail qui plus que le reste m'attache à Marquet : ses personnages dans la rue, réduits à de fines silhouettes noires. Presque fourmis, quasi fantômes, au bord de l'effacement. Et pourtant la vie est là, en eux, qui frémit.
 Porte de Saint Cloud, 1902. |
Les livres de Frédéric Pajak (cf. Pages d'écriture n°17) ne sont pas comme les autres. Un volume épais, de grand format ; à chaque page, un dessin et du texte ; des sujets insolites, la façon de les traiter plus encore.
Dans L'immense solitude, parue en 1999 chez PUF, trois personnages : Nietzsche, Pavese et la ville de Turin où tous deux souffrirent. Plus un quatrième, proche parent des précédents et de l'auteur : la Mélancolie. Pas de narration organisée : Pajak suit le fil de sa rêverie. D'habitude un livre avance comme une route ; les siens sont des sentiers enchevêtrés, pleins de tournants, d'impasses, de raccourcis, de ponts inattendus. Des dessins aux textes, là encore, flottements, frottements, balancements et bien du bonheur en chemin, malgré ce sujet si noir — solitude, suicide, folie... La mélancolie, nous dit-on, est parfois «langoureuse, extatique», et quelle douceur d'apprendre chez Pajak une aussi libre et souple façon de lire.
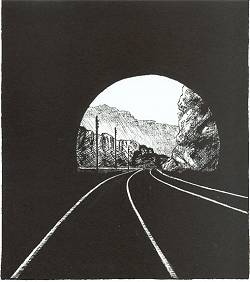 Un chant merveilleux d'une mélodie vraiment étrange... |
C'est un lecteur compulsif, un gribouilleur acharné de petits carnets. Il pratique intensément le sport. Il habite près de chez moi. Son nom rime avec le mien. Et si cela ne suffisait pas pour nous rapprocher, lui aussi écrit des livres inclassables, entre autobiographie, enfilage de citations et essai, où les livres et la vie se renvoient sans arrêt la balle. Rien d'étonnant à ce que je lise Denis Grozdanovitch avec une intensité particulière, à ce que j'apprécie les beaux coups de ce tennisman en connaisseur, à ce que je l'engueule parfois, trop sévèrement, comme un autre moi-même.
Son opus 1 s'appelait Petit traité de désinvolture, j'en ai dit beaucoup de bien dans Pages d'Écriture n°6. Avec le second, Rêveurs et nageurs, toujours chez Corti, ça me le refait : je peste un peu ici ou là contre un échange qui traîne, un adjectif dans le filet, mais ce type est un vrai félin, lent, nonchalant et puis clac, volée de revers, il nous balance un paragraphe de rêve, jeu, set et match !
Page 28 : Grozda, qui cherche à démolir Cioran, après deux ou trois balles pétouillées, aligne plusieurs aces d'anthologie qui laissent l'adversaire écrasé... Page 124 : hommage à la cinémathèque de Chaillot qu'on n'a jamais aussi bien racontée... Tout un chapitre admirable sur la présence des morts... Pages new-yorkaises étonnantes... Ahurissants personnages, histoires fabuleuses, présentées comme vraies, quoique incroyables, va savoir...
Peu de lectures font autant frétiller mes vieux neurones.
Mon livre de chevet : les œuvres de Cioran réunies dans un gros volume Quarto Gallimard. Le pavé trône sur ma table de nuit depuis cinq ans sans que j'arrive à y entrer. Au bout de quelques pages, accablé, je flanche. Notre monde apparaît là si sombre, si nul ! la moindre action si vaine ! Ce déluge de sarcasmes froids, systématiquement sinistres, j'en devine d'avance la suite ressassante ; j'ai lu Cioran jadis, j'ai même admiré ses Exercices d'admiration (nettement plus positifs que le reste), mais m'enfoncer à nouveau dans cette jungle désertique, dans ces noires galeries que seul éclaire le brillant d'un grand style glacé, non, plus le courage.
(Tout Cioran d'un coup, est-ce une bonne idée ? Cette lourde brique pour faire savoir que la vie, c'est du vent ? Ne faudrait-il pas le consommer, ce concentré de poisons, par petites doses, feuille par feuille, aussitôt envolées ?)
Flash-back. Années 60 : la fille que j'aime tombe dans les bras d'un mec plus âgé qu'elle et moi, un intello fan de Cioran qui la bassine avec le Précis de décomposition et autres manuels de nihilisme chic. Le seul nom du bilieux Emil produit alors en moi des crises d'urticaire, dont les effets atténués me démangent encore, dirait-on. À quoi tiennent parfois nos raisons d'aimer ou non un auteur...
Hugo, lui, je lui pardonne tout, pour un tas de raisons. L'homme, à cause de son parcours exemplaire, à contre-courant, de droite à gauche. L'écrivain, à cause des Misérables, dont les personnages me tiennent compagnie depuis l'enfance, plus réels que bien des êtres de chair ; à cause aussi de tous ces poèmes lus à l'école, appris par cœur, clinquants et grandiloquents parfois, mais dont le grand souffle fou balaie nos petites gloses raisonnables.
Cette façon qu'il a de joindre le pire et le meilleur, les réussites les plus sublimes et les ratages les plus grandioses, la lucidité la plus fine et la plus abyssale naïveté, sur une même page parfois, j'en arrive à l'apprécier, à y voir une part de son génie. De ce point de vue son roman L'homme qui rit est l'un des sommets de son œuvre. Il y a là ses plus longs tunnels, d'une hallucinante nullité, suivis des éclairs les plus fulgurants. On pourrait faire de cette histoire hirsute, qui bave sur cinq cents pages, une longue nouvelle cinq fois plus courte, bien dense, mais on y perdrait la démesure, le déferlement, la démence.
Pas très tendance, le vieux. J'entends ricaner dans son dos. Trop immense, insaisissable, mystérieux...
On veut tout de même un vrai livre de vacances ? Quelque chose de souriant, avec des voyages, du soleil ? C'est René Depestre qu'il nous faut, et son Eros dans un train chinois (Folio). Chine, Brésil, Japon, Yougoslavie, Haïti, ça ira comme ça ? Au menu, neuf récits, neuf aventures amoureuses dont une veste et huit parties de jambes en l'air somptueuses, contées de façon gourmande et galopante par un homme doté d'«un insatiable appétit de bonheur». Tout cela joyeux, luxuriant, pétant de santé, mais sans aveuglement : certaines allusions aux malheurs du monde, à l'arrière-plan, rappellent que tout ce bonheur, loin d'être acquis, reste toujours à conquérir, toujours menacé.
My summer of love. Petit film anglais. Trois personnages, presque rien : deux adolescentes qui s'aiment, le frère de l'une d'elles qui pique sa crise mystique. Dès les premières images, on le sent, il se passe quelque chose de rare. Ce village paumé, rugueusement réel, a en même temps les couleurs d'un conte de fées. Le metteur en scène inconnu, Pawel Pawlikowski, maintiendra jusqu'au bout ce miracle, s'appuyant sur un scénario subtil et deux jeunes actrices parfaites, évitant tous les pièges, touchant même aux sommets dans quelques scènes, pures merveilles toutes simples. Voilà une humble musique de chambre qui résonne en moi plus profondément, plus longuement que certaines symphonies colossales...
Femmes (suite). Doit-on laisser les mères allaiter en public ? Un peu partout aux USA, ces derniers temps, des mamans laitières qui se dégrafaient comme de coutume, en toute candeur, se sont vues condamnées pour comportement lascif. On ne va pas en faire des gorges chaudes, on sait déjà que ces temps-ci l'Amérique vertueuse est dans tous ses états. Seul sujet d'étonnement : que les Fous d'Allah en terre d'Islam et les Crétins de Jésus outre-Atlantique se haïssent à ce point, alors que tant de choses les rapprochent. À commencer par cette peur de la femme.
Osera-t-on donner un conseil au révérend Ben Laden ? Au lieu de massacrer des innocents, ce qui ne servira jamais qu'à faire l'union sacrée contre lui, pourquoi ne lancerait-il pas contre l'invincible Oncle Sam la seule arme absolue qui puisse causer sa débandade : une armée de femmes à poil ?
Sacrées femmes... Trois d'entre elles, catholiques, se font ordonner prêtresses à Lyon ! Par des évêquesses ! Que les moutons noirs dont les idées subversives menacent la paix du troupeau ne crient pas victoire trop vite : les trois mutines ont été excommuniées aussi sec.
Le très digne Henri Tincq, officiant au Monde, s'interroge l'air pincé sur l'opportunité de ces «provocations». Il me semble, ma foi, que si elles peuvent secouer un peu la chape de plomb vaticane, accélérer l'inéluctable processus d'un siècle ou deux, cela vaut la peine de se lancer. Mais je vois déjà plus loin. Je rêve au jour béni, que je ne verrai pas, où le pape sera une papesse...
Ah, j'oubliais : le Tour de France. Il a été remporté (je crois) par Armstrong, sur Ferrari.
Le programme de septembre ? On n'en sait rien. On va passer le mois d'août à y réfléchir. Dans les grandes lignes, la troisième saison de volkovitch.com ne devrait pas beaucoup s'éloigner des précédentes. Il y aura des extraits du Journal infime de 2003, des Coups de langue, des notes sur la traduction, des textes grecs traduits (prose et poésie), des citations. Elle, ma Grèce fera place à un autre feuilleton : Progrès en vue, pages écrites en 98 sur des sujets très divers. La série des portraits d'élèves, elle aussi achevée, sera suivie par des portraits de profs : ceux que j'ai eus jadis au lycée Claude-Bernard à Paris (1958-1965), puis mes collègues du lycée de Brimeil-Lévannes (1971-1999). Sachez enfin, pauvres volkonautes, que de nouvelles pubs se préparent, plus affligeantes encore que les anciennes.
VIERGE du 24 août au 23 septembre
Ne soyez plus con comme la Lune, cessez de lire les horoscopes ! Les planètes, c'est des blagues — parole de Sagittaire. N'écoutez pas trop non plus les conseils de vos amis. Bouquinez sans modération. Lisez un livre nul de temps en temps pour mieux apprécier les bons. Enfin n'oubliez pas : une année sans Dhôtel, c'est une journée sans ciel bleu. Dhôtel qu'on réédite enfin, vous n'aurez plus trop de mal à trouver ses livres, toutes les bonnes librairies sont pourvues. Mais si vous cherchez des ouvrages rares, si vous ne savez trop dans quelle boutique fouiner, alors offrez-vous le Guide des librairies spécialisées de Paris et sa banlieue, dû à David Alliot, chez Horay. 440 adresses commentées ! Le saviez-vous ? L'antre de Sylvain Goudemare, 9 rue du Cardinal Lemoine (Ve), est consacré uniquement à la Pataphysique ! Cornegidouille, voilà un bon ubu de promenade...
 Dessin : Fei-Bi Chen. |