
PAGES D'ÉCRITURE
N°13 Septembre 2004
J'ai beau vivre ce miracle chaque dimanche matin, je m'étonne encore : comment peut-on passer quatre heures et plus à pédaler sans bâiller d'ennui ?
C'est que tout change tout le temps : chemins nouveaux (désormais rares, d'autant plus précieux), paysages connus mais différents sous d'autres lumières, variations du terrain, du relief, de la vitesse, et sous ce défilement d'images la bande-son des messages innombrables du corps, douleur ou euphorie ou les deux ensemble, toute une musique rythmée par le souffle, et les battements du cœur sur un cadran au poignet. Mais si l'on s'ennuie si peu, c'est surtout que le moulinement, ce mouvement immobile, plonge peu à peu le pédaleur dans une semi-hypnose où le temps s'engourdit, se dissout, où le cerveau en veilleuse attend sans hâte il ne sait plus trop quoi, comme le pêcheur bercé par son bouchon.
Bonne pêche ce matin. Loin là-bas, vers Dampierre, deux riches moments.
D'abord la petite route du Mousseau que je découvre, déserte à cette heure-là, qui s'élève à travers bois sans à-coups ; effort étale, contenu — ralentir un peu, accélérer à peine, maintenir le cœur dans la cadence qui fait du bien, 130-140 pulsations-minute — avant que les arbres s'écartant je débouche à l'air libre, face au hameau qui peu à peu sort de terre, m'offrant sa belle ferme ancienne et cachant le vilain silo, comme si malgré le coup de pédale poussif, ma petite cuisine patiente méritait un brin de récompense.
Deuxième montée vers le bonheur : dans la forêt au-dessus de Senlisse, lieu-dit la Malvoisine, où une autre ferme plus vieille, plus belle encore se cache au bord du plateau, je rejoins le méchant raidillon découvert il y a deux ans, puis perdu. Pas long, mais si raide qu'on est tout le temps près de coincer. Arrivé là par hasard la semaine dernière, j'avais fait lâchement un détour. Cette fois-ci je l'affronte. Il vire un peu, le sournois. Une brèche s'ouvre là-haut entre les arbres sur du bleu. Une porte étroite mène en plein ciel. Le bleu se rapproche, de plus en plus lentement. Poids de la fatigue, poids des ans.
Ça y est. Ric-rac. Tu serais allé plus vite à pied, vieux bonhomme. Le cœur, lui, excès de vitesse. Tant pis, laissons-le galoper un coup, c'est le petit extra du dimanche, on n'en mourra pas.
Et quand bien même.
Bonheur de la sieste, le dimanche surtout après le vélo. Je sens mes membres, mes organes, non plus bêtement silencieux, mais résonnant des échos de l'effort. Mon corps bourdonne, habité — dans les parties éprouvées surtout, jambes, mains, épaules — d'un fourmillement continu. Lourd et en même temps léger. Chaud, irrigué, plus que jamais vivant.
Bonheur de sombrer dans le néant d'un sommeil profond, dont on sortira comme du tombeau, englué dans les derniers plis de la fatigue — de quoi s'effrayer, si l'on ne savait que cette faiblesse totale est provisoire, qu'on va s'ébrouer, la rejeter comme une peau morte. La vieille machine repart une fois de plus. Comme une pile ayant beaucoup servi, mais qui avant de se vider peut clignoter quelque temps encore.
(Journal infime, 2002)

|
«Comme s'il y avait à tout moment, quelque part, une hôtesse de l'air pour me voir, du haut de ses trente ans triomphants.»
Lourd, «il y avait». Lourde, la rime intérieure en -ar. Mauvais tout ça, mauvais.
C'était la dernière phrase de mon histoire de métro, dans Transports solitaires. J'ai peiné dessus jusqu'à la dernière seconde. Et soudain, au moment de renvoyer les épreuves, le déclic :
«Comme si à tout moment, quelque part, une hôtesse de l'air me suivait des yeux, du haut de ses trente ans triomphants.»
Cette fois, la cadence y était. Mission accomplie.
De toutes les phrases que j'ai écrites, c'est la seule qui me satisfasse pleinement. La seule que je sache par cœur.
Je me rappelle une mauvaise nuit à V***, le sommeil enfui ; cherchant une pensée consolante, j'ai invoqué ma phrase, l'ai déroulée dix fois, vingt fois, comme d'autres les ave maria, et peu à peu l'angoisse bercée s'endormait. Non, je n'étais pas perdu, un jour une déesse d'en haut poserait les yeux sur moi, et dans l'attente il me restait la joie d'écrire, d'avoir écrit ça qui serait bientôt publié, ce talisman, ce bloc de mots lourd et lisse comme un galet que je serrais dans mon poing et qui me rendait peu à peu l'énergie, la chaleur que j'avais mises en lui.
(Journal infime, 2002)
«Histoire d'entretenir le vertige du doute, de faire vaciller le sol sous le pas des lecteurs.»
Honte à l'auteur de cette phrase — honte à moi. Si elle venait d'un autre, sa nullité m'aurait frappé tout de suite. «Sous le pas des lecteurs» ! Accompagner le vacillement final par six syllabes, ce rythme bien assis ! Erreur de débutant.
«...sous nos pas» ? Plus brusque, bien meilleur.
(Un singulier, à tout prendre, eût été moins mauvais. «...sous le pas du lecteur» : une seule personne, pour mieux s'identifier ; victime isolée, d'autant plus fragile.)
Dire que j'ai revu cette page tant de fois !
On dira que personne ne verra rien, que tout le monde s'en fout. Quel cynisme. Quel défaitisme infect. Personne n'ira compter mes syllabes, d'accord, mais certains, de façon plus ou moins consciente, sentiront ici — je le crains, je l'espère plus encore —, un petit rien qui traîne, qui grippe, un infime cheveu qui marque la frontière entre Bon ça va et Pourrait mieux faire.
Ecrit un truc. Ça me paraît tenir. Et pourtant, difficile d'être fier de moi. Cette page droite et lisse, je sais trop combien j'ai tourné en rond et piétiné sur elle. Dans l'écriture, courir est au-dessus de mes forces, j'avance par petits pas risibles ou à quatre pattes.
Si je la trouve bonne un jour, ma page, ce sera plus tard, quand son auteur ne sera plus vraiment moi, mais un rival dont je puisse être jaloux.
Il arrive qu'on aime ce qu'on vient d'écrire, mais c'est là justement, si ça se trouve, qu'on s'est planté. Une belle surface parfois cache le vide. Inversement, on pense avoir loupé, et c'est cette maladresse qui peut accrocher l'émotion, puis s'incruster dans la mémoire du lecteur quand le reste aura sombré.
(Journal infime, 2001)
«[Alains] enmena ses freres et.c. de ses parens, et dist que de cele lignie puepliroit aucune gaste terre...»
C'est le début de Joseph d'Arimathie, roman médiéval, publié dans la Pléiade en 2001. Cette version originale est en bas de page et petits caractères, laissant la place d'honneur à une adaptation qui démarre ainsi :
«Emmenant ses frères et cent de ses parents, [Alain] assura que de cette lignée il peuplerait quelque territoire inculte...»
J'ai une vieille tendresse pour la Pléiade, et du respect pour le travail soigné. Je conviens qu'en l'occurrence une version moderne s'impose, et suis sûr que l'actualisateur est un homme savant, consciencieux, bourré de bonnes intentions. Je l'étonnerais en le qualifiant de traître.
Qu'a-t-il donc fait ? Oh, trois fois rien : coordonner habilement deux propositions gauchement juxtaposées ; remplacer le verbe «dire», cet indigent, par un synonyme plus distingué ; trouver partout le mot juste, comme ce «quelque» assurément fort précis. Résultat : la rude vigueur de l'original est noyée sous ce flot d'élégances. L'objet de bois taillé à la serpe prend des allures de meuble en faux Louis XV. Il y a même, au paragraphe suivant, un subjonctif imparfait : «Il ordonna qu'on les amenât» ! Se tromper de film à ce point, c'est grandiose. Rarement vu un échantillon si net, si exemplaire, de français d'éditeur dans sa joliesse gourmée, son conformisme insipide.
Le gang des porteurs de cravate a encore frappé !
Je n'irai pas plus loin dans ma lecture, pourquoi s'énerver ? Mais tout ce que je lirai sur cette Pléiade par la suite, dans la presse, jettera du sel sur la plaie : dans Le Monde, la Quinzaine, Télérama, on résume l'action, qu'on a trouvée palpitante, et pas un mot sur le travail de traduction — fût-ce pour en dire du bien. Comme si cette bibine light était le vin original. Comme si un livre n'était qu'une suite d'histoires, et non, avant tout, une incantation magique faite de mots et de phrases enchaînés.
Consternation (bis).
Votre façon d'approcher ce livre, chers confrères, vous ne la trouvez pas un peu ...médiévale ?
Ces cambrioleurs du soleil
n'ont jamais vu de rameau vert
jamais touché de bouche brûlante
jamais su la couleur du ciel
Dans ces chambres obscures ils s'enferment
ils ne savent pas s'ils vont mourir
ils guettent
avec des masques noirs et de lourds télescopes
des étoiles dans les poches salies par des miettes
des pierres à la main comme des lâches
ils guettent la lumière en d'autres planètes
Qu'ils meurent
Que tout Printemps soit jugé sur sa joie
sur sa couleur toute fleur
sur sa caresse toute main
sur son tressaillement tout baiser
Aujourd'hui je me suis vêtu
d'un sang chaud et rouge
aujourd'hui les gens m'aiment
une femme m'a souri
une fille m'a offert un coquillage
un enfant m'a offert un marteau
Aujourd'hui je m'agenouille sur le trottoir
je cloue sur les dalles
les pieds nus et blancs des passants
ils sont tous en larmes
et pourtant nul d'entre eux n'a peur
tous sont restés où je les ai trouvés
tous en larmes
et pourtant ils observent les réclames célestes
et une mendiante qui vend des brioches
au ciel
Deux personnes chuchotent
qu'est-ce qu'il fait il cloue notre cœur ?
il cloue notre cœur mais oui
alors c'est un poète
Oiseaux flèches de la dure amertume
aimer le ciel ne vous est pas chose facile
vous avez appris à dire qu'il est bleu
connaissez-vous ses bois ses grottes ses rochers ?
quand vous passez sifflets aux ailes noires
vous déchirez votre chair à ses vitres
et vos duvets collent à son cœur
Et quand la nuit s'approche apeurée sortant des arbres
vous regardez son mouchoir blanc la lune
la vierge nue qui hurle entre ses bras
la bouche de la vieille aux dents pourries
les épées les ficelles d'or des étoiles
son éclair sa foudre sa pluie
et de sa voie lactée la volupté lointaine
(Ballades)
Mìltos Sakhtoùris n'a jamais voyagé, n'a jamais eu de métier. Son seul travail, sa seule aventure a été la poésie.
Issu du surréalisme, comme bien des jeunes poètes grecs de l'époque, Sakhtoùris a bientôt - non moins normalement - acquis son indépendance. Quelque chose, pourtant, lui est resté des Surréalistes : son oeuvre, d'une rare continuité, est toute entière envahie par les images, qui par leur déchaînement continu, leur violence, installent dans ces pages un climat de cauchemar.
La poésie de Sakhtoùris est en même temps orgie et ascèse. Ses images obsessionnelles, cruelles, atteignent au plus grand dépouillement. Peu de couleurs: avant tout, le blanc, le noir, le rouge. Peu de motifs, passant par d'infinies métamorphoses.
«Ma poésie, dit Sakhtoùris, est une incessante autobiographie, elle ressemble - et c'est ainsi qu'elle doit se lire - à une sorte de journal inconscient de ma vie...» Mais on aurait tort de voir dans ce poète un créateur autiste, muré dans ses visions. La souffrance qui sourd de ses premiers recueils est aussi, pour une bonne part, historique : la Grèce connut alors une guerre mondiale et surtout une guerre civile, plus atroce encore.
On peut s'étonner de ce que cette poésie si noire soit si peu déprimante au fond. J'ai connu quelqu'un qui ne pouvait lire qu'elle dans les moments de cafard. «Mes poèmes ne sont pas pessimistes dit Sakhtoùris. Au contraire ils sont comme les exorcismes. Ils exorcisent le mal. Ils ressemblent à des masques africains. Des masques d'animaux et d'ancêtres pour exorciser la mort.»
Ces poèmes ont la force élémentaire, la rudesse des rituels archaïques. Il suffit d'entendre le poète les lire, les marteler d'une voix impassible, pour éprouver toute leur magie.
Sakhtoùris le sorcier manie les substances à l'état pur, actives, dangereuses, mais parfaitement dosées. Si cette poésie soigne et console, c'est qu'elle sait plonger jusqu'au fond de la douleur de vivre pour en extraire l'un des vaccins poétiques les plus forts.
Sakhtoùris est reconnu, chez lui du moins, comme l'un des très grands. Demandez à un jeune poète grec lequel de ses compatriotes vivants l'a davantage influencé: ce sera souvent - plus encore qu'Elỳtis, poète solaire - le sombre et solitaire Sakhtoùris.
(réponse sur le numéro de la citation...)
On ne sait jamais quand on naît : l'accouchement est une simple convention. Beaucoup de gens meurent sans être jamais nés ; d'autres naissent à peine, d'autres mal, comme avortés. Certains, par naissances successives, passent de vie en vie, et si la mort ne venait pas les interrompre, ils seraient capables d'épuiser le bouquet des mondes possibles à force de naître sans relâche, comme s'ils possédaient une réserve inépuisable d'innocence et d'abandon.
Il n'existait pas une parcelle au monde qui ne fût aussi splendide qu'un ciel étoilé.
Une nuit je rêvai que j'apprenais enfin à couper du bois. Tu vises, disait le rêve, le billot. Pas le bois. Alors seulement tu fends le bois, au lieu de le débiter en copeaux. Tu ne peux pas faire ton boulot proprement si tu ne considères pas le bois comme le moyen transparent soumis à une fin, en visant au-delà de lui.
Pour sortir d'une impasse il faut en prendre une autre.
Plongez, mais si vous plongez avec une bouée, vous êtes sûr de vous noyer.
Nouvelle saison, nouvelle formule, changements minimes. Les volkonautes aguerris s'y retrouveront, les autres pourront consulter l'Index.
Nouveautés de septembre : les PAGES D'ÉCRITURE N°13 ; le portrait d'un de mes élèves (MES ÉCOLES —> ÉLÈVES) ; un nouveau chapitre de ELLE, MA GRÈCE sur les transports grecs (train, bus, métro...) ; dans MADE IN GREECE, les poèmes de Stratis Pascàlis publiés de mois en mois l'an dernier, plus quelques autres ; un poème inédit de notre premier INVITÉ DU MOIS, Jacques Réda ; et enfin trois pubs édifiantes, dont une à la gloire du Lycée de Chèvres où je rempile cette année, hello les filles, salut les mecs, mes respects chers collègues.
En France, il se passe quoi ?
Une sombre histoire vient de gâcher notre été : Jean-Charles Marchiani, âme damnée d'un ancien ministre gaulliste, est en prison ! Un homme de l'ombre envoyé à l'ombre, quoi de plus normal, dira-t-on ; mais voilà que l'étau se resserre autour de son compatriote et patron — lequel, jadis redouté, déculotté aux dernières élections, n'est plus désormais qu'un vieux radoteur impuissant, second rôle pas drôle pour pièce imitée de Pagnol. Ô triste fin du gros Charles !
Si la justice commence à traquer les grands de ce monde, où allons-nous ?
Enfin, monsieur P. n'est pas encore en taule... Pas plus que notre cher président...
Pour meubler le vide estival, Le Monde a publié le 12 août un article intitulé «Je hais l'Islam, entre autres», où l'auteur lâche sur la démocratie ses crachats les plus gras, lui reprochant son goût mollasson du consensus, son action «soporifique», amenant «une douce sidération de la pensée». «Si la démocratie était en fin de compte aussi une maladie mentale ?» conclut-il avant de citer ses classiques : «''La guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l'amour du prochain.'' Ainsi parlait Nietzsche ! Ainsi parlait Zarathoustra ! Ainsi parlait la virilité !»
À propos de maladie, il en est une qui fait toujours des ravages : l'enflure des couilles...
Cette exhumation du Nietzsche facho des années 30 sent rudement la provoc ; je déplore un peu le tonnerre de protestations qui a suivi, lequel ravira l'histrion assoiffé de pub. Je me contenterai d'une seule vacherie à son égard, la pire pour lui : ne pas citer son nom.
Je voulais seulement revenir sur un point. L'auteur accuse la tolérance et le respect de faire du démocrate une espèce d'eunuque, amputé de sa faculté de haïr. Qu'il se rassure : la haine est éternelle en chacun de nous ; le démocrate n'est pas un être sans haine, mais un homme qui lutte pied à pied contre les montées de haine en lui.
Après Pasqua et autres créatures archaïques, restons dans le primitif. J'ai eu la chance de visiter le nouveau musée de la préhistoire aux Eyzies en Dordogne. Beauté du lieu, richesse des collections, habileté de la présentation, vérité des scènes reconstituées : une splendeur. J'ai suivi les vidéos montrant comment on travaillait la pierre ; j'ai cru que le mégacéros, bête énorme, allait me sauter dessus ; l'homme de Néanderthal, rendu au poil près, hallucinant, si humain ! semblait vouloir me parler. Mon aïeul, mon frère...
Autre belle rencontre en Dordogne : la famille Hausfater, prolifique, sympathique, folle de musique. Trois semaines plus tard, en Corrèze, retrouvé la même chaleur chez de vieux amis, les Michelet, au mariage de Marie et Pierre-Alexandre. Tous deux sont adorables — et volkonautes fidèles. Longue vie, jeunes gens, et pas trop d'enfants tout de même, gardez le temps de lire !
Le sujet d' en laisse, poème de Dominique Fourcade, apparaît dès la couverture : sur une photo récente, mais déjà entrée dans l'histoire, une soldate américaine tient en laisse un prisonnier nu à terre. Le poème est une méditation sur l'humanité absente ou présente dans chacun des trois personnages (la tortionnaire, la victime, le poète-spectateur), la laisse devenant l'image du lien qui horriblement les relie, «d'où il résulte qu'elle est moi qu'elle est l'un de mes moi et lui un autre... je te tiens tu me tiens par le bout de la laisse / le premier de nous deux qui tirera si c'est moi connaîtra / l'extrémité de l'humain...» En quelques lignes et sur douze pages on est au cœur d'un questionnement aussi vital que douloureux.
Ce qui m'émeut aussi dans ce fascicule minuscule, édité par le valeureux Michel Chandeigne, c'est qu'il paraît sans ISBN, hors commerce donc, pour une poignée de lecteurs amis. Encore un livre de catacombes, encore un exemple de cette circulation souterraine qui est le destin de beaucoup d'entre nous, y compris d'une partie des meilleurs, et dont l'existence me ravit autant qu'elle me désole.
Pas toujours emballé par les traductions de Valérie Rouzeau, mais alors ses poèmes ! J'avais adoré Pas revoir (Le dé bleu), sur la mort de son père. J'ai davantage de mal avec Va où (Le temps qu'il fait), qui tantôt me prend par la main, tantôt m'abandonne, me laissant croire qu'après tout, en effet, la poésie est trop forte pour moi... Puis je reprends pied, je me raccroche à des sentiments simples, l'absence, la mort des autres et de soi-même, portés par cette voix si personnelle : syntaxe concassée qui agglutine ou éparpille, expressions familières subtilement gauchies, assonances appuyées — matière en même temps compacte et aérienne, pensée dense et vive, et cela me pousse à lire encore, comme un enfant qui goûte une nourriture nouvelle, trop substantielle pour lui, mais dont il pense qu'un jour il pourra l'aimer.
Ana et les autres, film argentin d'une autre jeune femme, Caterina Murga. Là aussi, désorienté d'abord, mais pour la raison inverse : tout paraît trop simple, trop limpide, je m'ennuie un peu à suivre la lente errance de la jeune héroïne sur les traces de l'homme qu'elle aime, et la fin ouverte me paraît une facilité proche de l'entourloupe. Pourtant, le lendemain matin, le film est toujours là, il m'a envahi de sa douceur insidieuse et je n'ai pas envie de le quitter.
Il est des œuvres aux effets rapides comme une injection, et d'autres qui agissent lentement comme un massage ; des œuvres délicieuses qui nous laisseront bouffi et migraineux, et d'autres, amères ou insipides comme des potions, dont on sort plus léger, plus serein.
Bix Beiderbecke, cornettiste génial, mourut en 1931 à 28 ans, brûlé par la passion du jazz et l'alcool. Rédiger sa bio météorique était une gageure : Jean Pierre Lion relève le défi avec une érudition, une passion et un talent d'écriture qui font qu'on dévore ce Bix, aux éditions Outre Mesure (350 pages abondamment illustrées) avec délices. Autour du musicien, c'est toute une époque mythique (la Prohibition) et toute l'enfance du jazz que l'auteur a su faire revivre, même si l'on est fasciné d'abord par l'admirable et lamentable Bix. On sort du livre avec une furieuse envie d'écouter sa musique... Ce que j'ai fait. Une sonorité inouïe. Au cœur d'une musique a priori populaire et simple, des solos saisissants, fluides et subtils, moments de pure beauté.
Quand il se mettait à jouer, écrit un de ses compagnons musiciens, «on aurait cru entendre une fille qui disait : ''oui !''»
Poursuivant ma relecture d'Echenoz, épaté — plus encore qu'à la première lecture jadis — par L'équipée malaise, Lac et Nous trois. Examinant à la loupe les rouages de ces machines subtiles, je m 'épuise à traquer leurs secrets. Quel art, par exemple, dans le maniement des temps verbaux ! Ces plus-que-parfaits obsédants... ces présents de narration assassins... ces démarrages de futurs... ces transitions tantôt brusques, tantôt moelleuses... Mais comment diable fait-il, ce virtuose, avec ses effets somme toute voyants, ses décrochages perpétuels, pour conserver le fondu, la souplesse, la discrétion dans l'élégance ?
Un mot de sport. Croyez-vous que je puisse vous écrire toutes ces belles choses, pousser hors de moi ces longues phrases que soulève un inlassable souffle, en ne buvant que de l'eau claire ? Bande de naïfs ! Non, je me dope, comme les autres... Ma potion magique à moi : le jus d'orange (par voix orale).
Cerveau lent ? Muscles raides ? Minute Maid !
En octobre, sur volkovitch.com, on évoquera un 11 septembre et un 17 octobre ; on redira les charmes de la poésie ; on décortiquera le point-virgule ; on se frottera aux rudes poètes syldaves ; on se penchera sur la vie quotidienne des Hellènes d'aujourd'hui ; un nazillon de banlieue s'agitera sous nos yeux dégoûtés. Il y aura encore des pubs. L'invité sera Dominique Noguez.
BALANCE du 24 septembre au 23 octobre
Le clin d'œil de Pluton à Neptune donne à ce mois un goût d'aventure et de renouveau. Lisez des auteurs encore inconnus de vous, français ou étrangers. Intéressez-vous aux littératures francophones. Soyez attentifs aux nouveautés, mais sans excès : une cure exclusive de primeurs peut avoir des effets fâcheux... Fréquentez les Sagittaires.
Si vous avez un petit coup de blues, allez vous changer les idées à la librairie Millepages (174, 133 & 127, rue de Fontenay à Vincennes).
Les autres signes : idem.
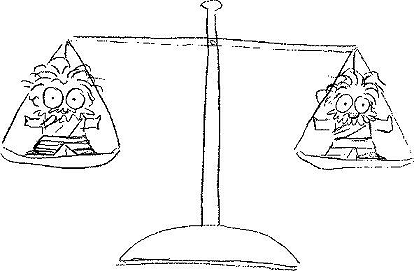 Dessin : Fei-Bi Chen. |